Agenda militant
Ailleurs sur le Web
![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)
- La transition énergétique, la question économique et la Gauche (26/04)
- L’amour de/dans la révolution. Lire Alexandra Kollontaï (26/04)
- Mélenchon: La jeunesse de Sciences Po est l’honneur de notre pays face au génocide (26/04)
- Il y a 50 ans, le Portugal entrait en révolution (25/04)
- Israël-Palestine : "C’est la liberté d’expression qu’on veut censurer" (25/04)
- Il y a 50 ans : la « Révolution des œillets » (25/04)
- Plan d’urgence pour l’Education nationale : bilan de la lutte (25/04)
- Miyazaki : forces et faiblesses d’un génie de l’animation (25/04)
- Grèce : Quelles suites après la grève réussie contre la misère ? (24/04)
- L’image de Lénine est au plus haut en Russie (24/04)
- Suicides à la Banque de France : un rapport décortique le management toxique de l’institution (24/04)
- Victoire historique dans le Tennessee pour le syndicat UAW (24/04)
- Soudan : La conférence de Paris controversée (24/04)
- Michel Pablo, une vie de révolutionnaire (24/04)
- La "Gauche démocratique et sociale" de Filoche appelle à voter France Insoumise (22/04)
- Elections au Pays basque espagnol : le parti séparatiste de gauche réalise une percée historique (22/04)
- Loi d’orientation d’Attal-Macron, crise de l’agriculture capitaliste, quelle réponse du mouvement ouvrier ? (22/04)
- L’émergence du capitalisme vue par un médiéviste, par Vincent Présumey. (21/04)
- La crise immobilière se poursuit : les prix vont encore baisser ! (21/04)
- Les désillusions et la décomposition du capitalisme mondialisé (21/04)
- La théorie de la dictature du prolétariat de Marx revisitée (21/04)
- Enseignants, les nouveaux prolétaires ? (21/04)
- Contre le délit d’opinion, pour défendre notre droit à soutenir la Palestine : il faut faire front ! (21/04)
- Controverses - Revue du Forum pour une Gauche communiste internationaliste (21/04)
- Libertés publiques...un pas de plus dans la répression! (20/04)
Liens
- Notre page FaceBook
- Site du NPA
- Démosphère (Paris, IdF)
- Site anti-k.org
- Le blog de Jean-marc B
- CGT Goodyear
- Démocratie Révolutionnaire
- Fraction l'Étincelle
- Anticapitalisme & Révolution
- Révolution Permanente (courant CCR)
- Alternative Communiste Révolutionnaire (site gelé)
- Ex-Groupe CRI
- Librairie «la Brèche»
- Secteur jeune du NPA
- Marxiste.org
- Wiki Rouge, pour la formation communiste révolutionnaire
Extrait de « L’utopie carcérale » de G. Salle
Ces articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » sont publiés à titre d'information et n'engagent pas la Tendance CLAIRE.
http://www.contretemps.eu/extrait-utopie-carcerale/
Grégory Salle, L’utopie carcérale. Petite histoire des « prisons modèles », Paris, Amsterdam, 2016, 232 p., 17€.
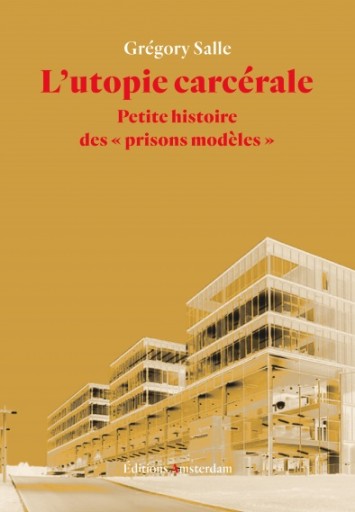
Chapitre 1. La Tour-Maîtresse, Genève (Suisse, 1825)
Une « bonbonnière » : voici comment Tocqueville railla la nouvelle prison de Genève (ainsi d’ailleurs que celle de Lausanne), après la série de visites qu’il y effectua en juin 1832, soit sept ans après son ouverture. Il est vrai qu’il se montrait sceptique avant même de s’y rendre. Dès 1831, il voyait en ces deux établissements « plutôt des palais que des prisons », peut-être bons pour la Suisse mais non pour la France : trop coûteuses, trop luxueuses. Sur place, son inspection le confirme dans cette voie. « Discipline dont la douceur et les minutieux détails ne conviennent qu’à une prison bonbonnière comme celle de Genève : lit complet, bains tous les mois, bibliothèque, récréation le dimanche, entraves aux punitions, pécule. Tout est soigné comme un boudoir de petite maîtresse. » Le comte blâme là une prison aux petits soins, du fait notamment de son exiguïté (elle est faite en principe pour ne verrouiller que 150 détenus). L’expression est si plaisante aux oreilles de celui que Jacques-Guy Petit appelle l’« anti-philanthrope », Louis-Mathurin Moreau-Christophe, soutien de Tocqueville au sujet du régime cellulaire, qu’on la retrouvera plus tard sous sa plume (une « bonbonnière de pénitencier »). On sait que des prisons jugées trop « douces », trop « confortables », sont la cible de prédilection des élites soucieuses de la moralisation coercitive des classes laborieuses, surtout lorsqu’elles menacent d’être dangereuses. Ceci étant, le jugement de Tocqueville n’est pas sans nuances, d’autant que les prisons françaises de l’époque ne sont pas meilleures à ses yeux. Il juge favorablement divers aspects de la prison suisse, certains généraux (l’encadrement par le personnel, l’état sanitaire), d’autres particuliers (les visites, l’organisation du pécule). Et s’il juge le régime nettement trop souple, il va jusqu’à écrire : « Si le pénitencier de Genève n’est point encore une bonne prison, il est donc du moins tout près de l’être. »
Avant Pentonville, que nous aborderons dans le chapitre suivant, avant même l’Eastern State Penitentiary de Philadelphie, alias Cherry Hill, qui n’ouvre qu’en 1829, c’est en effet la prison genevoise de la Tour-Maîtresse – du nom du bastion situé en bordure de la ville à partir duquel elle est construite – dont la réputation de modèle attire les regards européens du côté des philanthropes et autres partisans de la réforme des prisons. Quand Tocqueville et Gustave de Beaumont sont missionnés pour leur célèbre séjour états-unien, Genève est, comme Millbank en Angleterre que nous croiserons plus loin, plus influente en Europe que les ancêtres Walnut Street ou Auburn. Elle le doit à plusieurs caractéristiques, analysées en détail par l’historien Robert Roth, auteur de l’étude de référence, qui note au passage que le renouvellement pénitentiaire a historiquement eu comme terres d’élection de petites communautés politiques, voire des micro-États : après Amsterdam puis Philadelphie, Genève donc, marquée par une forte influence quaker. Une caractéristique nominale résume la nouveauté de la Tour-Maîtresse : la prison est expressément affublée de l’épithète pénitentiaire. Cet adjectif signe à lui seul le changement d’époque, du moins sur le plan de la pensée et du discours. L’optimisme qui préside à la construction de la prison n’empêche évidemment pas les débats et les oppositions, y compris sur la pertinence de cette appellation.
La Tour-Maîtresse apparaît d’abord comme une réalisation « imparfaite, mais indiscutable » du projet panoptique, et sans doute la « première réalisation panoptique européenne ». Imparfaite : elle n’est en toute rigueur qu’un « semi-panoptique apparent » qui ne respecte pas tout à fait le principe de surveillance permanente. Mais indiscutable, raison pour laquelle c’est en référence au Panoptique qu’elle est présentée dans le court film de Caroline Cuénod intitulé La Prison de Jeremy Bentham à Genève. Le « père » de la prison genevoise, Étienne Dumont (qui ne survivra pas longtemps à son œuvre puisqu’il meurt en 1829), théologien de formation, fut non seulement un admirateur, mais l’ami et l’émule de Bentham, son éditeur aussi. Ce modéré (effaré par le cours révolutionnaire, il n’a fait qu’un passage éclair à la Constituante début 1793), qui personnifie la synthèse ou du moins la rencontre entre utilitarisme anglais et calvinisme genevois, a pour ainsi dire été le commis voyageur du Panoptique : c’est à son zèle qu’on doit la version française. Quoique médiat, l’apport benthamien sur la conception de la prison genevoise est donc décisif. Et, quoique partiel – n’oublions pas que sous couvert de rationalité, le projet benthamien, littéralement utopique, porte une part de fantasque, et Dumont, plus pragmatique, fait le tri, faisant par exemple primer la fonction de mise au secret sur la fonction théâtrale envisagée par son maître –, il dépasse l’aspect architectural, indétachable de l’aspect doctrinal.
La prison de Genève n’a aucunement été bâtie sur un coup de tête. Au contraire, elle a pour propriété, écrit Robert Roth, « d’avoir été longuement conçue ; d’avoir fait l’objet de réflexions […] que peu d’institutions sociales ici et d’autres établissements pénitentiaires ailleurs ont suscitées ». C’est dire combien ferait fausse route l’argument qui imputerait l’échec à la précipitation ou à l’indifférence. Les concepteurs de la prison genevoise n’ignoraient rien du fossé qui, en la matière, a séparé jusqu’alors les réalisations des intentions. Ils entendaient justement les faire enfin correspondre. Les promoteurs de la Tour-Maîtresse connaissent l’expérience antérieure de Walnut Street et ils s’informent des expériences contemporaines de la leur, à commencer par celle de Millbank. Dans ce cas comme dans d’autres, s’il y a bien de l’utopie dans ce projet, il ne faut pas entendre par là, au moins du point de vue des protagonistes, une quelconque fantaisie ou rêverie, mais au contraire un projet élaboré sur une base qui se veut rationnelle (et bientôt « scientifique »), appuyée sur un savoir architectural, mécanique, statistique ou médical.
Prison modèle, la Tour-Maîtresse est aussi une prison symbole. Elle est investie d’une valeur spéciale aux yeux de ses promoteurs, issus de la fraction éclairée de l’élite genevoise. Sa réalisation doit symboliser un changement idéologique et politique, moral même, qui correspond à l’avènement d’une ère nouvelle, progressiste, soucieuse de progrès social. Elle est soutenue par un Parlement devenu majoritairement libéral dans un contexte intellectuel fait d’une intense sociabilité bourgeoise-libérale. Les influences intellectuelles sont multiples, qui mêlent calvinisme, utilitarisme, libéralisme, rousseauisme, quakerisme, progressisme, philanthropie, anglophilie… Légalisme aussi : décidée par une loi de 1822, l’ouverture de la prison trois ans plus tard s’accompagne d’une loi qui fait figure de « bréviaire pénitentiaire ». Dumont défendait à cet égard une position originale : la réforme carcérale devait précéder la réforme pénale. On ne saurait mieux signifier la place désormais centrale de la prison dans l’arsenal punitif.
Le régime censé prévaloir entre les murs mérite également l’attention. Tandis que le paradigme philadelphien fut dans l’ensemble dominant en Europe, la prison de la Tour-Maîtresse est en principe régie par un système auburnien mis au goût du jour. Un système qui apparaissait « très perfectionné », à telle enseigne que certains observateurs européens éminents, tels Carl Mittermaier et Charles Lucas, faisaient alors de Genève un type pénitentiaire en soi, au même titre que Auburn et Philadelphie et même supérieur car tirant partie du meilleur de chacun d’eux. On y voit généralement un système auburnien réarrangé par un système de classification, posant avant Pentonville les jalons du système dit progressif, soit des conditions de réclusion différentes en fonction de stades pénitentiaires, avec d’éventuelles réductions de peine à la clé. Un caractère pionnier, donc, même s’il demeure surtout théorique. Au début des années 1840, la prison s’est déjà peu ou prou conformée à l’option cellulaire façon Auburn, avec isolement en cellule la nuit et travail commun en silence le jour. À cet égard le terme de rééducation, qui trahit déjà un point de vue de classe, ne doit pas tromper. C’est une stricte discipline qui règne derrière ce mot d’ordre ; le premier directeur de la prison est d’ailleurs un policier. Peu de châtiments corporels, semble-t-il, mais « silence absolu, fers, costume et bien entendu, sanctions disciplinaires ».
Une « bonbonnière », la Tour-Maîtresse ? Cette comparaison moqueuse révèle avant tout la position sociale de ceux qui la font. Car en fait de bonbonnière, c’est peu dire qu’on a connu plus accueillant. D’autant que, selon la périodisation proposée par Robert Roth, le jugement de Tocqueville se situe à la charnière d’un changement de perception, au moment où l’on quitte les années « libérales » et qu’avec la déception vient le raidissement. Le légalisme apparent des débuts laisse place à l’intimidation et, après plusieurs amendements, la loi pénitentiaire progressiste de 1825 est écrasée une fois pour toutes en 1841 par une loi empreinte de sévérité. Entre les murs, c’est le repli vers l’isolement cellulaire et l’abandon de toute velléité d’instruction. Même l’arrivée progressive, en fin de période, de médecins et de psychologues est un processus ambivalent. La prison a déjà perdu depuis longtemps son éphémère prestige.
Ses partisans voulaient laisser une trace durable. C’est tout le contraire qui se produit. Dès lors qu’elle perd sa base sociale, la réalisation genevoise se périme à grande vitesse. Le décalage entre le « rêve pénal » et la « réalisation pénitentiaire » est même si brutal qu’il faut moins de quatre décennies pour que la prison genevoise ouverte en 1825 soit démolie – en 1862 exactement –, décision plus éloquente que tous les bilans écrits. Rapidement détruite, elle l’est de surcroît sans état d’âme, pour des motifs urbanistiques, et sans débat de fond. Son existence aura été aussi éphémère que précoce et, qui plus est, dépourvue de véritable postérité.
*
Sources. — Ce chapitre s’appuie essentiellement sur les travaux de Robert Roth, dont le livre Pratiques pénitentiaires et théorie sociale : l’exemple de la prison de Genève (1825-1862) (Genève, Droz, 1981, particulièrement pp. 161-171), préfacé par Michelle Perrot (citation p. vii) fut précédé par l’article « Prison modèle et prison symbole : l’exemple de Genève au xixe siècle », Déviance et société, vol. 1, no 4, 1977, p. 389-410 et une contribution intitulée « La réalisation pénitentiaire du rêve pénal à Genève », in J.-G. Petit (dir.), La prison, le bagne et l’histoire, Médecine & Hygiène, 1984, pp. 189-200 (citation p. 189). J’emprunte aussi à Michelle Perrot, Les Ombres de l’histoire. Crime et châtiment au XIXesiècle, Paris, Flammarion, 2001, notamment pp. 109-158 (p. 128 sur la « bonbonnière ») ; version antérieure in J-G. Petit (dir.), La Prison, le bagne et l’histoire, op. cit., pp. 103-113. Le court-métrage de Caroline Cuénod, qui donne la parole à Robert Roth et Michel Porret, s’intitule « La prison de Jeremy Bentham à Genève ». Ce documentaire de quatorze minutes s’accompagne d’une courte contribution écrite : « L’ombre de la discipline, la prison de Bentham à Genève », in P. Bergel, V. Milliot (dir.), La Ville en ébullition. Sociétés urbaines à l’épreuve, Rennes, PUR, 2014, pp. 361-365. Autres éléments tirés de : Jean-Louis Benoît, Tocqueville. Un destin paradoxal, Paris, Tempus, 2013 (2005), pp. 179-182 (citation p. 181) ; Jacques-Guy Petit, « L’amendement ou l’entreprise de réforme morale… »,Déviance et société, vol. 6, no 4, 1982, pp. 335 sq.
Image en bandeau via NotreHistoire.ch.




