Agenda militant
Ailleurs sur le Web
![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)
- Où va l’impérialisme allemand ? (05/01)
- L’économie mondiale en 2025 : année folle ou année tiède ? Par Michael Roberts (05/01)
- Ukraine : emprunter le douloureux chemin vers la paix (05/01)
- Où en sont les « socialistes » aux États-Unis ? (05/01)
- Pour gagner, la gauche doit-elle en revenir aux partis de masse ? (05/01)
- Narcotrafic : Darmanin et Delogu ne peuvent pas SE SNIFFER (05/01)
- Alma Dufour sur France Info (05/01)
- Diyarbakır : reconstruire une municipalité en ruines (28/12)
- Le marxisme aux paysans (28/12)
- Aux origines du socialisme japonais (28/12)
- Sauvons Kobané, sauvons le Rojava ! (28/12)
- Quelles perspectives pour les Kurdes au Moyen-Orient ? (27/12)
- Cuba : le mouvement du social (27/12)
- Procès de Georges Ibrahim Abdallah : la victoire est-elle proche ? (26/12)
- Île Maurice : la volonté de changement (26/12)
- Le socialisme dans un seul pays (26/12)
- Quel avenir pour la France insoumise ? (26/12)
- Les changements tectoniques dans les relations mondiales provoquent des explosions volcaniques (26/12)
- Un nouveau château de cartes (26/12)
- Le syndicalisme de Charles Piaget (26/12)
- Nabil Salih, Retour à Bagdad (26/12)
- La Syrie est-elle entre les mains d’Erdoğan ? (26/12)
- L’UE encourage l’exploitation du lithium en Serbie avec un grand cynisme (26/12)
- Le contrôle territorial d’Israël s’étend-il vers la Syrie ? (26/12)
- Scrutin TPE – Très Petite Élection (26/12)
Le Front populaire... ou la trahison des dirigeants socialistes et communistes

Le « Front populaire » ! Du côté des historiens bourgeois, comme du côté de ceux qui font l’hagiographie du PCF et de la « belle CGT » de Frachon, on présente cette période comme un moment mythique, magnifique, l’une des plus belles pages du mouvement ouvrier. Or, le Front populaire, dont on fête en ce printemps le soixante-dizième anniversaire, c’est avant tout une trahison ; c’est avant tout une alliance entre partis bourgeois et ouvriers pour le maintien du système capitaliste. C’est certes une période d’avancées sociales importantes ; mais ces conquêtes ont été arrachées par une lutte de classe gigantesque, qui attendait plus d’un gouvernement socialiste, soutenu par le parti communiste. Comment a-t-il été possible, à la SFIO et au gouvernement Blum, au parti communiste de Thorez et de Vaillant-Couturier, à la CGT réunifiée de Frachon et de Jouhaux, de détourner à ce point la lutte des ouvriers des villes et des campagnes de l’objectif révolutionnaire, socialiste, au profit de cette préservation de l’ordre bourgeois ? C’est ce que cet article va tenter d’expliquer, en s’appuyant tout à la fois sur les études d’historiens du mouvement ouvrier (1) et les textes que Léon Trotsky rédigea alors (2) .
La France est entrée dans la crise, certes plus tardivement que les autres pays capitalistes, mais aussi violemment : au début des années 1930, ouvriers, paysans et fonctionnaires la subissent de plein fouet, les uns du fait du chômage, les autres par l’effondrement des cours des produits agricoles, les derniers par la diminution de leur pouvoir d’achat. En effet, le Parti radical au pouvoir mène une politique dite de « déflation », visant à diminuer drastiquement les dépenses de l’État ; il se fait le champion de l’ « orthodoxie financière ». Dès lors, les premières coupes claires touchent les pensions et les salaires des fonctionnaires. En 1933, grèves et manifestations se multiplient contre les effets de la crise et de la politique gouvernementale ; les grèves sont très dures en particulier dans le textile du Nord, chez les mineurs du Nord-Pas-de-Calais et les métallurgistes de Citroën. Les marches de la faim des mineurs, puis des chômeurs, disent la situation de détresse dans laquelle la crise plonge le prolétariat. « La bourgeoisie a conduit sa société à la faillite », écrit Trotsky en posant la question : « Où va la France ? »
Le 6 février 1934, des ligues de droite et d’extrême droite, dont certaines sont fascisantes et d’autres ouvertement fascistes, rassemblent plusieurs milliers de manifestants à Paris, pour protester contre la mutation d’un préfet de police, Chiappe, particulièrement indulgent à leur égard ; le parti communiste appelle également à manifester contre le gouvernement du radical Édouard Daladier. Les heurts avec la police font quinze morts parmi les manifestants et plusieurs centaines de blessés. Daladier démissionne. Cette manifestation — 30 000 personnes environ — et sa conséquence, la chute du gouvernement, sont un symptôme : le fascisme n’est pas le produit du caractère national particulier des Italiens ou des Allemands, mais le fruit de la crise économique et sociale sans issue dans le cadre du capitalisme ; la France n’est pas à l’abri du danger fasciste. Dès cette époque, de grands patrons comme Ernest Mercier ou François Coty financent directement certains de ces groupuscules fascistes et les aident à s’armer : une partie du grand capital, donc, les soutient. Il n’y a pas là encore une force de masse, mais le fascisme peut le devenir s’il conquiert les classes moyennes peu à peu ruinées par la crise économique. L’exemple de l’Allemagne l’a prouvé. Un an auparavant, fin janvier 1933, Hitler est devenu chancelier : en trois mois, il a interdit toutes les organisations politiques autres que le NSDAP (Parti National-Socialiste Ouvrier allemand), à commencer par le SPD (parti social-démocrate d’Allemagne) et le KPD (parti communiste d’Allemagne), ainsi que les syndicats ouvriers et s’est fait attribuer les pleins pouvoirs. Les grèves et les manifestations ont été interdites et plus de 900 000 militants ouvriers ont été jetés dans les camps de concentration. La responsabilité de ce désastre politique retombe entièrement sur les épaules des chefs du KPD et du SPD, qui se sont réfugiés à l’étranger. Le KPD a refusé l’unité d’action avec le SPD contre le fascisme sous prétexte d’une politique « classe contre classe » (prolétariat contre bourgeoisie), désignant la social-démocratie comme le premier ennemi à vaincre, parlant de « social-fascisme ». Pourtant les intérêts du prolétariat exigeaient une tactique d’unité d’action de la base au sommet avec le SPD pour vaincre le fascisme. De son côté, le SPD, plus effrayé par le communisme qu’hostile au capitalisme, a soutenu de fait tous les gouvernements bourgeois et leur politique de régression sociale et de sécurité à tout crin, sous prétexte de faire barrage à Hitler : refusant de remettre en cause le capitalisme fauteur de misère et laissant les patrons décharger sur les masses le fardeau de la crise, le SPD ouvrait aux nazis le chemin du pouvoir.
Face à la menace fasciste, les dirigeants PC et SFIO pérorent, les travailleurs imposent le front unique ouvrier
Comment dans ces conditions réagissent les dirigeants de la SFIO et du PC ? Avaient-ils appris quelque chose de l’expérience allemande ? Le soir même du 6 février 1934, la direction nationale du Parti socialiste appelle à une « mobilisation du Parti » : « Préparez-vous, dit-elle en s’adressant à ses militants, à défendre vos organisations ». Mais aucun mot d’ordre d’action n’est donné, aucune action concrète n’est envisagée : pour lutter contre les bandes fascistes armées, les dirigeants se contentent de s’en remettre au « sang-froid » des « militants responsables ». Mais plus on se rapproche de la base, plus la réaction est combative. Certaines fédérations de la SFIO lancent des initiatives concrètes en vue d’un front ouvrier : la fédération de la Seine et celle de la Seine-et-Oise adressent au parti communiste une demande de rencontre « afin de fixer les bases d’un accord loyal et de réaliser l’unité d’action des travailleurs ». Comme cette adresse reste sans réponse, peu après minuit, une délégation de militants socialistes de ces deux fédérations se rend au siège du journal L’Humanité : en vain une nouvelle fois. Les chefs staliniens du parti communiste, aux ordres de la clique stalinienne de Moscou, n’ont visiblement rien appris de l’expérience allemande. Ils prétendent maintenir la même politique qui a conduit à l’écrasement dans le sang des travailleurs sous la botte d’Hitler et Goebbels. Sous la pression de leur base, la SFIO et le PC sont obligés de convoquer le 12 février 1934 des manifestations en réponse au coup du 6 février 1934. Mais, preuve qu’il s’agit de donner le change à la base et non de préparer la lutte contre le fascisme, ils ont appelé à des défilés soigneusement séparés. Malgré cela, ce sont plus de 150 000 ouvriers qui sortent battre le pavé : ils sentent instinctivement la nécessité du front unique et imposent aux cris de « Unité ! Unité ! » l’unification des deux cortèges en une seule manifestation.
Comment vaincre le fascisme ?
Trotsky, dirigeant de l’Opposition de gauche au sein de l’Internationale Communiste (IC) (1923-1929), puis de l’extérieur après son expulsion d’URSS (1929-1933) et fondateur du mouvement pour une IVe Internationale (après la politique de l’IC en Allemagne), a étudié de près le phénomène du fascisme sur l’exemple de l’Italie, où Mussolini a pris le pouvoir dès 1922, et sur l’exemple de l’Allemagne, où il a critiqué fermement la politique des dirigeants du KPD et du SPD indiquant la catastrophe à laquelle elle risquait de conduire ; il a développé une orientation marxiste mettant en son centre la tactique du front unique ouvrier pour vaincre le fascisme. Il reprend la question à propos de la France : « La signification historique du fascisme, écrit-il, est qu’il doit écraser la classe ouvrière, détruire ses organisations, étouffer la liberté politique. […] On peut dire du fascisme qu’il est une opération de "luxation" des cerveaux de la petite bourgeoisie dans l’intérêt de ses pires ennemis. Le grand capital ruine d’abord les classes moyennes puis, à l’aide de ses mercenaires, les démagogues fascistes, il tourne contre le prolétariat la petite bourgeoisie sombrant dans le désespoir. » Les classes moyennes ravagées par la crise sont en effet, on l’a vu en Italie et en Allemagne, la principale force sociale du fascisme. Certes, en France, ces classes moyennes continuent encore en 1934 à voter pour le parti radical, dont la composition sociologique est elle-même principalement petite-bourgeoise (commerçants, artisans, agriculteurs exploitants…). Mais, ce parti, créé en 1901, s’est donné pour pilier politique, outre la défense de la laïcité qu’il a d’ailleurs mise à mal lors d’un passage au pouvoir entre 1924 et 1926 (3), le respect de la propriété privée : en aucun cas il ne veut s’en prendre au fondement même de l’exploitation, au capitalisme. Il vit sur le mythe d’un bon capitalisme où les petits propriétaires privés pourraient vivre de leur travail en harmonie les uns avec les autres, mythe qui dans le contexte de la crise entre de plus en plus ouvertement en conflit avec la réalité du capitalisme, le chômage de masse et la paupérisation de la petite-bourgeoisie. Au vu de la politique menée par les radicaux, les classes moyenne pourraient donc très bien, et très vite, se détourner de lui. Le parti radical défend en pratique les intérêts du grand capital et de l’impérialisme français et non ceux des « petits » qu’il exalte. « Les radicaux sont le parti démocratique de l’impérialisme français », écrit Trotsky. En effet, ils soutiennent inconditionnellement « l’œuvre coloniale » de la France, officiellement au nom du bel universalisme français, en réalité en raison des sources de profit considérables que l’exploitation des travailleurs colonisés rapporte au capital national (4).
Dès lors, pour lutter efficacement contre le fascisme, il faut ouvrir une issue réelle à la crise. Cela ne peut se faire qu’en orientant et en organisant le prolétariat en vue de la conquête du pouvoir, car toute tentative de résoudre la crise dans le cadre du capitalisme ne peut signifier qu’en faire porter le fardeau aux masses, dans sa variante radicale comme dans sa variante fasciste. C’est seulement à condition d’ouvrir cette voie que le prolétariat pourra rassembler autour de lui la petite et moyenne paysannerie et les classes moyennes urbaines. Il ne peut être question, sous prétexte d’arithmétique parlementaire, de s’allier avec le parti radical, car il n’y a pas de solution à la crise dans le cadre du capitalisme.
Dans la mesure où il y a deux partis qui se revendiquant du socialisme, la SFIO (parti socialiste) et le PC (parti communiste), il n’y a pas d’autre solution que de chercher l’unité d’action, de la base au sommet, sur les mesures exigées par la situation du point de vue du prolétariat dans la perspective d’un gouvernement ouvrier Blum-Cachin. En même temps, à chaque étape de la lutte, le mot d’ordre de conquête du pouvoir doit être affiché ouvertement et être une perspective pratique des partis ouvriers : cette perspective, il faut la mettre en évidence dans la presse ouvrière, dans les meetings mais aussi à la tribune parlementaire, dans l’organisation de manifestations, en bref, dans toute une propagande révolutionnaire digne de ce nom. C’est la tactique du front unique ouvrier.
Les nécessités pratiques de la lutte contre le fascisme sont un point de départ idéal pour la dynamique du front unique. Les ouvriers ressentent le besoin de protéger leurs organisations, leur presse et eux-mêmes, contre les bandes fascistes. Cela appelle le mot d’ordre de la constitution d’une milice ouvrière. Car il faut être conscient que cette lutte sera aussi physique, et le prévoir. Comme la grève a besoin de piquets de grève pour s’opposer, si nécessaire par la force, à ceux qui veulent la briser, le prolétariat a besoin de s’armer, et dès lors l’un des mots d’ordre des partis ouvriers doit être l’armement du prolétariat et des paysans révolutionnaires. Pratiquement, il ne paraît pas très difficile à mettre en œuvre : ce sont bien les ouvriers qui fabriquent les armes, les transportent, construisent les casernes et fournissent leurs armements : « Ce ne sont ni des serrures ni des murs qui séparent les armes du prolétariat, écrit Trotsky, mais l’habitude de la soumission, l’hypnose de la domination de classe, le poison du nationalisme. Il suffit de détruire ces murs psychologiques et aucun mur de pierre ne résistera. Il suffit que le prolétariat veuille des armes, et il les trouvera. »
PC et SFIO impulsent le front populaire contre le front unique
C’est à nouveau sur ordre de Staline qu’un virage à 180 degrés est opéré par la direction du parti communiste. L’URSS en effet est directement menacée par le danger hitlérien : ses dirigeants recherchent des alliances avec certains États capitalistes, dont la France. Après une entrevue entre Joseph Staline et Pierre Laval, président du Conseil (c’est-à-dire chef du gouvernement) et membre du parti radical, le 2 mai 1935, un accord de défense mutuel est passé entre la France et l’URSS. Dès lors, Staline donne l’ordre d’une réconciliation politique du parti communiste avec toutes les forces politiques « démocrates » du pays, sans plus aucune considération de classe ! Le parti communiste devient « parti communiste français » et adopte chants et emblèmes jusqu’à présent honnis car considérés comme bourgeois, versaillais et chauvins : La Marseillaise, entonnée au même titre que L’Internationale, et le drapeau tricolore, arboré comme le drapeau rouge. Le PCF parle moins désormais de prolétariat que de peuple, d’anticapitalisme que d’antifascisme, de révolution que de république. Thorez lance son discours « de la main tendue » : main tendue aux radicaux, main tendue aux catholiques, main tendue même aux Croix-de-Feu du colonel de La Rocque, ligue d’une droite particulièrement réactionnaire. C’est aussi à ce moment, en juin 1935, que le Comité international contre la guerre et le fascisme, dit « Amsterdam-Pleyel », principalement composé d’intellectuels et présidé par Romain Rolland et Henri Barbusse, propose l’idée d’une vaste manifestation populaire à l’occasion du 14 juillet. C’est un immense succès : 500 000 personnes défilent à Paris en se réjouissant de l’unité.
Comment les dirigeants du PCF s’y prennent-ils, eux qui refusaient la simple unité d’action même avec la SFIO, pour faire avaler aux ouvriers l’unité avec un parti bourgeois, le parti radical ? Ils prétendent, d’une part, que « la démocratie » (bourgeoise) s’oppose absolument au « fascisme », et ils expliquent, d’autre part, qu’il est impossible d’obtenir la majorité au parlement sans les radicaux. On voit qu’ils ont renoncé à toute analyse en termes de classes ; en effet, « fascisme » et « démocratie » sont deux formes opposées de gouvernement d’une même classe, la bourgeoisie, et l’arithmétique parlementaire ne peut résoudre les contradictions du capitalisme qui explosent au grand jour dans la crise (5). Le parti communiste tient absolument à « sauver » le parti radical, alors que les masses se détournent de plus en plus de lui, comme le montrent ses reculs électoraux. En constituant un programme de « Rassemblement populaire », la coalition du parti communiste, du parti socialiste et du parti radical ne peuvent que se mettre d’accord sur l’extrême minimum : les dirigeants ouvriers recouvrent sous des mots d’ordre liés dans l’esprit des masses à la première révolution prolétarienne victorieuse, « pain, paix, liberté », un modeste programme de réformes dans le cadre du capitalisme comprenant la réduction de la durée du travail sans réduction de salaire, l’institution d’un fonds national de chômage, l’exécution d’un plan de grands travaux, la nationalisation des industries de guerre et la répudiation de la diplomatie secrète, la dissolution des ligues fascistes et fascisantes la défense du droit syndical et de l’école laïque. Aucun point d’accord n’a pu être trouvé sur la question des colonies, du fait de l’attachement indéfectible des radicaux à l’Empire français, du social-impérialisme de la SFIO et de la reconversion du PCF au chauvinisme ; il est simplement question de mettre en place une… commission d’enquête parlementaire, qui examinera la situation des peuples colonisés. Ce programme de Rassemblement populaire reflète bien ce qu’est un Front populaire, alliance des partis du prolétariat avec un parti de la bourgeoisie capitaliste et impérialiste, illustration par excellence de la collaboration de classes : il ne met en aucun cas en cause le système capitaliste ; il croit en lui, au contraire, et fait croire que, par la seule relance du pouvoir d’achat, un terme pourra être mis à la crise. En fait, ce programme de Front populaire va à peine plus loin que le programme traditionnel du parti radical.
Face à cette politique contre-révolutionnaire des appareils stalinien et social-démocrate, Trotsky avance la nécessaire perspective des comités d’action populaires, forme d’organisation révolutionnaire des masses en lutte : il préconise que des comités locaux se constituent et élisent leurs représentants, afin de contrer au niveau local et national le frein mis par les dirigeants à la lutte de classe révolutionnaire. En effet, alors même que les luttes ouvrières dures se multiplient, comme à Toulon, à Brest, à Limoges (où une sanglante répression a lieu contre une grève), la direction du parti communiste ne cesse de vouloir donner des gages de « respectabilité » au parti radical pour consolider son alliance avec lui.
Les élections législatives de fin avril-début mai 1936 sont une victoire pour les partis ouvriers : la SFIO obtient 1,9 million de voix et le PCF double les siennes par rapport aux élections de 1932 avec 1,5 million de suffrages. Le PCF, qui n’avait que 10 députés, en obtient 72 et la SFIO 146. Quant aux radicaux, ils perdent plus de 400 000 voix (il leur en reste 1,4 million) et 51 sièges (ils en gardent 116) ; si leur effondrement reste limité, c’est en grande partie grâce à la stricte application de la discipline électorale de Front populaire, consistant dans le désistement de candidats socialistes et communistes en faveur de candidats radicaux.
Malgré cette victoire électorale écrasante, la direction stalinienne veut à toute force rassurer son allié radical : pas question de toucher à un cheveu du système capitaliste ! Le 7 mai 1936, lors d’une conférence de presse, l’un des dirigeants du parti, Jacques Duclos, assure que le PCF respectera la propriété privée ; le communiqué du Bureau politique insiste sur la lutte pour la « sauvegarde du franc » et la « défense de l’étalon-or » ! Waldeck Rochet proclame que « les électeurs ne se sont pas prononcés pour la Révolution ; nous ne sommes ni des putschistes ni des partisans du tout ou rien. Nous prendrons nos responsabilités en collaborant à l’amélioration du sort des classes laborieuses dans le cadre de la société actuelle. » « Prendre ses responsabilités », dans la bouche des dirigeants « communistes », c’est bel et bien défendre l’ordre et le système tels qu’ils existent ! En particulier, dirigeants socialistes et communistes rejettent absolument le mot d’ordre d’armement du prolétariat. Le Populaire, journal de la SFIO, publie régulièrement le dessin d’un ouvrier désarmé ayant pour légende : « Vous comprendrez que nos poings nus sont plus solides que toutes vos matraques. » C’est clairement conduire le prolétariat à l’impuissance totale et à l’écrasement, comme en Allemagne.
Quant à Léon Blum, il déclare lors d’un meeting salle Wagram le 15 mai : « Donnons au pays l’impression du changement qu’il veut. » C’est tout dire ! Bien loin de mettre clairement en avant et en pratique une perspective socialiste, tous les discours du nouveau chef de gouvernement, soutenu par le PCF, ne cessent de répéter que les masses n’ont pas voté socialiste mais Front populaire et que, par conséquent, il ne faut pas toucher aux bases du système capitaliste. Alors que 3,5 millions d’électeurs ont donné leurs voix aux socialistes et aux communistes, il s’agit toujours de faire la politique des radicaux !
La grève générale et les occupations d’usines
Une telle orientation politique a des conséquences immédiates quand se déclenche, à partir de la mi-mai, le plus grand mouvement de grève que la France ait jamais connu jusqu’alors, une véritable grève générale. La première action a lieu au Havre, aux usines Bréguet, à l’origine pour protester contre la mise à pied d’ouvriers qui avaient débrayé le 1er mai. Des cahiers de revendication sont rédigés, qui réclament notamment la garantie d’un salaire minimal journalier, la reconnaissance des délégués désignés par les salariés seuls, la suppression des heures supplémentaires et la semaine de 40 heures. Le 28 mai, les 35 000 ouvriers de Renault cessent à leur tour le travail. La grève entraîne à sa suite plusieurs dizaines d’usines de la région parisienne. Pour la première fois en France, des usines sont occupées : de la sorte, elles restent sous contrôle ouvrier, les patrons ne peuvent les fermer ou faire appel à une main-d’œuvre de remplacement. Des comités de grève très organisés se mettent en place, avec le plus souvent services de sécurité, de ravitaillement, d’entretien, de garde. La grève se propage d’une usine à l’autre, spontanément, mais sans toutefois de coordination par branche ou géographiquement. On ne connaît qu’un seul exemple d’une réunion rassemblant des délégués de différentes usines en grève et se constituant en comité local de grève : elle a lieu à Levallois, à l’usine Hotchkiss ; elle est l’initiative du comité de grève de l’usine et montre la volonté tout à la fois de structurer le mouvement et d’établir un contrôle des travailleurs sur ce mouvement et sur leurs syndicats eux-mêmes. Mais cette tentative reste unique et isolée.
Les directions de la SFIO, du PCF et de la CGT contre la grève générale
En temps de relative paix sociale, les dirigeants réformistes pleurnichent en prétendant qu’ils aimeraient bien la grève générale, mais que malheureusement les travailleurs n’y sont pas prêts. Ils rejettent la responsabilité des reculs sur le manque de mobilisation des ouvriers. Mais qu’ont fait les directions de la CGT, du PC et de la SFIO lorsque les ouvriers ont d’eux-mêmes imposé et réalisé une grève générale, que leurs chefs n’avaient ni préparée ni prévue ni voulue ? Ils n’ont pas du tout cherché à développer des comités de grève, bien au contraire : « Les radicaux ont peur des comités. Les socialistes ont peur de la peur des radicaux. Les communistes ont peur de la peur des uns et des autres. » (6) Tous veulent éviter ce qui serait une véritable organisation démocratique de combat pour les ouvriers et paysans en grève, qui aurait supposé des comités d’action structurés avec délégués mandatés et révocables d’usine en usine, de quartier en quartier, de ville en ville et en village, se constituant en congrès de tous les comités d’action. « Des soviets partout ! », entend-on dans certaines manifestations. C’était l’un des mots d’ordre du parti communiste dans les années 1920, dans sa période gauchiste, quand cette perspective n’était nullement à l’ordre du jour ; au moment de la grève générale, en revanche, le PCF semble avoir complètement oublié ce mot d’ordre, là encore pour complaire au parti radical, c’est-à-dire à la bourgeoisie. Bref, les chefs réformistes se démènent pour empêcher le prolétariat de renverser l’État bourgeois et de le remplacer par son propre État.
En réalité, le PCF, comme les dirigeants syndicaux et la SFIO au pouvoir s’inquiètent vivement de ce puissant mouvement de grève et de ses répercussions. Par exemple, la grève totale des entrepôts de pétrole les perturbe tout particulièrement, au vu de l’intérêt stratégique de ce secteur-clef. C’est pourquoi Henry Raynaud, secrétaire communiste des Syndicats de la région parisienne, et Jules Moch, dirigeant socialiste, viennent supplier les ouvriers des entrepôts d’Ivry de laisser prélever du mazout au nom de l’État. Mais les grévistes refusent de leur ouvrir la porte ! De son côté, Léon Jouhaux ne cesse de répéter que les grèves de mai-juin 1936 sont d’ordre corporatif et doivent le demeurer. Ce qui fait écrire à Trotsky : « Selon la légende, à la question de Louis XVI : “Mais c’est une révolte ?”, un de ses courtisans répondit : “Non, sire, c’est une révolution”. Actuellement, à la question de la bourgeoisie, “C’est une révolte ?”, ses courtisans répondent : “Non, ce ne sont que des grèves corporatives”. »
CGT, PC et SFIO briseurs de grève
Devant l’ampleur de la grève, le gouvernement se sert du concours des directions syndicales et du patronat en leur faisant passer un contrat pour faire refluer le mouvement. Léon Blum et ses ministres organisent une rencontre à Matignon entre représentants syndicaux et patronaux. Le patronat concède une augmentation des salaires de 7 à 15 %, l’établissement de contrats collectifs généralisés, l’élection de délégués ouvriers dans les établissements de plus de 10 salariés et aucune sanction pour fait de grève. En échange, les dirigeants syndicaux s’engagent à demander la reprise du travail. En 1942, lorsqu’il témoignera au procès organisé contre lui par le gouvernement de Vichy à Riom (7), Blum expliquera sa tactique : « La contrepartie, c’était l’évacuation des usines ; les représentants de la CGT ont dit aux représentants du grand patronat : “Nous nous engageons à faire tout ce que nous pourrons, mais nous ne sommes pas sûrs d’aboutir. Quand on a affaire à une marée comme celle-là, il faut lui laisser le temps de s’étaler. Et puis c’est maintenant que vous allez peut-être regretter d’avoir systématiquement profité des années de déflation et de chômage pour exclure de vos usines tous les militants syndicalistes. Ils n’y sont plus pour exercer sur leurs camarades l’autorité qui serait nécessaire pour exécuter nos ordres.” Et je vois encore M. Richemond, qui était assis à ma gauche, baisser la tête en disant : “C’est vrai, nous avons eu tort.” » Blum expliquera à la même occasion que cet accord Matignon répondait bien à une revendication des patrons : « Sans nul doute j’aurais tenté moi-même ce qu’on a appelé l’accord de Matignon. Mais je dois à la vérité dire que l’initiative est venue du grand patronat… MM. Lambert, Ribot, Duchemin, Delbouze, anciens présidents de la Chambre de Commerce de Paris étaient chez moi et nous réglions ensemble une conversation avec la CGT, déjà acquise du côté patronal. » Il précisera : « On ne demandait qu’une chose aux chambres : allez vite, votez vite afin de liquider cette situation redoutable, cette situation que j’ai qualifiée non pas de révolutionnaire, mais de quasi-révolutionnaire, et qui l’était en effet. » Et Blum de conclure lui-même : « Dans la bourgeoisie, et en particulier dans le monde patronal, on me considérait, on m’attendait, on m’espérait comme un sauveur. »
Dans les jours qui suivent ces « accords Matignon », les dirigeants de la CGT mettent tout leur poids pour imposer cette reprise du travail. Il s’agit, selon le mot de Jouhaux, de « faire honneur à leur signature ». Ils présentent ces accords comme une victoire pour les travailleurs : la presse socialiste, communiste et syndicale le proclame sur tous les tons et demande par conséquent que la lutte cesse. Les grévistes semblent avoir un point de vue assez différent de celui de leurs dirigeants : beaucoup parlent des accords Matignon, qui frustrent leurs aspirations, comme des « accords Maquignon », et Eugène Hénaff avoue au comité central du PCF que d’ « excellents ouvriers révolutionnaires » voient dans ces accords, signés par Benoît Frachon, une réédition de la « trahison de Jouhaux », par allusion au ralliement de celui-ci à l’Union sacrée pendant la Première Guerre mondiale. Or, pour l’appareil stalinien, tant du PCF que de la CGT, l’ennemi principal, ce sont les ouvriers qui dénoncent les directions : Thorez répète qu’il faut « lutter sur deux fronts », contre le patronat… et contre les « gauchistes » ! « La presse ouvrière de juin-juillet, écrivent P. Broué et N. Dorey, fourmille d’indications sur cette poussée à la base, la volonté de durcir et de poursuivre l’action, le refus de souscrire à des accords jugés “insuffisants” : on les découvre seulement en “négatif” dans les communiqués de “mise en garde” des syndicats, fédérations, unions départementales, contre les “éléments inconnus”, “louches”, “provocateurs”, les "surenchères démagogiques” et les “agents du fascisme”. » (8)
Le gouvernement de Front Populaire réprime la grève
Pour faire cesser les grèves, les réformistes et les staliniens manient la carotte et le bâton. La carotte : Blum fait voter au pas de charge plusieurs lois sociales — réduction du temps de travail à 40 heures, généralisation des congés payés (deux semaines), conventions collectives, prolongation de la scolarité de 13 à 14 ans (9). Le bâton : le ministre de l’Intérieur « socialiste » du gouvernement Blum, Roger Salengro, est particulièrement clair dans sa volonté de rétablir ce qu’il appelle « l’ordre », c’est-à-dire l’ordre capitaliste. Devant la délégation des gauches, le 3 juin, il déclare : « Que ceux qui ont pour mission de guider les organisations ouvrières fassent leur devoir : qu’ils s’empressent de mettre un terme à cette agitation injustifiée. Pour ma part mon choix est fait : entre l’ordre et l’anarchie je maintiendrai l’ordre envers et contre tous. » Il réaffirme sa position devant le Sénat qui veut obtenir la condamnation des occupations d’usines par le gouvernement et l’assurance qu’elles cesseront : « Si demain des occupations de magasins, de bureaux, de chantiers, d’usines, de fermes, étaient tentées, le gouvernement, par tous moyens appropriés, saurait y mettre un terme. » De fait, des pelotons de gardes mobiles stationnent aux abords des centres ouvriers, mais aussi dans les campagnes touchées par les grèves des salariés agricoles. Les arrestations se multiplient dans les jours suivants : on en dénombre un peu plus de 1 300, dont 800 à Paris. De plus, le gouvernement « socialiste », soutenu par le PCF, fait procéder à des centaines d’expulsions de militants étrangers : plus de 1 100 arrêtés d’expulsion sont établis, c’est une véritable chasse à l’homme qui se met en place. Dans sa circulaire aux préfets du 4 juillet, Salengro la justifie ainsi : « La France entend rester fidèle à sa tradition de terre d’asile. Il ne serait pas cependant admissible que des étrangers […] puissent sur notre territoire prendre part de manière active aux discussions de politique intérieure et provoquer des troubles et du désordre. » Ce même gouvernement fait saisir à l’imprimerie tous les exemplaires du journal trotskyste La Lutte ouvrière et engage des poursuites contre les dirigeants de cette organisation, en raison de leur appel à constituer milices ouvrières et comités d’usine. Dans les établissements Delespaul-Havez à Marcq-en-Barœul (Nord), une fabrique de chocolats et de biscuits qui compte 650 ouvriers, ceux-ci, après un mois de grève, décident de remettre en marche pour eux-mêmes leur usine. Quelques heures plus tard, l’électricité est coupée et toutes les machines s’arrêtent : Salengro, qui fait le déplacement à Lille, ordonne de maintenir la coupure de courant et de taire, à l’échelle nationale, ce qui se passe dans cette usine. Cette conspiration du silence contre l’auto-organisation ouvrière est respectée scrupuleusement par la SFIO, le PCF et la CGT.
L’appareil de la centrale syndicale demande aux travailleurs de ne pas tenir compte « des tentatives de débauchage exercées par des éléments sans mandat ni responsabilité » (communiqué du 11 juin). Il faut tout faire pour que la reprise du travail ait lieu au plus vite, pour canaliser et cadenasser le mouvement de grève. Le secteur des services publics continue de fonctionner à peu près normalement, alors que c’est là que la CGT compte le plus grand nombre de syndiqués : tout est fait pour qu’ils ne rejoignent pas le mouvement. Dans le secteur du ravitaillement, c’est la même pression qui s’exerce pour éviter ou contenir la grève : « Les travailleurs doivent comprendre que la sympathie de la population doit leur être pleinement maintenue », affirment les dirigeants de la Confédération pour se justifier cette attitude. Pour eux, ce n’est pas encore l’heure de la « lutte finale », alors que les partis ouvriers sont au pouvoir et que deux millions de travailleurs sont en grève et occupent leurs usines, remettant ainsi directement en cause l’exploitation et l’aliénation capitalistes.
Pour limiter le recours à la grève, la CGT recommande aux travailleurs, avant de se servir de cette arme, de discuter d’abord avec le patron, et ce n’est qu’en cas de refus net qu’ils pourront éventuellement faire grève ; mais avant cela, ils doivent encore faire appel à l’intervention de l’État. À aucun moment, le mot d’ordre de « contrôle ouvrier », qui fait pourtant partie du programme de la CGT, n’est avancé. En juillet, les dirigeants de la CGT, suivant la ligne prescrite par les directions socialiste et communiste, vont jusqu’à condamner ouvertement le recours à l’occupation d’usine.
Malgré cela, on compte encore, pendant plusieurs mois, de nombreuses usines occupées : à l’automne, il y en a par exemple 113 dans le textile lillois, avec 33 000 ouvriers et ouvrières. En novembre, 2 500 métallos débrayent à Fives-Lille contre le licenciement d’un délégué. Le nouveau ministre de l’Intérieur socialiste, Marx Dormoy, exige des ouvriers l’évacuation de l’usine et Blum leur enjoint par télégramme « de s’incliner par patriotisme » ! Quelques mois plus tard, en mars 1937, à Clichy, alors que la CGT appelle à une manifestation contre le Parti populaire français de Doriot (ancien dirigeant du PCF devenu un fasciste forcené), les forces de l’ordre tirent sur la foule ; il y a cinq morts parmi les manifestants ouvriers. En réaction et spontanément, les grèves reprennent. Une nouvelle fois, la CGT entend les canaliser : l’UD CGT de la région parisienne appelle à une grève d’une demi-journée en ordonnant d’éviter « toutes les provocations, toutes les manifestations de rue » et de « reprendre partout le travail l’après-midi ». Frachon en personne vient expliquer aux militants de l’école du Syndicat parisien des métaux : « Nous savons que les efforts des militants syndicalistes ont empêché que de nombreux différends se transforment en grèves. Nous vous demandons de faire plus encore. Je sais qu’il est dur de maîtriser son impatience quand les injures et les parjures se multiplient. Mais il faut garder la tête froide et ne pas céder aux provocations. » Et encore : « Nous vous le disons franchement : dans le présent, votre intérêt bien compris réclame qu’il n’y ait plus d’occupation d’usines. » (L’Humanité du 17 octobre 1936.) Alors que la responsabilité de la fusillade de Clichy pèse directement sur le gouvernement Blum, c’est Jacques Duclos lui-même qui propose à la Chambre des députés un vote de confiance à ce gouvernement : même à cette date, même à ce stade, les dirigeants communistes n’ont nullement l’intention de briser le Front populaire. Ils restent sagement alignés derrière Blum, qui en appelle à « la concorde civile », à « l’ordre républicain », au « respect de la loi » (Le Populaire, 24 mars 1937). La presse de droite apprécie à sa juste mesure le service que les dirigeants staliniens rendent à la bourgeoisie, comme en témoignent ces quelques lignes signées du journaliste Marcel Lucain dans Paris-Midi, le 19 mars : « Les élus communistes […] font tout ce qu’ils peuvent pour contenir certains troubles déchaînés […] Il apparaît à ce freinage des chefs extrémistes qu’on pourrait qualifier de “réguliers” sur la pente révolutionnaire qu’ils redoutent d’être débordés […] Le dilemme pathétique est de savoir si les cadres parviendront dans cette tourmente à retenir les masses. »
La défaite et l’écrasement
Par des demi-mesures respectant scrupuleusement le système capitaliste, le gouvernement du Front populaire a fait revenir la hausse des prix et l’instabilité économique ; il détourne de lui les classes moyennes qu’il entendait séduire. Chez les ouvriers, il multiplie les sujets de déceptions et de désillusions : évacuation forcée de toutes usines occupées ; refus de l’échelle mobile des salaires (leur indexation sur les prix) ; dévaluation sans effet ; refus d’intervenir en Espagne pour aider la République espagnole assiégée par les troupes franquistes… Dès que la tempête est passée, la bourgeoisie se débarrasse du gouvernement de Blum : il est battu au Parlement en juin 1937. S’ensuivent plusieurs cabinets dirigés successivement par le radical Camille Chautemps puis, après un bref second gouvernement Blum, par Édouard Daladier. Il n’y pas d’avancées marquantes, hormis la nationalisation en août 1937 des usines d’armement et des compagnies de chemins de fer qui ne l’étaient pas déjà (c’est la création de la SNCF). Ces nationalisations s’expliquent par des raisons purement financières (le déficit croissant de ces entreprises l’imposait) et ne s’accompagnent pas de progrès sociaux (le statut des cheminots avait été acquis dès 1920). Les anciens propriétaires sont d’ailleurs généreusement indemnisés.
Finalement, soucieux de réduire les dépenses sociales, Daladier signe en avril 1938 la fin du Front populaire en ne prenant plus de ministres socialistes dans son cabinet et en remettant bientôt en cause la loi des quarante heures. En guise de protestation, Jouhaux et la CGT, qui ont cassé la grève générale de 1936, proposent le 30 novembre 1938 une « grève générale »… de vingt-quatre heures et pas davantage (tant il est vrai que la tactique bureaucratique des « journées d’action » sans lendemain ne date pas d’aujourd’hui !). Pour que les choses soient bien claires, la CGT va jusqu’à diffuser le communiqué suivant : « Quels que soient les circonstances ou les événements, le travail devra reprendre le jeudi 1er décembre au matin […]. La CGT déclare que la grève se fera sans occupation d’usine, de chantier ou de bureau. Le mercredi 30 novembre, il ne sera organisé aucune manifestation et tenu aucune réunion. » Cette ligne de capitulation sans combat conduit directement à l’écrasement et à la répression impitoyable de la grève : les forces de l’ordre ont recours aux gaz lacrymogènes (pour la première fois dans l’histoires des luttes sociales en France), les agents des service publics sont réquisitionnés, des milliers de grévistes sont licenciés ou sanctionnés. Les effectifs syndicaux s’effondrent : le nombre de syndiqués de la CGT passe de 4 millions en 1937 à moins de 1,5 million au début de l’année 1939.
La période du Front populaire a donc constitué tout à la fois l’une des plus belles luttes de classe jamais menées par les travailleurs en France et l’une des plus graves trahisons infligées par les appareils stalinien et social-démocrate. Au Congrès de Nantes de la CGT, Gilbert Serret, ancien secrétaire général de la Fédération unitaire de l’Enseignement, militant de l’École émancipée et du « Cercle syndicaliste Lutte de classes », le résume d’une formule on ne peut plus juste : « Le Front populaire, formidable escroquerie sociale, n’a non seulement en fait rien su réaliser de ce qu’il avait promis, mais encore il est parvenu à faire accepter à la classe laborieuse ce qu’elle n’aurait jamais accepté d’un gouvernement réactionnaire. »
1) Pierre Broué et Nicole Dorey, « Critiques de gauche et opposition révolutionnaire au Front populaire (1936-1938) », Le Mouvement social, n° 54, janvier-mars 1966, p. 91-133 ; Jacques Danos, Marcel Gibelin, Juin 36, deux vol., Paris, réed. Maspero, 1972 ; Jacques Kergoat, La France du Front populaire, Paris, La Découverte, 2003.
2) Léon Trotsky : « Où va la France ? », Série de textes écrits entre octobre 1934 et décembre 1938, publiés dans Le Mouvement communiste en France (1919-1939), Paris, Les Éditions de Minuit, 1967, textes choisis et présentés par Pierre Broué.
3) Sous le « Cartel des gauches » (gouvernement radical soutenu par la SFIO de 1924 à 1926), ni la suppression de l’ambassade du Vatican, ni la fin du Concordat en Alsace-Moselle où l’école est toujours confessionnelle et l’enseignement religieux obligatoire, ni la dissolution des congrégations non autorisées, toutes mesures qui figuraient au programme du Cartel, n’ont été finalement mises en œuvre.
4) Cf. notre article dans le précédent numéro du CRI des travailleurs.
5) Le PC exige et obtient des dirigeants de la SFIO comme condition pour conclure le front populaire l’exclusion de la SFIO des trotskystes constitués en fraction publique (Tendance Bolchévique Léniniste).
6) Trotsky, « L'étape décisive (5 juin 36) », in Où va la France ?, op. cit., p. 577.
7) Après la guerre, Blum n’est jamais revenu sur ces déclarations, et le parti socialiste les a publiées, ce qui était une façon de les cautionner.
8) P. Broué et N. Dorey, article cité, p. 101.
9) Une nouvelle fois, les colonies sont oubliées. Un projet très timoré visant à accorder la citoyenneté française à… 20 000 Algériens est abandonné car les radicaux s’y opposent.





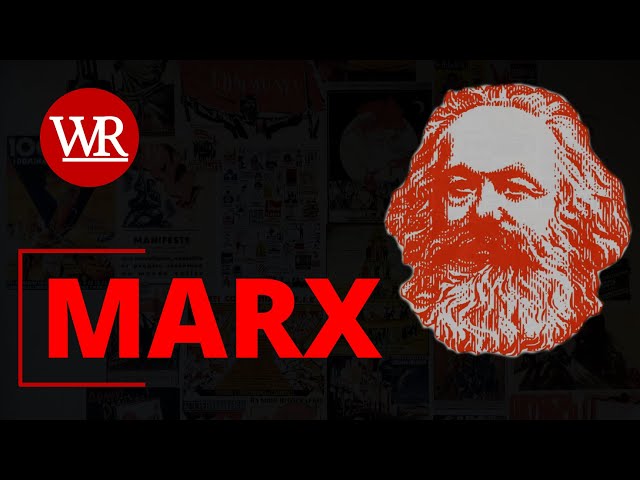

.jpg)
