Agenda militant
Ailleurs sur le Web
![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)
- Meeting avec Jean-Luc Mélenchon, Anaïs Belouassa-Cherifi et Florestan Groult à Lyon ! (26/02)
- Se souvenir du Black Panther Party (25/02)
- Le fascisme. Un texte d’Otto Bauer (25/02)
- JUAN BRANCO : UN ROUGE... TRÈS BRUN (25/02)
- Manu Bompard et Mathilde Panot dans les médias ce mercredi (25/02)
- Fascisme vs antifascisme : le renversement des valeurs - Avec Johann Chapoutot (25/02)
- Écrans: la guerre contre le scroll est déclarée (25/02)
- Antifascisme et LFI : les médias brutalisent le débat public (24/02)
- À Paris, la dynamique Chikirou (23/02)
- Meeting de la campagne municipale à Besançon (23/02)
- Municipales : La FI comme ligne stratégique ou l’usage contre-révolutionnaire de l’autonomie et de la radicalité (23/02)
- Conférence de presse de Mélenchon face aux nouveaux médias (23/02)
- Quand la finance colonise l’État (23/02)
- Faire face aux nazis, royalistes, fachos, identitaires, racistes... (23/02)
- À Bobigny, enseignants et collectifs mobilisés pour leurs élèves sans papiers (23/02)
- Francesca Albanese : itinéraire et succès d’une fake news (23/02)
- PS : 40 ANS DE TRAHISON ! (Saïd Bouamama, Nicolas Da Silva, Stefano Palombarini, Dr Zoé) (22/02)
- L’extrême droite : une histoire de morts (Ludivine Bantigny) (22/02)
- Manu Bompard et Mathilde Panot dans les médias ce dimanche (22/02)
- Rojava : l’État autonome kurde en Syrie en voie de disparition (21/02)
- Pour un antifascisme de masse ! (21/02)
- CENSURE PARTOUT : "On est une colonie numérique américaine" - Fabrice Epelboin (21/02)
- Affirmer notre antifascisme : le devoir du moment (20/02)
- Alternative communiste : Refuser l’instrumentalisation (20/02)
- L’AFFAIRE QUENTIN DERANQUE : CONTEXTE POLITIQUE et ANTI-FASCISME (20/02)
Liens
Ernesto "Che" Guevara : Un exemple pour les communistes révolutionnaires ?

La figure de “Che” Guevara est très populaire dans la nébuleuse de la « gauche radicale », ainsi que dans les boutiques de T-shirts ou de posters. Au point que les courants issus du trotskisme tentent parfois de « surfer » sur cette image, en minimisant les divergences stratégiques. C’est particulièrement le cas pour le courant issu de l’ex-LCR. On se souvient par exemple qu’Olivier Besancenot déclarait ne pas se reconnaître dans l’héritage de Trotsky, lui préférant comme référence la figure plus porteuse de “Che” Guevara. Il lui a même consacré un ouvrage sorti en 2007 (1).
Pour les communistes révolutionnaires, il est bien entendu hors de question de se référer à des figures du passé comme à des icônes, mais il s’agit d’analyser leur action politique et d’en tirer des leçons pour le présent. Voyons ce qu’il en est d’Ernesto Guevara.
Le parcours d’Ernesto Guevara
Guevara est né en 1928 dans une famille bourgeoise d’Argentine, de gauche et anti-autoritariste. En parallèle à sa formation de médecin, il parcourt lors de deux voyages le continent sud-américain, où il prend conscience de l’étendue de la misère à laquelle sont confrontées les masses. Il est en Bolivie en 1953, quelques mois après le début de la révolution et la victoire des mineurs contre l’armée, mais semble n’en avoir tiré aucune leçon sur le rôle dirigeant de la classe ouvrière dans la révolution. Il se rend ensuite au Guatemala : il y est confonté à l’intervention directe de l’impérialisme américain, qui renverse au travers de la CIA le président élu, Jacobo Arbenz, coupable d’avoir entamé une politique contraire aux intérêts impérialistes, en particulier une redistribution des terres. C’est du refus de celui-ci de sortir de la voie légale, cause de sa perte, que Guevara aurait conclu à la nécessité du combat révolutionnaire. C’est aussi là qu’il fréquente des miltants communistes et commence à se réclamer du marxisme. En 1954, il rencontre Fidel Castro et ses troupes au Mexique et y est rapidement intégré, tout d’abord en tant que médecin.
En novembre 1956, il fait partie de l’expédition de 82 hommes qui débarque à Cuba sous la direction de Castro. Piégée par l’armée cubaine du dictateur Batista, seule une poignée de combattants survit, se réfugie dans les montagnes et lance une guérilla. Malgré la supériorité en moyen de l’armée de Batista, soutenue par les États-Unis, la guérilla parvient à quelques succès militaires ; Guevara devient à cette époque commandant et dirige une colonne. La guérilla arrive à se lier avec les paysans et bénéficie aussi de l’appui des mouvements anti-Batista des villes. En particulier, dans les premiers jours de 1959, alors que Batista est en fuite, une grève générale parvient à faire échouer une tentative de coup d’État menée par ses généraux, et les guérilleros entrent triomphalement à la Havane. Guevara, par les capacités militaires dont il a su faire preuve, est une figure majeure de cette victoire.
À partir de ce moment-là, Guevara occupe plusieurs postes de responsabilité au sommet de l’État cubain (il est proclamé “citoyen cubain de naissance” par le gouvernement révolutionnaire). Après quelques mois à la tête de la prison de la forteresse de Cabaña, il entre au gouvernement en octobre 1959 ; il est d’abord chargé de la réforme agraire, puis nommé président de la banque nationale. À partir de février 1961, il est ministre de l’industrie et lance un plan d’industrialisation, qui avortera. Pendant cette période, il joue aussi un rôle important sur le plan international, en particulier dans les relations avec le bloc dirigé par l’URSS et le bloc des “non-alignés”. Il est aussi chargé de représenter Cuba à l’ONU, où il dénonce férocement l’impérialisme.
Durant ces années, il commence à prendre du recul vis-à-vis de la bureaucratie stalinienne, à qui il reproche de ne pas s’engager fermement auprès des peuples luttant contre l’impérialisme. Il est vraisemblable que ces critiques lui ont valu l’invitation à quitter le gouvernement cubain en 1965 sous la pression de l’URSS. Officiellement, une lettre de Guevara fait part de sa volonté de partir dans d’autres pays du monde pour mener la lutte révolutionnaire.
À partir d’avril 1965, il se rend au Congo avec une poignée de militants cubains pour appuyer un mouvement révolutionnaire se réclamant du marxisme, auquel ils servent en particulier d’instructeurs militaires. Cette expédition, décimée par les troupes de Mobutu, se solde par un échec, comme Guevara le reconnaîtra lui-même, et il quitte le pays au début de 1966.
Après quelques mois de clandestinité, il arrive en Bolivie en novembre 1966 avec quelques dizaines de combattants, afin de créer un nouveau “foyer de guérilla”. La troupe s’installe dans les zones montagneuses pour échapper à l’armée. Guevara pense pouvoir compter sur l’appui des paysans locaux. Mais sa guérilla reste isolée et l’appui logistique de Cuba insuffisant. L’armée bolivienne, qui reçoit l’aide de la CIA, traque les troupes guévaristes en déroute. Guevara et ses hommes sont capturés le 8 octobre 1967 et assassinés le lendemain, mourant héroïquement pour la cause de la révolution telle qu’ils la concevaient.
Un trotskyste qui s’ignore ?
Certains groupes trotskystes aiment à présenter Guevara comme un trotskyste “naturel”, qui serait parvenu aux positions politiques de Trotsky grâce à ses propres expériences. Les arguments les plus souvent avancés sont la dénonciation par Guevara de la bureaucratisation à Cuba même, ses prises de position internationalistes et ses analyses se rapprochant de la stratégie de la révolution permanente. Toutefois, faute d’avoir assimilé les leçons essentielles de Marx et de Lénine, ces combats sont restés inefficaces.
“Révolution socialiste ou caricature de révolution” : Guevara et la lutte contre la bourgeoisie nationale
Guevara a acquis son prestige parmi la jeunesse radicalisée d’Amérique Latine dans les années 60 en tant que représentant le plus éminent de la révolution cubaine. En effet, le renversement du dictateur Batista après une brève période d’alliance avec la bourgeoisie du Mouvement du 26 mai et l’expropriation de la bourgeoisie étaient la réfutation pratique de la politique de la bureaucratie stalinienne dans les pays semi-coloniaux. Les staliniens prétendaient que, étant donné le retard du développement capitaliste en Amérique Latine, le temps de la révolution socialiste n’était pas encore venu et qu’il fallait chercher des alliances avec les secteurs “progressistes” de la bourgeoisie nationale contre l’impérialisme. Guevara déclarait contre cette capitulation des PC devant leur bourgeoisie que “le devoir de tout révolutionnaire, c’est de faire la révolution” et proclamait, dans une fomule qui devait rester célèbre, qu’il s’agissait nécessairement d’une révolution socialiste : “Il n’y a pas d’autres changements à faire : révolution socialiste ou caricature de révolution.” Au contraire de ses épigones contemporains, qui soutiennent tous le bonaparte bourgeois Chavez, Guevara avait appris de son expérience que la bourgeoisie nationale et les propriétaires fonciers ne pouvaient plus jouer de rôle révolutionnaire : “Dans les conditions historiques actuelles de l’Amérique Latine, la bourgeoisie nationale ne peut pas prendre la tête de la lutte antiféodale et anti-impérialiste. L’expérience démontre que dans nos nations cette classe, même lorsque ses intérêts sont en contradiction avec ceux de l’impérialisme américain, a été incapable de s’affronter à celui-ci, paralysée par la peur de la révolution sociale et effrayée par la clameur des masses exploitées” (2). C’est là un point indiscutable de convergence avec le trotskysme.
La paysannerie comme moteur de la révolution socialiste
Mais Guevara a néanmoins une idée radicalement différente de la dynamique de classe qui doit rendre possible la révolution socialiste en Amérique Latine. Il fondait sa stratégie politique sur son analyse de la révolution cubaine :
“Nous considérons que les trois apports fondamentaux de la révolution cubaine à la mécanique des mouvements révolutionnaires en Amérique sont : 1) les forces populaires peuvent gagner une guerre contre l’armée; 2) il ne faut pas toujours attendre que toutes les conditions pour la révolution soient réunies ; le foyer insurrectionnel peut les créer ; 3) dans l’Amérique Latine sous-développée, le terrain de la lutte armée doit être fondamentalement la campagne” (La guerre de guérilla). Et il précisait : « Dans les conditions actuelles de l'Amérique, les lieux offrant les conditions idéales pour la lutte se trouvent à la campagne et par conséquent la base des revendications sociales que le guérillero défendra sera le changement de structure de la propriété agraire. »
Il en concluait : « Le guérillero est fondamentalement et avant tout un révolutionnaire agraire. » (Qu'est-ce qu'un guérillero ?)
Pour les trotskystes, au contraire, par sa place dans les rapport de production capitalistes, seule la classe ouvrière, même si elle est numériquement minoritaire, peut diriger une révolution victorieuse contre le capital, en entraînant derrière elle la paysannerie et la petite bourgeoisie pauvres. Celles-ci, en revanche, même si elles sont très opprimées et très pauvres, n’ont pas d’alternative à opposer à l’organisation capitaliste de la société et ne peuvent qu’osciller entre les deux classes fondamentales de la société capitaliste, le prolétariat et la bourgeoisie. Il ne s’agit d’ailleurs pas là d’une invention théorique de Trotsky, mais de la continuité du marxisme : une révolution socialiste ne peut être dirigée que par le prolétariat et elle ne peut consister qu’en l’auto-émancipation des travailleurs eux-mêmes. C’est pourquoi elle suppose un long travail de préparation au sein du prolétariat pour développer sa conscience politique et son auto-organisation : c’est le travail patient de la construction d’un parti politique marxiste révolutionnaire s’appuyant sur la lutte de classe spontanée du prolétariat.
L’expérience des années 60 et 70 en Amérique Latine a pleinement confirmé la justesse de cette perspective générale. À l’exception de Cuba, les divers foyers de guérilla ont toujours rencontré un échec retentissant, que ce soit en Bolivie, en Argentine ou encore au Pérou. Mais même la victoire de la guérilla à Cuba n’a été possible que par l’intervention autonome du prolétariat déclenchant la grève générale contre Batista et par les hésitations de l’impérialisme à soutenir un Batista chancelant face au Mouvement du 26 mai, qui ne se déclarait au début nullement socialiste. Partout, la montée révolutionnaire s’est exprimée sous la forme de la montée de l’auto-activité prolétarienne. C’est un soulèvement dirigée par la COB et les secteurs les plus concentrés du prolétariat, à commencer par les mineurs, qui a renversé la dictature miliaire en Bolivie à la fin des années 60 et ouvert une situation révolutionnaire. C’est la poussée du prolétariat au Chili, culminant dans l’organisation des “cordons industriels”, c’est-à-dire des assemblées coordonnant les comités d’usine par régions industrielles, qui a porté Allende au pouvoir et qui a conduit la bourgeoisie à un coup d’État militaire pour briser cette offensive. C’est aussi l’indépendance croissante des secteurs les plus concentrés du prolétariat en Argentine entre 1969 et 1976 qui a conduit la bourgeoisie à rappeler Peron, puis, face au développement des coordinations inter-usines et à la grève générale imposée par la base de la CGT, à recourrir à un sanglant coup d’État militaire pour briser cet élan (3).
Enfin, seul le prolétariat, expropriant le capital et les propriétaires fonciers, est capable de donner satisfaction aux revendications de la petite bourgeoisie, par l’instauration d’une banque d’État unique (les libérant de l’usure) et par la mise à leur disposition d’un matériel moderne, en transition vers une agriculture collective. Ce qu’illustre justement la révolution cubaine, c’est l’inconséquence et la duplicité sociale des mouvements nationaux petit-bourgeois : si la direction castriste a dû prendre dans un premier temps appui sur la classe ouvrière dans son combat pour l’indépendance nationale, et aller plus loin qu’elle ne le voulait elle-même vers la satisfaction des revendications de celle-ci, l’histoire a montré qu’elle a depuis, malgré les déclarations fracassantes, cédé aux exigences impérialistes (4).
La stratégie guérilleriste : substitutisme et discipline militaire
L’analyse de Guevara faisant de la paysannerie la classe centrale de la révolution débouche sur une stratégie guérilleriste qui prétend sauter par dessus le processus de maturation politique du prolétariat et de la petite paysannerie par un électrochoc produit à partir d’un foyer de guérilla. Dans cette conception, une petite avant-garde éclairée doit se substituer à l’auto-activité des masses. Il en résulte que le parti-armée fonctionne selon une discipline militaire stricte. Pour Guevara, “l’organisation militaire se fait sur la base d’un chef (…) qui nomme à son tour les différents commandants de régions ou de zones, avec le pouvoir de gouverner sur leur territoire d’action (…). Quand cette discipline se rompt il faut punir celui qui l’a rompue (…), le punir drastiquement et appliquer le châtiment là où cela fait mal.”
À l’opposé, les trotskystes, dans la continuité du marxisme révolutionnaire, conçoivent le parti comme l’avant-garde de l’avant-garde, dont la fonction est d’aider la classe à s’auto-organiser et à progresser dans sa conscience politique. C’est pourquoi ils se battent partout pour la démocratie ouvrière la plus complète et considèrent que leur parti doit être organisé sur la base du centralisme démocratique, avec à la fois une pleine liberté de discussion sur le programme et l’orientation, et la plus complète unité dans l’action. Cette discipline bolchévique n’est pas une discipline militaire, mais le produit de l’élévation de la conscience de classe, de la liaison des militants avec la masse des travailleurs et de la possibilité de vérifier dans la pratique la justesse de l’orientation du parti.
La conception bureaucratique de l’État ouvrier et la lutte purement morale contre la bureaucratie
La conception stratégique de Guevara n’a pas seulement pour conséquence un parti organisé sur le modèle d’une armée, mais aussi une conception bureaucratique de l’État ouvrier, appelé à construire le socialisme par en haut. Certes, lorsqu’il était lui-même à la tête de l’État cubain, Guevara, n’a pas manqué de critiquer la bureaucratie, non seulement telle qu’elle sévissait en URSS et en Europe de l’Est, mais aussi dans ses manifestations à Cuba même. De plus, son comportement personnel, fait d’austérité, de refus de tout privilège lié à sa fonction, en ferait un symbole de la lutte contre la bureaucratie, au point que certains en viennent à se demander si l’évolution dictatoriale du régime cubain n’aurait pas pu être évitée dans l’hypothèse où Guevara serait resté au gouvernement.
Mais, premièrement, son départ même de Cuba est un signe que la bureaucratisation du régime cubain avait déjà bien avancé pendant qu’il en faisait partie et que la révolution cubaine était donc déjà sur la voie de l’échec. Si l’on en croit l’argument couramment avancé, selon lequel Guevara a été prié de quitter le gouvernement sous la pression de la bureaucratie d’URSS, cela révèle, s’il en était besoin, que le pouvoir à Cuba n’était pas du tout entre les mains des masses, mais entre celles d’une poignée d’individus. Et cela confirme que la révolution cubaine, isolée internationalement, était déjà inféodée à la bureaucratie stalinienne : sa survie était liée aux intérêts contre-révolutionnaires de cette dernière à l’ère de la “coexistence pacifique” avec l’impérialisme.
En second lieu, et plus fondamentalement, l’inefficacité de la lutte contre la bureaucratie de la part de Guevara tient aux limites petites-bourgeoises de sa pensée et de son action. Guevara faisait de la lutte contre la bureaucratisation une affaire individuelle, morale. De ce point de vue, il appliquait certes pour lui-même ce que l’on est en droit d’attendre d’un dirigeant révolutionnaire, en refusant les privilèges matériels qu’aurait pu lui apporter sa fonction ; il tenait même tellement à sa valeur d’exemple qu’il s’engageait régulièrement dans des entreprises de travail volontaire lors de son temps libre ; et il exigaeait aussi cette discipline de ces collaborateurs : ceux qui ne feraient pas de travail volontaire ne progresseraient pas dans son ministère… Mais on ne peut pas faire de politique en se basant principalement sur la morale et en comptant sur un comportement individuel irréprochable des uns et des autres. Les principes de la démocratie ouvrière ne sont pas de simples ornements, ils sont indispensables à la réussite de la révolution. C’est en choisissant démocratiquement ses délégués aux postes de reponsabilités, en ayant la possibilité de les révoquer en cas de manquement, que la classe ouvrière peut éviter que ne se forme une couche de parasites bureaucratiques au-dessus d’elle. Or, tout au contraire, la révolution cubaine a toujours été conduite par une équipe petite-bourgeoise, pour qui la classe ouvrière pouvait servir de force de frappe en cas de besoin, mais n’avait pas vocation à diriger la révolution. Guevara n’a pas plus que les autres dirigeants cubains lutté pour une véritable démocratisation du régime, c’est-à dire pour son dépassement vers une authentique dictature du prolétariat. Tout au contraire, dans la suite de son parcours, il a théorisé sa méfiance à l’égard de la classe ouvrière, trop engluée selon lui dans cette “mentalité de classe ouvrière exploitée et spoliée, qui lutte seulement pour des revendications économiques”.
Ce mélange de rejet envers les aspirations de la classe ouvrière et de comportement moralisateur, dans lequel certains croient reconnaître un formidable humanisme – avec la promotion de l’“Homme nouveau” par Guevara, c’est-à-dire de l’homme enfin débarrassé de l’aliénation due à la domination du capitalisme et des appétits matériels – s’est reflété dans la politique du régime cubain : ainsi celui-ci a-t-il appelé “campagne grandiose pour déraciner le vieux vice d’un économisme étroit chez les travailleurs”… sa décision d’imposer des baisses de salaires ! L’austérité comme valeur est inefficace pour lutter contre la bureaucratisation ; quand elle est imposée à une classe ouvrière privée du pouvoir, ce n’est rien de plus que la triste banalité de la domination bourgeoise.
L’internationalisme
En sa qualité d’Argentin de naissance ayant mené une révolution victorieuse à Cuba, par son célèbre appel à créer “deux, trois, beaucoup de Vietnam” pour lutter contre l’impérialisme, par son engagement personnel dans la lutte armée au Congo, puis en Bolivie, qu’il a payé de sa vie, Guevara semble être un symbole de l’internationalisme révolutionnaire. Mais, là encore, cet engagement, si courageux soit-il, est marqué par ses limites petites-bourgeoises.
La victoire contre l’impérialisme, à travers son laquais Batista, a engendré un mouvement de sympathie et un certain prestige pour la révolution cubaine, en particulier en Amérique du Sud. Mais, contrairement à l’avènement de la IIIe Internationale avec la révolution russe de 1917, cela n’a entraîné aucun pas vers la construction d’une organisation internationale pouvant servir d’outil pour étendre la révolution.
L’isolement de la révolution cubaine ne pouvait que la mener à sa perte ; pour ne pas retomber dans les griffes de l’impérialisme, les dirigeants cubains ont dû se tourner vers l’URSS et la Chine. Ensuite, certes, Guevara a critiqué durement ces régimes, coupables de marchander leur soutien aux luttes armées contre l’impérialisme, en particulier au Vietnam, de ne pas engager la “lutte à mort”, sans frontière, contre l’impérialisme. Mais, restée dans les limites étroites d’un nationalisme radical et n’ayant pas construit l’outil politique pour mener cette lutte à mort, une telle attente envers la bureaucratie contre-révolutionnaire ne pouvait qu’être déçue.
Cette conception de l’internationalisme comme une juxtaposition de nationalismes radicaux se retrouve dans la suite du parcours de Guevara, au Congo, puis en Bolivie. Bien sûr, on peut louer le courage physique de Guevara, qui a dirigé lui-même ces expéditions armées, mais celles-ci marquent aussi l’impasse de la méthode du “foyer” et de la guérilla théorisée par Guevara. Pour lui, prenant exemple sur la victoire à Cuba, l’activité d’un noyau de guérilleros pourrait servir d’étincelle pour un mouvement révolutionnaire de masse. Mais, contrairement à ce qui s’est passé à Cuba, ces expéditions, de plus mal préparées, n’ont jamais pu faire la jonction avec les mouvements de contestation locaux. En Bolivie particulièrement, le parti pris de voir dans les paysans, en raison de leurs conditions de vie misérables, le fer de lance révolutionnaire, et de négliger la classe ouvrière malgré la force que lui confère sa place dans les rapports de production, s’est révélé dramatique. De plus, les troupes de Guevara, méconnaissant le problème spécifique de l’oppression ethnique des paysans indigènes, n’ont pas su faire la jonction avec ceux-ci, qui les dénonçaient le plus souvent à l’armée. Enfin, malgré cet échec, Guevara a persisté dans son principe de ne pas prendre appui sur le mouvement réel de la classe ouvrière organisée. Ainsi, alors que les mineurs, l’avant-garde du prolétariat en Bolivie depuis la révolution de 1952, organisés au sein de la COB, s’affrontaient à l’armée et étaient défaits dans le sang, Guevara s’est adressé à eux pour les inviter à rejoindre la guérilla et à ne pas “perséverer en des tactiques fausses, héroïques sans doute, mais stériles”. Par une triste ironie, l’impasse de la guérilla a mené cette poignée de combattants courageux à la mort à peine quelques mois plus tard.
Malgré une ressemblance superficielle, il y a donc bien une différence en termes de classe entre les principes de Guevara et ceux du trotskysme. On ne saurait reprocher à un militant son origine sociale, mais force est de constater que Guevara n’a pas, sur plusieurs points, rompu avec l’idéologie de sa classe d’origine, la bourgeoisie nationaliste d’un pays dominé. Or l’anti-impérialisme de celle-ci ne peut qu’être inconséquent, car non réellement anti-capitaliste. Le fait que des organisations se réclamant du marxisme révolutionnaire et plus spécifiquement du trotskysme, soient prêtes à suivre ses conceptions, en particulier en reprenant l’idée qu’un mouvement nationaliste petit-bourgeois puisse devenir la direction d’une révolution socialiste, est révélateur de leur abandon des principes de classe.
Les organisations d’origine trotskiste qui font l’apologie de “Che” Guevara, concèdent aussi bien souvent ce genre de critiques à son encontre, portant sur la sous-estimation du rôle du parti, la théorie de la guérilla ou le manque de relation avec la classe ouvrière. Toutefois, ce ne seraient selon elles que les inévitables points faibles d’un homme, qui pèseraient peu face à ses qualités de courage personnel, d’honnêteté, de conformité entre ses actes et ses idées. Mais, au-delà de la place des individus dans l’Histoire, l’essentiel est de dégager les positions programmatiques qui permettront la victoire de la révolution prolétarienne. À cette aune, suivre le chemin de Guevara, en oubliant ou même en sous-estimant la place dirigeante que devra avoir la classe ouvrière dans la révolution, la nécessité qu’elle s’organise pour cela à l’échelle internationale et l’impossibilité de mener une révolution anti-impérialiste qui ne soit pas réellement prolétarienne, ne pourrait mener qu’à une impasse.
1) Guevara, une braise qui brûle encore, co-écrit avec Michael Löwy, Mille et une nuits, septembre 2007.
2) Ernesto Che Guevara. La guerre de guérilla (1960). Maspero, Paris, 1968.
3) Cf. sur ce point la passionnante recherche réalisée par des militants du PTS sur cette période, Insurgencia obrera en la Argentina, 1969-76, Ruth Werner et Facundo Aguirre, Éditions IPS, Buenos Aires, 2007. — Notons que la direction de la “Quatrième Internationale”-Secrétariat Unifié (organisation internationale à laquelle appartenait la LCR) a dans cette période entièrement épousé les positions guérilléristes, avec des conséquence désastreuses en Bolivie et en Argentine, et au prix d’une scission dans ses sections latino-américaines, notamment en Argentine. Nous y reviendrons dans un prochain article.
4) Ce processus s’est accéléré dans les années 1990, avec la fin du monopole du commerce extérieur, la dissolution de l’organisme de planification et le vote d’une loi sur les investissements étrangers. Aujourd’hui, de nombreux secteurs (pétrole, tourisme, agro-alimentaire…) sont dominés au moins en partie par des entreprises à capitaux étrangers, en particulier en provenance des pays impérialistes européens.





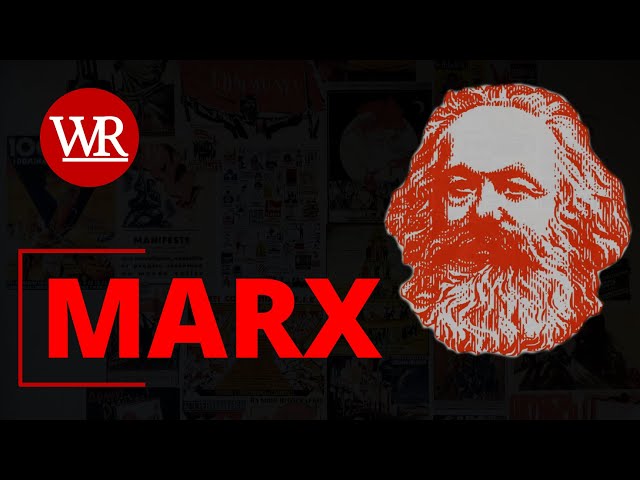

.jpg)
