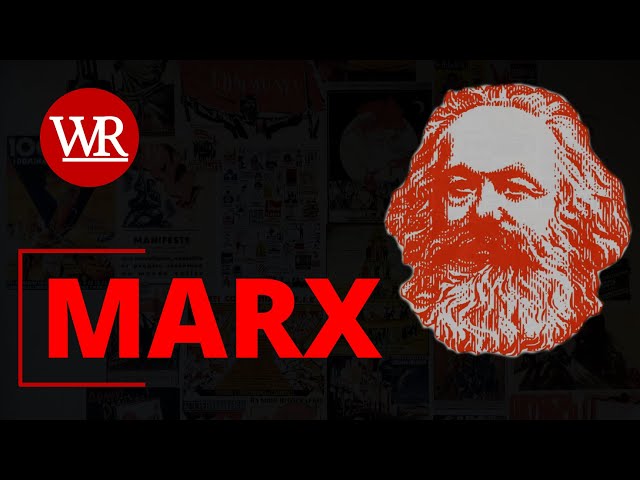Agenda militant
Ailleurs sur le Web
![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)
- Bayrou, le budget et la crise du NFP (25/01)
- Coquerel : "Les concessions budgétaires au groupe PS sont un écran de fumée" (25/01)
- PULSION (éd La Découverte) - Frédéric LORDON - Sandra LUCBERT (23/01)
- Meeting avec Jean-Luc Mélenchon et Louis Boyard à Villeneuve-Saint-Georges (23/01)
- Cessez-le-feu à Gaza : un échec pour les impérialistes (22/01)
- ChatGPT, une intelligence sans pensée, d’Hubert Krivine (22/01)
- Jean Jaurès, un républicain marxiste (21/01)
- Waly Dia. "Sarkozy, c’est la pookie de Neuilly" (18/01)
- Une Sécurité sociale auto-gérée pour retrouver le chemin de l’émancipation ! (18/01)
- Pour la socialisation du travail reproductif (18/01)
- Interview de Nicolas Da Silva pour l’Anticapitaliste (18/01)
- Un "pognon de dingues" : pourquoi le néolibéralisme veut la peau de la "Sécu" (18/01)
- Un nouveau cours pour gagner contre les fermetures d’usine et les suppressions d’emploi (18/01)
- Un mois de grèves et de luttes : Décembre 2024 (17/01)
- Syrie: La chute du régime (17/01)
- Iran. De la stratégie révolutionnaire au repli nationaliste (17/01)
- Serge Latouche : "Tout ce qui est beau et désirable se dévalue dès qu’il y a production de masse" (17/01)
- La fabrique du déficit public (17/01)
- Franz Fanon l’Algérien (17/01)
- La grève d’ID Logistics et le rôle de la CGT (17/01)
- L’hôpital grippé par les politiques libérales (17/01)
- Allemagne : Alstom, réduction de personnel, fermetures, délocalisations... (17/01)
- Impérialisme et ravages écologiques (17/01)
- Retour sur la condition ouvrière retraitée (17/01)
- Clémence Guetté - Censure de Bayrou : c’est l’heure de vérité (16/01)
Retours historiques sur le réformisme antilibéral « de gauche »

Cet article très partiel revient sur deux épisodes de l’histoire politique française, sous l’angle du discours économique du réformisme. Cela permet de relever des éléments récurrents qui sont encore ceux que nous entendons aujourd’hui, de confronter ce discours à l’expérience de « la gauche » au pouvoir, et de nourrir la réflexion sur le réformisme.
1924 : Le cartel des gauches contre le mur de l’argent
A la suite de la Première guerre mondiale, l'État français est très endetté et en crise financière. Pour les intérêts de l’impérialisme français, il a eu recours pendant la guerre à des emprunts massifs et a fait tourner la planche à billets. Pour rétablir les finances, résorber la dette, ce sont alors des budgets de rigueur qui sont imposés, et qui, comme aujourd’hui, frappent plus durement la classe travailleuse.
Le Bloc national au pouvoir après la guerre se veut le continuateur de l’Union sacrée, mais celle-ci a de plus en plus de mal à passer. Dans le sillage de la révolution russe, les revendications ouvrières ont resurgi, poussant à gauche l’ensemble du spectre politique. Un « cartel des gauches » voit alors le jour pour les élections législatives de 1924, entre les socialistes (Section française de l’internationale ouvrière, SFIO) et des forces de la gauche bourgeoise centrées autour du Parti radical. La SFIO n’ose pas participer au gouvernement Herriot : le « ministérialisme » n’est pas encore assumé totalement (malgré le précédent de Millerand, un socialiste qui a accepté un poste de ministre en 1899 avec le soutien de Jaurès), et il se justifie déjà face à la dénonciation de son opportunisme par le jeune parti communiste (Section française de l’Internationale communiste, SFIC). Ce cartel est néanmoins une prémisse de « front populaire » basé sur le dénominateur de « gauche » et de « progressisme ».
Au delà de la trahison c’est aussi le début d’une propagande prétendant que le « progrès » est possible pour les exploités en s’alliant avec des forces pro-capitalistes.
Les radicaux étant naturellement peu enclins à empiéter sur la « propriété privée », ce sont les socialistes qui vont les pousser à des « réformes », visant à taxer le capital et notamment les profiteurs de guerre. Cela n’a pas débouché sur un programme économique commun à l’échelle nationale, mais par exemple en Île-de-France, le cartel déclare :
« Nous voulons l’assainissement des finances, la justice sociale par la prédominance de l’impôt direct frappant la richesse acquise, la répression impitoyable des fraudes et des spéculations illicites (…). Nous voulons garantir les commerçants contre les abus du droit de propriété (…) le commerce et l’industrie honnêtes contre les mercantis, les classes moyennes contre les entreprises d’une ploutocratie sans vergogne ».1
La prétention à défendre les petits patrons face aux gros, les entrepreneurs contre les spéculateurs, tout ça dans le cadre du système, est déjà là.
Aussitôt le nouveau gouvernement mis en place, une panique bancaire se déclenche, ce qui aggrave la crise et la pénurie budgétaire. C'est alors qu'Édouard Herriot emploie pour la première fois l'expression de « mur d'argent », pour dénoncer le sabotage des milieux bancaires et financiers, et notamment le rôle du conseil de régence de la Banque de France, un organisme semi-privé dirigé par le banquier Rothschild et le métallurgiste Wendel.
Toutefois, on ne peut réduire cette crise à un complot de la finance. La fuite des capitaux était réelle, tout comme la dépréciation du franc, la panique a gagné y compris les petits épargnants... C’est ce qu’explique l’historien Jean-Noël Jeanneney2, qui s’inscrit pourtant dans la pure lignée de cette gauche bourgeoise qui aboutit au PS d’aujourd’hui. Le gouvernement Herriot chute en avril 1925. Six gouvernements du cartel lui succèdent et sont incapables de stabiliser la situation économique, ce qui conduit au retour de Poincaré (alliance de la droite et des radicaux) en juillet 1926. Cet échec montre l'impossibilité pour un gouvernement bourgeois de «gauche» de mettre en œuvre des mesures sociales significatives, et donc les limites du volontarisme dans le cadre capitaliste. Non pas simplement parce que les financiers n'en veulent pas, mais parce que ces mesures accroissent les dysfonctionnements du système capitaliste. Deux issues sont alors possibles : soit la logique du système s'impose et les mesures sont retirées, soit un gouvernement révolutionnaire (c'est à dire un gouvernement porté par la mobilisation des masses ou issu de cette dernière) prend des mesures radicales pour mettre hors d'état de nuire les capitalistes.
Il faut d’ailleurs noter que quelques mesures du cartel sont passées, celles qui n’étaient pas vraiment structurelles et donc « digérables » par le système3 : transfert des cendres de Jaurès au Panthéon, reconnaissance de l'URSS, une contre-offensive laïque timide... ou même l’autorisation pour les fonctionnaires de se syndiquer, et des amnisties pour des arrestations d’ouvriers et de progressistes, Quant aux intérêts colonialistes, ils étaient bien défendus (répression au Maroc, en Syrie, au Liban...).
1936 : L’interventionnisme du Front populaire
Les partis conservateurs seront renforcés pour un temps par cet échec du « réformisme ». L’application de strictes politiques de rigueur (appelées alors « politiques de déflation ») et de stabilisation monétaire (le « franc Poincaré » sera fixé à l'or en 1928) reprendront alors de plus belle, et le mouvement ouvrier connaîtra un profond recul.4 Mais après de nombreux sacrifices subis, au lieu d’une amélioration, c’est la crise mondiale qui vient frapper les exploités au début des années 1930.
Dans les milieux d’économistes, les politiques classiques (dites de « laissez faire ») provoquent des remises en question en raison des conséquences sociales désastreuses qui menacent la survie même du système. Les thèses de Keynes ne sont pas vraiment connues en France (sa Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie sera publiée en français en 1942), ni même aux Etats-Unis (son ouvrage phare n'est publié qu'en 1936, trois ans après le lancement du New Deal), mais l’interventionnisme étatique est déjà tenté aux États-Unis par Roosevelt depuis 1933.
La « gauche » va épouser cette école économique, parce qu’elle était idéale pour justifier sa volonté opportuniste de s’intégrer à l’État capitaliste. La SFIO sera la plus créative dans l’élaboration d’un programme économique réformiste. Et cette fois, la SFIC (totalement stalinisée) ne freinera pas, mais sera au contraire moteur pour l’adoption d’un programme avec les radicaux.
Dans les discussions qui préparent le Front populaire5, Léon Blum constate entre les différentes composantes « une entente sur la lutte anticrise par la reflation, par l’accroissement de la consommation générale ». Et pour cela, la SFIO défend la relance plutôt que l’austérité :
« Jusque-là, c’est de l’équilibre comptable rigoureux du budget qu’on espérait la renaissance économique. C’est, au contraire, de la renaissance économique que nous attendons de bonnes finances. » Vincent Auriol
Mais les radicaux sont sceptiques, et ne veulent pas d’un budget en déficit. Léon Blum argumentera en disant que ces mesures sont de nature à limiter la crise (les nationalisations partielles permettraient de diminuer les coûts de production, le crédit pourrait être orienté vers l'achat de biens de consommation…). Mais tout en assurant son parti qu’il n’y avait là aucun révisionnisme : ces nationalisations partielles avec indemnisation des capitalistes (liées à « l’exercice du pouvoir » par le parti) ne sont pas sur le même plan que les « socialisations » sans indemnisation (liées à la « conquête du pouvoir » par le prolétariat, plus tard !).
Il est d’ailleurs intéressant de noter que la SFIO (dans laquelle existait un courant « planiste », pro-nationalisations) proposait sur le papier la « nationalisation du crédit, des assurances et des grandes industries monopolisées », alors que la SFIC refusait en disant qu’il fallait « réunir le plus grand nombre d’organisations et de citoyens ».
Le débat portait aussi sur la fiscalité. Les communistes mettaient en avant la « taxation du capital », considérée comme « revendication immédiate », alors que socialistes et radicaux voulaient au contraire une « détente fiscale » pour inciter les investissements. Pour autant, les communistes se souciaient de présenter leurs mesures comme compatibles avec le capitalisme. Ainsi ils précisaient que ce prélèvement était « exceptionnel » et que :
« À un moment où les capitaux hésitent à s’investir, le prélèvement sur les grosses fortunes pour réaliser de grands travaux, loin d’être une faute est une nécessité économique : il permet d’investir dans l’économie nationale des capitaux nouveaux. Loin d’augmenter le chômage, il crée du travail et tout un nouveau courant d’affaires. »

Finalement, le programme n’inclura que la nationalisation des industries de guerre ou encore la réglementation des milieux banquiers et la réorganisation de la Banque de France sans pour autant nationaliser le crédit. Cette mesure revient donc à peu près au « pôle public bancaire » que propose le Front de gauche aujourd’hui6.
Il est intéressant aussi de constater que le débat sur la dévaluation du franc ressemble assez à des débats actuels. Officiellement, les deux partis ouvriers avaient pour position « ni déflation, ni dévaluation », pour ne pas que les salaires réels soient rognés par la hausse des prix. Les économistes de la SFIO étaient cependant très tentés par la dévaluation… si bien qu’il fut convenu lors d’une réunion secrète entre socialistes et radicaux d’en acter le principe, sans le mentionner dans le programme du Front populaire.
Le Front populaire était une manière pour le PCF (qui adopte à ce moment-là le F de français) et la SFIO de canaliser dans les institutions la mobilisation anti fasciste qui naissait au sein du mouvement ouvrier. Mais au grand dam des vainqueurs, la victoire électorale fait éclater la grande grève de juin 1936. Cette irruption des travailleur-se-s aurait pu déboucher sur l’expropriation directe des gros capitalistes, et rendre ainsi obsolètes toutes ces lois économiques du système. C’en aurait été fini des contradictions reflation/déflation (politique de la demande / politique de l'offre dirait-on aujourd’hui). Au lieu de cela, les bureaucrates mirent toute leur énergie pour que ce formidable mouvement soit calmé en toute hâte par des concessions (congés payés, hausses de salaires, semaine des 40h…). 7
La stabilisation politique signifiait le retour à la soumission aux lois de ce système instable : l’augmentation des salaires fut absorbée par la hausse des prix dès septembre, les 40h ne furent jamais appliquées, de nombreux riches partaient en Suisse, Léon Blum annonça la « pause » des réformes sociales en 1937… La réaction fut incarnée de façon terrible par la guerre mondiale et le régime de Vichy.
Tirer les leçons du passé pour montrer l'impasse du réformisme antilibéral
Ces retours historiques permettent de faire des constats et d'en tirer les leçons, utiles dans le débat idéologique avec le réformisme d’aujourd’hui :
-
L’austérité, les coupes dans les dépenses publiques, les baisses d'impôts pour les patrons, la frilosité à remettre en cause la « liberté » des entreprises ne sont pas un simple choix que les politiques feraient parmi tant d'autres, mais une tendance structurelle sous le capitalisme car elles visent à maximiser le taux de profit. Cette même tendance est trop souvent présentée comme singulière sous le nom de « néolibéralisme »8.
-
La tentative d’élaborer des solutions à la crise dans le cadre du système est aussi une tendance récurrente, et les courants de type keynésiens sont assez naturellement l’expression principale de ces tentatives.
-
Ces tentatives de sortir des crises ou des marasmes capitalistes par des politiques de redistribution ont échoué partout, et ces échecs ont entraîné des reculs terribles pour le mouvement ouvrier.
L’économie politique fait partie intégrante du terrain idéologique, sur lequel le réformisme doit être combattu. Ceci est d’autant plus vrai si l’on prend du recul sur ce qu’est le réformisme aujourd’hui.
Le vieux réformisme du mouvement ouvrier visait à justifier un « exercice du pouvoir » (bourgeois) tout en prétendant préparer le terrain à la révolution socialiste. Le réformisme du Front de Gauche n’a plus vraiment à se justifier devant un électorat ou une base militante ayant une conscience socialiste. La conscience de classe a connu de tels reculs que ce réformisme est très proche d’un réformisme bourgeois, comme celui de Roosevelt.
Quant au Parti socialiste de François Hollande, il n’a rien d’un parti réformiste, dans aucun sens que ce soit. Bien au contraire, il s’inscrit totalement dans la lignée des partis bourgeois ordinaires qui ne cherchent qu'à servir au mieux les intérêts des capitalistes.
En conséquence, il n’est plus pertinent de se contenter de dénoncer le réformisme sous l’angle de la « trahison » (il faudrait pour cela qu’il y ait des attentes socialistes, une mémoire de ce que faisaient les staliniens et les sociaux-démocrates, etc.). Il faut simultanément élaborer un vrai programme révolutionnaire contre les capitalistes, et expliquer que les idéologies fondées sur des réformes sont impuissantes face à la crise du système. Pourtant, bien peu d’anticapitalistes se sont attelés à cette tâche.
1 http://blogs.lesechos.fr/echos-d-hier/11-mai-1924-le-victoire-ambigue-du-cartel-des-gauches-a10511.html
2 http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/quand-le-cartel-des-gauches-crevait-le-plafond_1421206.html
3 Quelques affiches de propagande de l’époque en disent long sur les oppositions de « valeurs » d'alors : http://www.histoire-image.org/site/etude_comp/etude_comp_detail.php?i=773
4 Le taux de syndicalisation était tombé à 7 % en 1934, comme aujourd’hui.
5 Michel Margairaz, L’État, les finances et l’économie. Histoire d’une conversion 1932-1952
http://books.openedition.org/igpde/2292?lang=fr
6 Mitterrand en 1981 fut plus radical en nationalisant toutes les banques... avant d'imposer presque aussitôt le « tournant de la rigueur ».
7 Voir notre brochure sur le Front populaire : http://tendanceclaire.npa.free.fr/article.php?id=23
8 Il y a bien eu depuis les années 1980 un retournement idéologique et une profonde réorganisation du monde du travail, mais les politiques économiques que l'on nous impose ne sont pas nouvelles.