Agenda militant
Ailleurs sur le Web
![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)
- Une Sécurité sociale auto-gérée pour retrouver le chemin de l’émancipation ! (18/01)
- Pour la socialisation du travail reproductif (18/01)
- Interview de Nicolas Da Silva pour l’Anticapitaliste (18/01)
- Un "pognon de dingues" : pourquoi le néolibéralisme veut la peau de la "Sécu" (18/01)
- Un nouveau cours pour gagner contre les fermetures d’usine et les suppressions d’emploi (18/01)
- Un mois de grèves et de luttes : Décembre 2024 (17/01)
- Syrie: La chute du régime (17/01)
- Iran. De la stratégie révolutionnaire au repli nationaliste (17/01)
- Serge Latouche : "Tout ce qui est beau et désirable se dévalue dès qu’il y a production de masse" (17/01)
- La fabrique du déficit public (17/01)
- Franz Fanon l’Algérien (17/01)
- La grève d’ID Logistics et le rôle de la CGT (17/01)
- L’hôpital grippé par les politiques libérales (17/01)
- Allemagne : Alstom, réduction de personnel, fermetures, délocalisations... (17/01)
- Impérialisme et ravages écologiques (17/01)
- Retour sur la condition ouvrière retraitée (17/01)
- Clémence Guetté - Censure de Bayrou : c’est l’heure de vérité (16/01)
- Benoît Coquard : "les classes populaires rurales et les sympathisants de gauche tendent à s’éloigner" (16/01)
- Un jeu d’ombres et de fausses dupes (16/01)
- Houria Bouteldja : RÊVER ENSEMBLE (15/01)
- Mélenchon: Avant veille de censure (14/01)
- "La loi du mort-mélanine" - La chronique de Pierre-Emmanuel Barré dans "La dernière" (12/01)
- Pour l’arrêt des poursuites contre Abdourahmane Ridouane (12/01)
- Rosa Meyer-Leviné. Vie et mort d’un révolutionnaire (12/01)
- Un fascisme tardif ? Entretien avec Alberto Toscano (12/01)
La Commune de Paris, leçons de la première prise de pouvoir par le prolétariat

Pour l'anniversaire de la Commune de Paris de 1871, expérience centrale du mouvement ouvrier, nous republions un texte du 29 mai 2009.
Le 28 mai 1871 les dernières barricades de la Commune de Paris tombent. Le 30 mai, Marx signe La Guerre civile en France. C’est la première fois qu’il pose de manière aussi évidente la nécessité d’un État ouvrier transitoire.
Il est important aujourd’hui de tirer les leçons de la Commune de Paris. Dès son livre Le 18 brumaire de Louis Bonaparte, Marx avait commencé à comprendre la nécessité pour la classe ouvrière de détruire la machine de l’État bourgeois, marquant par là une avancée sur le Manifeste du Parti communiste qui, lui, ne posait pas encore la question d’un État ouvrier. Pour Marx, l’expérience de la Commune est la confirmation historique de ce qu’il avait conçu.
Nous allons tâcher, par ce compte-rendu de lecture, de montrer en quoi l’expérience de la Commune de Paris demeure aujourd’hui une expérience centrale du mouvement ouvrier. Elle a tout d’abord prouvé que les travailleurs étaient capables de diriger leur propre gouvernement : « De simples ouvriers, pour la première fois, osèrent toucher au privilège gouvernemental de leurs “supérieurs naturels", les possédants. » Mais elle a aussi et surtout montré de façon vivante que, pour y parvenir, les ouvriers ne pouvaient pas reprendre la machine de l’État bourgeois, mais devaient au contraire la détruire et construire leur propre État de transition vers le socialisme.
Le contexte
Le 19 juillet en 1870, Napoléon III déclare la guerre à la Prusse et moins de deux mois plus tard (le 2 septembre) l’armée française est défaite et Paris assiégé. L’empereur est fait prisonnier. Le gouvernement de Louis Napoléon Bonaparte a perdu toute crédibilité dans sa défaite face à la Prusse. Le 4 septembre, les ouvriers de Paris se soulèvent contre l’Empire. Les républicains bourgeois, si peu vindicatifs sous la dictature de Napoléon III, s’empressent de faire proclamer la République pour canaliser le mécontentement ouvrier et populaire dans le cadre du capitalisme. Selon la même logique, ils refusent de capituler face à la Prusse. Vu le nombre de soldats prisonniers, ils ne peuvent assurer la poursuite de la guerre et notamment défendre Paris sans armer les ouvriers. Ce simple changement de régime dans le cadre de l’État bourgeois s’accompagne donc de l’armement du peuple. Mais, une fois le peuple armé, il commence à être un danger pour la bourgeoisie toute entière.
Les hommes qui viennent de parvenir à la tête de cette nouvelle République vont donc avoir comme principal enjeu d’ôter le pouvoir au peuple, c’est-à-dire le priver de sa force de résistance, ses armes.
La défaite de la République et avec elle de la Révolution sera leur objectif, même s’ils doivent l’atteindre au prix de la capitulation pure et simple de la France face à la Prusse.
La bourgeosie se trouve alors divisée. La frange républicaine (à commencer par le « gouvernement de défense nationale » du 4 septembre) entend mener la « guerre à outrance » contre la Prusse. L’autre fraction, plus réactionnaire, entend, elle, mettre en oeuvre tout ce qui est en son pouvoir pour faire entrer les troupes prussiennes dans Paris afin de détruire la République. Mais pour ce faire, elle a besoin d’une nouvelle légitimité. Elle va donc organiser des élections. La France, dont plus d’un tiers est occupé par la Prusse et dont les départements sont entièrement coupés de la capitale, est dans un tel état qu’il aurait fallu prévoir des mois de campagne pour se donner les moyens d’élections véritablement démocratiques même d’un point de vue bourgeois. Avides d’une nouvelle légitimité qui leur est désormais vitale, Thiers et les autres « usurpateurs du 4 septembre » décident de les organiser en huit jours ! Le nouveau gouvernement aurait la seule tâche de « décider de la paix ou de la guerre ». L’assemblée élue est composée de 400 députés monarchistes sur près de 650. À une époque où la population est très largement rurale, ce vote s’explique par le poids des notables et des curés dans la paysannerie, mais également par le mot d’ordre de paix immédiate mis en avant par les monarchistes, qui représente l’aspiration d’une grande partie de la population, dont en particulier la bourgeoisie (de la petite à la grande) et la paysannerie.
À peine élue, l’assemblée nomme Thiers chef du gouvernement. Il vote le 28 janvier la capitulation de la France, via un « traité de paix » qui consiste à accepter toutes les concessions que demande Bismarck, y compris financières (annexion de l’Alsace-Moselle et versement de 5 milliards de francs-or).
Paris, déserté par la bourgeoisie et devenu essentiellement populaire et ouvrier, se tient alors sur le qui-vive. Se mettent en place des comités de vigilance animés par des révolutionnaires (membres de l’AIT donc « internationalistes », jacobins, blanquistes…) qui désignent le « comité central des vingt arrondissements », préconisant la guerre à outrance et un gouvernement démocratique et social. Une fédération de bataillons de la garde nationale se forme dans le peuple au moment des élections de février. La garde nationale élit un comité central pour assurer l’organisation.
« Paris en armes était le seul obstacle sérieux sur la route du complot contre-révolutionnaire. » Rendre les armes consisterait simplement pour les ouvriers de Paris à rendre le pouvoir à la bourgeoisie. Jugeant Paris assez affaibli après des mois de siège, Thiers ouvre donc la guerre civile en attaquant la nuit du 17 mars la garde nationale qui résiste héroïquement. Prenant ce courage des ouvriers pour un acte de faiblesse et de désespoir, il croit opportun d’envoyer le 18 mars ses troupes à Montmartre, en les chargeant de récupérer les canons aux mains de la classe ouvrière. Mais la bourgeoisie a alors entièrement sous-estimé la puissance de la classe ouvrière, qu’elle croit débile et sans défense. Les ouvriers et ouvrières de Paris se livrent alors spontanément à un combat d’un grand courage, et fraternisent avec nombre des soldats, qu’ils rallient à leur cause. Claude Lecomte et Clément Thomas, deux généraux, sont fusillés par l’armée mutinée.
Thiers et son gouvernement, suivis par des dizaines de milliers de Parisiens (des quartiers les plus chics), décident de s’installer à Versailles et comprennent qu’il leur faut constituer une nouvelle armée puisque l’armée bonapartiste est presque entièrement prisonnière de la Prusse. Ils engagent donc les 300 000 membres de la garde nationale à les rejoindre. Seuls 300 répondent positivement.

La naissance d’un État ouvrier
Si Marx avait déjà clairement dégagé que la tâche centrale du prolétariat était la conquête du pouvoir politique et l’avait inscrit au cœur du Manifeste et des statuts de l’A.I.T., il n’avait en revanche pas théorisé comment cela se ferait. S’il avait déjà posé l’idée générique de « dictature du prolétariat », il n’avait pas encore élaboré la forme concrète qu’elle prendrait, celle d’un État ouvrier. Il ne s’est donc pas agi de réaliser un projet longuement mûri et pensé. Les ouvriers ont commencé par imposer un changement de République, sans remettre l’État bourgeois en cause dans ses fondements. C’est en réaction à la totale défaillance de la bourgeoisie que la classe ouvrière a mis en place son propre État. Marx s’efforce de tirer les leçons des événements de la Commune et de la créativité révolutionnaire du prolétariat en précisant sa pensée sur la conquête du pouvoir politique : « La classe ouvrière ne peut pas se contenter de prendre tel quel l’appareil d’État et de le faire fonctionner pour son propre compte. » La classe dominante a mis en place des institutions pour répondre directement à ses besoins. Sa hiérarchie, son système d’élections, sa « séparation des pouvoirs », tous ces éléments sont là pour défendre ses intérêts. L’État bourgeois est lui-même le fruit de la lutte de classes qui a porté la bourgeoisie au pouvoir. Jamais cet État ne saurait être mis au service d’une autre classe.
Les ouvriers de la Commune comprennent cela quand ils déclarent, dans le manifeste du 18 mars du comité central :
« Les prolétaires de la capitale au milieu des défaillances et des trahisons des classes gouvernantes, ont compris que l’heure était arrivée pour eux de sauver la situation en prenant en main la direction des affaires publiques [...] Le prolétariat [...] a compris qu’il était de son devoir impérieux et de son droit absolu de prendre en main ses destinées, et d’en assurer le triomphe en s’emparant du pouvoir. »
Un État d’un nouveau type
« S’emparer du pouvoir » pour le prolétariat signifie qu’il cesse de compter sur les institutions en place, qu’il les détruit et qu’il crée les siennes propres.
Le premier décret de la Commune consiste à entériner le remplacement de l’armée permanente par des milices populaires : au lieu de prétendre « démocratiser » l’armée sans toucher à son essence, la Commune décide de dissoudre ce corps spécial composé d’hommes armés, instrument décisif de l’exploitation et de l’oppression de l’immense majorité au profit d’une infime minorité de capitalistes et de propriétaires fonciers ; elle lui oppose l’armement du peuple tout entier, seule garantie sérieuse de sa liberté et de la défense de ses intérêts de classe.
Ensuite elle décide que tous les membres du nouvel État (la police, les magistrats, etc.) soient élus, responsables et révocables à tout moment. C’est-à-dire qu’ils doivent rendre des comptes. Le comité central rend publique la moindre de ses décisions, la moindre de ses hésitations.
La Commune abolit également la séparation des pouvoirs. « La Commune devait être non pas un organisme parlementaire, mais un corps agissant, exécutif et législatif à la fois. » Pourquoi cette décision ? On apprend à l’école que l’un des critères de démocratie d’un régime est la séparation des pouvoirs. En fait, si l’on y regarde de plus près, cette prétendue « séparation des pouvoirs » consiste en réalité à faire élire par l’ensemble de la population des « moulins à parole » (Lénine) et à donner les tâches exécutives (c’est-à-dire réellement politiques) à une caste de fonctionnaires qui ne sont pas eux soumis au suffrage universel (hautes administration, magistrats, police, armée, etc.). Dans L’État et la Révolution, Lénine explique :
« Au parlementarisme vénal, pourri jusqu’à la moelle, de la société bourgeoise, la Commune substitue des organismes où la liberté d’opinion et de discussion ne dégénère pas en duperie, car les parlementaires doivent travailler eux-mêmes, appliquer eux-mêmes leurs lois, en vérifier eux-mêmes les effets, en répondre eux-mêmes directement devant leurs électeurs. Les organismes représentatifs demeurent, mais le parlementarisme comme système spécial, comme division du travail législatif et exécutif, comme situation privilégiée pour les députés, n’est plus. »
L’État cesse d’être une institution morale, qui se voudrait au-dessus des classes ; il devient un simple outil, et s’assume comme tel.
La Commune instaure aussi la séparation de l’Église et de l’État, les prêtres devant désormais vivre de l’aumône des fidèles, et non plus des subventions de l’État. De pair avec cette résolution, l’instruction devient gratuite, entièrement ouverte au peuple, et sans ingérence de l’Église. Elle met en place un moratoire sur les échéances des petits commerçants, la réquisition des logements vacants et la restitution gratuite d’objets déposés au mont-de-piété.
La Commune n’eut pas le temps d’étendre son modèle à la France entière, mais c’est bien sûr ce à quoi elle aspirait (il y a eu néanmoins des communes à Lyon, Marseille, Saint-Étienne, Narbonne, Toulouse). Elle publia un décret en ce sens, qui disait que son modèle devait être appliqué même au plus petit hameau en France.
« Les fonctions, peu nombreuses, mais importantes, qui restaient encore à un gouvernement central, ne devaient pas être supprimées, comme on l’a dit faussement, de propos délibéré, mais devaient être assurées par des fonctionnaires de la Commune, autrement dit strictement responsables. »
Nous y reviendrons plus loin, mais la Commune est en ce sens un modèle de centralisme, et non pas un exemple de fédéralisme, comme certains le prétendent.
Un État réellement démocratique
« L’unité de la nation [...] devait devenir une réalité par la destruction du pouvoir d’État qui prétendait être l’incarnation de cette unité, mais voulait être indépendant de la nation même, et supérieur à elle, alors qu’il n’en était qu’une excroissance parasitaire. Tandis qu’il importait d’amputer les organes purement répressifs de l’ancien pouvoir gouvernemental, ses fonctions légitimes devaient être arrachées à une autorité qui revendiquait une prééminence au-dessus de la société elle-même, et rendues aux serviteurs responsables de la société. »
L’idéologie bourgeoise tend à faire croire que l’État serait une entité neutre, garante d’intérêts fondamentaux de l’Homme, qu’il planerait au-dessus des intérêts de classe et même de la société en général. Il n’en est rien. L’État est essentiellement un organe de domination d’une classe sur une autre. Les prolétaires de la Commune eux n’ont jamais nié que l’État qu’ils mettaient en place devait servir leurs intérêts contre ceux de l’ancienne classe dominante. Il était donc normal que les membres de cet État doivent rendre des comptes, pour que l’on s’assure des intérêts qu’ils servent.
« La Commune ne prétendait pas à l’infaillibilité, ce que font sans exception tous les gouvernements du type ancien. Elle publiait tous ses actes et ses paroles, elle mettait le public au courant de toutes ses imperfections. »
On le voit bien, les ouvriers de la Commune n’ont pas agi en idéalistes indomptables, comptant sur la seule honnêteté de l’être humain, comme on caricature bien souvent les communistes. Ils ont simplement mis en place un État à même de servir leurs intérêts. Personne n’a alors parlé de faire confiance aux ouvriers qu’on élisait, parce qu’ils étaient « bons » par nature. Bien au contraire, la Commune a tout de suite mis en place une structure qui rende chacun responsable, notamment en faisant de chaque membre de l’administration une personne révocable et sous mandat, chargée de rendre des comptes. La Commune se gardait bien de compter sur la « nature humaine », en se berçant d’illusions sur la bonté naturelle de l’humain.
Des avancées internationalistes et féministes
À l’époque, les Allemands sont stigmatisés et victimes d’une xénophobie exacerbée par la guerre. La Commune de Paris n’hésite pourtant pas à nommer un ouvrier allemand comme ministre (« Le drapeau de la Commune est celui de la République universelle »). Dans un État où la classe dominante n’a plus besoin d’exacerber le sentiment national pour faire avaler des couleuvres à la population, le racisme et la xénophobie finissent par disparaître. De même l’oppression des femmes tend à s’amenuiser. Les femmes ont joué un rôle central lors de la Commune de Paris : la classe ouvrière avait davantage d’intérêts à ce que les femmes soient sur les barricades plutôt qu’elles ne demeurent à s’occuper du foyer et des enfants, rôle auquel la bourgeoisie les avait cantonnées. Enfin les vols et les agressions avaient presque disparu et ne revinrent qu’avec le retour des Versaillais.
Classe ouvrière et « classe moyenne »
Marx insiste sur la centralité de la classe ouvrière et il explique comment elle peut sur la base de son propre programme politique s’allier la paysannerie et les « classes moyennes » de la ville (boutiquiers, commerçants, négociants).
Par son rôle dans la production, la classe ouvrière est la seule à avoir des intérêts entièrement antagonistes à ceux de la bourgeoisie. C’est la seule classe qui peut être capable d’arracher le pouvoir à la classe dominante. La petite-bourgeoisie, classe de petits propriétaires, est foncièrement attachée à la propriété privée des moyens de production. Cependant, en tant que petits propriétaires, ils subissent le fardeau du capitalisme toujours avantageux aux grands propriétaires des moyens de production. Mais, en raison à la fois de leur caractère de propriétaires de leurs moyens de production et de leur dispersion, ils sont incapables de se forger une conscience de classe propre : ils ne peuvent qu’osciller entre les deux classes sociales fondamentales, la bourgeoisie et le prolétariat. Dans son chemin vers la victoire, la classe ouvrière doit faire de toutes les classes intermédiaires ses alliées. Cette union a commencé à se réaliser lors de la Commune, où les ouvriers de Paris étaient en train de gagner le soutien de la paysannerie et de la petite-bourgeoisie, avant que le gouvernement de Versailles ne parvienne à isoler Paris.
En 1848, ces classes intermédiaires se sont alliées à la bourgeoisie pour défaire la classe ouvrière qui se révoltait. Ils ont élu Louis Napoléon Bonaparte. Mais il n’a pas tenu le programme dans lequel les classes intermédiaires avaient foi : l’éducation avait été remise aux mains des prêtres ; la guerre contre la Prusse avait ruiné et humilié la France ; en outre, les paysans se trouvaient imposés pour financer les frais de cette guerre dont ils ne voulaient pas. La Commune, quant à elle, a décrété que devaient payer les frais de la guerre ceux qui l’avaient engendrée, et donc supprima son impôt à la paysannerie. Ce type de mesures concrètes, de même que la séparation de l’Église et de l’État, qui impliquait que le paysan n’avait plus à payer pour entretenir le prêtre, ont pu faire dire avec raison à la Commune s’adressant aux paysans : « notre victoire est votre seule espérance ».
Pour essayer de nous faire croire que les idées de Marx et le marxisme seraient dépassées, on nous raconte aujourd’hui qu’à l’époque où Marx écrivait, tout était plus simple : il n’y aurait eu que deux classes sociales, le prolétariat et la bourgeoisie. Les choses seraient devenues beaucoup plus complexes aujourd’hui avec le « développement de la classe moyenne ». Cette simplification extrême conduit à la conclusion que l’analyse de classes n’est plus d’actualité, que le monde a changé. Certes le monde a changé, mais il y avait bien à l’époque déjà une classe moyenne (créanciers, petits commerçants, etc.) et une paysannerie. La problématique de leur ralliement à la Révolution se posait déjà. Ce que dit Marx, ce n’est pas qu’il n’y a que des prolétaires et des bourgeois : il explique simplement que la société est dominée par la bourgeoisie, et que la seule classe qui soit capable de prendre le pouvoir et de construire une société nouvelle, débarrassée de l’exploitation et de l’oppression (c’est-à-dire de faire la Révolution) est la classe ouvrière. Quand la paysannerie ou la petite-bourgeoisie tentent de prendre la tête d’une révolution, ils ne peuvent en fait s’en remettre qu’aux intérêts de l’une ou de l’autre des deux grandes classes antagonistes. En 1848, ces classes intermédiaires s’étaient ralliées à la bourgeoisie ; en voyant que cette dernière a trahi leurs intérêts, elles tendent à se rallier en 1871 aux ouvriers de Paris. Il n’y a que la classe ouvrière qui peut poser dans sa lutte la question du pouvoir. Les classes intermédiaires, quant à elles, se posent la question d’un changement de régime, mais pas de leur propre gouvernement.
La guerre civile finit par avoir raison de la Commune
Les Versaillais ont d’ailleurs fini par prendre conscience de la nécessité de couper Paris du reste de la France. Ils prirent la décision d’organiser de nouvelles élections pour tenter d’isoler Paris encore plus qu’ils ne le faisaient déjà (en plus de l’état de siège, le gouvernement réfugié à Versailles veillait à ce que la presse de la Commune, ses décrets, ses décisions, ne parviennent pas au reste la France). Malgré toutes les précautions et leurs promesses (ô combien mensongères) d’être cléments envers Paris et de ne jamais les réprimer dans le sang, les Versaillais perdent les élections (orléanistes et bonapartistes réunis obtinrent 8 000 conseillers municipaux sur 700 000).
Face à cet échec cuisant, il ne restait plus aux Versaillais qu’à s’en remettre à la Prusse pour venir à bout par la force de la Commune de Paris. « La domination de classe ne peut plus se cacher sous un uniforme national, les gouvernements nationaux ne font qu’un contre le prolétariat ! » On envoya deux émissaires discuter avec Bismarck : la France paierait ses dettes plus rapidement, en échange de quoi Bismarck acceptait de libérer l’armée bonapartiste, c’est-à-dire de donner une armée aux Versaillais pour exterminer Paris. Le 18 mai, ce « traité de paix » avec la Prusse est ratifié par l’Assemblée nationale siégeant à Versailles et le 22, Thiers annonce à l’Assemblée : « L’ordre, la justice, la civilisation ont enfin remporté la victoire ».
Les Communards combattirent avec un courage héroïque, tenant près de 500 barricades, dont les dernières tombèrent huit jours plus tard. 30 000 morts dont au moins 20 000 prisonniers fusillés sans jugement, 36 000 prisonniers, 10 000 condamnés, des communards tués à la baïonnette dans leur sommeil… Telle fut la victoire de « l’ordre, la justice et la civilisation » : « la sauvagerie sans masque et la vengeance sans loi » (Marx).
Quelles leçons pour le mouvement ouvrier aujourd’hui ?
La bourgeoisie n’est pas expropriée
La principale limite de ce gouvernement ouvrier est qu’il ne se pose pas la question de l’expropriation de la bourgeoisie. Contrairement aux révolutions du XXe siècle, et principalement à la Révolution russe, la Commune de Paris ne fait pas suite à une grève générale. Le processus révolutionnaire ne naît donc pas dans un contexte de remise en question de la propriété privée capitaliste. C’est face à la défaillance du gouvernement bourgeois que les ouvriers décident de mettre en place leur propre gouvernement. Ils le font en outre en s’alliant avec des bourgeois républicains (« de gauche »), qui eux n’ont pas pour objectif l’émancipation de la classe ouvrière.
Lors des élections, la fraction la plus réactionnaire de la bourgeoisie est vaincue, mais ces élections ne représentent pas pour autant une victoire proprement ouvrière. À cette époque, la classe ouvrière n’a pas en France de parti qui la représente et qui défende ses intérêts. Cela explique entre autres éléments les limites de ce gouvernement ouvrier.
Les illusions petites-bourgeoises d’une révolution qui ne soit pas une guerre civile
Le comité central a commis la funeste erreur de ne pas marcher sur Versailles quand cela lui était encore possible. Cette décision reflétait l’illusion typiquement petite-bourgeoise selon laquelle la révolution pouvait se faire en trouvant un compromis pacifique avec la bourgeoisie. C’était au fond la négation de la réalité de la lutte de classes, car la logique de cette dernière est que la bourgeoisie luttera jusqu’au bout et par tous les moyens pour préserver son pouvoir et ses profits. Il dit aux Versaillais qu’il rendrait « œil pour œil, dent pour dent », mais n’en fit rien. Dès que les ennemis s’en rendirent compte, ils reprirent les tortures et les exécutions qu’ils avaient interrompues par peur de la menace. Quand ils virent qu’ils pouvaient entrer dans Paris en dissimulant des armes, et pris sur le vif de leur trahison, étaient relâchés par les ouvriers de Paris qui ne voulaient pas s’adonner à cette basse besogne répressive, alors rien n’arrêta plus leur cruauté. La Commune abattit pourtant un général (suite à la mutinerie de ses soldats qui refusaient de tirer sur la foule comme on le leur ordonnait) ainsi que 64 otages, dont l’archevêque de Paris. Mais la valeur symbolique de cette exécution arrangea bien les affaires de la bourgeoisie. Elle exacerba l’événement pour faire des Communards d’infâmes assassins. La seule libération de Blanqui aurait délivré tous ces otages, mais les Versaillais préféraient largement sacrifier un évêque plutôt que de rendre un dirigeant ouvrier tel que Blanqui.
Par ce rappel de l’indulgence des Communards, nous n’entendons pas faire une apologie du pacifisme. Au contraire, il s’agit de comprendre, par l’expérience historique, l’illusion qui consiste à croire que la révolution n’impliquerait pas une guerre civile entre le prolétariat et ses alliés contre la bourgeoisie et les siens. Si le prolétariat n’a pas une claire conscience de cela, il sera toujours et partout vaincu. Les conséquences furent tout simplement l’écrasement de cette Révolution ouvrière qui commençait. Si les Versaillais avaient été éliminés avant qu’ils ne constituent une armée, l’issue aurait pu être tout autre.
La nécessité d’un État ouvrier
Que signifie historiquement la création d’un État ouvrier ? L’expérience de la Commune revêt deux aspects fondamentaux. Il dit aux réformistes de tout poil : non, l’État bourgeois ne peut pas être mis au service de la classe ouvrière, celle-ci a besoin de son propre État ; pour cela, elle doit d’abord détruire le vieil État, machine au service de la bourgeoisie. Mais il dit à la fois aux anarchistes : non, tant que les classes sociales n’auront pas disparu, l’État ne pourra pas disparaître ; État bourgeois ou État ouvrier, dictature du capital ou dictature du prolétariat, telle est l’alternative ; refuser l’institution d’un État ouvrier, c’est se condamner à laisser exister ou se reconstituer l’État bourgeois, c’est tout simplement renoncer à la révolution.
Pourtant beaucoup de militants anarchistes revendiquent l’héritage de la Commune. Or il n’était pas davantage possible pour les ouvriers de Paris de se passer d’un État que de faire marcher l’État bourgeois à leur service. Les tâches de coordination et d’organisation d’un État demeuraient nécessaires. Lénine l’explique : « Nous ne sommes pas des utopistes. Nous ne "rêvons" pas de nous passer d’emblée de toute administration, de toute subordination ; ces rêves anarchistes, fondés sur l’incompréhension des tâches qui incombent à la dictature du prolétariat, sont foncièrement étrangers au marxisme et ne servent en réalité qu’à différer la révolution socialiste jusqu’au jour où les hommes auront changé. Nous, nous voulons la révolution socialiste avec les hommes tels qu’ils sont aujourd’hui, et qui ne se passeront pas de subordination, de contrôle, “de surveillants et de comptables". ».
Quand les ouvriers déclarent la Commune libre de Paris en 1871, ils cherchent spontanément la meilleure forme d’organisation possible, celle qui leur permettra de lutter contre la bourgeoisie qui les livre à l’armée prussienne, mais également de fonctionner entre eux. Ils mettent donc en place tout ce que nous avons décrit plus haut (juges révocables, milices armées, comité central, etc.) et que nous appelons un « État ouvrier ». Un « semi-État », précisera Lénine, puisqu’il s’agit d’un État temporaire voué à dépérir, dans la mesure où il a pour but la destruction de la base même de l’État, la division de la société en classes sociales aux intérêts antagonistes. L’État ouvrier, en contribuant à la lutte contre les exploiteurs, à l’extension internationale de la révolution, à l’appropriation sociale des moyens de production et à la réorganisation de la production sous la direction des travailleurs eux-mêmes, sape ainsi lui-même sa propre base. Mais ce sera tout de même un État, au service du prolétariat, dans la mesure où la victoire de la révolution, qui plus est dans un seul pays, ne met pas fin à la division de la société en classes et par conséquent à la lutte de classes.
Cet outil, puisqu’il s’agit bien de ça, se doit d’avoir un pouvoir centralisé. Jamais la Commune n’a promu le modèle du fédéralisme.
La Commune et la dictature du prolétariat
Pourtant, nous dira-t-on, le comité central a bien organisé des élections au suffrage universel dans Paris. Ce fait tend à contredire l’idée qu’une « dictature du prolétariat » se mettait en place : sociaux-démocrates et anarchistes se servent de cet argument pour remettre en question la centralité ouvrière, puisque même la Commune aurait mis tous les « êtres humains » sur le même plan. Nous l’avons dit plus haut, le Paris où s’organisent ces élections est un Paris ouvrier, déserté par la bourgeoisie dans son ensemble. Non seulement ses dirigeants sont réfugiés à Versailles mais encore ce sont des dizaines de milliers de bourgeois qui fuient la guerre et les ouvriers qui s’y sont réfugiés. La Commune aurait peut-être réfléchi à deux fois avant de consulter la bourgeoisie sur la manière de s’émanciper.
La nécessité d’un parti révolutionnaire
Enfin, il a manqué au prolétariat un authentique parti révolutionnaire. Les efforts déployés par Marx et Engels pour la constitution de la classe ouvrière en un grand parti des travailleurs, en particulier la fondation en 1864 de la Ière Internationale ou Association Internationale des Travailleurs, avaient certes contribué à avancer vers un tel objectif. Cependant, l’organisation politique de la classe ouvrière restait à cette époque encore trop embryonnaire pour lui permettre de renverser durablement la bourgeoisie. En France, c’était encore les proudhoniens, c’est-à-dire une des variétés de l’anarchisme, fondamentalement crypto-réformiste, et les blanquistes, parti consciemment prolétarien, mais croyant pouvoir substituer l’action d’une minorité à l’action de la classe sous la direction de son avant-garde, qui dominaient. Les militants de l’A.I.T. se reconnaissant d’une façon générale dans les idées de Marx et d’Engels étaient non seulement peu nombreux, mais surtout même pas encore réellement organisés en parti politique au sens étroit du terme. C’est précisément le mérite des bolcheviks, sous l’impulsion de Lénine, d’avoir su non seulement se consacrer de façon patiente à la construction d’une telle organisation révolutionnaire solide avant que la révolution n’éclate, mais aussi d’avoir su, lors de la révolution de 1917, mener une politique montrant qu’ils avaient tiré à la fois dans la théorie, mais aussi dans la pratique, les leçons de la défaite de la Commune.





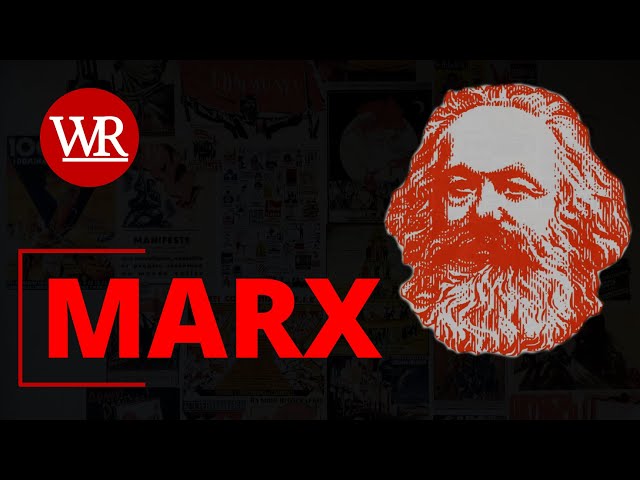

.jpg)
