Agenda militant
Ailleurs sur le Web
![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)
- Où va l’impérialisme allemand ? (05/01)
- L’économie mondiale en 2025 : année folle ou année tiède ? Par Michael Roberts (05/01)
- Ukraine : emprunter le douloureux chemin vers la paix (05/01)
- Où en sont les « socialistes » aux États-Unis ? (05/01)
- Pour gagner, la gauche doit-elle en revenir aux partis de masse ? (05/01)
- Narcotrafic : Darmanin et Delogu ne peuvent pas SE SNIFFER (05/01)
- Alma Dufour sur France Info (05/01)
- Diyarbakır : reconstruire une municipalité en ruines (28/12)
- Le marxisme aux paysans (28/12)
- Aux origines du socialisme japonais (28/12)
- Sauvons Kobané, sauvons le Rojava ! (28/12)
- Quelles perspectives pour les Kurdes au Moyen-Orient ? (27/12)
- Cuba : le mouvement du social (27/12)
- Procès de Georges Ibrahim Abdallah : la victoire est-elle proche ? (26/12)
- Île Maurice : la volonté de changement (26/12)
- Le socialisme dans un seul pays (26/12)
- Quel avenir pour la France insoumise ? (26/12)
- Les changements tectoniques dans les relations mondiales provoquent des explosions volcaniques (26/12)
- Un nouveau château de cartes (26/12)
- Le syndicalisme de Charles Piaget (26/12)
- Nabil Salih, Retour à Bagdad (26/12)
- La Syrie est-elle entre les mains d’Erdoğan ? (26/12)
- L’UE encourage l’exploitation du lithium en Serbie avec un grand cynisme (26/12)
- Le contrôle territorial d’Israël s’étend-il vers la Syrie ? (26/12)
- Scrutin TPE – Très Petite Élection (26/12)
La révolution allemande et ses enseignements (1918-1923)
Les enseignements à tirer de la révolution allemande et de son échec sont nombreux et riches de sens pour les militants révolutionnaires aujourd’hui. Ils concernent au premier chef les modalités de la trahison sociale-démocrate, aujourd’hui arrivée à son point de parachèvement. Ils portent aussi, fondamentalement, sur la question du pouvoir, et les stratégies adoptées pour le conquérir. Enfin, ils indiquent la nécessité vitale de l’organisation, sous la forme de la construction d’un parti prolétarien indépendant.
L’Allemagne et le parti social-démocrate au début du siècle
À la fin du XIXe siècle et au début du siècle suivant, l’Allemagne réunit toutes les caractéristiques d’une société prête au socialisme : sa population compte une majorité écrasante d’ouvriers ; cette population ouvrière se trouve regroupée dans de grandes villes et centres industriels ; l’économie elle-même est très concentrée sous la forme de grandes entreprises, trusts ou cartels. Le parti social-démocrate est une organisation extrêmement puissante, sorte d’État dans l’État, disposant de journaux, revues, associations diverses. Mais, par sa composition sociale, ce parti montre certaines faiblesses, qui seront sans doute décisives par la suite : 10% des adhérents sont des travailleurs non-salariés, éléments petits-bourgeois auxquels le parti ne manque pas de faire des concessions pour des raisons électorales, et une grande majorité des adhérents est issue de l’aristocratie ouvrière, dans laquelle le dirigeant Pankoek voit alors une couche privilégiée, source principale d’un certain opportunisme dans le parti. En outre, le Reich souffre d’un archaïsme politique par rapport à ses voisins, à commencer par la France, en République depuis plusieurs décennies. Bismarck et ses successeurs s’appuient sur cet archaïsme pour concéder des droits sociaux face à la pression du mouvement ouvrier. La bourgeoisie allemande, notamment dans les organisations religieuses, tente d’agiter le sentiment nationaliste parmi les masses, pour faire obstacle à la lutte de classes. Cette volonté de réconcilier le prolétariat avec le Reich, s’appuyant sur une idéologie chauvine, trouve son apogée lorsqu’éclate la Première Guerre mondiale.
1914 : trahison du SPD, résistance de Karl Liebknecht
La guerre impérialiste déclenchée en 1914 voit les dirigeants sociaux-démocrates désemparés, surpris dans leur routine, incapables d’organiser une mobilisation, et craignant l’entrée dans la clandestinité. Par peur de la répression, tous se rallient à l’Union sacrée, comme en France. La pression des couches privilégiées dans le parti se fait alors grandement sentir (1). Les travailleurs qui tenteraient de s’opposer à la boucherie impérialiste sont isolés ; bien loin d’être soutenus par leurs dirigeants, ils sont réprimés dans leur propre parti. Karl Liebknecht vote seul contre les crédits de guerre au Bundestag, le Parlement allemand, le 3 décembre 1914. Mobilisé et envoyé sur le front, il y organise la résistance, par la diffusion massive de tracts, proclamant l’union des travailleurs contre leurs gouvernements impérialistes, avec ce mot d’ordre : « L’ennemi principal est dans notre propre pays. »
1917-1918 : le prolétariat relève la tête, le SPD entre au gouvernement bourgeois
Mais la lutte des travailleurs contre la guerre s’organise, et un véritable mouvement révolutionnaire émerge à partir d’avril 1917, notamment chez les marins qui se livrent à un héroïque combat, violemment réprimé. Les opposants de gauche du parti socialiste, exclus du parti en 1917 pour leur combat révolutionnaire (Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Karl Radek entre autres) diffusent par avions des milliers de tracts reproduisant l’appel à la paix du gouvernement soviétique : la Révolution russe représente un immense espoir pour les travailleurs allemands. De grandes grèves ont lieu dans tout le pays entre avril 1917 et janvier 1918, mais l’un des principaux dirigeants sociaux-démocrates, Ebert, proclame que le devoir des travailleurs allemands est de combattre sur le front contre les Français et condamne les grèves. Pour contenir le mouvement révolutionnaire, la bourgeoisie fait d’ailleurs appel à des sociaux-démocrates, dont Ebert, pour constituer un gouvernement de coalition : la trahison du parti social-démocrate, commencée en 1914 avec l’Union sacrée dans la guerre impérialiste, des millions de travailleurs étant ainsi envoyés à la tuerie pour la défense des intérêts de la bourgeoisie, trouve là un premier apogée. Dès lors, cette trahison se reproduira d’étape en étape dans l’histoire de la Révolution allemande. Lénine en a déjà conclu que les militants ouvriers révolutionnaires doivent rompre avec le SPD traître, et constituer un nouveau parti communiste révolutionnaire Non sans hésitations, Rosa Luxemburg et ses camarades constituent le groupe Spartakus, mais restent au sein de l’USPD, le parti socialiste unifié, né d’une scission de gauche du SPD, mais dirigé par les centristes et les social-pacifistes.
Novembre 1918 : révolution et nouvelles trahisons du SPD
En 1918, la révolution allemande a commencé. Elle prend la forme de conseils d’ouvriers et de soldats, sur le modèle des soviets en Russie, organisés par entreprises ou par quartiers. À Berlin, le 9 novembre 1918, les drapeaux rouges couvrent la ville, et Karl Liebknecht proclame la « République socialiste allemande ». Mais la bourgeoise allemande et les sociaux-démocrates tentent de lutter contre la démocratie des conseils qui se met ainsi en place, en brandissant le mot d’ordre d’Assemblée constituante, élue au suffrage universel. Ce mot d’ordre est, en la circonstance, sciemment contre-révolutionnaire : sous prétexte de « défendre la démocratie », c’est-à-dire la démocratie bourgeoise, qui s’exprimerait par les urnes, il vise à mettre bas le pouvoir des conseils ouvriers, dont les membres sont élus à tous les niveaux, mandatés et révocables. Ainsi, la bourgeoisie allemande, plus vigoureuse qu’en Russie, et qui dispose d’une armée puissante, sait qu’elle peut compter sur les sociaux-démocrates et sur les appareil des syndicats pour parvenir à ses fins. Comme dans toute situation révolutionnaire, les classes dirigeantes sont contraintes d’octroyer des concessions sociales pour ne pas perdre leur pouvoir, pour ne pas être emportées par la vague révolutionnaire : le patronat allemand signe donc un accord avec les responsables syndicaux, instaurant notamment la journée de huit heures.
Début 1919 : création tardive du parti communiste, participation du SPD à la répression dans le sang de la révolution
Les militants ouvriers, dans ces circonstances révolutionnaires, décident enfin, au début de l’année 1919, de fonder le KPD, le parti communiste allemand, conscients de la nécessité de créer un nouveau parti révolutionnaire. Sans doute auront-ils trop tardé à le faire, Rosa Luxemburg ayant longuement hésité à quitter son parti d’origine : pour elle, dans ce parti, il y avait les masses, il devait donc être possible de le redresser de l’intérieur, en luttant contre son appareil traître. Cependant, R. Luxemburg et ses camarades sont bien évidemment de toutes les luttes, pour le pouvoir aux conseils, contre les manœuvres de la social-démocratie. Ils décident d’occuper le siège du journal tenu par le SPD, le Vorwärts. À la suite de cette action, R. Luxemburg et K. Liebknecht sont arrêtés par les militaires, les corps francs, et abattus ; leurs corps sont jetés dans la rivière berlinoise, la Spree. Nous sommes en janvier 1919. Deux mois plus tard, le gouvernement du « socialiste » Noske lancent les corps francs sur Berlin, qui écrasent la révolution allemande et les conseils ouvriers. La première phase de la révolution s’achève, dans l’échec et le sang.
Cette première partie de la révolution, un temps victorieuse, a montré la nécessité, pour que le prolétariat prenne le pouvoir, qu’il s’organise en conseils, centres de la démocratie ouvrière, contre la prétendue « démocratie » réclamée par la bourgeoisie, les dirigeants traîtres du SPD et les centristes. Elle montre aussi, dans ses revers, le manque cruel d’une organisation révolutionnaire indépendante qui ne soit pas trop tardivement constituée, la nécessité d’un parti puissant à même d’aider le prolétariat à prendre conscience de ses propres forces révolutionnaires, à rompre avec les dirigeants traîtres sociaux-démocrates et à exiger : « Tout le pouvoir aux soviets ». Ce sont là autant d’enseignements à méditer aujourd’hui pour la construction du parti communiste révolutionnaire internationaliste et pour l’aide à l’élaboration des revendications du prolétariat, qui ne doit jamais compter que sur sa propre organisation indépendante.
L’écrasement du putsch Kapp par la mobilisation ouvrière
Celle-ci est à nouveau éclatante en mars 1920, lors du putsch de Kapp, représentant des grands propriétaires fonciers, les Junkers. Le premier réflexe du gouvernement fédéral de Berlin, dirigé par le social-démocrate Noske, est de prendre la fuite. En revanche, face à la lâcheté de ce gouvernement bourgeois incapable de défendre sa propre République encore toute jeune, les masses ouvrières organisent leur propre résistance, dans un mouvement de masse contre les putschistes, grâce notamment à la mise en place de milices ouvrières armées. Cette mobilisation ouvrière, fondée sur la grève générale, écrase le putsch en quelques jours. C’est un discrédit complet pour la direction sociale-démocrate. Le mouvement a montré l’importance d’un front commun de militants de différentes organisations ouvrières. L’action s’achève par une négociation entre le gouvernement social-démocrate et les directions syndicales pour la reprise du travail, sous diverses conditions, parmi lesquelles le départ de Noske, l’épuration des administrations et des entreprises de tous les contre-révolutionnaires, l’application des lois sociales en vigueur. Le gouvernement, s’appuyant sur l’armée, parvient à établir le retour « à l’ordre », bien que des assemblées ouvrières, dans les usines, aient pris position contre les décisions des centrales syndicales. L’événement démontre la force d’une action politique organisée, sous la forme de comités d’action, formés par les partis et les syndicats ouvriers, comités qui représentent alors un véritable pouvoir démocratique-révolutionnaire, et posent donc concrètement la question de la prise du pouvoir. Mais l’attentisme et la passivité de la direction du jeune parti communiste lors de cette mobilisation donnent lieu à une scission « gauchiste » et la constitution du K.A.P.D., le parti communiste allemand des travailleurs.
Le « gauchisme »
Un courant « gauchiste » traverse en effet l’Europe à cette époque, incarné notamment par Panekoek (Hollande), Bela Kun (Hongrie), Bordiga (Italie). Ces « communistes de gauche » ou « gauchistes » opposent abstraitement les masses ouvrières à leurs chefs, contestent la nécessité de construire un parti ouvrier de masse, qui conduirait selon eux de toute éternité à une attitude opportuniste, et appellent à sortir des syndicats réformistes et à lutter pour la construction de « syndicats révolutionnaires » minoritaires. Au contraire, le deuxième Congrès de l’Internationale communiste, dans la définition des « vingt-et-une conditions » d’adhésion à l’I.C., insiste sur la nécessité de réaliser un travail actif dans les syndicats, et d’utiliser les parlements bourgeois comme tribunes. Lénine appelle les communistes allemands à être présents partout où se trouve la classe ouvrière : « Il faut, écrit-il, faire en sorte que le parti prenne part aussi aux parlements bourgeois, aux syndicats réactionnaires, aux conseils d’usine, mutilés, châtrés par les Scheidemann [dirigeant social-démocrate], partout où il y a des ouvriers, influer sur la masse ouvrière ». Pour Lénine, qui rédige alors Le gauchisme, maladie infantile du communisme, il s’agit de lutter, au sein même des syndicats, qui organisent la masse des travailleurs conscients, contre les dirigeants opportunistes et traîtres, au lieu de baisser les bras et d’abandonner les organisations ouvrières à l’emprise de leurs dirigeants réformistes.
L’action de mars 1921
En raison de la lâcheté des dirigeants du parti social-démocrate face au putsch de Kapp, le KPD est sorti renforcé de l’aventure. Toute une aile gauche du parti social-démocrate indépendant (USPD, centriste) le rejoint. En 1920, Le parti compte des centaines de milliers d’adhérents, des écoles, une trentaine de journaux. Ses membres sont dans leur écrasante majorité (à 90 %) des ouvriers, souvent jeunes, actifs et dévoués à la cause du prolétariat. Les dirigeants du parti sont élus, mandatés et révocables, les permanents ne sont jamais en majorité dans les instances de l’exécutif.
Cependant, les dirigeants du KPD, (à l’exception de Paul Levi qui condamnera, de sa prison, cette stratégie), tentent de déployer une tactique offensive, volontariste, pour faire surgir la vague révolutionnaire dont ils croient voir les prodromes dans la résistance spontanée des ouvriers au putsch de Kapp. L’initiative vient entre autres du crypto-gauchiste Bela Kun, président de l’exécutif de l’Internationale en mission en Allemagne. C’est « l’action de mars » 1921. Il s’agit de se porter à tout prix à l’assaut du pouvoir, par tous les moyens, y compris en essayant de décréter la grève générale. Les erreurs les plus graves sont alors commises dans le déploiement de cette stratégie offensive qui se coupe peu à peu des masses. L’énorme majorité des travailleurs non communistes, qui ne suivent pas les mouvements de grève ainsi provoqués, sont qualifiés de « jaunes » par les dirigeants du parti. Le parti communiste perd alors 200 000 membres en quelques semaines. La répression s’abat. Des dizaines de milliers de grévistes sont licenciés et placés sur les listes noires du patronat, ou encore condamnés à de lourdes peines de prison. Ce cuisant échec montre que les actions révolutionnaires ne peuvent être menées par le parti sans la conquête patiente et opiniâtre des masses, qu’elles ne peuvent être portées par le prolétariat, aidé et organisé par et dans le parti. Lénine avait écrit, dans Les bolcheviks garderont-ils le pouvoir ?, que l’insurrection avait besoin : 1) du développement de la révolution à l’échelle nationale ; 2) d’une faillite morale et politique complète de l’ancien gouvernement ; 3) de grandes hésitations dans le camp des éléments intermédiaires. Or, manifestement, ces conditions n’étaient pas réunies en mars 1921 en Allemagne, et les communistes allemands apprennent alors, à leurs dépens, que le volontarisme coupé des masses ne peut l’impuissance, et que leur responsabilité est d’abord de se construire comme parti partiemment, opiniâtrement, au sein du prolétariat tel qu’il est dans telle ou telle situation, et non tel qu’on voudrait qu’il soit…
Gouvernement ouvrier et mots d’ordre de transition
L’échec de l’action de mars confiorme et accélère le reflux général de la vague révolutionnaire de l’après-guerre en Europe. À partir de 1921-1922, sous l’impuslion de l’I.C., pour conquérir les masses, dont la majorité est restée sous l’influence social-démocrate, notamment en Allemagne, les militants révolutionnaires réfléchissent pour la première fois au problème d’un programme de transition (adapté à des conditions non révolutionnaires) et au mot d’ordre de gouvernement ouvrier. Celui-ci diffère de la dictature du prolétariat (gouvernement des conseils), il n’est qu’une étape vers la dictature du prolétariat ; il désigne la coalition gouvernementale de partis ouvriers, incluant les partis-ouvriers dirigées par l’appareils social-démocrate, mais sans participation de ministres issus des partis bourgeois. « Il serait faux de dire, remarque avec humour le dirigeant communiste Karl Radek, que l’évolution de l’homme, du singe au commissaire du peuple, doit passer par la phase de ministre du gouvernement ouvrier. Mais cette variante est possible ». Le mot d’ordre de « gouvernement ouvrier » détermine la stratégie du front unique, c’est-à-dire de l’alliance, sur des bases claires et un programme précis, des organisations ouvrières. Il s’accompagne de revendications transitoires : participation majoritaire de l’État contrôlé par les organisations ouvrières à toutes les entreprises ; contrôle ouvrier sur l’industrie par la mise en place de comités d’usine ; levée du secret des banques, du secret de fabrication, du secret commercial ; monopole de l’État sur le commerce extérieur, le ravitaillement et le secteur bancaire… Une nouvelle période s’ouvre dès lors dans la stratégie des partis communistes révolutionnaires.
L’occupation de la Ruhr et la crise économique
Au début de l’année 1923, les troupes françaises, sur ordre de Poincaré, viennent occuper la région de la Ruhr, bassin industriel essentiel à l’économie allemande, sous prétexte de faire payer à l’Allemagne les « réparations » de guerre. Aussitôt, le parti communiste allemand appelle les travailleurs à lutter sur deux fronts : contre l’impérialisme français, mais aussi contre leur propre bourgeoisie, qui les abuse en essayant de détourner leur lutte ; il s’agit d’arracher la classe ouvrière allemande au nationalisme que le gouvernement tente de lui instiller pour mieux lui faire oublier ses intérêts de classe. On se souvient que, déjà, dans les années qui précédèrent la Première Guerre mondiale, la bourgeoisie allemande avait à toutes forces cherché à allumer une flamme nationaliste et chauvine chez les ouvriers allemands, afin de leur faire croire que leur espoir et leur salut se trouvaient dans le Reich et non dans leur lutte de classe internationaliste. En 1923, les ouvriers ont conscience que ce ne serait pas leur propre cause qu’ils défendraient en se déclarant solidaires de leurs patrons. La misère et le chômage règnent, l’inflation s’accroît dans des proportions gigantesques, et elle devient terrible avec l’occupation. En mai 1923 éclate une grève sauvage, spontanée, à l’occasion d’une nouvelle et brusque flambée des prix. La bourgeoisie allemande montre alors clairement sa duplicité, en s’adressant au gouvernement français pour que ses troupes d’occupation l’aident à réprimer la grève, un haut fonctionnaire allemand rappelant par exemple à un général français que, « lors du soulèvement de la Commune de Paris, le commandement allemand alla de son mieux au devant des besoins des autorités françaises agissant en vue de la répression ». Le cynisme ainsi affiché montre de manière éclatante l’alliance de classe des bourgeoisies nationales, par-delà les concurrences interimpérialistes, dès que leurs intérêts sont menacés par la mobilisation de la classe ouvrière de leur propre pays.
Au cours de l’année 1923, la crise sociale ne cesse de s’aggraver : la spéculation, la corruption à tous les niveaux triomphent, et l’on assiste à la dissolution de tous les garde-fous sociaux. La faillite du système s’étale au grand jour. La pauvreté, le chômage frappent de plein fouet la petite bourgeoisie et les travailleurs allemands. La classe ouvrière ne tarde pas à réagir à cette situation extrême. De nouveau, un mouvement de conseils ouvriers se développe, très rapidement, tout au long de l’année 1923, s’organisant par industrie et par ville, puis par districts et par régions. Des centuries prolétariennes sont mises sur pied pour l’autodéfense de la classe ouvrière. La situation est bel et bien pré-révolutionnaire.
Grèves massives et nouvelle trahison de la social-démocratie
En août 1923, un important mouvement de grèves spontanées a lieu dans de nombreuses usines du pays. La question brûlante est alors de savoir si les directions syndicales vont soutenir et appuyer ces grèves, qui ouvrent la perspective d’un renversement du gouvernement bourgeois de Cuno, et la prise du pouvoir par un gouvernement ouvrier. Mais les dirigeants sociaux-démocrates, pour beaucoup, craignent la grève, qui représente à leurs yeux le désordre et l’anarchie. Une fois de plus, la social-démocratie rejette l’alliance avec les communistes et met fin aux grèves, en passant un accord avec la bourgeoisie pour des réformes ponctuelles (mesures fiscales contre les grandes sociétés et renforcement de la surveillance des groupes d’extrême droite). Le parti communiste, qui soutient les grèves et s’est fait, depuis 1921, le champion de la lutte pour le front unique ouvrier, pour un gouvernement ouvrier de rupture avec la bourgeoisie, est le seul parti à se renforcer malgré la terrible crise qui touche toute la population.
La préparation de l’insurrection
Les dirigeants soviétiques estiment que l’insurrection est à l’ordre du jour. Dans un enthousiasme qui gagne la masse de la population soviétique, ils préparent activement la prochaine étape de la révolution socialiste, la révolution allemande, qui doit briser l’isolement de l’U.R.S.S. On le sait, Lénine n’a cessé de répéter que la révolution devait absolument s’étendre au-delà de la Russie, le socialisme ne pouvant être réalisé dans un seul pays, d’autant que l’U.R.S.S., arriérée économiquement, ne pouvait relever à elle seule ce défi — principes marxistes et internationalistes qui seront bafoués et piétinés par Staline. Pour Lénine, Trotsky et tous les communistes de l’époque, l’Allemagne, étant donné la puissance et l’organisation de sa classe ouvrière, est le maillon principal à partir duquel le socialisme pourra s’étendre en Europe et au-delà. L’internationalisme n’est pas un principe abstrait. La population et le gouvernement soviétiques accumulent des réserves d’or et de céréales à l’intention des travailleurs allemands, des stocks d’armes sont préparés, et des cadres communistes russes sont envoyés en Allemagne. Les travailleurs soviétiques sont pleinement mobilisés dans la préparation de l’insurrection. Côté allemand, le parti communiste entier est sur le pied de guerre, chacun de ses membres s’entraîne militairement ; on fabrique clandestinement armes et munitions ; un plan stratégique précis est arrêté pour la prise du pouvoir. Conformément à la tactique du front unique ouvrier, les communistes constituent avec les sociaux-démocrates un gouvernement « de défense républicaine et prolétarienne » dans les Länder de Saxe et de Thuringe. Tout semble être prêt pour une puissante insurrection.
La révolution trahie par la social-démocratie
Mais une fois de plus, les sociaux-démocrates vont dresser un obstacle décisif contre la révolution ouvrière allemande. Tout se joue alors à Chemnitz, en novembre, lors de la conférence des conseils d’usine. Brandler, un ancien ouvrier maçon qui dirige alors le parti communiste, lance la proposition de grève générale. Mais les sociaux-démocrates, y compris les sociaux-démocrates de gauche, sur lesquels les communistes comptaient pour mettre en minorité les sociaux-démocrates de droite, refusent d’appeler à la grève. Après s’en être ainsi remis à des sociaux-démocrates contestataires, mais incapables de rompre réellement avec la social-trahison, Brandler, décontenancé, retire sa motion, et en propose une autre, dilatoire : la création d’une commission paritaire qui réfléchira au problème de la grève générale. C’est reporter la révolution aux calendes grecques ! Tout le plan communiste d’insurrection est brutalement bloqué. C’est la retraite sans combat, sauf à Hambourg, où les communistes, ignorant l’échec de Chemnitz, lancent l’insurrection, réprimée dans le sang (on compte vingt-et-une victimes parmi les insurgés). Le général Von Seeckt, en vertu de l’état de siège, interdit toute grève à Berlin. Les troupes de la Reichswehr entrent en Saxe et expulsent les dirigeants communistes du gouvernement du Land.
Analyse d’un échec
Certes, la capitulation de Brandler (qui sera remplacé à la tête du parti par Remmele et Thaelmann, lequel deviendra par la suite l’exécutant fidèle des directives de Staline) devant les sociaux-démocrates, est une erreur politique. Mais il serait simpliste d’accabler, comme l’ont fait entre autres Zinoviev, Kamenev et Staline, un seul homme pour lui faire porter le poids de cet échec et ainsi mieux se dédouaner de leurs propres défaillances. La responsabilité fut celle de la direction du K.P.D. et surtout de l’Internationale. Les dirigeants communistes se sont en effet souvent montrés hésitants, peu aptes à apprécier avec précision les changements rapides de la situation objective au cours de ces mois décisifs de 1923. Ainsi la grève spontanée contre le gouvernement Cuno en août 1923 avait-elle pris de cours Zinoviev et les dirigeants de l’I.C., qui se mirent alors brutalement, fiévreusement, à organiser l’insurrection, alors que celle-ci aurait dû être préparée longuement, patiemment, méthodiquement, dans la lutte de classe quotidienne d’une année 1923 particulièrement riche en combats de classe du prolétariat. Au moment de la conférence de Chemnitz, l’armement que possédait le parti communiste à lui seul était trop faible pour une insurrection à l’échelle nationale. Pour que réussisse le mouvement révolutionnaire, les communistes avaient un besoin vital de l’alliance et des forces des sociaux-démocrates de gauche : ceux-ci ont préféré rester dans le camp du capitalisme, en refusant de l’affronter à un moment pourtant crucial de l’histoire de la classe ouvrière allemande, mobilisée et prête au combat. Ce repli contre-révolutionnaire n’était que l’aboutissement d’une longue série de trahisons de la social-démocratie, qui à plusieurs reprises avait fait alliance avec la bourgeoisie, y compris en entrant dans des gouvernements bourgeois et en les dirigeant, pour réduire le mouvement révolutionnaire, jusqu’à se rendre complice de l’assassinat de nombreux militants, dont Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht en janvier 1919.
Plus généralement, cet échec de la révolution allemande pose le problème de l’organisation même du parti : les spartakistes s’étaient longtemps opposés à une conception bolchevique d’un parti fondé sur le centralisme démocratique (liberté totale dans la discussion, unité et discipline dans l’action). Un certain fatalisme, la croyance spontanéiste selon laquelle la révolution aurait lieu quelle que soit la politique du parti, des hésitations dans les moments décisifs ont empêché les dirigeants d’avoir une estimation juste de la situation. Le K.P.D. était doté de cadres dévoués, désintéressés et courageux, mais peu capables d’analyser la situation par eux-mêmes, s’en remettant souvent aux dirigeants de l’Internationale, à cette époque Zinoviev et Kamenev. Cet état d’esprit faisait dire à Karl Radek que le K.P.D. était un excellent parti ouvrier mais pas un parti communiste. Ses dirigeants, en effet, se montraient incapables de s’orienter clairement dans une situation concrète et, comme Lénine aimait à le dire, d’« entendre le blé pousser ».
Après l’« octobre allemand », le K.P.D. est interdit, de nombreux militants sont arrêtés, et la reconstruction sera rude. Désormais, la politique du parti communiste allemand s’alignera sur celle de Moscou et de Staline.
1) Karl Liebknecht note à ce sujet : « L’opportunisme a été engendré pendant des dizaines d’années par les particularités de l’époque de développement du capitalisme où l’existence relativement pacifique et aisée d’une couche d’ouvriers privilégiés les “embourgeoisait“, leur donnait des bribes de bénéfice du capital, leur épargnait la détresse, les souffrances et les détournait des tendances révolutionnaires de la masse vouée à la ruine et à la misère ».





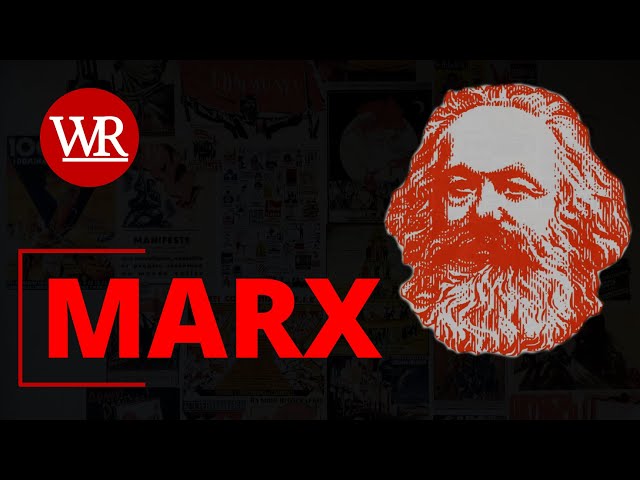

.jpg)
