Agenda militant
Ailleurs sur le Web
![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)
- Où va l’impérialisme allemand ? (05/01)
- L’économie mondiale en 2025 : année folle ou année tiède ? Par Michael Roberts (05/01)
- Ukraine : emprunter le douloureux chemin vers la paix (05/01)
- Où en sont les « socialistes » aux États-Unis ? (05/01)
- Pour gagner, la gauche doit-elle en revenir aux partis de masse ? (05/01)
- Narcotrafic : Darmanin et Delogu ne peuvent pas SE SNIFFER (05/01)
- Alma Dufour sur France Info (05/01)
- Diyarbakır : reconstruire une municipalité en ruines (28/12)
- Le marxisme aux paysans (28/12)
- Aux origines du socialisme japonais (28/12)
- Sauvons Kobané, sauvons le Rojava ! (28/12)
- Quelles perspectives pour les Kurdes au Moyen-Orient ? (27/12)
- Cuba : le mouvement du social (27/12)
- Procès de Georges Ibrahim Abdallah : la victoire est-elle proche ? (26/12)
- Île Maurice : la volonté de changement (26/12)
- Le socialisme dans un seul pays (26/12)
- Quel avenir pour la France insoumise ? (26/12)
- Les changements tectoniques dans les relations mondiales provoquent des explosions volcaniques (26/12)
- Un nouveau château de cartes (26/12)
- Le syndicalisme de Charles Piaget (26/12)
- Nabil Salih, Retour à Bagdad (26/12)
- La Syrie est-elle entre les mains d’Erdoğan ? (26/12)
- L’UE encourage l’exploitation du lithium en Serbie avec un grand cynisme (26/12)
- Le contrôle territorial d’Israël s’étend-il vers la Syrie ? (26/12)
- Scrutin TPE – Très Petite Élection (26/12)
Italie : « Crise » ou « fin » du mouvement ouvrier traditionnel ?

La crise du système capitaliste inaugurée en 2008 touche durement l'Europe et plus particulièrement les pays du Sud de l'Europe : Portugal, Espagne, Italie, Grèce, Chypre... Si chacun de ces pays fait régulièrement la une de l'actualité suite à des mouvements de contestations importants, les mobilisations italiennes demeurent plus confidentielles, du moins voilées par les frasques du politicien ayant le plus marqué la vie politique italienne ces 20 dernières années : Silvio Berlusconi. L'état de la « gauche italienne » et la disparition récente de Sinistra Critica (section italienne du Secrétariat Unifié de la Quatrième Internationale, séparée en deux groupements, un parti en continuité : Sinistra Anticapitalista, et une organisation aux structures plus diffuses : Solidarieta Internazionalista), nous poussent à nous interroger sur l'évolution des organisations du mouvement ouvrier italien ainsi que les raisons d'une énième scission des organisations héritières de Trotsky, qui prend cette fois-ci une forme plus inattendue.
I. Débâcle historique des communistes et socialistes, soumission des syndicats
La déroute de la gauche italienne n'est pas un phénomène nouveau. On peut dire de façon globale qu'il s'agit d'une longue décomposition qui s'est manifestée partout en Europe dans les partis communistes et partis sociaux-démocrates. Cependant, en Italie, la vitesse et la profondeur de ces mutations et adaptations politiques a été particulièrement frappante.
Le Parti Communiste Italien renaît après la chute de Mussolini à la fin de la Seconde guerre mondiale. Il participe d'entrée à la reconstruction du pays, conformément aux directives de Staline dans le cadre du « partage du monde » signé à Yalta avec les États-Unis et la Grande Bretagne. Alors que le pays est traversé par des troubles majeurs, le PCI accepte un référendum sur le maintien ou la suppression de la monarchie totalement discréditée, puis après le résultat mettant en place une République, il participe à la rédaction de la nouvelle constitution en collaboration avec les socialistes, mais aussi avec la Démocratie chrétienne. Situation analogue à la France à la même période : le PCF et le PCI sont d'ailleurs très proches quant à leur poids national respectif. Aux premières élections, le PCI obtient 20% des sièges à la Chambre des députés. Le PCI n'a d'ailleurs pas uniquement un poids politique, il est également très présent dans la vie culturelle et intellectuelle du pays ; beaucoup d'artistes, de réalisateurs et d'intellectuels sont des compagnons de route du PCI ; il polarise les débats.
Prenant ses aises dans les sphères institutionnelles et les débats de société, malgré son implantation dans la classe ouvrière via la principale confédération syndicale qu'il contrôle (la CGIL) le PCI va cesser de promouvoir les conquêtes par les luttes et de mobiliser les éléments de sa classe pour se concentrer sur le parlementarisme bourgeois. Et, comme en France, dès 1947 les communistes sont « remerciés » pour leur servilité et mis à l’écart du pouvoir. Le PCI ne cessera de donner toujours plus de gages de sa modération pour revenir sur la scène politique. Les oppositionnels de gauche sont mis à l'écart, voire exclus, alors que des carriéristes prêts aux compromissions sont cooptés à la tête du parti. Le vide laissé par le PCI à sa propre place va alors donner naissance – fin des années 1970, années 1980 – aux mouvances autonomes ou encore aux Brigades Rouges, adeptes des actions minoritaires, spontanées et « insurrectionnelles ». Le terrain idéologique et culturel va aussi lui échapper. Face à l'ultra-gauche italienne, le PCI va au contraire redoubler d'efforts pour s'afficher comme respectable, pour prendre encore plus ses distances avec le mouvement de classe réel et s'acoquiner au gouvernement volontairement avec la Démocratie Chrétienne.
Le PCI est l'un des premiers partis communistes à avoir affirmé son indépendance vis-à-vis de Moscou et à s'en être détaché politiquement. Mais cela a été le reflet non pas d'une évolution vers la gauche (trotskiste ou autre), mais d'une adaptation à l'économie de marché. Avant même la chute de l'URSS et la disparition du Parti Communiste d'Union Soviétique, le PCI change de nom pour devenir un « Parti Démocrate de Gauche » (PDS en italien), abandonnant le projet communiste, la subversion et le renversement du capitalisme (même graduel), la lutte des classes... Mais à ce moment-là le déclin est déjà à marche forcée. C'est au début des années 1980 que le PCI est au faîte de sa puissance électorale, avec 30% des voix qui lui font espérer parvenir au pouvoir par la voie légale. La chute des années suivantes n'en est que plus spectaculaire...
Comme partout en Europe, les années 80 et l'émergence du néolibéralisme vont accentuer la tendance des partis de gauche et des directions syndicales à adopter des politiques capitalistes et pro-patronales. En Italie, le néo-libéralisme comme politique et comme idéologie va s'imprégner en profondeur. En parallèle des reculs sociaux, le pays va connaître une multiplication des scandales politiques et de corruption, entraînant un dégoût de plus en plus net de la population pour les questions politiques et, en l'absence de luttes sociales unitaires, vers un individualisme exacerbé de façon beaucoup plus profonde que dans les autres pays occidentaux.
C'est dans ce contexte qu'apparaît politiquement et surtout médiatiquement Silvio Berlusconi au milieu des années 1990. Se présentant comme le Messie anti-corruption, ce patron d’un empire médiatique (6e fortune du pays) va réussir par son discours populiste à polariser la politique italienne. Il est le Président du Conseil des Ministres à la plus grande longévité : environ 8 ans à ce poste sur 15 ans, sans compter les innombrables mandats de ministre. Et il va lui-même rapidement profiter de la corruption qu’il dénonçait. L'opposition à sa gauche et en particulier le Parti démocrate va alors glisser toujours plus sur le terrain de Berlusconi, sur l’immigration comme sur les sujets économiques et sociaux. Cette « gauche » va même réussir à avoir l’appui complet de la bourgeoisie pour son retour au pouvoir en 2006. Berlusconi avait en effet tendance à favoriser trop ouvertement ses propres affaires. Alors que son gouvernement était celui « d'un seul patron », la coalition dite de « centre-gauche » de Romano Prodi va véritablement se faire reconnaître comme le gouvernement « de tous les patrons ».
Quant au mouvement syndical, il a vécu une mutation analogue. À la sortie de la Seconde guerre mondiale, la classe ouvrière est dotée d'un syndicat unique, la CGIL, qui participe activement à la reconstruction capitaliste du pays. Celui-ci va se morceler selon les différents courants qui l’influencent : scission des démocrates chrétiens qui vont fonder la CISL dès 1948, scission des socialistes et républicains de gauche en 1950 qui créent l'UIL. La CISL tout comme l'UIL sont devenus des syndicats tout aussi dociles que la CFDT en France, avant tout « partenaires » du patronat et des gouvernements successifs, se satisfaisant des négociations dans les limites du cadre fixé par les capitalistes. La CGIL se définit encore à leur gauche, mais tout comme la CGT française, elle n’organise pas de vraie riposte des travailleur-se-s, et prend souvent prétexte de la nécessité de l’unité avec ses deux compères de droite (qui n’en veulent pas) pour ne rien faire. Les contre-réformes passent donc sans résistances importantes de la classe ouvrière.
De façon générale, l'intégration des syndicats à l'appareil d'État en Italie est encore plus poussée qu'en France. Une modification de la Constitution adoptée il y a quelque temps définit qu'un syndicat est reconnu par l'État – et peut donc jouir des droits de représentativité – à la seule condition qu'il reconnaisse la base de négociation et les limites posées par le gouvernement et le patronat. Cette réforme de la Constitution a été obtenue dans la passivité syndicale, sous prétexte qu'elle implique également que le patronat respecte ses engagements (pas bien dur de respecter ce qu'on avait déjà choisi de laisser passer avant l'ouverture des négociations !).
II. Vide politique et poussées populistes
Aujourd'hui en Italie, nous pouvons dire que les partis qui ont structuré historiquement la classe ouvrière (PC/PS) n'existent plus – le PCI étant devenu un « Parti Démocrate » ordinaire, du centre et bourgeois, et le PS ayant déjà rendu l'âme. Cette histoire du XXe siècle ouvrier est maintenant enterrée. Les mutations du PCI ont cependant accouché d'un rejeton qui s'est voulu un temps continuateur de la lutte de classe : le Parti de la Refondation Communiste. Parallèlement, les deux partis principaux sont particulièrement faibles et discrédités. L’accord avec les autres dirigeants européens pour mettre en place le gouvernement « technique » de Monti en 2011 a mis à nu la fragilité de cette situation, où la bourgeoisie ne dispose d’aucune force stable pour être à la tête de sa « démocratie ».
En l’absence de perspective dans la voie de la lutte de classe, les ressentiments populaires s’expriment très confusément. Ils peuvent être dirigés contre « ceux d’en haut » (ultra-riches, politiciens corrompus) et contre ceux d’en bas (immigrés notamment). Dans ces conditions, la crise des partis institutionnels profite à des personnalités populistes émergentes comme Beppe Grillo. Cet ex-humoriste et son « mouvement 5 étoiles » défend des propositions mi-réactionnaires, mi-utopiques : soutien aux petites et moyennes entreprises, luttes écologiques (contre le train à grande vitesse), lutte anti-corruption, refus de l'austérité, hostilité populiste à l'Union européenne... Il prône une démocratie directe soi-disant réalisée dans l’organisation par réseaux sociaux de son mouvement, mais établit dans le même temps un vrai pouvoir personnel, veut interdire les syndicats...
Début décembre, un nouveau mouvement de protestation s'est fait entendre en Italie, effectuant parfois des actions destructrices, appelé « Forconi », « les fourches », référence à la révolte des petits paysans propriétaires au Moyen-Âge, tout comme en Bretagne nous avons nos « Bonnets rouges ». Les Forconi sont un mouvement de petits commerçants qui plongent à cause de la crise, et qui dénoncent la politique du gouvernement qui obéit avant tout aux désirs des grands patrons. Cette petite bourgeoisie se retrouve, en l'absence de mouvement de classe des travailleurs, sous influence de l'extrême droite.
Cette décomposition de la « démocratie » capitaliste et cette montée du populisme, commencée sous l’ère Berlusconi, ne peut que croître, car la crise du système est inscrite sur la durée, et ces divers mouvements sont incapables d’y changer quoi que ce soit.
III. La section italienne du SU-QI1 : de Rifondazione à Sinistra Anticapitalista
Le Parti de la Refondation Communiste, « Rifondazione Communista », appelé parfois tout simplement « Rifondazione » est fondé par ceux qui refusent la mutation de 1991 du PCI en Parti démocrate. Mais il s’agit plus d’un conservatisme que d’une radicalisation à gauche. D'entrée, Rifondazione est défini comme un parti ouvrier mais réformiste, destiné à occuper la place politique laissée vacante par la disparition du PCI.
C'est aussi un projet soutenu par le Secrétariat Unifié de la Quatrième Internationale (SU-QI) dans la continuité des choix entrepris dans les congrès du milieu des années 80 : la volonté de construire des « partis anticapitalistes larges » — non sur la base de mouvements de masse cherchant à se doter d'une expression politique, mais en renonçant à la construction de partis trotskystes.
La logique réformiste a malheureusement débordé les militant-e-s du SU au sein de Rifondazione. Rifondazione se retrouve en effet à deux reprises dans des gouvernements de coalition pilotés par Romano Prodi, qui menent une politique pro-capitaliste à chaque fois. Ces gouvernements n’ont eu pour délimitation que « tout sauf Berlusconi ». Les poids respectifs étaient tels que la coalition de centre-gauche ne pouvait se passer de Rifondazione pour constituer son gouvernement. Comme tout parti réformiste où l'influence institutionnelle prend plus d'importance que la lutte sur le terrain, Rifondazione collabora pour ne pas être tenu responsable du retour au pouvoir de Berlusconi. Les membres du SU, organisés en tendance au sein de Rifondazione sous le nom de Sinistra Critica, soutiennent de fait cette politique, notamment au Parlement où ils ont des élus après les élections de 2006, sous prétexte du « moindre mal », votant des mesures budgétaires d'austérité et cautionnant même l'envoi de troupes en Afghanistan !2
Cependant, Sinistra Critica ne va pas tenir la contradiction et démissionnera (tout en s'arrangeant pour transférer ses sièges aux membres de Rifondazione plutôt que de risquer de faire chuter la coalition si les sièges changent de camp politique lors de l'élection partielle). Elle scissionne finalement avec Rifondazione fin 2007.
Mais Sinistra Critica est mal préparée. En effet, les militant-e-s n'ont construit que trop peu d'élaboration depuis l'émergence de Rifondazione sur le champ institutionnel, cherchant seulement à freiner la dérive opportuniste de Rifondazione. Eux-mêmes avoueront qu'il s'agissait de « cuisine » pour présenter un plat comestible quoique pas très fin, de « bricolage » pour éviter à la charpente de s'effondrer. Mais à peine formé le parti se lance corps et âme dans les élections législatives anticipées de 2008, pour ne recueillir que 0,46 % des voix. Ce revers accroît les difficultés internes (crise de trésorerie, abandon de postes de permanents politiques...).
En 2013, alors que la crise s’approfondit en Italie, sans que la riposte ouvrière soit à la hauteur, un nouveau débat émerge au sein de Sinistra Critica. La section italienne du SUQI, considérant que « la subjectivité ouvrière, la classe pour soi, n'est plus présente », en est arrivée à se diviser en deux moitiés lors de son dernier congrès , qui ont donné naissance à deux organisations radicalement différentes :
- Sinistra Anticapitalista parle de « crise » de la conscience ouvrière qu'il faudrait reconstruire à partir de l'existant, via un parti marxiste, intervenant dans les syndicats, ainsi que dans des collectifs comme « Ross@ » (un collectif anticapitaliste), le collectif « No TAV » (mouvement contre le train à grande vitesse, projet que l'on pourrait comparer à Notre Dame des Landes).
- Solidarieta Internazionalista parle plus volontiers de « fin » du mouvement ouvrier tel qu'il a existé au XXe siècle, avec les références qui ont marqué son histoire : l'histoire des partis ouvriers, le clivage réforme/révolution, l'URSS, les quatre internationales... Considérant que la conscience de classe est retombée à un niveau très bas, que les syndicats existants n'exercent plus d’influence sur les travailleurs/ses, il s’agirait de « faire table rase » du passé, de « repartir de zéro ». Ce serait selon eux un retour à la situation des débuts du mouvement ouvrier, et à ce titre leur modèle est celui de l’Association Internationale des Travailleurs, la Première Internationale où cohabitaient marxistes, anarchistes et d’autres socialistes. Cela les amène à rejeter y compris la forme parti, et à s’organiser dans un réseau, autour d'un média sur internet, peut-être d'une publication papier. Leur but étant de lier les différentes formes de résistances « anti-capitalistes », d’investir ou créer des espaces « hors-système » autogérés, de nouvelles formes de solidarité... L’exemple des mouvements de type « Indigné-e-s » ou « Occupy », ainsi que le mouvement autonome ont certainement eu une influence dans ce choix. Le tout en espérant voir émerger de ces expériences de nouvelles formes de représentation d'une classe ouvrière qui se reconstitue, jusqu’à ce qu’il soit possible de recréer une Internationale « anticapitaliste » sans lien avec les Internationales passées.
IV. La nécessité d'un parti révolutionnaire
Pourtant, la lutte des classes et ses effets se font toujours plus sentir. Les régressions sociales en série ne se font pas sans manifestations de colère des travailleurs/ses. Et malgré son affaiblissement historique, la bureaucratie syndicale continue de jouer un rôle majeur dans la période actuelle : celui de résigner les exploité-e-s à leur sort. Elles tiennent ouvertement un discours d’union nationale : « c'est la crise », « tout le monde doit faire des efforts » « On est tous dans le même bateau ; il ne faut pas faire de tort aux patrons qui font comme ils peuvent ».
Elles n’y réussissent pourtant pas totalement. Un fort mouvement de grèves et manifestations a eu lieu en octobre contre les différentes mesures d'austérités (blocage des salaires, suppression de postes de fonctionnaires...). 50 000 personnes ont défilé dans les rues de Rome et la grève a beaucoup touché certains secteurs (éducation, santé, mais aussi transports à Turin ou à Bologne). Ce mouvement a été à l’initiative des COBAS (« syndicats de base »), soutenu par le « Réseau 28 avril » (oppositionnels de gauche dans la CGIL), l'extrême gauche et Rifondazione. Son écho a été assez important pour que les trois confédérations traditionnelles se sentent obligées d’appeler quelques jours plus tard à une grève... mais de 3 ou 4 heures seulement.
Les COBAS sont un ensemble de petits syndicats qui ont souvent été fondés à l'occasion de luttes dures et emblématiques, notamment par des militant-e-s révolutionnaires déçu-e-s du PCI. Ces syndicats ont donc le mérite d’être anti-bureaucratiques et résolument radicaux. Mais selon nous, ils ont deux écueils : leur éparpillement et leur délimitation « syndicaliste révolutionnaire », qui nuisent à la lutte unitaire de la classe et pourraient faire obstacle au combat pour un parti révolutionnaire se battant pour le pouvoir des travailleurs/ses.
On le voit, aussi dure que soit la situation, il y a des forces militant-e-s et des points d’appui pour donner un second souffle à la lutte de classe. Entre des confédérations collaboratrices quand elles ne sont pas passives et des syndicats révolutionnaires minoritaires, il est possible d'aller, avec ces syndicats radicaux et avec les militant-e-s radicaux/ales du syndicalisme traditionnel, vers un mouvement d'ensemble opposé au gouvernement et aux régressions sociales en construisant un vrai plan de mobilisation. De ce point de vue, les camarades de Sinistra Anticapitalista ont raison de s’investir dans la lutte pour un syndicalisme combatif et anti-bureaucratique (en particulier dans le « Réseau 28 avril ») et d’insister sur le renforcement de ses sections locales affaiblies et la construction du parti.
A l’inverse, il nous semble que les camarades de Solidarieta Internazionalista vont vers une impasse. S’il est très important pour les révolutionnaires de dialoguer avec les militant-e-s qui expriment leur révolte dans différentes formes de luttes, il est de leur responsabilité de proposer une stratégie, issue des expériences accumulées. Sans un militantisme coordonné autour d’objectifs clés comme faire sauter le verrou des bureaucrates, aucune recherche « d’alternatives » ne pourra déboucher sur des luttes subversives majoritaires.
Cela étant dit, il est primordial que les camarades de Sinistra Anticapitalista ne se contentent pas de vouloir maintenir intacte la maison. Le seul moyen d’aller réellement de l’avant est de tirer un bilan critique de Sinistra Critica. Il faut en finir avec la politique du « moindre mal », qui a justifié toutes les dilutions. Il faut mener jusqu'au bout la critique impitoyable de sa politique de capitulation suicidaire pendant le gouvernement Prodi. Il faut en finir – et c’est valable également pour le NPA – avec l’illusion que l’on peut construire un parti de masse d’abord et que l’outil révolutionnaire viendra (comment?) plus tard. C’est à chaque instant que le clivage réforme-révolution a des conséquences sur l’action immédiate.
La bureaucratisation des syndicats et leur collaboration avec le patronat est un phénomène structurel et général dans la société capitaliste, tout comme la pression électoraliste et la « modération » des partis contestataires. C’est qu’un « parti ouvrier », un parti défendant les intérêts des travailleur-se-s, est déjà en contradiction avec la société actuelle. Il ne peut y avoir d’avancée pour les travailleurs sans accroître les éléments de crise économique et politique. Un parti « flou » sera toujours poussé à résoudre cette contradiction en mettant de l’eau dans son vin. A l’inverse, seul un parti consciemment révolutionnaire peut assumer de se battre résolument dès aujourd'hui.
Le parti semble souhaiter une vraie formation marxiste de ses militant-e-s, ce qui est essentiel. Mais cela ne doit pas être une simple transmission d’un héritage et de références. L’enjeu central est que les débats sur la stratégie soient pris à bras-le-corps.
C'est aussi la question clé que posent les courants de la gauche du NPA, mais aussi du SUQI lui-même. Et, en Italie, il faut également que la discussion se mène avec les autres organisations issues du trotskysme, notamment le PCL (Parti communiste des travailleurs, membre de la Coordination pour la Reconstruction de la IVe Internationale dont la principale organisation est le Parti ouvrier d'Argentine) et avec le Parti de l'Alternative communiste (la section italienne de la LIT, dont la principale organisation est le PSTU brésilien). Nous y reviendrons dans un prochain article...
1Le Secrétariat Unifié de la Quatrième Internationale est une organisation internationale se revendiquant de la Quatrième Internationale fondée par Trotsky. C’est le courant international auquel appartenait la LCR.
2Voir à ce sujet l'article d'Antoni Mivani dans Le CRI des travailleurs n° 26, avril 2007, http://groupecri.free.fr/article.php?id=361





.jpg)
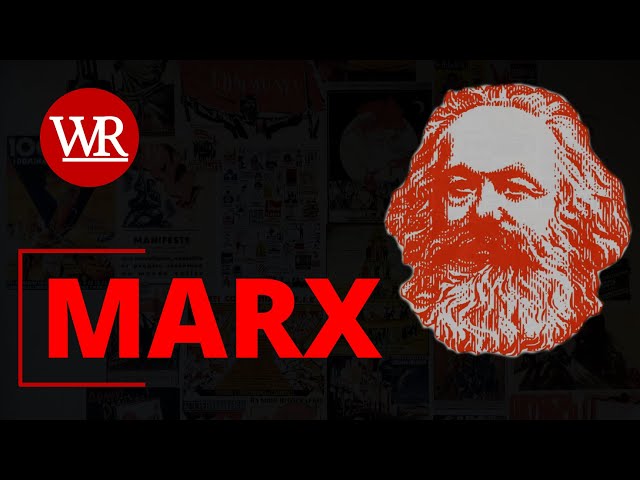

.jpg)