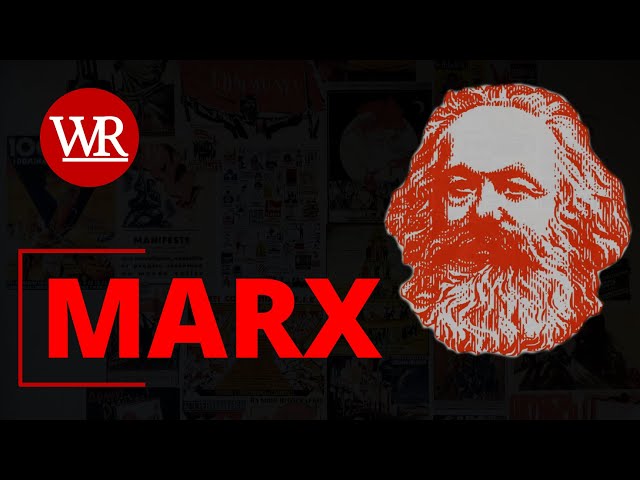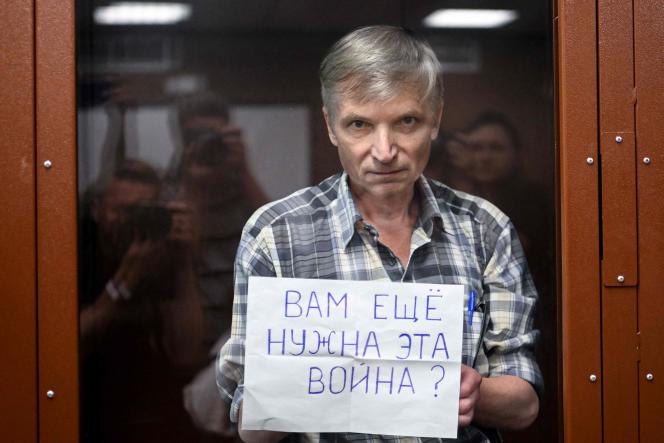Agenda militant
Ailleurs sur le Web
![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)
- Le Portugal mis à l’arrêt par la plus grande grève générale depuis 2013 (12/12)
- L’ARNAQUE DU "MANAGEMENT BIENVEILLANT" (11/12)
- Les Grandes Gueules : sur RMC, la petite bourgeoisie vous parle (11/12)
- Pourquoi la classe compte, et pourquoi il faut (re)lire Erik Olin Wright (11/12)
- Le PCF, l’eurocommunisme et la dictature du prolétariat. Extrait du livre de Laurent Lévy (11/12)
- La bulle de l’IA et l’économie étatsunienne (11/12)
- Une vie de doctorant (11/12)
- Non, les chars russes ne sont toujours pas à Paris ! (11/12)
- Dans les années 1970, la gauche a laissé passer une crise qui aurait pu tourner à son avantage (08/12)
- Audition de Mélenchon devant la commission d’enquête anti-LFI (07/12)
- France Info fait du CNews : Antoine Léaument explose le plateau (07/12)
- Action de mise à l’arrêt d’une usine de pesticides interdits : "bloquons BASF" (04/12)
- Organisation du Travail et Communisme - Bernard FRIOT & Frédéric LORDON (02/12)
- La « peur rouge » aux États-Unis, hier comme aujourd’hui (02/12)
- Le service militaire. - La chronique de Pierre-Emmanuel Barré (30/11)
- Décès d’Henri Benoits (30/11)
- Guerre et service militaire : les médias sonnent le tocsin (29/11)
- La meute médiatique, le retour ? Manuel Bompard, Rima Hassan et Paul Vannier publient leurs réponses à Belaich et Pérou (29/11)
- Le capitalisme comme totalité : une introduction rapide à son histoire (27/11)
- L’État contre les associations. Extrait du livre d’Antonio Delfini et Julien Talpin (27/11)
- SONDAGE MÉLENCHON - BARDELLA : C’EST PIRE QUE CE QUE VOUS CROYEZ !! (27/11)
- Contre-enquête sur le fiasco du Louvre (25/11)
- Mélenchon : Magouilles et trahisons à tous les étages (25/11)
- Face à la crise du capitalisme : la militarisation de l’enseignement (24/11)
- Russie. Depuis sa cellule, entretien avec Boris Kagarlitsky (24/11)
En défense de la révolution d’Octobre… et de la « dictature du prolétariat »
La critique la plus courante pour essayer de disqualifier les bolcheviks consiste à les présenter comme des ennemis de « la démocratie », ce dont la dissolution de la Constituante par le pouvoir soviétique en janvier 1918 apporterait une preuve éclatante. Plus généralement, on leur reproche d’avoir porté atteinte à la liberté de la presse, au droit de réunion et au pluralisme politique. Lieu commun des manuels d’histoire officiels, cette critique est aussi reprise par des groupes ou partis qui opposent à un socialisme dit « autoritaire » des bolcheviks une voie « démocratique » vers le socialisme. Tous se rejoignent pour affirmer ou suggérer un amalgame, implicite ou explicite, entre bolchevisme et stalinisme.
On comprend dès lors que l’étude et la réflexion sur la révolution d’Octobre et la politique des bolcheviks ne constituent pas un exercice académique, mais intéressent profondément tous les travailleurs et les opprimés qui veulent en finir avec l’ordre bourgeois. La dissolution de la Constituante par le gouvernement soviétique était-elle légitime ? La République soviétique, second État ouvrier de l’histoire après la Commune de Paris, est-elle d’une façon générale moins démocratique, ou plus démocratique, que la plus démocratique des républiques bourgeoises ordinaires ? Y a-t-il deux voies possibles vers le socialisme, l’une autoritaire, et l’autre « démocratique » ?
De la révolution d’Octobre à la convocation de la Constituante
Un subterfuge banal de la bourgeoisie et de ses chiens de garde pour poser « le problème de la Constituante » consiste à le poser de façon abstraite et isolée, hors du temps et de l’espace, c’est-à-dire hors du développement réel de la lutte entre les classes sociales pendant la révolution russe. Il leur est ainsi possible d’opposer une « bonne » bourgeoisie « démocratique » et de « bons » socialistes « démocratiques » (les mencheviks et les socialistes-révolutionnaires de droite), aux « méchants » socialistes anti-démocratiques, les bolcheviks. À l’inverse, on suivra ici le déroulement réel de la lutte des classes, dans lequel s’exprime les positions réelles de chaque classe à travers son parti.
Que faire face à la contre-révolution ?
La révolution victorieuse est généreuse : des représentants de la bourgeoisie, notamment des officiers et élèves-officers, faits prisonniers au moment de l’insurrection, sont libérés sur parole par le pouvoir soviétique. En échange, ils s’engagent à ne pas essayer de renverser le pouvoir soviétique. Mais la plupart, à peine libérés, trahissant leur parole, préparent, organisent ou essayent d’organiser des soulèvements armés, comme à Moscou. La bourgeoisie par l’intermédiaire de son parti, le parti cadet, et de ses relais dans l’armée et le vieil appareil d’État, s’efforce de rétablir son pouvoir par la violence.
Les mencheviks et les socialistes-révolutionnaires (SR) de droite, quant à eux, s’opposent au pouvoir issu de la révolution : après avoir quitté le IIe Congrès des Soviets, où ils étaient en minorité, ils refusent d’envoyer leurs délégués au Comité exécutif central des soviets de Russie en proportion de leur représentation à ce congrès. Et ils prétendent substituer au gouvernement élu par ce dernier (conseil des commissaires du peuple) un gouvernement de coalition comprenant des bolcheviks, des mencheviks, des SR et des socialistes populistes (ces derniers étant dirigés par Kerensky, lequel, chef du gouvernement provisoire d’avant Octobre, avait multiplié les actes de répression contre les travailleurs et les soldats, ouvrant la voie à la préparation du coup d’État militaire de Kornilov (1)). Le Comité exécutif du syndicat des cheminots, dirigé par les mencheviks, menace de bloquer le ravitaillement de la capitale si le gouvernement soviétique ne cède pas.
Des pourparlers sont engagés entre les représentants du gouvernement soviétique, des différents partis se revendiquant du socialisme et le Comité exécutif du syndicat des cheminots. Le gouvernement demande au syndicat des cheminots d’envoyer des troupes pour mater l’insurrection contre-révolutionnaire des élèves-officiers de Moscou. Ce dernier, en affirmant sa « neutralité », démasque devant le peuple tout entier le sens réel de sa politique. Le pouvoir soviétique rompt alors les pourparlers, dont la fonction (quelles que soient les bonnes intentions de certains socialistes-révolutionnaires ou mencheviks) se révèlait être objectivement celle d’un soutien politique à la lutte contre la révolution d’Octobre, c’est-à-dire contre le décret sur la paix, le décret sur la terre, le contrôle ouvrier sur l’industrie et plus généralement le pouvoir des ouvriers et des paysans (2).
D’un côté, le gouvernement soviétique dirigé par les bolcheviks s’efforce de réduire par la négociation tous les soulèvements contre le pouvoir, même armés : les soldats fidèles aux soviets reçoivent ordre de ne pas tirer les premiers. Les bolcheviks entendent ainsi démontrer à tous qu’ils ne veulent pas la guerre civile. Mais, de l’autre, le gouvernement réagit sans faiblesse aux menées de la contre-révolution : il triomphe militairement des troupes qui ne se rendent pas et décide de mettre en état d’arrestation les dirigeants du parti cadet, cerveaux de la contre-révolution, de placer ce parti sous surveillance et d’interdire sa presse.
La question de la liberté de la presse
Les mencheviks et les SR de droite se scandalisent : comment oser porter atteinte à la sacro-sainte liberté de la presse ? Comment oser interdire la presse bourgeoise ? Les mencheviks, les SR de droite et les socialistes-populistes n’avaient pas fait preuve d’autant de réticences à « porter atteinte à la liberté de la presse » et à recourir à la violence lorsque, aux lendemains des journées de juillet, ils avaient décidé d’interdire la presse du Parti bolchevik, d’envoyer l’armée fermer ses imprimeries, détruire ou confisquer son matériel et arrêter ses principaux dirigeants, qui passèrent les mois de juillet et août dans les prisons du gouvernement des mencheviks, des SR et des socialistes-populistes…
Dès lors, s’ils se scandalisent de la mesure d’interdiction de la presse bourgeoise au moment où celle-ci répand toutes sortes de fausses nouvelles et de calomnies contre le pouvoir soviétique dans l’objectif de son renversement, ce n’est pas qu’ils soient attachés à la « liberté de la presse » pour elle-même, mais plutôt qu’ils sont aussi déterminés à rétablir le pouvoir bourgeois qu’ils l’ont été à étouffer par tous les moyens la révolution prolétarienne. Pour eux, la presse est « libre » lorsque la presse est dans les mains de quelques grands hommes d’affaires et présente la réalité à leur avantage, calomniant les révolutionnaires (comme les bolcheviks, accusés sans fondement en juillet d’être financés par l’État-major allemand), tandis que l’immense majorité n’a tout simplement pas les moyens matériels de disposer de ses propres médias. À l’opposé, la politique des bolcheviks consista, dans l’esprit du projet de décret sur la presse, d’une part, à imposer à tous les journaux l’obligation de rendre publics leurs comptes, afin que le peuple puisse connaître le ou les commanditaire(s) du journal et, d’autre part, à collectiviser les imprimeries et à les mettre à la disposition de tout groupe significatif d’ouvriers ou de paysans désirant éditer un journal ou une revue (Lénine suggérait d’accorder ce droit à tout groupe d’au moins 10 000 ouvriers ou paysans) (3). En donnant ainsi réellement la possibilité aux exploités et aux opprimés de faire leur propre presse, ces mesures constituaient un pas vers la liberté réelle de la presse.
Lutte politique et lutte militaire sont indissociables
Les rumeurs répandues par la presse bourgeoise ne peuvent être séparées des préparatifs militaires de coup d’État. En ce sens, faire preuve de la moindre faiblesse face à la contre-révolution, même avec les meilleures intentions du monde, c’est trahir la révolution. Tous les hésitants (comme les SR de gauche et le groupe Zinoviev-Kamenev dans le parti bolchévik) semblent avoir oublié les leçons de la Commune de Paris. La bourgeoisie française n’avait continué à discuter avec les communards que le temps de réunir, en accord avec Bismarck (représentant les intérêts de la bourgeoisie allemande), les forces nécessaires pour écraser la révolution prolétarienne commençante. La lutte politique et médiatique de la bourgeoisie contre le gouvernement révolutionnaire et son recours à la force militaire ne sont pas deux politiques opposées, mais les deux moments d’une même politique, dont le résultat ne peut être rien d’autre que le rétablissement du pouvoir de la bourgeoisie sur la base du massacre des ouvriers révolutionnaires.
Le comportement du gouvernement soviétique à l’égard des paysans
On reproche aussi aux bolcheviks d’avoir accordé aux ouvriers une sur-représentation dans les soviets, devenus organes de l’État, par rapport à la paysannerie, qui était largement majoritaire en Russie. Pour les « démocrates » bourgeois et petits-bourgeois, cela représente une violation inadmissible de « la » démocratie, incarnée selon eux dans le principe : un homme, une voix. Pourtant, ce principe formel ignore que, sous le capitalisme, c’est la ville qui commande à la campagne. Dès lors, la question politique principale qui se pose, en ce qui concerne la paysannerie, est de savoir quelle classe la dirigera : la bourgeoisie ou le prolétariat ? En régime de « démocratie » bourgeoise, c’est la bourgeoisie — les banquiers, les propriétaires fonciers qui en général sont eux-mêmes des bourgeois, les gros fermiers capitalistes, les patrons qui produisent les machines agricoles, les patrons des supermarchés qui imposent des prix au rabais, etc. —, qui commande à la paysannerie, comme à toutes les autres classes. C’est cette bourgeoisie qui domine la terre, surexploite les salariés agricoles, pille les petits paysans et souvent les exproprie en les conduisant à la ruine.
Le gouvernement soviétique, au contraire, s’est efforcé d’aider les travailleurs salariés et les paysans pauvres à lutter contre les bourgeois et les paysans riches, tout en essayant d’obtenir la bienveillante neutralité du paysan moyen (celui qui peut vivre de sa terre sans employer de salarié). Dans les premiers jours qui suivent la révolution d’Octobre, la grande majorité du prolétariat est déjà ouvertement du côté du pouvoir soviétique, mais la position de la paysannerie est encore incertaine. Pour la gagner à la révolution prolétarienne, le gouvernement soviétique fait connaître dans les campagnes ses premières mesures et convoque un congrès extraordinaire des soviets de délégués paysans de Russie. Parmi les délégués, on compte 197 SR de gauche, 65 SR de droite et 37 bolcheviks. Au terme d’une âpre lutte politique, les délégués de ce congrès, tout en reprenant la revendication menchevik et SR de la formation d’un gouvernement de coalition incluant, en plus des bolcheviks et des SR de gauche, des mencheviks, des SR de droite et des socialistes-populistes, affirme que ce gouvernement devra appliquer le programme adopté par le IIe Congrès des soviets de Russie, réuni en Octobre. Il démontre ainsi que le développement de la lutte entre les classes au cours de la révolution, modelé par un combat politique acharné entre les partis qui les représentent, a fini par placer, malgré ses oscillations constantes, la majorité de la paysannerie du côté du pouvoir soviétique. Car seul ce pouvoir s’est révélé capable d’apporter à une réponse positive aux revendications paysannes, en décidant l’expropriation des propriétaires fonciers et la répartition égalitaire de la terre entre les paysans. La conquête du pouvoir par le prolétariat permet ainsi de grouper autour de lui tous les opprimés, ce qui est une condition pour la victoire finale. C’est dans ce contexte que l’Assemblée constituante est appelée à se réunir.
Constituante et Soviets
Opportunisme sans principe… ou réalisme révolutionnaire ?
La bourgeoisie accuse souvent les bolcheviks de n’être que des conspirateurs sans scrupules, ne reculant devant aucun coup tordu pour parvenir à leurs fins. Dans le cas de la dissolution de l’Assemblée Constituante, on présente souvent les choses comme si les bolcheviks avaient été des partisans inconditionnels de la Constituante jusqu’au moment où, s’y retrouvant en minorité, ils auraient choisi de s’en débarrasser… Qu’en est-il en vérité ?
Entre avril et juillet, les bolcheviks ont maintes fois exigé la convocation de la Constituante, tout en ne cessant de souligner que, si une république bourgeoise avec Constituante était préférable à une telle république sans Constituante, car plus démocratique, une république ouvrière, c’est-à-dire soviétique, était encore mille fois plus préférable à la république bourgeoise avec Constituante, car mille fois plus démocratique. Durant ces mois, la bourgeoisie et ses valets mencheviks et SR ont refusé de convoquer la Constituante, sous prétexte qu’il aurait été impossible d’organiser des élections libres en pleine guerre (mensonge démasqué par l’organisation des élections en octobre 1917, alors que la guerre impérialiste se poursuivait). En réalité, la bourgeoisie et son parti, les cadets, soucieux de préserver au maximum l’ancien état des choses, ne voulaient pas de Constituante, car il ne faisait aucun doute que les partis se revendiquant du socialisme (mencheviks, bolcheviks et SR) y remporteraient la majorité absolue. Mais les mencheviks et les SR n’en voulaient pas non plus, car cela les aurait empêchés de continuer à se cacher derrière la prétendue force de la bourgeoisie pour refuser d’assumer le pouvoir que leur avaient remis les ouvriers par leur insurrection de février contre le tsar.
En fait, les cadets, les mencheviks et les SR, qui avaient délibérément refusé de convoquer la Constituante pendant cinq mois (d’avril à juillet), ne sont devenus d’ardents partisans de cette dernière qu’à partir du moment les bolcheviks ont commencé à gagner la majorité dans un soviet après l’autre à partir d’août, suite à la politique bourgeoise menée par les mencheviks et les SR avec le gouvernement provisoire (poursuite de la guerre impérialiste, refus de donner la terre aux paysans, refus de combattre le sabotage des capitalistes, etc., avec des conséquences désastreuses pour les masses). Ce sont donc eux, et non les bolcheviks, qui ont fait preuve de « principes » à géométrie variable. Pour les révolutionnaires, ces événements constituent une bonne leçon de dialectique historique, car ils montrent clairement qu’un même mot d’ordre peut se charger d’un contenu de classe entièrement différent selon le développement de la situation politique.
L’Assemblée Constituante élue en octobre ne représente plus la volonté du peuple en janvier
Mais, bien évidemment, on reproche surtout aux bolcheviks le simple fait d’avoir dissout la Constituante. Ce faisant, ils auraient fait violence à la volonté populaire. Qu’en est-il ? L’Assemblée Constituante avait été élue en octobre 1917, c’est-à-dire avant la révolution du 25-26 octobre 1917, donc avant que ne soient prises les premières mesures du gouvernement soviétique, répondant aux besoins élémentaires des exploités et des opprimés. À cette époque, le parti SR était encore uni : il ne s’est divisé entre deux fractions opposées qu’après la révolution Octobre, l’une la soutenant et participant au conseil des commissaires du peuple (les « SR de gauche »), l’autre la combattant (les « SR de droite »). Les électeurs avaient ainsi voté en octobre indistinctement pour les uns ou les autres, puisqu’ils s’étaient présentés sur les listes uniques, celles du parti SR encore uni. Or, moins représentés dans les sphères dirigeantes du parti que les SR de droite, les SR de gauche ne disposaient que d’une minorité des députés élus sur cette liste. C’est pourquoi les bolcheviks et les SR de gauche ne formaient ensemble qu’une forte minorité à l’Assemblée Constituante.
Or, les élections au congrès pan-russe des soviets réuni en janvier 1918 donnent lieu à l’écrasement des SR de droite, qui n’obtiennent que 7 délégués, soit moins de 1 %, tandis que les SR de gauche raflent plus de 30 % des sièges. Ainsi les SR de droite, qui forment le groupe le plus nombreux à l’Assemblée Constituante élue sur la base des listes faites avant la révolution d’Octobre, ne représentent en réalité plus qu’une infime minorité des travailleurs en janvier. Il est donc clair que, lors de sa première réunion en janvier 1918, l’Assemblée Constituante ne représente pas du tout la volonté réelle du peuple et n’est donc pas légitime. Par contre, le système soviétique, celui des conseils ouvriers et paysans, reposant sur des élections régulières et fréquentes (octobre 1917, janvier 1918, mars 1918, juin 1918) et incluant la possibilité de révoquer ses représentants, démontre concrètement son immense supériorité démocratique sur le parlementarisme bourgeois.
Lors de la réunion de la Constituante, les mencheviks et les socialistes-révolutionnaires de droite prouvent une nouvelle fois à qu’ils ne sont que des valets de la bourgeoisie
Mais, dira-t-on, pourquoi les bolcheviks ont-ils laissé la Constituante se réunir, alors qu’ils savaient d’avance qu’ils la dissoudraient de toute façon ? Cette décision a précisément pour but de permettre le développement le moins douloureux possible de la révolution. En effet, les élections à la Constituante ont donné 21 millions aux socialistes-révolutionnaires, 9 millions de voix aux bolcheviks, 4,5 millions aux partis officiels de la bourgeoisie (les cadets et leurs alliés) et 1,7 million aux mencheviks (4). Les partis se revendiquant du socialisme, à savoir les socialistes-révolutionnaires, les bolcheviks et les mencheviks, disposent donc à eux tous d’une écrasante majorité, avec 87 % des sièges. En laissant la Constituante se réunir, les bolcheviks offrent ainsi une nouvelle fois aux mencheviks et aux SR la possibilité de rompre avec la bourgeoisie et de prouver qu’ils sont des socialistes. Pour cela, il leur suffit de reconnaître la légitimité des conquêtes de la révolution d’Octobre et le pouvoir des soviets, ouvrant la voie à un gouvernement soviétique unitaire des socialistes authentiques. Et ce dénouement est assurément celui qui aurait été le plus favorable au renforcement de la révolution. Or, les mencheviks et les SR de droite présentèrent au contraire une motion qui propose d’abolir toutes les mesures prises par le pouvoir soviétique depuis octobre, c’est-à-dire en particulier le décret sur la terre, l’adresse internationale pour mettre fin à la guerre, le décret sur le contrôle ouvrier ! Ils proposent aussi que soit instituée la suprématie de la Constituante sur les Soviets. Dans ces conditions, il était juste de dissoudre cette Constituante contre-révolutionnaire qui se camouflait sous des phrases démocratiques et socialistes. De fait, ni le prolétariat, ni les paysans ne protestèrent contre cette décision, qui correspondait à leurs intérêts, comme le confirment les résultats des élections aux soviets en janvier.
Forme et contenu de classe
Par delà les formes institutionnelles, l’enjeu de la lutte entre les Soviets et la Constituante n’était rien d’autre que la lutte entre la révolution prolétarienne et la contre-révolution bourgeoise. Après l’échec de la voie putschiste pour en finir avec la révolution (échec du coup d’État de Kornilov fin août 1917), la bourgeoisie a cherché une autre façon de mettre un terme à la révolution, qui signifiait son expropriation et sa perte du pouvoir politique. Entre septembre 1917 et janvier 1918, elle a concentré son offensive sur la question de la Constituante en arguant du caractère sacré de la « démocratie ». En fait, elle cherchait à utiliser les formes de la démocratie bourgeoise, en apparence « neutres », pour tordre le cou à la révolution prolétarienne. Dès avant l’échec de cette manœuvre, mais surtout après, la bourgeoisie russe passait à l’option militaire : elle déclenchait la guerre civile, avec l’appui des tous les pays capitalistes réunis dans une grande offensive contre la République des soviets (Japon, France, Angleterre, Roumanie, Allemagne, etc). Nous y reviendrons dans notre prochain numéro ; mais nous terminerons le présent article en montrant l’actualité de la « dictature du prolétariat », telle que les soviets dirigés par les bolcheviks l’ont mise en place, refusant de céder aux exigences et aux illusions des « démocrates » bourgeois et petits-bourgeois de tout poil.
Quelques leçons politiques pour le présent et l’avenir…
Le congrès de la LCR tenu en 2003 a décidé de rayer de son programme la lutte pour la « dictature du prolétariat », remplaçant cette formule précise par celle d’un « pouvoir des travailleurs ». Il ne s’agit pas ici d’un mot d’ordre transitoire ou d’une formulation populaire de l’objectif que signifie le concept de « dictature du prolétariat » : il s’agit d’un renoncement programmatique. Pendant deux ans, ce renoncement a notamment eu comme contenu concret l’acceptation pure et simple, par la direction de la LCR et par le « Secrétariat Unifié » dit de la « IVe Internationale » (organisation internationale dont la LCR est la section française), de la honteuse participation de leur section brésilienne (Démocratie Socialiste) au gouvernement bourgeois de Lula (avec notamment le ministre de la réforme agraire, Miguel Rossetto) (5) ! Sous couvert de refuser le « dogmatisme », il s’agit en fait d’une révision des bases mêmes du marxisme, et d’une capitulation face à l’opinion publique démocratiste petite-bourgeoise (6). Et que dire du PT, par exemple, dont le courant CCI a eu le culot de critiquer en paroles ce renoncement de la LCR… mais qui renonce tout autant au programme du communisme révolutionnaire et défend aujourd’hui la « République une et indivisible », c’est-à-dire… la dictature de la bourgeoisie ? (7)
Défense de la dictature du prolétariat
Pour les marxistes, tous les États, quelle que soit la société qui est leur base et quelle que soit leur forme, sont fondamentalement des organismes par lesquels la classe dominante assure sa domination sur les classes dominées : « L’État, écrit Engels, n’est rien d’autre chose qu’une machine pour l’oppression d’une classe par une autre, et cela, tout autant dans la république démocratique que dans la monarchie » (Préface à La Guerre civile en France de Marx). Or il en va de même de l’État prolétarien qui naît de la révolution, et qui est nécessaire pour organiser la violence de la classe ouvrière contre la bourgeoisie contre-révolutionnaire, à l’échelle nationale et internationale. Engels écrit ainsi : « L’État n’étant qu’une institution temporaire dont on est obligé de se servir dans la lutte, dans la révolution, pour réprimer par la force ses adversaires, il est parfaitement absurde de parler d’un État populaire libre : tant que le prolétariat a encore besoin d’un État, ce n’est point pour la liberté, mais pour réprimer ses adversaires. Et le jour où il devient possible de parler de liberté, l’État cesse d’exister comme tel » (Lettre à Bebel, 28 mars 1875).
La formule de « dictature du prolétariat » n’a évidemment pas été inventée par Lénine et les bolcheviks, mais par Marx. Dans la Critique du programme de Gotha (programme du parti social-démocrate d’Allemagne en 1875), Marx écrit textuellement : « Entre la société capitaliste et la société communiste se place la période de transformation révolutionnaire de celle-là en celle ci. A quoi correspond une période de transition politique, où l’État ne saurait être autre chose que la dictature révolutionnaire du prolétariat ». Cette phrase elle-même n’est que la synthèse des nombreuses indications de Marx et d’Engels sur l’État prolétarien, faites entre les révolutions de 1848 et la Commune de Paris. Certains objectent que Marx et Engels n’excluaient pas une victoire pacifique du prolétariat, du moins dans certains pays. Cela est exact : à une époque où la machine d’État, armée et police, était fort peu développée aux États-Unis et en Angleterre, ils avaient émis l’hypothèse que peut-être il serait, dans ces cas-là, possible de l’emporter sans recours direct à la violence. Mais cette époque est révolue depuis bien longtemps : dans tous les États modernes, la bourgeoisie a depuis développé un très important appareil de répression.
De plus, Marx et Engels, tirant les leçons de la Commune de Paris (qu’ils considèrent comme le premier exemple historique de la « dictature du prolétariat »), ont précisément reproché aux communards d’avoir été trop pacifistes, trop naïfs à l’égard des phrases démocratiques, en un mot : pas assez « dictatoriaux » (8). Selon eux, cette faiblesse politique a contribué à mener la la révolution à la défaite, avec le massacre par les troupes de Thiers de 30 000 ouvriers révolutionnaires et plus de 10 000 déportations au bagne. Or c’est cette leçon politique que les bolcheviks ont su tirer de l’histoire (même s’il leur est arrivé à eux aussi, comme nous l’avons signalé à eux aussi d’être trop généreux et naïfs, comme lorsqu’ils ont laissés libres les élèves-officiers de Petrograd, en échange de leur seule parole). Ils ont suivi notamment ce que disait Engels : « Ont ils jamais vu une révolution, ces messieurs [les anti autoritaires] ? Une révolution est à coup sûr la chose la plus autoritaire qui soit, un acte par lequel une partie de la population impose à l’autre partie sa volonté à coups de fusils, de baïonnettes et de canons, moyens autoritaires s’il en fut. Force est au parti vainqueur de maintenir sa domination par la crainte que ses armes inspirent aux réactionnaires. Est-ce que la Commune de Paris aurait pu se maintenir plus d’un jour si elle ne s’était servie de l’autorité d’un peuple en armes contre la bourgeoisie ? Ne pouvons-nous pas, au contraire, la blâmer de ce qu’elle ait fait trop peu usage de cette autorité ? » (9)
Défense de la "révolution permanente"
Mais alors, n’y a-t-il aucune différence entre l’État prolétarien qui naît de la révolution et tous les États qui ont existé dans l’histoire jusqu’à présent ? La différence est en réalité fondamentale : c’est que l’État prolétarien est entre les mains de la majorité (les soviets du prolétariat et de la paysannerie) et réalisent les intérêts de la majorité en servant d’instrument pour la construction du socialisme, alors que les États précédents étaient dans les mains de minorités et servaient les intérêts minoritaires. En ce sens, comme l’écrit Lénine dans L’État et la révolution, l’État prolétarien n’est déjà plus qu’un « demi-État ».
Pourtant, objectent les partisans de la voie « démocratique » vers le socialisme, comment comprendre qu’un État représentant la majorité de la population puisse encore avoir besoin de faire usage de la violence ? S’il représente réellement la majorité, n’est-il pas évident qu’il n’aura pas besoin d’y recourir ? S’il y a recours n’est-ce pas un indice clair que cet État, loin de représenter l’ensemble du prolétariat et des opprimés, ne représente qu’une minorité ? En réalité, il est évident que la bourgeoisie renversée politiquement et expropriée ne cesse pas pour autant d’exister socialement et de garder un rôle et une influence dans le pays. De plus, le renversement de la bourgeoisie dans un pays n’empêche pas qu’elle continue d’exister dans tous les autres pays. Il est donc irréaliste de raisonner comme si, après la prise du pouvoir par le prolétariat dans un pays, la bourgeoisie ne devait plus être éliminée comme classe, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Il est indéniable que la prise du pouvoir par les travailleurs dans un pays rencontre une immense sympathie parmi les prolétaires et les opprimés de tous les pays et accélère de façon formidable la lutte de classe à l’échelle internationale. Mais, tant que la révolution ne triomphe pas dans les autres pays, le premier État prolétarien reste inévitablement isolé, attaqué de l’intérieur par les forces bourgeoises qui lui résistent et essaient de se reconstituer, et entouré d’un ensemble d’États bourgeois hostiles, qui s’efforcent de le déstabiliser par tous les moyens pour le détruire. En ce sens, longtemps après avoir pris le pouvoir dans un pays, le prolétariat allié aux classes populaires est donc dans l’obligation de recourir à la violence pour maintenir son pouvoir et s’en servir pour développer la révolution à l’échelle du monde.
C’est ce qu’enseigne l’histoire de la révolution russe et de son isolement tragique, cause principale de sa dégénérescence stalinienne ultérieure de l’État prolétarien. C’est ce qu’enseigne aussi la théorie de la « révolution permanente » de Trotsky : la révolution prolétarienne socialiste ne pourra avoir lieu qu’en s’approfondissant constamment à l’intérieur de chaque pays et en s’étendant à l’échelle internationale ; elle ne cessera donc ni dans le temps, ni dans l’espace, jusqu’à la réalisation du communisme achevé.
1) Rappelons que ce coup d’État avait finalement été défait par la mobilisation des ouvriers révolutionnaires dirigés par les bolcheviks dans le cadre d’un front unique avec les SR et les mencheviks. Cf. l’article de Frédéric Traille dans Le CRI des travailleurs n° 16, janvier-février 2005.
2) Sur les premières mesures du gouvernement soviétique, cf. notre article dans le précédent numéro.
3) Nous avons tous les jours l’occasion de constater ce que la « liberté de la presse » signifie concrètement dans le régime bourgeois : le droit pour les capitalistes et leurs représentants (le gouvernement, l’ensemble des partis bourgeois, les grosses entreprises comme Bouygues, Vivendi, Hachette, Dassault…) de déverser sans discontinuer leur propagande, découpant, tronquant et falsifiant l’information et s’efforçant d’abrutir le peuple pour préserver leurs intérêts (cf. à ce sujet l’article de Laura Fonteyn dans Le CRI des travailleurs n° 16). L’actuelle campagne pour le référendum du 29 mai en est une nouvelle illustration (cf. ci-dessus l’article de Nina Pradier et Ludovic Wolfgang).
4) Si l’on exclut leurs 800 000 voix de Transcaucasie, les mencheviks réunissent en tout moins de 700 000 voix. Dans les centres industriels, ils sont tout simplement inexistants. À Petrograd et Moscou, les bolcheviks obtiennent au total 840 000 voix, contre 515 000 aux cadets, 218 000 aux SR et un nombre insignifiant aux mencheviks.
5) Sur ce point, cf. Le CRI des travailleurs n°1 (février 2003), 3 (avril 2003), 8 (octobre 2003) et 9 (novembre-décembre 2003). Ce n’est que tout récemment qu’une résolution du Comité Exécutif International de cette soi-disant « IVe Internationale » a condamné pour la première fois la participation de Démocratie socialiste au gouvernement Lula. Pourtant, le soutien à cette participation jusqu’à présent a en même temps été justifié dans cette même résolution par le prétexte de ne pas aborder la réalité à partir de « formules dogmatiques ». De plus, comme cela ressort nettement du récit fait par Jean-Philippe Divès dans Avanti ! n° 24, ce changement d’attitude n’est pas tant le produit d’une nouvelle orientation de la direction internationale qu’une timide réaction, contrainte et forcée, face à la politique de rupture politique avec le « Secrétariat Unifié » dont la direction de DS a pris l’initiative, excluant la tendance minoritaire (dont Heloisa Helena, membre de la direction internationale du SU, était la principale dirigeante) et affichant publiquement son mépris total pour cette même direction internationale et ses « conseils ». Enfin, le Comité Exécutif International continue de se prononcer pour le « maintien des relations avec toutes les parties de la section brésilienne de la IVe Internationale – qui sont tous membres de la IVe Internationale de plein droit » (résolution du CI du SU du 28 février 2005). — Au demeurant, Olivier Besancenot est lui-même plus qu’ambigu sur la nature du gouvernement auquel la LCR pourrait participer. Lire sur ce point le bon article de Sylvestre Jaffard dans Avanti n° 16, « Rupture, avec quoi ? » (cf. www.avanti-lcr.org.)
6) Il en découle que les nombreux militants de la LCR critiques ou très critiques à l’égard leur direction devraient, s’ils étaient conséquents, s’organiser authentiquement en tendance, voire en fraction, permanente, pour mener un combat pied à pied contre la direction révisionniste de la LCR, et non se borner à de simples groupement d’idées, comme c’est le cas actuellement pour certains.
7) Quant à LO, si elle réaffirme correctement la lutte pour la dictature du prolétariat dans sa revue à diffusion restreinte Lutte de classes (n° 77, décembre 2003-janvier 2004, article « Les fondements programmatiques de notre politique »), elle n’en a pas soufflé mot dans son journal hebdomadaire, diffusé à 15 000 exemplaires, où elle s’est bornée, pour toute leçon du XVe congrès de la LCR (novembre 2003), à se féliciter de l’accord électoral LO-LCR pour les régionales et européennes ! (Lutte ouvrière n° 1840 du 7 novembre 2003.)
8) Il faut d’ailleurs préciser que l’argument fort répandu selon laquelle la Commune aurait été plus démocratique que la révolution russe parce qu’elle aurait conservé le suffrage universel est erroné : les élections de La Commune ont eu lieu après le départ de Paris des bourgeois et de leurs amis pour Versailles ; en ce sens, le maintien formel du suffrage universel n’a pas empêché que, de fait, seuls les prolétaires et les exploités ont pu voter. Et surtout, il faut rappeler à tous les professeurs de « démocratie pure » que le gouvernement de la Commune est bien sûr le produit d’une insurrection parfaitement illégale du prolétariat de Paris contre le gouvernement bourgeois légal.
9) Fr. Engels, À propos de l’autorité. — Faut-il rappeler que tous les exemples historiques après Octobre 1917 ont confirmé cette vérité (malheureusement pour les travailleurs, toujours par la négative, c’est-à-dire toujours par l’écrasement du prolétariat s’engageant sur la voie de la révolution) ? On peut en donner quelques-uns : écrasement des conseils ouvriers en Allemagne en 1919 par le gouvernement SPD dirigé par Ebert avec l’appui des troupes d’élite de l’armée ; liquidation du mouvement ouvrier italien par les fascistes dès 1922 ; écrasement préventif du puissant mouvement ouvrier chinois par le Kuomintang en 1927 ; liquidation du mouvement ouvrier par le national-socialisme à partir de 1933 ; écrasement des conseils par l’armée de la bureaucratie « soviétique » en 1956 en Hongrie et en 1968 en Tchécoslovaquie ; liquidation du mouvement ouvrier au Chili par un coup d’État militaire appuyé par la CIA en 1973 après que Allende, arrivé au pouvoir par les élections, eut engagé des mesures commençant à s’attaquer à la propriété capitaliste et eut refusé d’armer les ouvriers et les paysans au nom de la « démocratie » formelle…