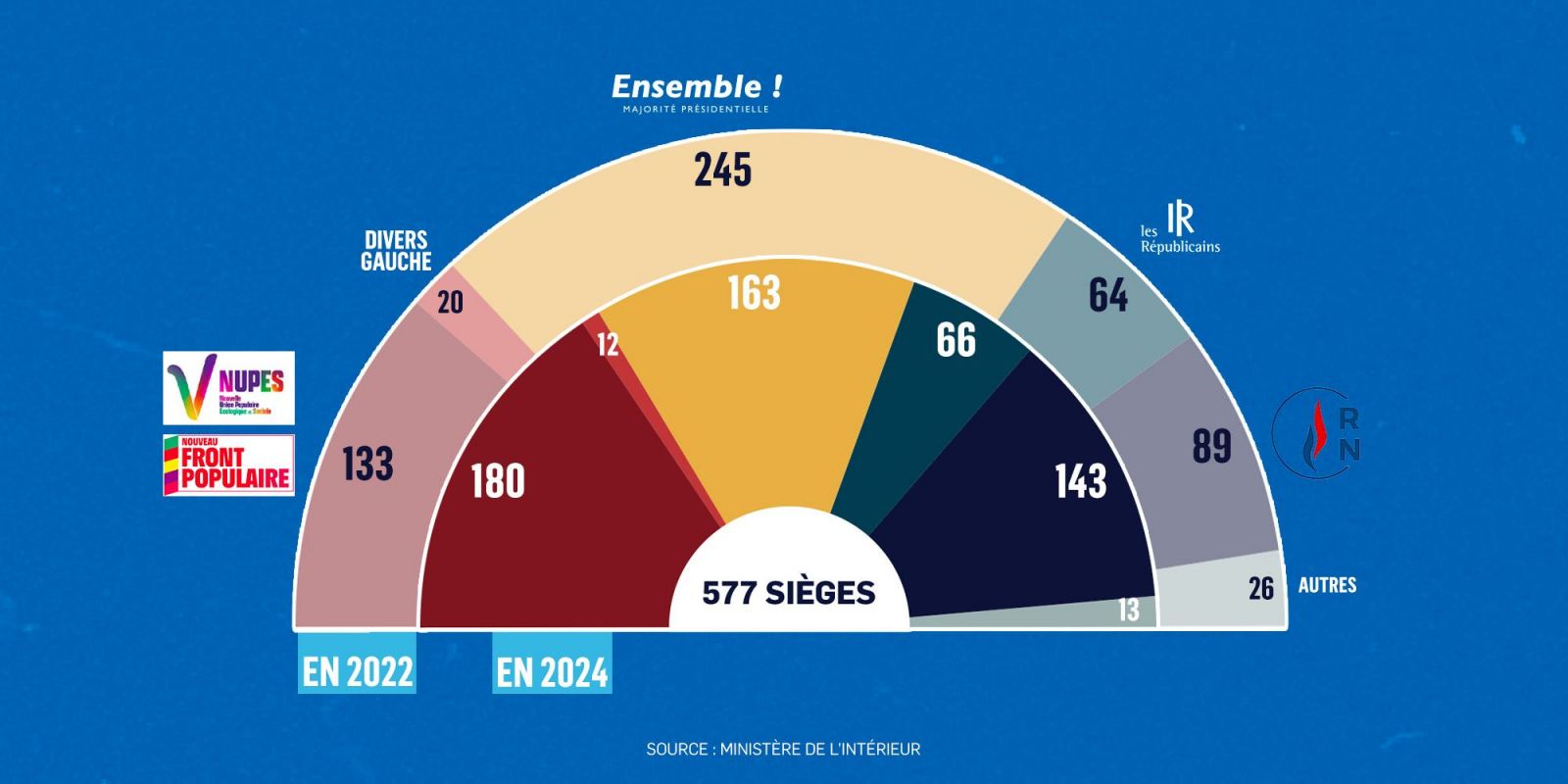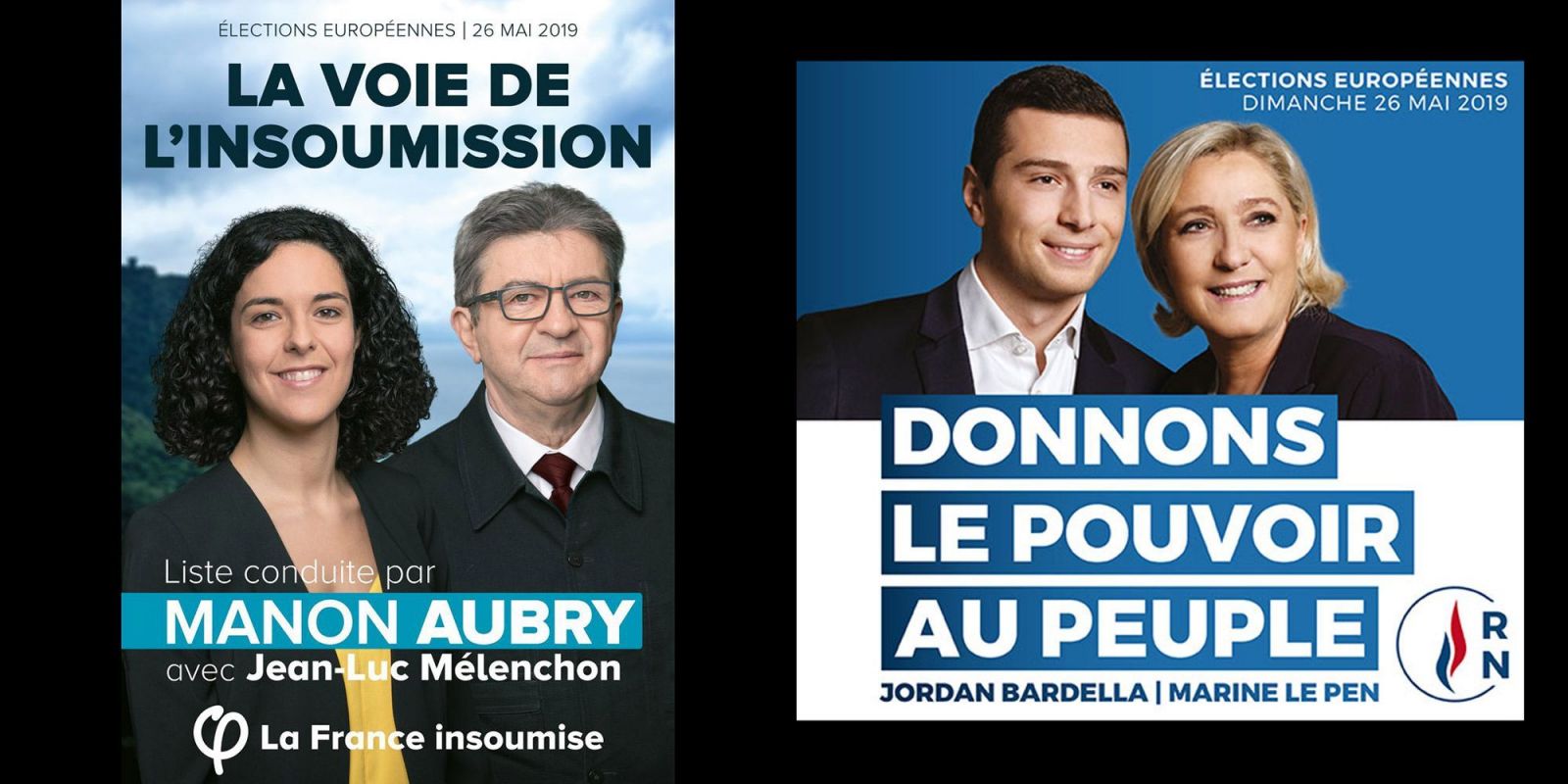Agenda militant
Ailleurs sur le Web
![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)
- La loi du plus fort - La chronique de Pierre-Emmanuel Barré (12/01)
- Retour sur le blocage du périph’ - A propos de la résistance à l’accord UE-Mercosur et à la politique d’abattage total. (12/01)
- Venezuela : des médias intoxiqués par la propagande de guerre (12/01)
- Où vivent les plus riches ? Ce que la géographie des hauts revenus dit des fractures françaises (11/01)
- Une récompense pour les criminels ! Le prix Nobel de la « paix » (11/01)
- La crise de la gauche portugaise. Entretien avec Catarina Príncipe (11/01)
- Victor Klemperer, critique impitoyable du sionisme (11/01)
- USA - VENEZUELA : UNE OPÉRATION MAFIEUSE SALUÉE PAR LES "COLLABOS" - Maurice Lemoine (11/01)
- Le paradoxe de la Sécurité sociale : et si, pour faire des économies, il fallait l’étendre ? (11/01)
- LFI : Soutien au peuple venézuélien contre l’agression de Trump ! (10/01)
- Du militarisme à gauche. Réponse à Usul et à Romain Huët (09/01)
- Face à l’impérialisme trumpiste : ne rien céder (08/01)
- Attaque américaine au Venezuela : ce que révèle le "zéro mort" de franceinfo (08/01)
- Que signifie "abolir la monnaie" ? (08/01)
- Abject dessin antisémite dans Marianne contre le député LFI Rodriguo Arenas (08/01)
- "ILS FONT LE SAV DE TRUMP !" CE QUE DISENT LES MÉDIAS FRANÇAIS SUR LE VENEZUELA (08/01)
- VENEZUELA : CE QUE NE DIT PAS LA PROPAGANDE DE TRUMP (08/01)
- Les États-Unis prennent d’assaut le territoire et le gouvernement du Venezuela (08/01)
- Les systèmes militaro-industriels, noyau totalitaire du capitalisme contemporain (08/01)
- LE KIDNAPPING DE MADURO - LE BANDITISME D’ÉTAT AMÉRICAIN (08/01)
- Le Moment politique de Mélenchon (06/01)
- In memoriam Mohammed Harbi (1933-2026) (05/01)
- "Coup de Caracas" : enlever Maduro pour voler le pétrole ? Pas sûr que ça marche (04/01)
- Venezuela : déclaration de l’Institut des Hautes Études de l’Amérique Latine (IHEAL) (04/01)
- Interventions de Mélenchon place de la République samedi soir (03/01)
Liens
Il n’y a rien à attendre d’un éventuel gouvernement du PS! Retour sur le bilan de la «gauche plurielle» au pouvoir (1997-2002)
Nous publions ici un bilan du gouvernement Jospin-Buffet-Mélenchon de 1997-2002. Cet article a été écrit quelques mois avant les précédentes élections présidentielles, mais il n’a rien perdu de son actualité. Au moment où il est vraisemblable que le PS revienne au pouvoir avec sans doute le soutien plus ou moins franc du Front de gauche, il est juste de nous rafraîchir la mémoire. D’autant plus que la politique d’austérité qui s’annonce avec Hollande dans une situation de crise internationale sans précédent sera incomparablement pire que la politique déjà bien réactionnaire menée par Jospin pendant une période de croissance assez soutenue...
Peu de prolétaires et de jeunes se font d’illusions sur les capacités et la volonté du PS d’améliorer leur sort s’il emporte les prochaines élections. Certains, cependant, se demandent s’il ne vaut pas mieux porter ce parti au pouvoir pour faire barrage à Sarkozy et à la droite, dans l’idée que la politique de la « gauche » serait, sinon meilleure que l’actuelle, en tout cas « moins pire ». Cet état d’esprit exprime une certaine lucidité, tout à fait saine en elle-même, impliquant un fort recul des illusions réformistes qui prévalaient jusqu’aux années 1980 ; mais, en même temps, un tel raisonnement reflète une crise profonde de la politique en tant qu’instance capable de porter des projets alternatifs et des espoirs pour les masses : on ne se prononce plus pour un programme, mais on se sert du vote pour éliminer tels ou tels politiciens. Dans cette situation, les communistes révolutionnaires ont plus que jamais à proposer clairement aux travailleurs et aux jeunes leur propre programme : ils n’ont pas à céder aux sirènes du prétendu « réalisme » consistant à porter au pouvoir le PS et ses alliés sous prétexte de « battre la droite ».
En effet, le patronat et les gouvernements à son service, quels qu’ils soient, ne peuvent être réellement « battus » que par la lutte de classe. Leurs défaites électorales ne constituent absolument pas un but en soi, même si elles peuvent avoir tactiquement de l’importance dans certaines circonstances (ce fut le cas notamment lors du référendum du 29 mai 2005, qui a affaibli Chirac et son gouvernement, mais aussi le PS dont la direction appelait à voter Oui). Pour les communistes révolutionnaires, ce qui compte avant tout est de faire progresser la combativité, le degré d’organisation et la conscience de classe du prolétariat et des opprimés. Dans cette perspective, il peut être juste d’appeler à voter pour un parti réformiste quand il n’a pas exercé le pouvoir depuis longtemps et qu’une partie importante des travailleurs se font des illusions à son sujet : il faut alors les aider à faire leur propre expérience quant à la réalité de ce parti en accompagnant le mouvement par lequel ils le portent au pouvoir. En revanche, quand les travailleurs n’ont plus d’illusions à l’égard de tels partis, et a fortiori quand ceux-ci sont devenus de purs et simples partis bourgeois, comme c’est le cas du PS aujourd’hui, il n’est pas possible d’appeler à voter pour eux, mais il faut consacrer toutes les forces à la préparation d’une puissante résistance aux attaques de la bourgeoisie, avec l’objectif d’une contre-offensive générale et décisive.
Or il ne s’agit pas là de principes abstraits : s’il revient au pouvoir, le PS ne mènera en aucun cas une politique favorable au prolétariat et à la jeunesse. Ce serait retomber dans les pires illusions réformistes que de prétendre le pousser à prendre des mesures progressistes. Tout ce que pourront faire les travailleurs et les jeunes, c’est de résister aux attaques d’un éventuel gouvernement de gauche, qui s’inscriront dans la continuité de celles de l’actuel gouvernement de droite. La question de vaincre le gouvernement du PS ne se poserait pas moins fortement que celle de battre le gouvernement actuel. De manière générale, dans le cadre de l’État bourgeois, même « démocratique », c’est le patronat qui gouverne, non le gouvernement officiel. Et, en ce qui concerne le PS en particulier, l’expérience récente montre que, quand il était « aux affaires », il n’a jamais rien fait pour contrer les exigences des capitalistes, mais qu’il s’y est au contraire constamment plié. C’est pourquoi il est tout particulièrement utile de rappeler les traits les plus saillants de la politique mise en œuvre pendant cinq ans par la « gauche plurielle » sous le gouvernement Jospin.
Élue après la puissante lutte de classe de novembre-décembre 1995, la « gauche plurielle » n’a fait que poursuivre et aggraver la politique anti-ouvrière de Balladur et Juppé
Après le puissant mouvement de novembre-décembre 1995 (contre le plan Juppé sur la Sécurité sociale, le projet de réforme des retraites des fonctionnaires et le contrat de plan État/SNCF), le gouvernement Chirac-Juppé est considérablement affaibli et ne parvient pas à mener efficacement la politique qu’exige de lui la bourgeoisie française. Moins de deux ans après sa victoire à la présidentielle de 1995, Chirac se résout donc à tenter le tout pour le tout en décidant la dissolution de l’Assemblée nationale : il espère une relégitimation par les urnes de sa politique partiellement mise en échec dans la rue. Mais sa défaite est cuisante : la coalition de « gauche plurielle » (PS, PCF, Verts, MDC, Radicaux de gauche) s’impose aux élections législatives anticipées de 1997. Lionel Jospin est nommé Premier ministre par Chirac (c’est la troisième « cohabitation » en onze ans) et constitue un gouvernement où se trouvent à la fois des chefs du PS (Strauss-Kahn, Allegre, Royal, Lang, Aubry…), du PCF (Gayssot, Buffet), des Verts (Voynet) et du MDC (Chevènement).
L’une des premières décisions de Jospin est de laisser fermer l’usine de Renault-Vilvorde (Belgique), alors que lui-même et l’ensemble des partis de la gauche plurielle avaient manifesté contre cette décision quelques mois avant leur élection et s’étaient engagés à empêcher sa liquidation s’ils revenaient au pouvoir. À partir de là, Jospin et ses ministres n’auront de cesse de réitérer leur refus de s’en prendre aux intérêts patronaux, fût-ce manière limitée. Par exemple, à la rentrée 1999, au moment où 7 500 suppressions d’emplois sont annoncées par Michelin, Jospin déclare sur France 2 : « Je ne crois pas que l’on puisse administrer l’économie. Il ne faut pas attendre tout de l’État. » De même, en avril 2001, la ministre Élisabeth Guigou affirme à l’Assemblée nationale : « La loi ne peut pas tout. Il ne faut pas semer de fausses illusions. » En fait, la seule fois où Jospin fait mine de critiquer les capitalistes, c’est quand il se défausse de ses responsabilités en refusant de venir en aide aux victimes de la catastrophique tempête de 1999 : « Le gouvernement n’entend pas se substituer aux assurances privées », déclare-t-il pour justifier son refus de donner de l’argent aux sinistrés…
Pourtant, le gouvernement Jospin n’est nullement impuissant : il sait très bien faire prendre des mesures efficaces… quand il s’agit de servir les intérêts des patrons et de démanteler les uns après les autres les droits des travailleurs et les services publics. C’est ainsi que, après avoir refusé d’augmenter les minima sociaux en 1998 (déclenchant un fort mouvement des chômeurs contre sa politique), il cautionne, en 1999-2000, une réforme de l’Unedic qui aggrave considérablement la subordination de l’assurance-chômage au flicage généralisé des demandeurs d’emploi. Puis, en octobre 2000, Jospin et Aubry approuvent l’accord passé entre le MEDEF et la CFDT instaurant le PARE, destiné à individualiser les droits de chômeurs et à radier ceux qui n’acceptent pas n’importe quel travail : c’est cet accord, s’appliquant depuis juillet 2001, qui explique les dizaines de milliers de radiations annuelles que nous connaissons depuis. Un mois plus tard, en application de directives européennes, l’Assemblée nationale dominée par la « gauche » brise des acquis fondamentaux du mouvement ouvrier en autorisant le travail de nuit des femmes dans l’industrie et en rétablissant l’autorisation du travail des enfants à partir de 13 ans.
Les lois Aubry déréglementent le temps de travail
Mais les lois Aubry, dira-t-on, n’ont-elles pas permis une diminution du temps de travail, ne sont-elles pas un acquis des travailleurs ? En fait, cette mesure-phare du gouvernement Jospin ne se contente nullement de répondre à une revendication fondamentale des travailleurs : en réduisant d’un côté le temps de travail annuel, elle introduit de l’autre une série de dispositions qui sont en fait tout à l’avantage des patrons : non seulement les entreprises bénéficient de nouveaux crédits d’impôts substantiels et de nouvelles exonérations de cotisations sociales, mais l’annualisation du temps de travail accroît la durée de nombreuses journées et semaines de travail (flexibilité des horaires) et bloque les salaires (notamment par l’instauration d’un double SMIC et par la suppression de la majoration des heures supplémentaires qui étaient antérieurement prises en compte sur une base hebdomadaire). De plus, les lois Aubry mettent en cause le « principe de faveur », en autorisant des accords d’entreprise à déroger aux règles plus favorables des conventions collectives. Dès lors, il n’y a rien d’étonnant à ce que les grèves se multiplient dans les entreprises au moment où les lois Aubry s’appliquent concrètement (grèves malheureusement dispersées par la tactique des directions syndicales complices du gouvernement, mais parfois puissantes, comme celle des travailleurs de la SNCF en mai 1999). Et il n’est pas plus surprenant que Martine Aubry elle-même déclare à l’Assemblée Nationale, en février 1998, que sa loi est une « véritable opportunité pour les entreprises ».
Application du plan Juppé, budgets maastrichtiens et privatisations des services publics
Dès l’élaboration de leur premier budget, à l’automne 1997, les députés de gauche appliquent le plan Juppé contre la Sécurité sociale (le PCF s’abstenant), alors que tous leurs partis s’y étaient opposés en décembre 1995, sous la pression de la lutte de classe. Puis, année après année, leurs lois de financement de la Sécurité sociale n’auront de cesse d’augmenter les exonérations de cotisations patronales (jusqu’à 17 milliards d’euros) et de prévoir des plans d’économies toujours plus drastiques au détriment des assurés sociaux. Au moyen de « l’enveloppe globale », ils imposent notamment une restructuration des hôpitaux, sommés de réaliser des économies à n’importe quel prix : cela se traduit par la fermeture de milliers de lits, de centaines de services d’urgence (plan Kouchner de mars 1998), de nombreux établissements spécialisés pour les enfants handicapés, de maternités, de services psychiatriques, voire d’hôpitaux entiers (comme l’hôpital Rothschild à Paris). Pour faire croire à bon compte qu’il mène une politique favorable aux plus démunis, le gouvernement Jospin met en place la CMU (Couverture Maladie Universelle) en 1999 ; mais au lieu d’étendre les droits de la Sécurité sociale à ceux qui en sont privés, cette opération très médiatique, accompagnée d’énormes larmes de crocodiles, introduit le « principe » ignoble du « panier de soins et de services médicaux » : celui-ci consiste en une enveloppe financière à ne pas dépasser, interdisant ainsi aux malades les plus pauvres d’être soignés comme les autres, selon leurs besoins.
De manière générale, la politique budgétaire du gouvernement Jospin, cadrée par le Traité de Maastricht, le Traité d’Amsterdam (ratifié au printemps 1998) et la préparation du passage à l’euro, consiste à limiter drastiquement des dépenses publiques, à augmenter les impôts payés par les travailleurs et à alléger ceux des patrons. C’est ainsi qu’il maintient l’augmentation de la TVA de 2 %, décidée par Juppé, alors que les partis de gauche l’avaient dénoncée avant d’arriver au pouvoir. De plus, il augmente le montant de la redevance audiovisuelle et il décide, dès l’automne 1997, d’intégrer les indemnités de maternité dans le revenu imposable, accroissant ainsi le nombre de ménages soumis à l’impôt sur le revenu et le montant des impôts de ceux qui le paient déjà. En revanche, le gouvernement de « gauche » multiplie les crédits d’impôts pour les patrons qui embauchent, bien qu’il s’agisse surtout de contrats précaires, allège la taxe professionnelle et, chaque année, un nombre croissant d’impôts payés par les entreprises.
Au lieu de lutter contre la précarité, le gouvernement Jospin ajoute un nouveau type de contrats précaires à ceux qui existent déjà : ce sont les fameux « emplois-jeunes ». Si 300 000 jeunes en signent pour assurer leur survie, aucun avenir ne leur est garanti : de fait, la plupart seront « remerciés » au bout de cinq ans au plus. Dans le même temps, le ministre de l’Éducation Claude Allègre annonce son projet de « dégraisser le mammouth », c’est-à-dire de réduire le nombre d’emplois dans l’Éducation nationale. Il supprime 3 000 postes statutaires de surveillants (MI-SE), de nombreux postes d’agents administratifs (notamment par la mise en place de la gestion déconcentrée des personnels) et des milliers de postes aux concours de l’enseignement (alors que les enseignants, les élèves et les parents revendiquent plus de moyens, avec notamment une puissante mobilisation en Seine-Saint-Denis). Parallèlement, Allègre, avec sa complice Ségolène Royal qui est alors ministre deleguée de l’enseignement scolaire, aggrave l’autonomie des établissements et instaure les « contrats éducatifs locaux » (rentrée 1998), mettant en cause l’égalité des droits et le caractère national des programmes. Après la démission d’Allègre sous la pression d’un puissant mouvement des enseignants, Lang poursuit la même politique, se contentant de formules plus courtoises. Il décide en outre la mise en place de la réforme dite « LMD » des diplômes universitaires, au nom de l’« harmonisation européenne », en fait pour démanteler le caractère national des diplômes, leur contenu d’enseignement et l’égalité des droits qui leur était liée.
Tous les services publics sont touchés par la politique régressive du gouvernement de « gauche plurielle », qui avalise l’ensemble des décisions des sommets européens successifs (où Chirac et Jospin parlent d’une seule voix), impulse une politique d’intercommunalité forcée destructrice des services publics de proximité (loi Chevènement de février 1999) et privatise à lui seul plus que Balladur et Juppé réunis. Il procède notamment à l’« ouverture du capital » de France Telecom et d’Air France (été 1998), ainsi qu’à l’ouverture à la concurrence (fin du monopole pour de nombreuses activités) des marchés de La Poste (ordonnances d’octobre 2000) et d’EDF-GDF (février 1999). Il privatise le Crédit lyonnais, le CIC, Thomson-CSF et Aérospatiale. Le ministre PCF Gayssot fait éclater la SNCF par la création du RFF (Réseau Ferré Français), séparant les activités liées aux infrastructures et celles de l’exploitation pour préparer l’ouverture à la concurrence et la privatisation. Tandis que la baisse du taux de rémunération du livret A est décidée (été 1999), le statut des Caisses d’épargne est aligné sur celui des banques classiques (février 2001). Au ministère des finances, Christian Sautter essaie de faire passer une contre-réforme en février 2000, provoquant une puissante mobilisation qui le contraint finalement à reculer, puis à démissionner.
Enfin, Jospin lance (à partir de l’été 2000) un plan de destruction de milliers de logements sociaux alors qu’il en manque cruellement dans la plupart des communes urbaines. Cela contribue à augmenter les loyers des HLM (sous prétexte de réhabilitation) et s’accompagne d’une politique de généreuses subventions pour le logement privé.
Mesures contre les sans-papiers et les immigrés, politique impérialiste
Le gouvernement Jospin-Chevènement refuse de régulariser globalement les sans-papiers, se contenant d’en régulariser une partie après un examen des dossiers au cas par cas, qui permet aussi un fichage généralisé. Il condamne ainsi des centaines de milliers de travailleurs et leurs familles à continuer à vivre dans la clandestinité, victimes quotidiennes des patrons et de la police.
De plus, en décembre 1997, la loi Guigou alourdit les conditions d’acquisition de la nationalité française pour les personnes nées en France. Et, en janvier 1998, la loi Chevènement reprend à son compte l’ensemble des lois anti-immigrés de ses prédécesseurs, y compris les lois Pasqua-Debré dénoncées par la gauche quand elle était dans l’opposition, et elle les aggrave même, notamment en prolongeant la durée de détention possible de 10 à 12 jours pour les étrangers en situation irrégulière. Dans ce cadre, des expulsions d’étrangers ont lieu régulièrement, pavant la voie à la politique actuelle de Sarkozy.
Quant à la politique impérialiste de la France, Jospin marche main dans la main avec Chirac, se contenant de regretter que l’ONU n’ait pas été consultée lorsque le gouvernement étatsunien bombarde l’Irak (notamment en février et décembre 1998) et participant directement au bombardement de la Yougoslavie dans le cadre de l’OTAN (Chevènement démissionne alors du gouvernement, mais non Buffet et Gayssot, qui se contentent de gémir lamentablement), puis à l’intervention impérialiste en Afghanistan à l’automne 2001.
Préparation des mesures mises en place par Raffarin-Fillon
Enfin, le gouvernement Jospin avait préparé d’autres contre-réformes majeures, qu’il n’a pas eu le temps de mettre en œuvre lui-même, passant finalement le relais à Raffarin. En particulier, dès octobre 2000, une commission est mise en place sous la direction de Pierre Mauroy pour approfondir la régionalisation, l’intercommunalité forcée et le transfert des personnels techniques et administratifs de l’Éducation nationale aux collectivités territoriales. Les conclusions de ce rapport seront largement mises en œuvre par la loi de décentralisation de Raffarin en 2003.
De même, Jospin a largement engagé la préparation de la contre-réforme des retraites finalement imposée par Fillon. Il avait commandé au commissaire au plan Charpin un rapport préparatoire, paru au début de l’année 1999, qui préconisait notamment la contre-réforme des régimes spéciaux. L’année suivante, en février 2000, le rapport Teulade propose de mettre en place des fonds de pensions. La loi Fabius de 2001 commence à réaliser ce programme, avec la mise en place d’une épargne salariale présentée comme « fonds de pensions à la française », c’est-à-dire consistant en une capitalisation accompagnée de quelques « garanties ». Enfin, au sommet européen de Barcelone, Jospin signe avec Chirac l’engagement d’élever l’âge de la retraite pour les fonctionnaires et pour tous les salariés, ouvrant la voie à ce qui deviendra la contre-réforme contre laquelle des millions de travailleurs se sont mobilisés au printemps 2003…
Finalement, à l’exception du PACS, mesure progressiste malgré son insuffisance (il maintient une inégalité entre les couples mariés et non-mariés, il ne s’accompagne pas du droit à l’adoption pour les couples homosexuels, etc.), c’est bien l’ensemble de la politique du gouvernement Jospin qui a été régressive si l’on se place du point de vue des intérêts des prolétaires et de la majorité de la population. C’est pourquoi, lors de l’élection présidentielle du 21 avril 2002, 32 % des électeurs se sont abstenus ou ont voté blanc, le PS a perdu 2,5 millions de voix, le PCF s’est effondré en perdant 2/3 des siennes par rapport à 1995, alors que les forces d’« extrême gauche » (LO, LCR et PT) doublaient leurs scores en dépassant la barre des 10 %, avec 3 millions de voix en tout. Cette sanction populaire du gouvernement Jospin avait d’ailleurs été annoncée l’année précédente, en mars 2001, au moment des élections municipales, où la « gauche plurielle » avait gagné les villes bourgeoises de Paris et de Lyon, mais perdu une quarantaine de villes de plus de 20 000 habitants, notamment celles où se présentaient des ministres en poste (Guigou, Trautmann, Lang, Mélenchon, Voynet, Gayssot…).
Aujourd’hui, les communistes révolutionnaires doivent rafraîchir les mémoires, refuser de céder au chantage du « vote utile » et à l’épouvantail de l’extrême droite, dont la progression ne s’explique que par les dégâts du capitalisme et de la politique « alternée » de la droite et de la gauche à son service. Seule la lutte de classe la plus résolue, guidée par un programme anti-capitaliste clair et conséquent, pourra faire reculer et vaincre la bourgeoisie, ses gouvernements et ses forces politiques de toutes les nuances. Ce n’est que dans cette perspective que la question de la participation tactique aux élections doit être posée, avec l’objectif de faire connaître à des millions de travailleurs et de jeunes un véritable programme anti-capitaliste capable de faire progresser leur conscience, de leur donner envie de s’organiser politiquement et de nourrir leurs luttes de classe directes.