Agenda militant
Ailleurs sur le Web
![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)
- Quelles perspectives pour les Kurdes au Moyen-Orient ? (27/12)
- Cuba : le mouvement du social (27/12)
- Procès de Georges Ibrahim Abdallah : la victoire est-elle proche ? (26/12)
- Île Maurice : la volonté de changement (26/12)
- Le socialisme dans un seul pays (26/12)
- Quel avenir pour la France insoumise ? (26/12)
- Les changements tectoniques dans les relations mondiales provoquent des explosions volcaniques (26/12)
- Un nouveau château de cartes (26/12)
- Le syndicalisme de Charles Piaget (26/12)
- Nabil Salih, Retour à Bagdad (26/12)
- La Syrie est-elle entre les mains d’Erdoğan ? (26/12)
- L’UE encourage l’exploitation du lithium en Serbie avec un grand cynisme (26/12)
- Le contrôle territorial d’Israël s’étend-il vers la Syrie ? (26/12)
- Scrutin TPE – Très Petite Élection (26/12)
- Une étudiante ingénieure déchire son diplôme en pleine cérémonie en protestation contre l’industrie d’armement (26/12)
- Des étudiants en lutte pour la paix : blocage historique à Tolbiac Paris I (24/12)
- Aurélie Trouvé sur RTL ce lundi (23/12)
- RÉVÉLATIONS DE MARC ENDEWELD SUR MACRON ET SON ENTOURAGE (23/12)
- La Grèce sous Kyriakos Mitsotakis: de la frustration sociale à la crise politique (23/12)
- Syrie : “Entre discours réformiste et répression réelle : Comment HTS a géré les manifestations à Idlib” (23/12)
- Contre les GAFAM, redécouvrir Jacques Ellul (23/12)
- Dialogue avec Benjamin Lemoine: les fonds vautours à l’assaut de la dette mondiale (23/12)
- Le cyclone Chido et la responsabilité de l’impérialisme français (22/12)
- Aurélie Trouvé sur France Info (22/12)
- Entretien avec Aymeric Caron - Palestine, antispécisme et journalisme (22/12)
Mai-juin 1968 en France

Grève générale mais situation révolutionnaire trahie
« Le pouvoir aux travailleurs ! », « Gouvernement ouvrier ! » Dans les entreprises occupées, dans les manifestations monstres, dans les assemblées générales et les meetings improvisés, en ces mois de mai et juin 1968, l’exigence est montée, disant l’espoir d’en finir avec un régime — le gaullisme autoritaire et policier —, un système — le capitalisme exploiteur de la force de travail humaine s’épuisant au nom des exigences du profit —, un ordre néo-colonial — l’impérialisme n’en finissant pas de piller les ressources des peuples dominés, voire, purement et simplement, de les massacrer. En mai et juin 1968, des millions de travailleurs brisent avec le quotidien de leur exploitation et l’enchaînement à la logique des normes industrielles et productivistes. Ils se réapproprient la parole confisquée jusqu’alors par l’idéologie dominante et ses instruments divers. Des milliers de tracts et de cahiers de revendications sont élaborés collectivement. Sur la Sorbonne, le Palais de Justice, la Bourse du Travail, sur le toit des usines flottent des drapeaux rouges. Toute l’économie est paralysée : pas d’essence donc pas de voiture, pas d’autobus, pas de métro, pas de train, les usines arrêtées, les bureaux et les écoles fermées. Le système capitaliste est frappé au cœur. L’ordre bourgeois est mis à mal, tant c’est le mode de gestion des entreprises capitalistes qui est directement contesté. Au cours de cette grève générale gigantesque et inédite, se dessinent les contours d’une situation révolutionnaire, qui n’est d’ailleurs pas nationale, mais mondiale, avec des luttes étudiantes et ouvrières dans de très nombreux pays, parfois férocement réprimées, comme à Mexico à la veille de l’organisation des Jeux olympiques, ou à Prague en août 1968. La France seule cependant connaît une grève générale.
Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et de façon sans cesse accrue durant les années 1960, l’impérialisme est contesté au niveau mondial : la lutte anti-impérialiste rassemble des forces de plus en plus nombreuses et résolues ; elle sera un puissant détonateur des combats de 1968 en France et dans le monde. L’impérialisme français a dû céder face aux coups de boutoir des peuples qu’il avait colonisés ; il a mené deux guerres, en Indochine (1946-1954) puis en Algérie (1954-1962), révélant tout à la fois la misère de la population dans ces territoires dominés, la détermination des combattants pour l’indépendance et l’atrocité des pratiques utilisées par l’armée impérialiste, notamment la torture. En Algérie comme en France, le pouvoir use d’une violence exacerbée contre tous ceux qui contestent sa domination, violence qui laisse des traces et demeure de longues années durant dans les mémoires. À Cuba, le renversement du dictateur Batista et la prise de pouvoir par les castristes en 1959 viennent défier l’impérialisme américain à sa porte. Au Vietnam, l’armée américaine engagée depuis 1965 s’enlise ; la médiatisation internationale du conflit expose là aussi les atrocités commises par les troupes US contre la population vietnamienne, qui résiste victorieusement malgré la technologie et l’armement de la première puissance impérialiste mondiale ; elle provoque une vague d’indignation qui revêt bientôt la forme d’une lutte fortement structurée, notamment dans les campus des universités, dans de nombreux pays, dont les États-Unis. Dans le même temps, les partis « communistes » à la botte de Moscou entérinent la « coexistence pacifique » entre les puissances impérialistes et la bureaucratie stalinienne et écrasent, par l’épuration ou la répression sanglante (Hongrie 1956 et bientôt Tchécoslovaquie 1968), toute forme de contestation réellement révolutionnaire.
Dans ces circonstances, la grève générale de mai-juin 1968 en France marque une étape décisive dans un cycle très intense de la lutte de classe, caractérisé par de nombreuses grèves ouvrières et par la montée en puissance de la contestation étudiante. Certes, la croissance économique est forte au cours de cette période, de 6 % par an en moyenne. Mais certains secteurs sont particulièrement touchés par un retard salarial dans cette conjoncture d’inflation ; c’est le cas des mineurs, dont les salaires sont inférieurs de 11,5 % à la moyenne des salaires dans l’industrie. La crainte du chômage, sans être encore massive, est bien réelle : nombreux sont, avant et pendant Mai, les slogans protestant contre « le chômage et les salaires de misère ». En 1968, on recense près de 360 000 demandeurs d’emploi, contre 170 000 en 1966. Les jeunes travailleurs sont les plus touchés par cette progression du chômage : entre 1966 et 1967, le nombre de chômeurs recensés croît de 64 % dans la tranche d’âge des 18-24 ans, contre 41 % en moyenne. « Ces premiers signes de détérioration n’ont certes pas la même portée que la montée du chômage dans les années 1970 (1) » ; toutefois, certains secteurs entrent déjà en crise : c’est le cas des charbonnages, du secteur textile, de la sidérurgie. Au cours des années 1960, plus de 100 000 emplois sont supprimés dans le textile, plus de 85 000 dans les charbonnages et plus de 45 000 dans la sidérurgie (2). Au cœur de ces prétendues « Trente Glorieuses », les conditions de travail restent très dures, dans l’enfer des cadences du système tayloriste et du travail parcellisé, où les salaires au rendement sont légion, et les semaines de travail de plus de 45 heures, courantes. La souffrance au travail est vive, et plus encore pour certaines catégories d’ouvriers, les travailleurs immigrés, le plus souvent manœuvres ou OS, et les femmes, victimes en outre de discriminations salariales. Le capitalisme est de plus en plus concentré, ce qui accentue plus que jamais la division du travail.
Un cycle de puissantes luttes de classe
1963-1967 : intensité de la lutte de classe et trahison systématique des appareils
Dans ce contexte, un cycle nouveau de la lutte des classes s’ouvre en mars 1963, avec la puissante grève générale des mineurs, longue de cinq semaines. Le gouvernement De Gaulle-Pompidou ne parvient pas à la réduire. Il tente bien de recourir à la réquisition, mais la détermination des travailleurs des mines fait échouer cette tentative de briser leur grève. Seule la trahison des appareils syndicaux parvient à venir à bout de ce combat des mineurs. Et c’est l’autre caractéristique de la période — qui certes ne lui est pas spécifique, mais qui se révèle décisive en cette ère de montée des luttes : les directions syndicales mettent tout en œuvre pour garder la main sur ces mobilisations ouvrières, les contrôler et les canaliser. Dans ce but, elles empêchent toute convergence entre les travailleurs. Ainsi, en ce mois de mars 1963, différents secteurs entrent en lutte pour une ou plusieurs journées de grève extrêmement suivies : SNCF, RATP, EDF, PTT, sidérurgistes de Lorraine, salariés de la chimie et d’autres grandes entreprises dans la région parisienne, à Lyon, Nantes, Toulouse. Ainsi encore, le 13 mars 1963, lorsque plusieurs milliers de mineurs lorrains viennent manifester à Paris, ils sont accueillis par des ouvriers du dépôt de Clichy de la RATP qui se sont mis en grève par solidarité et se rassemblent au cri de « Grève générale : c’est l’aide aux mineurs ». Le bureau confédéral de la CGT rétorque alors que la grève générale n’est rien d’autre qu’une vue de l’esprit chimérique : « Vous proposez la grève générale à l’appel des trois centrales syndicales, c’est une idée aussi séduisante qu’utopique (…), une solution de facilité (…) (3). » En guise de solidarité avec les mineurs, la direction de la CGT se contente d’organiser des collectes…
Il y a dans cet événement un double trait structurant de la période : combativité puissante des travailleurs d’une part, obstacle dressé par les appareils d’autre part. Alors même que la perspective de la généralisation de la grève se dessine dans bien des secteurs mobilisés — et c’est le sens de l’appel adressé par les personnels du dépôt de Clichy de la RATP aux confédérations syndicales : « La seule façon pour que la victoire des mineurs et la nôtre soient totales, c’est : tous ensemble dans la grève » —, lesdites confédérations et leurs relais fédéraux et locaux entendent à toute force empêcher une grève générale qu’ils ne pourraient pas maîtriser et qui rapidement les déborderait.
Les années 1963-1967 sont donc ponctuées par d’innombrables grèves tournantes, empêchant toute jonction des mobilisations. Certaines sont particulièrement fortes, chez les métallos, les cheminots, les postiers et dans diverses usines. Les travailleurs de l’entreprise Neyrpic à Grenoble sont en lutte pour l’emploi et contre les licenciements pendant une année et demie, entre janvier 1963 et juin 1964. En 1964, les ouvriers de Renault-Flins réclament une réduction de la semaine de travail en scandant : « Nous voulons du temps pour vivre (4) ». La grève du 11 décembre 1964 est générale dans la fonction publique et les services publics. Le 1er février 1967, une grève nationale avec manifestation de grande ampleur a lieu dans différents secteurs, mais « les dirigeants syndicaux assurent catégoriquement que, dans la poursuite de leur action, ils n’envisagent aucune manifestation générale d’ici le 5 mars (5) » : tactique déjà bien rodée des journées d’action dispersées et sans lendemain, qui épuisent les travailleurs en lutte et les conduisent systématiquement à l’échec. À la Rhodiaceta, à Lyon et Besançon en février 1967, les salariés débrayent plusieurs jours, mais les appareils passent leur lutte sous silence et la laissent isolée : on est en pleine période de campagne électorale pour les législatives et les directions n’entendent pas gâcher les chances de leurs candidats SFIO (socialistes) et PCF. Après 23 jours de grève, alors que le patronat vient de lâcher à peine 3 % d’augmentation salariale, les ouvriers refusent de reprendre le travail et huent le dirigeant CGT qui les invite à le faire en proclamant « la victoire ». Chez Berliet aussi, au cours de la même période, les ouvriers se mettent en grève ; les CRS occupent l’usine. L’automne 1967 est marqué par d’autres mouvements importants, au Mans, à Caen, à Redon, où les travailleurs s’affrontent aux CRS. Il en va de même en janvier-février 1968 à la Saviem (usine de montage de camions) : particularité dans le cas de cette usine caennaise, une bonne centaine d’étudiants — la JCR y jour un rôle actif — viennent aider les travailleurs dans leurs affrontements avec les forces de l’ordre (6). Entre décembre 1967 et avril 1968, les salariés de Sud-Aviation (aéronautique) débrayent à de nombreuses reprises — le PDG est alors Maurice Papon, ancien préfet de police, massacreur des Algériens en 1961 ; il deviendra ministre du Budget en 1974 — ; 138 travailleurs signent un manifeste lançant la perspective de la grève générale dans l’aéronautique contre les licenciements, pour les 40 heures payées 48, pour la retraite à 60 ans (7) ; là, ce sont des militants de l’OCI qui sont influents.
Finalement, au cours de cette période, le nombre de journées de grève n’aura cessé d’augmenter à l’échelle du pays : 2,5 millions en 1964 et en 1966, 4,5 millions en 1967 (8). Des formes de lutte particulièrement offensives et systématisées sont à l’œuvre : occupations d’usine (à la Rhodiaceta ou sur les carreaux de mine lorrain).
Les attaques de la bourgeoisie
Revenu au pouvoir en 1958 au moyen d’un coup d’État, De Gaulle impose un pouvoir fort, que fondent les institutions de la Ve République. Le Parlement n’y tient plus le rôle que de chambre d’enregistrement. Le gouvernement peut légiférer par décret pour mettre en œuvre ses attaques les plus frontales contre la classe ouvrière. C’est le cas avec les ordonnances promulguées par le gouvernement Pompidou, auquel l’Assemblée nationale vient d’accorder les pleins pouvoirs pour ce faire, à l’été 1967. Ces textes prévoient notamment la remise en cause de la Sécurité sociale et du salaire différé qui la régit. Ils entendent aussi promouvoir l’intéressement, manière de « faire participer les travailleurs à l’expansion des entreprises ». Quatre ans plus tôt, suite à une « grève surprise » des salariés du métro parisien, l’Assemblée nationale avait adopté une loi s’en prenant directement au droit de grève, car rendant obligatoire dans les services publics le dépôt d’un préavis de cinq jours francs avant le déclenchement de toute grève (9).
C’est aussi un État policier qui se renforce sans relâche : les dernières années de la guerre d’Algérie en ont fait la démonstration, par la violence de la répression contre les manifestants protestant contre la guerre. L’acmé de cette violence est atteinte avec la ratonnade du 17 avril 1961 qui voit périr plusieurs centaines d’Algériens sous les matraques des CRS ou noyés dans la Seine, et les neuf victimes du métro Charonne, le 8 avril de l’année suivante. Les témoignages sur cette extrême violence policière abondent ; citons celui d’Arlette Laguiller, que la découverte de cette véritable sauvagerie policière, lors de la répression des rassemblements étudiants contre la guerre le 27 octobre 1960, amène à l’engagement militant : « Donc, avec quelques personnes de l’agence du Crédit Lyonnais où je travaillais, dans le XVIIIe arrondissement, à l’époque, on décide d’aller à cette manifestation étudiante. Il y a pas mal de monde, la police charge, on reçoit des coups, et un des camarades de mon agence, un vieux militant socialiste, est matraqué. Enfin, il y a tout ça, et le soir, je rentre, je me dis “cette fois ça suffit, je vais quelque part ! Je ne sais pas où, je vais aller au PSU (10).” » Le pouvoir n’a de cesse de consolider le dispositif policier, au premier rang duquel les CRS instaurés en 1947 par le ministre « socialiste » de l’Intérieur Jules Moch pour mater les grandes grèves d’alors ; c’est d’ailleurs en 1947 qu’apparaît le slogan « CRS SS », repris en 1968.
Enfin, en 1967, le pouvoir s’en prend à l’université avec la réforme Fouchet, qui soumet plus directement l’enseignement supérieur aux besoins du capitalisme. Elle peut se résumer dans les mots du recteur Capelle : « Faire de l’université une entreprise rentable (11). » Elle doit également accentuer la sélection et l’élimination d’un grand nombre d’étudiants : elle prévoit en effet l’interdiction des redoublements et de la poursuite des études après un échec au premier cycle — ce que Capelle nomme « éliminer les deux tiers de déchets », soit plus de 300 000 étudiants. Cette contre-réforme ne fait que mieux souligner le caractère de classe de l’université et de sa fonction socioéconomique. La réforme Fouchet suscite immédiatement une levée de boucliers chez les étudiants. En novembre 1967 a lieu à Paris un premier meeting rassemblant 5 000 personnes, suivi d’une manifestation proclamant « À bas la sélection », « À bas le plan Fouchet », « À bas les ordonnances », « Vive les travailleurs du Mans » — slogan qui salue ainsi leur grève récente et montre déjà la volonté de jonction avec la classe ouvrière —, « Non au gouvernement » (12).
Situation et mobilisation des étudiants
Les étudiants sont 600 000 en 1968, soit 400 000 de plus que dix ans auparavant. Cette croissance numérique engendre une certaine diversification sociologique. Cependant, les enfants d’ouvriers et de paysans sont six fois moins représentés que dans le pays, alors que ceux des professions libérales et des cadres supérieurs le sont presque six fois plus. En outre, les modifications intervenues dans le système capitaliste laissent craindre une raréfaction des débouchés correspondant à la formation et au niveau d’études.
À cette crainte provoquée par les contradictions du capitalisme s’ajoutent les mobilisations d’opposition à l’impérialisme. Les manifestations contre la guerre du Vietnam se multiplient. En février 1968, des délégations d’étudiants français se rendent à la gigantesque manifestation organisée à Berlin en soutien au peuple vietnamien, à l’initiative notamment de la SDS, l’union des étudiants socialistes allemands que dirige Rudi Dutschke. Ces rassemblements considérables témoignent de la combativité des étudiants anti-impérialistes. Le 11 avril, Rudi Dutschke est victime d’un attentat : il est très grièvement blessé par balles (13). Les manifestations de protestation, rassemblant travailleurs, étudiants, lycéens et apprentis, se répandent alors dans les plus importantes villes d’Allemagne. Les étudiants présents reviennent en France avec le sentiment que la lutte est possible et qu’elle doit rassembler étudiants et travailleurs.
En France, c’est la faculté de Nanterre qui s’affirme en bastion du militantisme anticapitaliste et anti-impérialiste. Cette faculté a bel et bien été « conçue selon les catégories mentales de la production et de la productivité industrielles, de la société néocapitaliste (…) Les bâtiments disent le projet et l’inscrivent sur le terrain. Ce sera une entreprise, destinée à la production d’intellectuels moyennement qualifiés et de “petits cadres” pour cette société, pour sa gestion, pour la transmission d’un savoir déterminé et limité par la division sociale du travail (14). » Plusieurs dizaines de militants d’extrême gauche, trotskystes, maoïstes, anarchistes, entretiennent la contestation d’une université autoritaire et destinée à faire des étudiants les futurs cadres de la société capitaliste, ses gardes-chiourmes, un avenir qu’ils sont de plus en plus nombreux à rejeter. Début 1967, des conférences sont organisées par des étudiants militants, débouchant notamment sur des pétitions contre le règlement intérieur (et entre autres choses le cloisonnement des bâtiments séparant filles et garçons, la répression sexuelle, après l’étude des textes de Wilhelm Reich sur ce sujet). Les mesures de rétorsion ne se font pas attendre, puisque près de trente étudiants sont exclus de la cité universitaire de Nanterre (15). Au premier trimestre 1967-1968, une grève à laquelle participent plusieurs milliers d’étudiants de Nanterre dénonce les conditions de travail à l’intérieur de la faculté. Au trimestre suivant ont lieu diverses manifestations, en solidarité notamment avec un étudiant menacé d’expulsion, et en protestation contre le flicage systématique à l’entrée de la faculté — de nombreux étudiants arborent en signe de protestation contre ce contrôle policier une étoile jaune marquée « étudiant ».
Les étudiants de psychologie et de sociologie sont particulièrement mobilisés ; ils mettent en cause la nature même de l’université, dont ils perçoivent la mise au service de l’idéologie dominante, la fonction de reproduction de l’ordre social et l’objectif économique de soumission à la logique et aux besoins du capitalisme. En mars, certains, en psychologie, boycottent leurs examens ; d’autres, en sociologie, diffusent un tract intitulé « Pourquoi des sociologues ».
La grève générale
L’étincelle de Nanterre met le feu aux poudres à l’université
Le 20 mars 1968, lors d’une manifestation contre la guerre du Vietnam, un étudiant de Nanterre est arrêté pour avoir brisé une fenêtre du siège de l’American Express ; cinq autres militants anti-impérialistes avaient déjà été arrêtés pour avoir pris part à des manifestations interdites. En réaction, le 22 mars, un meeting de protestation à Nanterre débouche sur le vote de l’occupation du bâtiment administratif — 150 étudiants environ prennent part à cette occupation nocturne. Le Mouvement du 22 Mars se constitue, composé notamment de militants anarchistes, JCR (Jeunesse communiste révolutionnaire), ÉSU (étudiants socialistes unifiés) et situationnistes, et permet une intense politisation sur le campus (salles occupées pour des débats, réalisation d’affiches et de tracts, interventions dans les cours…). Le doyen Grappin croit nécessaire de suspendre les cours, le 28 mars. Le 2 avril, ce sont 1 500 étudiants qui participent à un meeting contre la répression policière, pour une université critique, pour le droit à l’expression politique dans les universités. Dans diverses disciplines, le boycott des examens est d’ores et déjà entériné. Durant tout le mois d’avril, des commissions, des distributions de tracts, des discussions contribuent à structurer le mouvement, qui se généralise.
Le PCF s’empresse de condamner la mobilisation en marche et d’affirmer que les étudiants ne se sentent pas concernés, les confinant ainsi dans leurs études et la préparation des examens… On peut ainsi lire dans L’Humanité, le 2 mai : « Les étudiants de Nanterre, dans leur immense majorité, souhaitent travailler dans les meilleures conditions et, à quelques semaines de leurs examens, leurs préoccupations n’ont rien à voir avec celles des semeurs de troubles. » Le lendemain, toujours dans L’Humanité, Georges Marchais, membre du bureau politique du PCF, vitupère « de faux révolutionnaires à démasquer » parmi lesquels « l’anarchiste allemand Cohn-Bendit (16) ». Et le député PCF Louis Baillot demande en séance parlementaire au ministre Peyrefitte quelles mesures celui-ci compte prendre « pour permettre aux étudiants de pouvoir étudier normalement et préparer leurs examens dans de bonnes conditions(17) ». Les dirigeants staliniens sont pourtant rapidement démentis. Le 3 mai, à la Faculté des sciences de Paris et à la Sorbonne, face à la brutalité de la répression policière, des arrêts de cours se produisent, des assemblées générales se tiennent dans des amphithéâtres bondés. Ce même 3 mai, à la Sorbonne, un meeting rassemblant environ 400 étudiants est organisé par différentes organisations — l’UNEF (alors politiquement dirigée par le PSU, Parti socialiste unifié de Michel Rocard), la JCR, la FER (Fédération des étudiants révolutionnaires, dirigée par l’OCI) et le Mouvement du 22 Mars —, pour protester contre la fermeture de la faculté de Nanterre et en soutien aux sept étudiants convoqués devant le conseil de discipline de l’université ; les étudiants présents entendent aussi protéger le quartier Latin des groupuscules fascistes, lesquels n’hésitent pas à proclamer qu’ils « nettoie{ront} la Sorbonne de la racaille marxiste ». C’est la stupeur quand, à la demande du recteur Roche, la police envahit la Sorbonne et procède à des centaines d’arrestations (suivies quelques jours plus tard de condamnations, parfois à des peines de prison ferme) : jamais les « forces de l’ordre » n’avaient pénétré dans une université depuis l’Occupation nazie. Dès la soirée du 3, des manifestations rassemblant au moins 2 000 personnes s’organisent spontanément au cri de « Libérez nos camarades ». La police réplique en chargeant et en usant de grenades lacrymogènes. Bilan : une centaine de blessés et 600 arrestations.
Lorsque la Sorbonne est fermée et occupée par la police, l’UNEF et le SNESup lancent le mot d’ordre de grève générale dans l’université (étudiants, personnels, enseignants). Ils en appellent aussi à la solidarité des travailleurs. L’adresse de l’UNEF à la population pose de fait explicitement la question du front unique entre étudiants et salariés : « En effet, leur lutte est fondamentalement la même : les ouvriers refusent la société qui les exploite, les étudiants refusent une Université qui tend à faire d’eux les cadres dociles d’un système fondé sur l’exploitation, parfois même les complices directs de cette exploitation. » Les 6 et 7 mai, des centaines de travailleurs, essentiellement des jeunes, alors les plus combatifs dans les entreprises, rejoignent les cortèges étudiants, à nouveau violemment réprimés par la police. Une solidarité pratique se met en place. Des barricades s’érigent, pour résister aux assauts policiers et s’en protéger. Dans certaines villes universitaires de province, on dresse aussi des barricades pour éviter que la police ne vienne occuper des facs qui ne le sont pas encore.
Tandis que la grève s’étend à la plupart des universités de province, les lycéens se joignent eux aussi aux manifestations, à l’initiative des CAL (comités d’action lycéens) apparus en 1967 dans le prolongement des comités Vietnam. En région parisienne, près de 200 CAL (dirigés par la Jeunesse communiste révolutionnaire, notamment Michel Recanati, et par la Tendance marxiste révolutionnaire, notamment Maurice Najman) impulsent la grève dans les lycées. C’est bientôt par milliers que les lycéens rallient le mouvement. Le 9 mai, ils décident la grève générale des lycées. Les lycéens déjà dans la lutte partent débrayer dès le lendemain matin d’autres établissements ; ils tiennent aussi des meetings dans la rue. Le 10 mai, 8 000 lycéens manifestent à Paris des Gobelins à Denfert-Rochereau. Le mouvement s’étend peu à peu, notamment aux collèges techniques, et se généralise.
La violence de la répression policière contre les lycéens, les étudiants et les jeunes salariés entrés dans la lutte horrifie une large partie de la population. Elle culmine avec la manifestation de la nuit du 10 au 11 mai. Pour tenter de reprendre la Sorbonne à la police et montrer leur détermination, plusieurs milliers d’étudiants, emmenés par le Mouvement du 22 Mars, dressent des barricades, ainsi justifiées par Daniel Cohn-Bendit — lequel ne dirige rien ce soir-là mais tente de négocier avec les autorités (18) : « Il ne pouvait plus s’agir d’une simple procession — les étudiants n’auraient pas compris — mais on ne pouvait pas non plus chercher délibérément l’affrontement avec la police, parce qu’on n’envoie pas les gens au massacre. Notre idée était donc d’occuper un lieu, pacifiquement, et d’y rester jusqu’à ce que nos trois revendications — libération de nos camarades, retrait des forces de police du quartier Latin, réouverture de la Sorbonne — aient été satisfaites (…) La consigne était : pas d’affrontement (19). » Selon Alain Geismar, qui dirige alors le SNESup, « l’idée de construire des barricades s’est faite partout, s’est propagée mais véritablement comme une traînée de poudre. Je ne crois pas qu’il y ait eu de consignes précises d’une organisation politique ou autre de construire des barricades (20). » Les CRS donnent l’assaut jusqu’au petit matin.
Devant cette violence policière, une houle de protestation monte dans tout le pays. Elle provoque la panique au sein du gouvernement. Rentré précipitamment d’un voyage en Afghanistan, le Premier ministre Pompidou veut rétablir le calme et éviter à toute force une jonction entre étudiants et travailleurs. Car c’est bien là la hantise du pouvoir, comme le reconnaîtra plus tard un proche conseiller de De Gaulle : « Face à des situations de ce type, l’État ne peu répondre que par des solutions classiques qui consistent à diviser ce qui est uni : l’université s’est unie au mouvement ouvrier, ce qui, pour un État, est insupportable. Il n’est pas possible d’éviter un mouvement ouvrier, mais il n’est pas possible d’avoir en même temps un mouvement étudiant ; il faut à tout prix avoir l’un et l’autre successivement, mais pas ensemble, et le drame de 1968 c’est qu’on les a vu venir, se réunir, se conjuguer et qu’on n’a pas pu empêcher cette vague (21) » Pompidou, dès lors, peut bien ordonner à la police d’évacuer la Sorbonne, faire rouvrir celle-ci et libérer les étudiants emprisonnés : il est trop tard. La montée vers la grève générale vient de commencer.
La généralisation de la grève
Les directions syndicales comprennent en effet, face aux prémisses de la solidarité active entre travailleurs et étudiants, qu’il leur faut faire un geste : la CGT, la CFDT, la FEN, l’UNEF, le SNESup et l’UGE (Union des Grandes Écoles) appellent à une grève générale de 24 heures, avec manifestations dans toute la France. Ce 13 mai, un million (22) de travailleurs et d’étudiants manifestent, brandissant les slogans « CRS SS », « Dix ans, ça suffit ! », « À bas de Gaulle », « À bas l’État policier ». Le drapeau rouge colore la manifestation, et « L’Internationale » en est le chant.
Les directions syndicales croient, avec cette gigantesque manifestation, en être quittes. C’est sans compter sur la spontanéité de la classe ouvrière, puissamment mobilisée le 13 et dont certaines fractions prolongent immédiatement la grève le lendemain. C’est le cas des travailleurs de Sud-Aviation de Bouguenais (dans la banlieue de Nantes), dont on a vu la détermination et l’exaspération face aux grèves tournantes et aux actions sans lendemain. Dès le 9 mai, la section Force ouvrière locale, conduite par le militant de l’OCI Yvon Rocton, a indiqué qu’il n’y a plus qu’une seule solution pour faire reculer le patronat : « la grève totale ». Le 14 mai, la grève illimitée est déclenchée ; les travailleurs occupent leur usine et séquestrent leur patron — pendant deux nuits et un jour, les grévistes lui diffusent « l’Internationale » (23)… Le lendemain, ce sont les salariés de Renault-Cléon, des Chantiers navals de Bordeaux, de Contrexéville, etc., qui entrent dans la grève. Puis les 16 et 17 viennent Renault-Billancourt, Renault-Flins, Rhône-Poulenc-Elbeuf, Berliet, la Saviem, les Chantiers de l’Atlantique de Saint-Nazaire… Entre le 18 et le 20, c’est au tour des salariés de la Fonction publique et des services publics (postiers et cheminots notamment). Les entreprises du textile sont touchées à partir du 20. Le 22, la grève est générale dans l’enseignement. On estime aujourd’hui à 8 millions environ les travailleurs grévistes — les 10 millions souvent évoqués incluant les lycéens et étudiants. Ce nombre est trois fois supérieur à celui de 1936. À cette époque les salariés, toutes catégories confondues, sont au nombre de 15 millions : les grévistes sont donc une majorité absolue.
Ainsi donc, la grève devient générale. Pourtant, à aucun moment les directions syndicales ne se résolvent à y appeler : il n’y aura jamais de leur part de mot d’ordre de grève générale, ni même d’ailleurs de mot d’ordre de grève dans telle ou telle branche. En bien des endroits, la grève est enclenchée sans aucune impulsion syndicale, sans même qu’il y ait de section syndicale sur place. De fait, l’extension du mouvement se mène par la base.
Modalités de la lutte
La grève s’accompagne d’occupations des entreprises. Dans le Nord-Pas-de-Calais, par exemple, 47 % des entreprises sont occupées, avec des différences selon les secteurs (entreprises nationalisées : 87,5 % ; métallurgie : 70 % ; chimie : 50 % ; textile : 37 % ; services : 33 % ; bâtiment : 15 % (24)). Cependant, les occupations d’entreprises ne sont pas comparables à celles de 1936. Un moins grand nombre de travailleurs y prennent part, car les appareils syndicaux, traumatisés par la spontanéité révolutionnaire de 1936 (25), entendent s’approprier et se rendre maîtres de ces occupations, les transformant en simples gardes de l’usine. Il s’agit d’emblée d’exclure les travailleurs de leur propre grève.
Les comités d’action, de quartier, de ville ou d’arrondissement notamment, parfois associant travailleurs et étudiants, se mettent en place, nombreux. Dans la région parisienne, un comité de coordination— où sont présents des militants de l’OCI — définit ainsi clairement les revendications, la structuration du mouvement et en trace les perspectives. Dans un tract du 20 mai, il commence par rappeler les exigences des travailleurs (telles qu’elles sont généralement formulées dans les tracts locaux, les cahiers de revendications et lors des assemblées générales) : abrogation des ordonnances, de la réforme Fouchet, de la réforme de la formation professionnelle ; contre le Ve Plan ; garantie de l’emploi et de la qualification ; pas de salaire inférieur à 1 000 francs par mois ; les 40 heures immédiates pour tous. Puis il souligne la nécessité des comités de grève élus et de la fédération de ces comités. Enfin, il en appelle à la grève générale jusqu’à la victoire et termine sur « Plus de gouvernement De Gaulle-Pompidou Plus de gouvernement capitaliste (26) ».
Un manque cruel de véritables comités de grève
Cependant, l’une des limites majeures du mouvement est qu’il y a très peu de comités de grève élus en assemblée générale de grévistes, avec délégués syndiqués et non-syndiqués mandatés et révocables. Les appareils syndicaux font tout pour les éviter et contrôler les structures collectives de la grève. Pour reprendre l’exemple du Nord-Pas-de-Calais bien étudié par Jacques Kergoat, s’il y a officiellement un comité de grève dans 70 % des usines de la région, seuls 14 % ont été élus, seuls 23 % comptent des non-syndiqués et seuls 2 % sont révocables par l’assemblée générale de grévistes (27). Dans la plupart des entreprises, ce sont les responsables syndicaux qui composent seuls le comité de grève, ou bien le désignent. En Loire-Atlantique, si Alexandre Hébert (dirigeant anarcho-syndicaliste de FO, proche de l’OCI) obtient la constitution d’un comité de grève départemental, celui-ci est composé exclusivement des représentants des trois unions syndicales départementales. À la Thomson de Bagneux, la CGT et la CFDT forment chacune un comité de grève. À Renault-Billancourt, le comité de grève est appelé « comité des six » : il est formé par les dirigeants syndicaux, à raison de deux par syndicat (28). Il y a des exceptions, mais elles sont rares et parfois ambiguës : à l’usine Rhône-Poulenc de Vitry, 39 comités de base regroupent tous les travailleurs ; ils élisent des délégués qui constituent un comité central de grève ; mais au sommet, c’est un comité exécutif qui chapeaute le tout ; or, ce comité est composé uniquement de responsables syndicaux non élus (29).
De surcroît, à plusieurs reprises, la direction de la CGT affirme son refus de la coordination de ces « comités de grève ». Georges Séguy déclare par exemple, répondant à un auditeur sur Europe n°1, le 17 mai : « Vous préconisez l’organisation de tous les comités sous une forme nationale. Eh bien, je crois que les confédérations peuvent prendre elles-mêmes en charge les tâches qui leur incombent (30). » Dans le même esprit consistant à empêcher toute coordination et structuration de la lutte au-delà de l’entreprise, les appareils syndicaux font tout pour que les grévistes soient coupés les uns des autres : il faut ainsi plusieurs jours de tractations pour qu’une délégation intersyndicale de Renault-Flins pénètre à Renault-Billancourt (31) !
Modes de jonction entre travailleurs et étudiants
Tout au contraire, dès le début du mois de mai, les étudiants en lutte affichent clairement leur volonté de lier leur action à celle des travailleurs. Dès lors que la Sorbonne a pu être réoccupée par les étudiants, la coordination parisienne des comités d’action étudiants proclame « la Sorbonne aux travailleurs » et précise : « Maintenant il faut aller vers la classe ouvrière. Non pour l’organiser nous-mêmes, mais pour profiter de l’audience que nous a donnée notre courage et expliquer la nécessité de renverser le régime (32). » Le 8 mai, un millier d’étudiants manifeste à Nantes derrière une banderole « Ne laissons pas la bourgeoisie séparer les étudiants des travailleurs (33) ». Le 15 mai, l’assemblée générale qui se réunit en Sorbonne vote cette même nécessité de ne pas isoler les étudiants des travailleurs et prend pour thème quasi unique les modalités de cette liaison (34).
Dans les universités occupées — qui fonctionnent quant à elles avec assemblées générales souveraines, élisant des comités de grève et des commissions spécialisées par thèmes —, des ouvriers, souvent de jeunes travailleurs, viennent parfois assister et participer aux réunions. C’est le cas par exemple des jeunes ouvriers de l’usine Hispano-Suiza de Bois-Colombes, qui vont à la Sorbonne. Les militants de la CFDT de l’usine Rhône-Poulenc tiennent leurs réunions à l’université de Censier. Les membres du comité d’action de Renault-Cléon se rendent quant à eux à l’université de Rouen (35). À l’inverse, de nombreux étudiants tentent de rejoindre les travailleurs dans les usines, malgré les obstacles dressés par les « forces de l’ordre » — celles de l’État bourgeois et celles de l’appareil PCF-CGT. Les animateurs du Mouvement du 22 Mars y insistent avec raison : « Nous avons tout fait pour que ce qui se criait “ouvriers-étudiants un seul combat” se trouve concrétisé (36). » Ils organisent par exemple des tournées de ravitaillement en sillonnant la campagne et en y récoltant des vivres pour les usines occupées. Ils apportent aussi une aide concrète dans les affrontements qui opposent les ouvriers aux CRS.
Trahison et répression
PCF et CGT entendent limiter la grève à quelques revendications économiques et démocratiques
Face à la montée révolutionnaire qu’ils ont toujours appréhendée, craignant d’être incapables de la canaliser, les dirigeants de la CGT essaient, dans un premier temps, d’éviter la contagion de la grève. Le 16 mai, à Billancourt comme dans de nombreuses entreprises, ce sont de jeunes ouvriers qui lancent le mouvement, alors que « trois heures durant, les délégués syndicaux ont tenté de les raisonner (37) ». À Citroën-Javel, le 17 mai, tandis que de jeunes ouvriers veulent se lancer dans l’action et suivre l’exemple de leurs camarades de Renault, les responsables CGT appellent à un meeting… trois jours plus tard, sans tracer la moindre perspective (38). Le même jour, à la RATP (au dépôt de Nation), la grève commence, mais les permanents syndicaux avertissent : « C’est une bonne initiative… mais il ne faut pas faire grève tout de suite. Nation 2 et 6 ne sauraient être seuls » ; puis ils estiment que la généralisation est impossible (39).
C’est que tel n’est pas leur but. Dès la mi-mai, ils affichent clairement leurs perspectives, au double volet : d’une part négociations, sur quelques revendications élémentaires, avec le patronat et l’État comme à Matignon en 1936 — rappelons que la dernière clause des accords Matignon prévoyait la reprise du travail (40) ; d’autre part élections — le PCF, dans le cadre de « l’union de la gauche », se prononce « pour une démocratie véritable unissant les forces de gauche sur un programme commun au contenu social avancé », « pour des transformations démocratiques profondes » (41) : un réformisme à l’état brut et sans ambages. C’est ce qu’exprime notamment un tract diffusé nationalement le 17 mai par le bureau confédéral de la CGT, sur lequel ne figure pas une seule fois le mot « grève » (42). Dans certains secteurs, comme celui de la presse, l’appareil de la CGT empêche concrètement la grève, pour laisser à la presse bourgeoise (parisienne et donc nationale) la possibilité de se diffuser. Aux ouvriers d’une imprimerie, Henri Krasucki vient expliquer : « Les travailleurs de la presse se considèrent aussi comme grévistes et c’est par esprit de responsabilité, je tenais à vous le dire, à vous qui êtes en grève, qu’à la demande de la Fédération du Livre et en accord avec le Bureau confédéral de la CGT, ils font les journaux quotidiens pour assurer l’information indispensable (43). »
Les manœuvres d’appareils sont tellement évidentes et caricaturales que la presse bourgeoise reconnaissante, tout en les louant, s’inquiètent de leur pérennité, ainsi le journal patronal Les Échos : « Tout le problème pour les états-majors syndicaux qui prennent le “train en marche” est de savoir s’ils pourront longtemps continuer à jouer le rôle de serre-freins (44). » Le 20 mai, lors d’un meeting à l’usine Renault-Billancourt, Georges Séguy avertit : « Toute entreprise de diversion, tout mot d’ordre irresponsable, aventurier et provocateur, tel celui d’insurrection, qui risquerait de dénaturer le caractère revendicatif et démocratique de notre lutte, et nous aliénerait nos alliés, ne peuvent que faire le jeu du gouvernement et du patronat ». Le bureau politique du PCF enfonce le clou : « Les grandes masses populaires, dont l’action est décisive, ne se sont engagées ni dans une entreprise de replâtrage du pouvoir personnel ni dans une grève insurrectionnelle (45). » Le PCF qui s’autoproclame « le seul parti révolutionnaire, dans le bon sens du terme (46) » ne poursuit en l’occurrence qu’un seul objectif : empêcher le développement de la situation vers la révolution.
Dans ce cadre, il n’a pas de mots ni de pratiques assez durs pour fustiger les révolutionnaires. De fait, la haine du PCF à l’égard de ceux qu’il appelle « les gauchistes » apparaît incommensurablement plus violente et déterminée que sa lutte contre le pouvoir bourgeois. À ses yeux, ceux qui, sur les barricades, entendent mener un combat décisif contre le régime, ne sont que des provocateurs au service du pouvoir — les dirigeants staliniens ne cessent de faire rimer « gauchistes et gaullistes ». Le bureau de la Fédération PCF de la Gironde proclame ainsi au sujet des étudiants et jeunes travailleurs en lutte : « Tout le monde a pu reconnaître parmi les arracheurs de pavés et les constructeurs de barrages, baptisés “barricades”, la lie de Bordeaux : souteneurs, voleurs, repris de justice, commandos d’anciens paras, fascistes de tout poil, etc (47). » La « lie » : la violence du terme (et l’assimilation au lumpenproletariat et aux fascistes n’a d’égale que celle du ministre de l’Intérieur Christian Fouchet taxant les manifestants les plus radicaux de « pègre chaque jour plus nombreuse qui rampe, enragée, depuis les bas-fonds de Paris, qui se cache derrière les étudiants et se bat avec une folie meurtrière », et terminant par ces mots : « Je demande que Paris vomisse la pègre qui la déshonore (48). » Lorsque, le 21 mai, Daniel Cohn-Bendit est frappé d’une mesure d’interdiction du territoire français — il vient de se rendre à Berlin pour prendre part à un meeting étudiant —, bien loin de condamner cette mesure exemplaire de l’arbitraire étatique bourgeois, le PCF s’en réjouit implicitement et condamne explicitement les manifestations massives de solidarité à l’égard du jeune dirigeant anarchiste : « Quelles que soient les motivations qui ont finalement conduit le gouvernement à refuser à Cohn-Bendit de rentrer en France, on nous permettra de rappeler le comportement du personnage. Quelles perspectives ce prétendu révolutionnaire offre-t-il aux ouvriers, aux étudiants ? (…) Dire la vérité sur le rôle de Cohn-Bendit, c’est défendre les intérêts de ceux qui pourraient se laisser abuser. Les manifestations en faveur de Cohn-Bendit ne peuvent être que division, diversion, provocations (49). »
Les responsables staliniens font également tout pour empêcher la jonction des étudiants et des travailleurs puis, lorsque celle-ci se réalise malgré tout, pour l’entraver et empêcher les étudiants de s’exprimer dans les meetings ouvriers. Lors de la gigantesque manifestation du 13 mai, la CGT tente, selon le témoignage des militants étudiants du « 22 mars », de cloisonner le défilé, « ici les étudiants, là les ouvriers. À partir du moment où on a bien compris ça on a réagi en faisant un cortège parallèle (…) Et à chaque passage d’une rue latérale des gens, des jeunes naturellement venaient en courant se joindre à nous, quittant le cortège “officiel”. Des camarades présents dans le premier discutaient avec des jeunes d’Aubervilliers, d’Hispano-Suiza, du 18e arrondissement et essayaient de sortir mais chaque fois le service d’ordre de la CGT resserrait ses rangs autour de la manifestation, disant “poussez-vous, poussez-vous” (50). » Un tract de la CGT Renault diffusé le 17 mai met en garde surtout « les plus jeunes » travailleurs contre les étudiants (51). L’union syndicale CGT de la région parisienne fait placarder des affiches dans les usines, le 7 juin, dénonçant dans les étudiants qui oseraient venir prêter main forte aux travailleurs dans les entreprises « des groupes étrangers à la classe ouvrière (52) ».
Le pouvoir et les appareils main dans la main pour la reprise du travail
Le 25 mai s’ouvrent au ministère du Travail, rue de Grenelle, les négociations tripartites que la CGT appelait de ses vœux. Elles débouchent sur de maigres avancées, au regard de l’ampleur de la grève générale, très en deçà des revendications, et suscitent par là même une très vive déception chez les millions de grévistes : augmentation des salaires de 7 % en juin et de 3 % en octobre ; hausse du SMIG de 35 % ; suppression des abattements d’âge pour les moins de 18 ans ; réductions du temps de travail ponctuelles et ne concernant que les horaires hebdomadaires les plus lourds (48 heures dans la métallurgie) : ces réductions portent sur une demi-heure à une heure et les compensations salariales ne sont pas toujours garanties ; reconnaissance de la section syndicale d’entreprise (53). Dans le relevé de conclusions, la dernière phrase de Séguy qui y figure est sans ambiguïté : « La reprise du travail ne saurait tarder. » Des revendications essentielles sont « oubliées » en cours de route, comme l’abrogation des ordonnances de 1967, l’abaissement de l’âge de la retraite, l’échelle mobile des salaires, les 40 heures. On mesure facilement ce qu’une augmentation de salaire de 7 % a de dérisoire, par comparaison avec l’ampleur de la grève, lorsqu’on se rappelle qu’à cette époque les salaires progressent en moyenne annuelle de près de 6 %. Si le SMIG augmente quant à lui fortement, il est en fait porté à seulement 519 francs par mois, ce qui est très inférieur à ce que réclament les grévistes lorsqu’ils exigent : « Pas de salaire en dessous de 1 000 francs par mois. » De surcroît, cette augmentation du SMIG n’est pas un problème pour la classe dominante, qui la réclamait d’ailleurs de ses vœux : dans Le Monde du 20 février 1968, le ministre de l’Industrie Albin Chalandon en appelait à « une très forte réévaluation du SMIG ». De fait, c’est une façon pour le capitalisme d’éliminer les entreprises les plus petites et les moins compétitives — celles qui emploient le plus de salariés au SMIG — au profit de regroupements et d’absorptions. Cette hausse sera d’ailleurs extrêmement vite balayée par l’inflation dans les années qui suivront, signe que tout recul de la bourgeoisie n’est jamais que temporaire dans le cadre du système capitaliste et que tout acquis peut être très vite mis en cause par ce système même, dès que le rapport de forces s’est un tant soit peu modifié.
Ainsi donc, au plus fort de la grève générale et alors même que le rapport de forces n’a jamais été aussi favorable à la classe ouvrière, les dirigeants staliniens insistent sur « le seuil, c’est-à-dire la limite jusqu’où il faut aller et les limites qu’il ne faut pas dépasser, parce qu’à ce moment la grève s’effiloche. (…) Cela pose la question du compromis, de savoir à un moment donné s’arrêter. (…) On a fait tout ce qu’on a pu (54). » Les deux dirigeants de la CGT, Frachon et Séguy, entendent immédiatement se servir de Renault-Billancourt comme d’un test pour annoncer les résultats de Grenelle et inciter à la reprise du travail, devant les ouvriers réunis en meeting, qui ont voté une demi-heure avant leur arrivée la poursuite de la grève. Immédiatement conscient de l’état d’esprit à Billancourt — et pour cause : les protestations et les huées virulentes fusent de tous côtés —, Séguy a ces mots on ne peut plus alambiqués : « [Les travailleurs] feront la part des choses, ils apprécieront ce qu’il y a là-dedans de positif, ce qui l’est moins et ce qui manque. (…) Il reste à la direction de votre syndicat, tous syndicats unis, d’organiser cette consultation et de faire savoir à votre patron ce que vous en pensez (55). » Ce qui revient à s’asseoir sur le vote qui vient d’avoir lieu ! Pour autant, les travailleurs de Renault refusent de reprendre le travail. Et dans tout le pays, la grève se poursuit. L’exigence qui remonte des usines en grève vers les directions syndicales tient en trois mots : « Ne signez pas ! »
Le rejet de cette politique de trahison s’exprime sans détours par la déclaration de cet ouvrier de Citroën, syndiqué depuis 20 ans à la CGT : « En 36, on était déjà pas prêt. En 45, on était pas prêt parce qu’il y avait les Américains sur le tas. En 58, on était toujours pas prêt parce qu’il fallait pas déconner, l’OAS, on savait pas où ça allait, tout le machin. En 68, on est toujours pas prêt parce que l’armée, parce que ceci, le rapport de forces, et ça va (…). On forme des cortèges, on défile dans les rues, les mains vides, la bouche pleine de slogans (…). On nous fait gueuler un grand coup, ça décontracte les mecs, tout le monde rentre chez soi, respire, puis tu vois c’est comme une marmite (…) En haut, à l’état-major [de la CGT], ils continuent à mastiquer les mêmes mots ou les mêmes slogans, nos traitements, nos pensions, nos retraites (56). »
De fait, la CGT n’a de cesse, tout au long de cette grève générale qu’elle n’a pas souhaitée et à laquelle elle n’a pas appelé, de se présenter en « organisation responsable », « gardienne de l’ordre » et par là même « rempart contre le chaos étudiant » (57). La CFDT apparaît quant à elle plus « mouvementiste », plus favorable à la mobilisation étudiante. Ici ou là, ses sections locales appellent même à voter contre la reprise du travail après Grenelle, comme à Hispano-Suiza ou à Renault-Flins (58). Cependant, elle entretient aussi la confusion. Son secrétaire général Eugène Descamps parle indifféremment, pour l’université, de « cogestion » ou d’« autogestion ». Quant au président de la CFDT, André Jeanson, il s’adresse aux sommets de l’État en les invitant à « partager » le pouvoir (59). Ce n’est là rien d’autre qu’un appel explicite à la collaboration de classes, bien dans la ligne de cette confédération issue du syndicalisme chrétien rejetant la lutte de classes elle-même et par conséquent la lutte de la classe ouvrière en tant que telle.
La violence d’État
Au regard de la sauvagerie policière, on s’étonne qu’il n’y ait pas eu davantage de morts au cours de ces deux mois. Pour cette raison même — on recense habituellement quatre morts —, Maurice Rajfus a pu parler d’un « massacre rentré (60) ». Les charges des CRS et des gendarmes mobiles, casqués, armés de boucliers et de matraques, recourant sans vergogne aux gaz lacrymogènes et aux grenades amorcées au phosphore, sont d’une violence inouïe dès les premières manifestations de début mai. Les compagnies d’intervention matraquent alors souvent au hasard, s’en prennent à des passants et s’acharnent sur des blessés à terre. Le journaliste Philippe Labro note, au lendemain des « événements », comment la police peut empêcher les services de soin de fonctionner, malgré l’urgence et le nombre de victimes : « Sur le matin [du 11 mai], Europe 1 demande explicitement qu’on apporte à ses studios des médicaments pour les blessés. Des quantités de médicaments parvinrent rue François-Ier, mais ce qui ne fut pas dit, c’est qu’ils furent interceptés par la police qui les jetait dans les caniveaux. Des plaintes ont été déposées pour vols de médicaments par les forces de l’ordre, rue François-Ier. Qui l’a su (61) ? » Les témoignages concordent, indiquant que les policiers ont entravé l’action des secouristes et ont même, à l’occasion, usé de leurs matraques contre eux (62). On compte des centaines de blessés durant les premiers jours de mai.
L’énorme manifestation du 24 mai vers la gare de Lyon — 150 000 manifestants à Paris — est, cette fois au cœur de la grève générale, elle aussi sauvagement réprimée, les policiers s’acharnant sur les centaines de blessés. Il y a un mort. Début juin, la violence s’abat toujours sur les principaux bastions de la résistance à la reprise, comme Renault-Flins ou Peugeot-Sochaux. Dans la nuit du 6 au 7 juin, des half-tracks enfoncent les portes de l’usine Renault de Flins, des centaines de CRS y pénètrent. La police protège au matin l’entrée de jaunes. Or, malgré les barrages policiers — 4 000 CRS sont déployés dans le secteur —, des travailleurs grévistes et des étudiants parviennent à atteindre le seuil de l’usine pour informer les travailleurs que la reprise n’a pas été décidée (alors que la CGT entretient l’ambiguïté sur le sujet). 2 000 à 3 000 manifestants se tiennent devant l’usine tandis que des cadres syndicaux leur enjoignent de se disperser. Ils tentent d’empêcher les étudiants présents de s’exprimer, mais les ouvriers entendent bien quant à eux leur laisser la parole. C’est finalement Alain Geismar qui prend le micro pour expliquer qu’à la Sorbonne les étudiants ont pu tenir tête aux CRS et que l’unité des étudiants et des travailleurs fait leur force pour réoccuper l’usine. Alors, la police charge. Les combats font rage pendant plusieurs jours (63). À leur propos, plusieurs jeunes ouvriers témoignent du courage physique dont font preuve les étudiants qui se battent aux côtés des travailleurs, et de leur expérience pratique dans l’affrontement avec la police : « Heureusement que les étudiants étaient là pour retarder les charges de CRS ; ils connaissaient leurs méthodes, ils étaient toujours en première ligne » ; « Les étudiants ont appris un certain nombre de tuyaux pratiques comme le service d’ordre pour faire reculer les manifestants, la protection au moment des charges… » ; « c’est ce que j’ai trouvé champion de leur part à eux de rester tout le temps en première ligne, alors qu’ils pouvaient se dire qu’ils n’avaient rien à voir là-dedans » (64). Le 10 juin, un lycéen de 17 ans militant de l’organisation maoïste UJC(ml), Gilles Tautin, se noie dans la Seine, près de Meulan, après avoir été matraqué. Dans la nuit du 10 au 11, au cours d’une intervention des CRS, un ouvrier de Peugeot, Pierre Baylot, est tué par balle.
Le pouvoir reprend la main, grâce au relais des appareils
Négociation traditionnelle, violence policière : les solutions ne suffisant pas à mettre bas la grève générale, le pouvoir gaulliste use d’une troisième carte, spectaculairement mise en scène. Durant une journée, celle du 29 mai, on ne sait pas ce qu’est devenu De Gaulle, qui semble avoir « disparu ». Les spéculations, durant vingt-quatre heures, vont bon train. Mitterrand et Mendès France se positionnent pour prendre éventuellement sa succession — deux jours plus tôt, au cours d’un meeting organisé au stade Charléty par l’UNEF, FO, la FEN, la CFDT et le PSU, Mendès France, ex-président du Conseil (équivalent de Premier ministre) sous la IVe République et membre du PSU, est acclamé. En fait, De Gaulle est allé consulter le général Massu pour s’assurer du soutien de l’armée, y compris des anciens farouches partisans de l’Algérie française qui en ont toujours voulu à De Gaulle d’avoir finalement cédé l’indépendance (non sans avoir obtenu l’assurance de continuer à profiter du gâteau, en particulier par l’exploitation du Sahara). Lorsque De Gaulle revient le 30 mai, c’est pour annoncer la dissolution de l’Assemblée nationale et la tenue de nouvelles élections. Mais la condition posée à leur déroulement est la fin de la grève. Le chantage à l’intervention militaire est sans ambiguïté. De Gaulle déclare : « Si cette situation de force se maintient, je devrai, pour maintenir la République, prendre, conformément à la Constitution, d’autres voies que le scrutin immédiat du pays. » Au cours de cette journée, les pro-gaullistes, composant les fractions les plus diverses de la bourgeoisie, petite et grande, envahissent les Champs-Élysées, aux cris de « De Gaulle n’est pas seul », « Cohn-Bendit en Allemagne », « le rouquin à Pékin », « Cohn-Bendit à Dachau », « les cocos au poteau », « les prolos au boulot ».
Cela n’empêche nullement les directions syndicales, et tout particulièrement la CGT, de s’engouffrer dans la nasse électorale tendue opportunément par le pouvoir. Appareils des syndicats et des partis (PCF et SFIO) n’ont plus en tête que cette perspective. Les dirigeants syndicaux vont donc négocier branche par branche et entreprise par entreprise ; ils font pression pour faire reprendre, petit à petit, le travail. Déclinaison de l’ignominieux mot de Thorez au cœur de la grève générale en 1936 — « Il faut savoir terminer une grève » —, le bureau confédéral de la CGT indique que, « partout où les revendications essentielles ont été satisfaites, l’intérêt des salariés est de se prononcer pour la reprise du travail (65). » Toujours soucieux de respectabilité et d’ordre, Jacques Duclos tient ce discours, lors d’un meeting à la Bourse du travail de Lyon le 1er juin : « Nous voulons aller à la lutte dans un climat d’ordre et de tranquillité publics (66). » La prétendue « lutte » dans la bouche du dirigeant stalinien n’est en l’occurrence rien d’autre qu’électoraliste. Pour autant, ses espérances se cantonnent à de bons résultats aux législatives, certes pas à la prise de pouvoir, comme Fajon, directeur de L’Humanité, le dit expressément au micro d’Europe 1 le 10 juin : « Le Parti communiste, dans cette campagne électorale, ne revendique pas le pouvoir. Il ne revendique même pas la direction du gouvernement (67). » Le bureau politique du PCF se contente de proposer un « programme de progrès social et de paix et de politique d’union de toutes les forces démocratiques », donc sans aucun contenu de classe et dans la perspective d’un front populaire l’unissant à des organisations bourgeoises comme celle de Mitterrand.
Cependant, les calculs opportunistes des dirigeants du PCF, espérant que les élections leur seront favorables, s’avèrent ridiculement battus en brèche. La peur bleue qu’a provoquée la grève générale chez certaines classes et fractions de classes sociales donne lieu à une nouvelle Assemblée nationale bleue elle aussi, lors des élections des 23 et 30 juin, d’un « bleu CRS (68) » : le parti gaulliste, l’UDR (Union pour la Défense de la République) obtient la majorité absolue avec 293 sièges sur 487. Le PCF quant à lui perd 600 000 électeurs, 2,5 points (il rassemble 20 % des suffrages) et 39 élus par rapport aux élections législatives de l’année précédente. Ce triomphe gaulliste doit être expliqué bien sur par le vote des classes possédantes et donc de toutes les fractions de la bourgeoisie, mais également par les modalités du découpage électoral, d’une part, par le mode de scrutin d’autre part, enfin par l’abstention. Le pouvoir s’est en effet toujours arrangé pour se composer de « bonnes circonscriptions » et pour réduire l’influence du vote populaire : en 1967, les 22 000 électeurs de la 2e circonscription de la Lozère valent ainsi autant que les 103 000 électeurs de la 5e circonscription du Rhône (Villeurbanne) ; dès lors, un député PCF représente en moyenne 70 000 mandats tandis qu’un député de la majorité n’en rassemble que 44 000 (69). Le scrutin majoritaire uninominal à deux tours nuisant fortement aux petites formations politiques, les voix qui se sont déportées du PCF et de la FGDS vers le PSU (qui passe de 2,2 à 3,9 des suffrages (70)) n’ont guère pesé. Enfin, l’abstention s’est accrue entre les élections législatives de 1967 et celles de 1968 ; elle atteint 20 % ; on peut estimer qu’il y a eu là un rejet du piège électoral par une partie de la classe ouvrière et des étudiants en âge de voter. Car il faut aussi souligner que les travailleurs étrangers, fortement engagés durant les grèves, mais aussi les jeunes de moins de 21 ans sont exclus du droit de vote.
Avant même ce triomphe, le pouvoir use de l’arbitraire légal pour étouffer les organisations révolutionnaires. Un décret paru au Journal officiel du 13 juin 1968 porte dissolution de la Jeunesse communiste révolutionnaire (JCR), de la Fédération des étudiants révolutionnaires (FER), du Comité de liaison des étudiants révolutionnaires (CLER), du groupe « Révoltes », de l’Organisation communiste internationaliste (OCI), de l’Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes (UJCml), du Parti communiste marxiste-léniniste de France (PCMLF), de Voix ouvrière (ancêtre de LO) et du Mouvement du 22 Mars. Quelques jours plus tard, une cinquantaine de membres de l’OAS (Organisation de l’Armée secrète qui défendit jusqu’au bout et par la pratique des attentats l’Algérie française) condamnés pour assassinat (dont Salan, le général, membre de l’OAS, qui tenta en avril 1961 un putsch contre De Gaulle afin de préserver l’Algérie française) sont amnistiés, autorisés à rentrer en France ou libérés de prison (71). Dans le même temps, des dirigeants trotskystes sont arrêtés et incarcérés. C’est le cas, fin juin, de Pierre Franck, l’un des responsables du Parti communiste internationaliste, gardé à vue et interrogé pendant dix jours sans qu’aucune charge ne pèse contre lui, puis, en juillet, d’Alain Krivine, écroué à la prison de la Santé avec douze militants JCR sous l’inculpation de reconstitution de groupement dissous (72). Plusieurs dizaines de jeunes étrangers, suspectés d’appartenir à des organisations d’extrême gauche (notamment 22 jeunes Allemands du SDS), sont expulsés du territoire français. Il leur est reproché d’avoir pris part à des manifestations interdites (73).
Aucune condamnation n’émane pour autant de la direction du PCF, tout au contraire. Les principaux responsables staliniens justifient sans vergogne ce qui constitue bien une approbation des mesures prises à l’encontre des organisations révolutionnaires par le pouvoir gaulliste. Lors d’un meeting organisé par le PCF à la Mutualité le 30 octobre 1968, René Andrieu et René Piquet sont interpellés par les jeunes présents dans la salle, qui leur demandent pourquoi la direction du PCF ne s’est pas prononcée contre l’interdiction des organisations, comme en témoignent les questions écrites émanant de la salle et parvenues à la tribune, dont les archives ont laissé trace — et non bien sur le compte rendu du meeting dans L’Humanité : « Pourquoi le PCF n’a pas condamné la dissolution des organisations politiques d’extrême gauche le 12 juin 1968 ? N’est-ce pas une attaque de la bourgeoisie contre les “libertés démocratiques” et à long terme le droit pour la classe ouvrière de s’organiser politiquement ? » ; « Pourquoi n’avez-vous rien dit contre la dissolution des organisations ouvrières et contre la répression de leurs militants ? Vous approuvez ainsi en ne disant rien le gouvernement » ; « Pourquoi le Parti communiste n’a-t-il pas protesté contre cette mesure ? Pourquoi n’a-t-il pas organisés une pétition nationale pour protester contre cette mesure ? » ; « Puisque les groupes gauchistes étaient néfastes à la classe ouvrière et servaient le pouvoir gaulliste, pourquoi celui-ci les a-t-il dissous ? » Les deux responsables staliniens sont donc contraints de s’expliquer longuement sur le sujet : « Oui, nous aurions pu prendre cette position de principe, c’était facile ; si nous avions été des démocrates bourgeois tout simplement, eh ! bien oui nous aurions montré une belle âme en disant ces gens-là sont persécutés, pas tellement d’ailleurs, mais enfin on pouvait prendre cette position. Mais on ne l’a pas fait. (…) Nous ne pouvions pas prendre une position de principe contre la dissolution, parce que si nous avions pris une position de ce genre, il aurait fallu en fait mener une campagne de solidarité politique avec des groupements dont depuis longtemps nous dénoncions justement le caractère particulièrement néfaste pour l’unité des travailleurs et le mouvement démocratique. Alors nous avons été logiques avec nous-mêmes (74). »
Les années qui suivront seront de fait marquées par une intense répression patronale et policière (provocations et matraquages à la porte des usines, licenciements…) contre les grévistes et les militants d’extrême gauche, parfois, en ce qui concerne ces derniers, avec l’aide directe des responsables staliniens sur place. Caractérisant cette évidente collaboration de classe, le sous-préfet de Montbéliard en viendra à écrire en juin 1970, observant le rôle de la CGT chez Peugeot entre autres, et après avoir précisé que « la CGT et le Parti communiste qui, l’an dernier, prenaient encore des intermédiaires pour signaler les maoïstes à la Police ou à la gendarmerie, le font maintenant directement » : « Il est certain que la CGT et le PCF “objectivement“ solidaires du gouvernement sont dans la période actuelle les véritables garants du maintien de l’ordre dans le bassin industriel et non les forces de police. (75) »
Remarques finales : les forces révolutionnaires en présence et la nature de la situation
État des lieux des organisations se réclamant de la révolution
Les organisations révolutionnaires au cours de cette période, en raison de leur très petite taille, n’ont pas pu jouer un rôle décisif, même si, ici ou là, elles ont tenu une place importante, parfois déterminante, dans le lancement d’une grève dans telle ou telle entreprise, ou chez les étudiants. La JCR (350 militants environ en avril 1968, 1 000 en juin (76)) est alors surtout présente dans les universités, en région parisienne et surtout à Toulouse et Rouen. Elle compte à cette époque à peine 30 % de militants ouvriers et employés (77). Elle parvient néanmoins à créer des liaisons étudiants-travailleurs grâce à la mise en place de divers comités d’action et comités de soutien, comme on l’a vu pour Caen dès janvier 1968. L’Organisation communiste internationaliste (OCI) peine encore elle aussi à développer un ancrage ouvrier. Ses deux principaux bastions industriels sont les usines Nord-Aviation à Châtillon-sous-Bagneux et Sud-Aviation à Bouguenais. Une importante partie de ses forces est composée, comme pour la JCR, d’étudiants, regroupés depuis avril 1968 au sein de la FER (Fédération des étudiants révolutionnaires), qui succède au CLER (Comité de liaison des étudiants révolutionnaires) fondé en 1961 : la FER compterait en mai 1968 1 000 adhérents (78). Voix ouvrière, quant à elle, est beaucoup plus petite mais présente dans les usines. Ses militants à Peugeot-Sochaux Montbéliard, par exemple, jouent un rôle essentiel semble-t-il dans la mise en place d’un comité de grève. Il en va de même, entre autres, chez Roussel-Uclaf à Romainville (79). Au total, Voix ouvrière paraît, sinon être directement présente, du moins diffuser sa « feuille de boîte » dans une soixantaine d’entreprises (80).
En dehors des organisations qui se revendiquent du trotskysme, il faut également évoquer la place des militants maoïstes, que se partagent l’UJC(ml) et le PCMLF. Ils lancent à partir de 1967 une campagne d’« établissement », destinée à implanter les militants étudiants dans les usines (81). Dans quelques entreprises, ces « établis » jouent un rôle dans le lancement de la grève, comme à Contrexéville le 15 mai ; le rôle des militants UJC(ml) à l’usine de Flins est aussi non négligeable.
À propos des étudiants et des barricades
Toutes ces organisations soutiennent d’emblée la contestation étudiante, dans laquelle elles reconnaissent un combat potentiellement révolutionnaire. Dès le 11 mai, le PCMLF affirme que « les étudiants ont raison de se révolter et de se défendre » ; il exalte « la lutte héroïque des jeunes étudiants », « digne des traditions révolutionnaires », et conclut sur l’indispensable unité des travailleurs et des étudiants (82). La position de l’UJC(ml) est semblable. De ce point de vue, c’est Voix ouvrière qui, tout en apportant son soutien aux luttes étudiantes et en les saluant, manifeste certaines ambiguïtés et réticences à leur encontre. Assurément, fin avril, VO atteste sa solidarité à l’égard de Daniel Cohn-Bendit, menacé d’expulsion — « À travers lui, précise Voix ouvrière, c’est le droit à l’expression de toute l’extrême gauche qui est en jeu (83). » Assurément, il s’agit pour elle de « soutenir les étudiants qui ne se battent pas seulement pour la réforme de l’Université, mais contre l’État bourgeois et ses flics (84) ». Elle voit en fait dans cette lutte, non pas une prémisse révolutionnaire, mais « la première étape d’un glissement à gauche (85) » — et ce vocabulaire gauche/droite la distingue des autres organisations qui se réclament de la révolution et qui répugnent davantage à l’usage de ce vocabulaire bourgeois. VO prend néanmoins des pincettes à l’égard tant des revendications que des modes d’action étudiants, jugés « contestables (86) » — « mais est-ce vraiment de leur faute ? », ajoute-t-elle (87). Les raisons de leur lutte lui apparaissent « confuses ». Et d’affirmer, au moment même où s’enclenche un processus de solidarité avec les étudiants : « {ils} se battent peut-être d’une façon qui nous choque (88) ».
Les autres organisations trotskystes sont quant à elles bien plus fermes dans leur soutien aux étudiants et dans l’analyse de leur engagement. Lors de sa conférence constitutive des 27 et 28 avril 1968, la FER, « salue, comme pointe avancée du prolétariat international, les combats de ces milliers d’étudiants (89) ». De même, la JCR voit dans les étudiants en lutte une avant-garde révolutionnaire. Raillant les maoïstes qui entendent placer les étudiants « au service du peuple » (90), Daniel Bensaïd insiste sur la mise sous tutelle du prolétariat français par le PCF stalinien : « Déjà en 1902 des gens étaient apparus qui, disait Lénine, “se mettaient à genoux pour contempler le postérieur du prolétariat russe”. Gageons que nos mandarins en mal de prolétariat ne trouveront pas, après 40 ans de stalinisme, le postérieur du prolétariat français plus reluisant que celui de son homologue slave (91). » Dès lors, selon Daniel Bensaïd et Henri Weber (JCR), les étudiants jouent désormais « le rôle d’avant-garde délaissé par les partis ouvriers (92) ». « Il y a encore, estime aussi le Secrétariat unifié dit de la IVe Internationale, un important décalage entre la maturité révolutionnaire de l’avant-garde jeune et l’état de conscience du prolétariat (93). » Pierre Franck, son principal dirigeant en France, juge que le mouvement étudiant se place clairement « sur la gauche du mouvement [et] à un niveau très élevé du point de vue marxiste révolutionnaire (94) ».
L’un des principaux désaccords entre la FER et les autres organisations révolutionnaires (principalement la JCR et les maoïstes ; Voix ouvrière ne participe pas aux événements, faute d’être présente en milieu étudiant) porte sur les barricades. JCR, UJC(ml) et PCMLF prennent en effet part à la résistance sur les barricades, lors de la nuit du 10 au 11 mai (95). Le risque est d’isoler les étudiants dans le ghetto du quartier Latin et de les conduire à un véritable massacre. Sortant de leur meeting à la Mutualité, plusieurs centaines de militants de la FER, à la tête desquels se trouve Claude Chisseray, viennent inciter les étudiants radicalisés à abandonner les barricades au nom du mot d’ordre « 500 000 travailleurs au quartier Latin ». Dans son ouvrage, François de Massot oublie d’ailleurs opportunément de mentionner que ce que Chisseray suggère ce soir-là, c’est bien de quitter les barricades (96). La position de la FER et de l’OCI suscite dès lors l’incompréhension et un profond rejet teinté de mépris chez beaucoup d’étudiants en lutte. Il est certain que les étudiants ne pouvaient pas monter seuls à l’assaut du pouvoir. Si un processus révolutionnaire implique nécessairement de la violence, pour le mener, la classe ouvrière doit être l’acteur principal du combat, ce qui n’est pas le cas ces 10 et 11 mai — même si des travailleurs ont rejoint les étudiants sur les barricades et si ceux-ci ont reçu l’aide d’habitants du quartier. Cependant, la position de la FER et de l’OCI apparaît comme une grave erreur politique dans ces circonstances. Si une organisation révolutionnaire n’a pas à chercher, par provocation, l’affrontement avec la police lorsque le rapport de force est très insuffisant, elle doit être capable de développer son orientation en s’appuyant sur la spontanéité des masses. Elle se doit d’être au côté des milliers d’étudiants qui, faisant leur propre expérience, ont décidé courageusement de tenir tête à la police pour se réapproprier la Sorbonne. D’autant plus que le service d’ordre bien organisé de la FER et de l’OCI aurait permis d’encadrer une retraite la moins coûteuse possible en blessés et en arrestations, lorsque les CRS ont fini par déloger les barricades et ont pourchassé leurs occupants dans les moindres recoins du quartier Latin. Cette attitude est la seule à même de rendre crédibles la FER et l’OCI, de convaincre l’avant-garde étudiante de la justesse du mot d’ordre de « 500 000 travailleurs au quartier Latin ».
Plus généralement, l’OCI se montre très opposée à tout ce qui peut ressembler à une « université critique ». Elle n’a que condescendance à l’égard de ce qu’elle nomme « la kermesse de la Sorbonne (97) ». Or, il faut souligner que, pour les militants et organisations qui composent le Mouvement du 22 Mars, cette université critique ne peut se concevoir sans une attaque directe du système capitaliste à la racine. En ce sens, François de Massot les calomnie lorsqu’il assimile leurs positions à « de douceâtres homélies sur la possibilité d’une “réforme démocratique” de l’Université dans le cadre de la société capitaliste » et que « les éléments petits-bourgeois à la Cohn-Bendit » ne « voi[ent] pas la possibilité de l’unification des luttes (98) ». De Massot cite lui-même l’intervention d’un membre du Bureau national de la JCR « avec laquelle Cohn-Bendit se déclare en accord » : « La classe ouvrière reste l’élément historique qui renversera le capitalisme à l’échelle mondiale. La politique syndicale est un frein. (…) Il faut avoir pour objectif une organisation révolutionnaire car : 1° il n’est pas question de se mettre à la remorque des directions syndicales ; 2° la classe ouvrière est classe quand elle s’oppose en tant que telle au patronat (99). » En fait, toutes les organisations d’extrême gauche, et non pas seulement la FER et l’OCI, sont bien conscientes des « problèmes politiques posés à un niveau tel qu’ils ne pouvaient plus être réglés par la seule action des étudiants (100) » ; c’est pourquoi elles se battent avec justesse pour la jonction des luttes, ouvrières et étudiantes.
Positions à l’égard des directions syndicales et de l’appareil stalinien
Les organisations qui se réclament de la révolution divergent également sur la position à tenir à l’égard des directions des organisations syndicales. Assurément, toutes dénoncent leur politique. L’UJC(ml) vitupère par exemple les accords de Grenelle comme un « coup de poignard dans le dos des ouvriers (101) » : la direction de la CGT « accepte de jouer le jeu du capital (102) ». L’axe central de cette organisation est d’ailleurs de chasser l’appareil de la CGT, par « l’expulsion des bureaucrates et des capitulards (103) », de sorte que les travailleurs se réapproprient leurs syndicats. L’UJC(ml) souligne donc la nécessité que « les syndicalistes prolétariens, appuyés par les masses, prennent le pouvoir dans la CGT de lutte de classe (104). » La position du PCMLF est proche ; pour lui, « les ouvriers ont le devoir de se révolter contre les cadres syndicaux qui trahissent leurs intérêts de classe (105) ».
Voix ouvrière est elle aussi très claire dans sa dénonciation des appareils syndicaux, et tout particulièrement de la CGT. Elle emploie les termes de « complicité abjecte (106) » avec le pouvoir, de « trahison », de « compromis pourri » de la part d’un PCF « devenu l’un des piliers de l’ordre bourgeois (107) ». Mais il faut souligner l’importante ambiguïté dont fait preuve VO. En effet, elle dénonce certes le fait que, « comme en 36, le PCF {veuille} cantonner la grève sur le terrain économique (108) ». Cependant, le 20 mai, Voix ouvrière conditionne la reprise du travail à la satisfaction de quatre revendications : pas de salaire inférieur à 1 000 francs ; 40 heures sans diminution de salaire ; paiement intégral des jours de grève ; libertés syndicales et politiques entières dans les entreprises (droit de libre circulation de la presse, droit de réunion). Bien plus réductrice encore est sa position du 24 mai : « Il faut que sur les revendications essentielles : salaire et horaire, la classe ouvrière remporte une victoire (109) ». C’est là se situer très en deçà des revendications majoritairement exprimées par les millions de grévistes et oublier totalement toute perspective politique. Réduction de la réduction, Voix ouvrière finit par affirmer que « les grèves actuelles ont, bien entendu, comme premier objectif une augmentation des salaires (110) ». Ce qui revient à emboîter le pas du PCF qui prétend avoir une telle analyse de la grève. Dès lors, bien loin d’appeler à la grève générale, voici ce qu’aurait dit VO à la place de Séguy à Billancourt après les Accords de Grenelle : « Camarades, voilà ce que propose le gouvernement. Nous, syndicalistes, pensons qu’il s’agit de broutilles et sommes pour la continuation de la grève. Mais c’est à vous d’en décider (111). »
PCI et OCI sont quant à eux intransigeants sur la dénonciation des bureaucraties syndicales et de l’appareil stalinien. Pierre Lambert, pour l’OCI, condamne « les dirigeants du PCF et de la CGT sacrifi{ant} les intérêts les plus immédiats et les plus généraux du mouvement ouvrier », « la honte du stalinisme » (112). Le PCI stigmatise pour sa part une « honteuse trahison », le « passage définitif {des directions du PCF et de la CGT} du côté de l’ordre bourgeois (113) ». Dans ce contexte, seule l’OCI interpelle les directions syndicales afin qu’elles appellent à la grève générale (114). De fait, il était juste de ne pas séparer l’auto-organisation des travailleurs de la nécessité d’un mot d’ordre central de grève générale, que seules les directions des confédérations ouvrières pouvaient lancer en l’absence d’un comité central de grève. Bien sûr, elles ne le voulaient pas, et donc ne le faisaient pas. Mais précisément, par la mise en avant de ce mot d’ordre, il fallait les y contraindre et aider les masses à comprendre la vraie logique de leur politique. Au vu du poids déterminant qu’avaient ces confédérations syndicales, un tel appel aurait joué un rôle considérable dans le renforcement et la poursuite de la grève jusqu’à la chute de De Gaulle et la mise en place d’un gouvernement ouvrier.
Structuration de la lutte : comités de grève et comité central de grève
Enfin, ce sont principalement les organisations se réclamant du trotskysme qui prônent la nécessité des comités de grève élus, avec la participation de non-syndiqués. Certes, l’UJC(ml) consacre parfois quelques lignes au fait que les comités de grève n’en sont pas véritablement et suggère ponctuellement d’« imposer des comités de grève qui reflètent la volonté de combat des travailleurs (115) ». Mais cette question demeure à la marge de son intervention et si elle déplore cette situation, l’UJC(ml) paraît malgré tout s’en accommoder, même si elle en appelle à une véritable occupation, massive, des usines, contre les délégués syndicaux qui invitent systématiquement les ouvriers à rentrer chez eux. En fait elle privilégie les comités de soutien populaires aux grévistes, notamment pour le ravitaillement, sous la forme de comités d’action. De même, le PCMLF en appelle à la constitution de « comités de base » et ponctuellement à une « liaison entre eux pour coordonner leur combat » (116), mais n’en fait pas un enjeu décisif. C’est là une très grave lacune des organisations maoïstes.
Parmi les organisations trotskystes, Voix ouvrière est celle qui accorde le moins d’importance à cette question pourtant fondamentale. Certes, il lui arrive d’évoquer, très occasionnellement, « les comités de grève dans les entreprises, les comités populaires dans les quartiers (117) », et d’écrire « Il faut occuper l’usine (118) ». Toutefois elle n’explique en rien la nature des comités qui se mettent en place, ne parle nullement de la nécessité de délégués élus, mandatés et révocables, qu’ils soient syndiqués ou non-syndiqués. A fortiori ne mentionne-t-elle pas la nécessaire fédération de ces comités de grève. Le 28 mai, VO se contente mollement d’inviter les travailleurs à « se voir les uns les autres » et à participer à « des colloques, à des assemblées où l’on discute démocratiquement ». Bon nombre de ses articles — comme aujourd’hui dans Lutte ouvrière… — se terminent sans aucune proposition concrète, laissant aux travailleurs le soin et la responsabilité d’en décider, parfois sous une pure forme interrogative dubitative : « Dans le mouvement gréviste actuel qui se développe et prend l’ampleur d’un nouveau 36, les travailleurs iront-ils plus loin qu’à l’époque (119) ? » ; « tout dépend encore de l’initiative des travailleurs (120) » ; « ce que nous voulons, nous le voulons tout de suite et pour longtemps (121) » ; « {la classe ouvrière} n’a pas dit son dernier mot (122) ».
Au contraire, de façon très juste, l’OCI et le PCI accordent une place déterminante à la fédération des comités de grève et à la perspective d’un comité central national de grève. L’OCI en fait l’axe central de son intervention politique. Le PCI y insiste également : « Dans les entreprises, élection démocratique des Comités de grève par tous les travailleurs syndiqués ou non pour diriger le combat et établir le contrôle ouvrier (contrôle de l’embauche, des livres de compte, etc.). Coordination locale, régionale et nationale de ces comités avec les Comités d’étudiants, d’enseignants, de lycéens, de paysans travailleurs (123) » ; « les comités devraient aussi vite que possible se fédérer localement, régionalement et nationalement en un Congrès national des comités d’usine et des comités d’action populaire dans les écoles et les quartiers, noyau de la future République socialiste française (124) » ; pour « un réseau de comités démocratiquement élus tendant à donner naissance à une direction beaucoup plus représentative de la classe en lutte, à une direction beaucoup plus dépendante des grévistes que d’un appareil syndical ou parti (125) ». De fait, en s’accaparant de faux comités de grève non élus, les appareils se sont approprié la grève et en ont expulsé les travailleurs. Pour remporter une victoire décisive, prendre la mesure de leur force en tant que classe, les travailleurs avaient un besoin impérieux de fédérer leurs comités élus, mandatés et révocables, à tous les niveaux, local, régional et national. C’était là, par l’auto-organisation de la classe ouvrière, avancer d’un pas décisif dans la montée révolutionnaire, aller vers une situation de double pouvoir.
La question du pouvoir
L’essentiel en effet, dans la situation, devait être de tracer une perspective politique dotée d’un programme de classe qui pose la question du pouvoir de façon compréhensible par les masses en grève. Les maoïstes de l’UJC(ml) appelaient à un vague « Front populaire pour la liberté ». Mais ce « pouvoir populaire » qui seul pouvait « libérer des patrons et de l’exploitation (126) » n’était guère défini, sauf à préciser que ce gouvernement serait « composé des représentants actifs et dynamiques des masses populaires en lutte ». En revanche, l’UCJ(ml) était claire sur le refus de toute organisation bourgeoise dans ce gouvernement, ce qu’elle traduisait par le mot d’ordre : « Gouvernement populaire, oui ! Mitterrand, non ! ». Mais cette position revenait en fait à reprendre le mot d’ordre du PCF, semant la confusion parmi les masses. La position du PCMLF était différente : à ses yeux, ce gouvernement populaire ne pouvait pas comprendre de représentants de ces deux partis ouvriers réformistes. Dès lors, sa formule « Vive le pouvoir du peuple, pour le peuple, par le peuple » renvoyait à un pouvoir émanant de comités d’action révolutionnaire, inexistants cependant en mai-juin 1968.
Une fois encore, Voix ouvrière s’est distinguée, au sein des organisations se réclamant du trotskysme, par une position politique particulièrement faible et sans perspective. Au risque de voir son appréciation ridiculisée et immédiatement balayée, VO n’a pas hésité à écrire noir sur blanc dans son édition du 15 mai que « les travailleurs sont démoralisés » — on constate que depuis, le discours de Lutte ouvrière n’a guère changé… — et que « les prolétaires n’ont pas les moyens de suivre les étudiants » (127) ! Face à pareille constatation, il n’est pas étonnant qu’à aucun moment au cours des mois de mai et de juin, Voix ouvrière n’ait posé la question du pouvoir. Elle se contente de titrer avec des généralités sans perspective positive : « Vive la grève générale » (20 mai), « La censure est dans la rue » (24 mai), « La plus grande grève générale jamais vue en France nos soi-disant représentants voudraient la brader. Qu’ils n’y comptent pas ! » (28 mai), « Non à De Gaulle vive la grève générale ! » (31 mai), « Ne bradons pas la grève pour un bulletin de vote » (4 juin), « La classe ouvrière reste invaincue » (26 juin). Elle est allée jusqu’à faire croire qu’un gouvernement Mitterrand ou Mendès France — « même s’ils ne représenteraient pas non plus les intérêts des travailleurs » —pouvait constituer, parce qu’il aurait signifié une défaite du gaullisme, « une victoire des travailleurs (128) », alors qu’il n’y aurait eu là qu’une solution de rechange bourgeoise avec des politiciens bourgeois. Une fois encore, c’est l’usage immodéré du mot « gauche », sans véritable caractérisation de classe des diverses organisations, qui a mené Voix ouvrière à cette extrémité : un travers que l’on retrouve aujourd’hui et qui l’a conduite tout aussi bien au vote Royal qu’à l’alliance dès le premier tour avec le PS pour les élections municipales.
L’OCI liait quant à elle la question du pouvoir à la fédération des comités de grève : « Ce sont les comités de grève qui détiennent avec la grève générale tous les leviers de commande de l’économie. Ce sont les comités de grève qui détiennent la puissance économique et politique. » Dès lors, le comité central de grève devait être « le seul gouvernement ouvrier qui peut donner satisfaction à toutes les revendications ouvrières, des étudiants, des travailleurs, des paysans et des jeunes (129). » Comme on le sait cependant, un tel comité central de grève n’existait pas en mai-juin.
Quant au PCI, il développait la perspective d’un gouvernement des travailleurs, « émanation des organisations représentatives de la classe ouvrière — aujourd’hui encore les syndicats demain des comités démocratiquement élus ». Il précisait : « Sans doute, , une telle revendication équivaut dans l’immédiat à appeler les grands partis ouvriers, associés aux syndicats à prendre le pouvoir : ils jouissent encore en effet de l’appui de la majorité de la classe ouvrière ». Mais il soulignait que c’était seulement une étape vers la prise de pouvoir par les travailleurs eux-mêmes, organisés dans des « comités » (comités de grève et comités d’action) (130). Le PCI posait aussi la question de l’indispensable armement ouvrier — en publiant l’article de Trotsky, « Front populaire et comités d’action » (26 novembre 1935), qui soulevait clairement la nécessité de milices ouvrières (131), mais également en appelant à la constitution « de noyaux de gardes populaires d’étudiants et d’ouvriers armés pour protéger les locaux occupés (132) ».
Cette question du pouvoir a bel et bien été soulevée spontanément par les salariés et étudiants lorsqu’ils ont scandé les mots d’ordre « Le pouvoir aux travailleurs », « Gouvernement ouvrier » ou repris le slogan du PCF « Gouvernement populaire », qu’ils entendaient comme gouvernement des organisations ouvrières. L’objectif était bien de chasser De Gaulle, donc le gouvernement de la bourgeoisie, et de porter au pouvoir les représentants du mouvement ouvrier. Le PCF a quant à lui transformé la perspective, ancrée dans les esprits des millions de grévistes, d’un gouvernement des organisations ouvrières, en une agitation électoraliste et réformiste, dans le cadre d’un front populaire : non seulement il ne postulait pas au pouvoir, comme on l’a vu, mais en outre il s’est allié à la FGDS qui, sous la houlette de Mitterrand, regroupait, outre la SFIO, des formations de « gauche » bourgeoises. En ne jurant que par la tenue d’élections, le PCF, la CGT et la SFIO permettaient à l’État bourgeois de se restabiliser. Mais ils avaient aussi la capacité de le faire, en raison de leur emprise idéologique et organisationnelle sur les masses.
C’est pourquoi, tout en combattant pour des comités de grève élus à tous les niveaux et un comité central national de grève permettant de dresser la classe ouvrière comme acteur du processus révolutionnaire, il fallait tenir compte de l’influence écrasante des organisations traditionnelles, à commencer par le PCF et la CGT, sur cette classe ouvrière puissamment organisée. Il fallait donc mettre en œuvre une tactique de front unique ouvrier et exiger de ces organisations qu’elles prennent le pouvoir, qu’elles forment un gouvernement des organisations ouvrières, sur la base d’un programme d’urgence satisfaisant l’ensemble des revendications des millions de grévistes et conçu par conséquent comme premier acte d’une politique ouvrière contre le capitalisme et l’État bourgeois. Cela aurait permis d’aider les masses à formuler clairement leurs aspirations, à exercer dès lors une pression maximale sur les directions et à mettre en évidence leur refus de prendre le pouvoir. Combinée à la construction des comités de grève et à leur centralisation, cette tactique permettait seule de développer à la fois l’auto-organisation des masses et une orientation tenant compte de leur état d’esprit réel, qui incluait leurs illusions à l’égard des organisations traditionnelles ; or seule leur propre expérience pouvait dissiper ces illusions, avec l’aide d’une organisation révolutionnaire à la fois forte théoriquement, claire stratégiquement et habile tactiquement.
En mai-juin 1968, la situation était bel et bien révolutionnaire. Des millions de travailleurs et d’étudiants ont exprimé leur rejet du pouvoir gaulliste, de l’exploitation capitaliste, de l’oppression impérialiste et néocoloniale. La grève générale a fait vaciller le gouvernement De Gaulle-Pompidou et a ainsi ouvert une brèche. Cependant, la direction de la classe ouvrière était quant à elle contre-révolutionnaire. Il n’y a pas donc pas eu de révolution. L’appareil du PCF et de la CGT est parvenu à inverser le cours de cette montée révolutionnaire, à la canaliser par tous les moyens possibles et finalement à la briser. Devant la puissance de cet appareil, les toutes petites organisations qui se réclamaient de la révolution, avec leurs forces, leurs faiblesses et leurs erreurs, ne pouvaient pas faire face. On saluera l’initiative de la JCR, du PCI et de Voix ouvrière qui constituèrent, à partir du 19 mai, un « comité permanent de coordination » et appelèrent les autres organisations se réclamant du trotskysme à les rejoindre. L’OCI n’y apporta aucune réponse. Indéniablement, en mai-juin 1968, il a manqué un parti révolutionnaire.
1) Jean-Charles Asselain, Histoire économique de la France de 1919 à la fin des années 1970, Paris, Seuil, 1984, p. 141.
2) Xavier Vigna, L’Insubordination ouvrière dans les années 68, Essai d’histoire politique des usines, Presses universitaires de Rennes, 2007, p. 149.
3) Cité in Stéphane Just, « La grève générale de mai-juin 1968 est venue de loin », La Vérité, n°591, avril 1980, p. 43.
4) Kristin Ross, Mai 68 et ses vies ultérieures, Paris, Éditions Complexe, 2005, p. 39.
5) Le Monde, 8 fév. 1967, cité ibidem p. 50.
6) Xavier Vigna, op. cit., p. 77.
7) Stéphane Just, op. cit., p. 61.
8) Jacques Kergoat, « Sous la plage, la grève », in Antoine Artous, Didier Epsztajn, Patrick Silberstein (dir.), La France des années 1968, Paris, Syllepse, 2008, p. 49.
9) Cette disposition anti-démocratique est toujours en vigueur aujourd’hui.
10) Témoignage d’Arlette Laguiller cité in Jean Birnbaum, Leur jeunesse et la nôtre. L’espérance révolutionnaire au fil des générations, Paris, Stock, 2005, p. 60.
11) François de Massot, La grève générale (Mai-Juin 1968), Supplément au numéro 437 d’Informations ouvrières, p. 25.
12) Stéphane Just, op. cit., p. 55.
13) Rudi Dutschke, très gravement paralysé, est mort des suites de cet attentat en 1979.
14) Henri Lefebvre, L’irruption de Nanterre au sommet, Paris, Anthropos, 1968, rééd. Syllespe, 1998, p. 96.
15) Mouvement du 22 Mars, Ce n’est qu’un début continuons le combat, Paris, Maspero, 1968, p. 12.
16) Étudiant en sociologie à l’université de Nanterre, Daniel Cohn-Bendit, quoique né en France, n’a pas la nationalité française.
17) L’Humanité Dimanche, 5 mai 1968.
18) On le voit aujourd’hui, dans d’interminables entretiens et émissions, bavarder tranquillement avec l’ancien préfet de police Grimaud et cette réconciliation en forme de mascarade fait la joie des médias bourgeois.
19) Cité in François de Massot, op. cit., p. 51.
20) Cité ibidem, p. 52.
21) Exposé de Bernard Ducamin, in De Gaulle en son siècle. Moderniser la France, Paris, Institut Charles de Gaulle/Plon/La Documentation française, 1992, p. 388.
22) 450 000 selon la police (Xavier Vigna, op. cit., p. 26).
23) Xavier Vigna, op. cit., p. 106.
24) Jacques Kergoat, op. cit., p. 67.
25) Cf. notre article dans Le CRI des travailleurs n° 22, printemps 2006.
26) Cité in Stéphane Just, op. cit., p. 66.
27) Jacques Kergoat, op. cit., p. 71.
28) Idem.
29) Xavier Vigna, op. cit., p. 63.
30) Cité in Jacques Kergoat, op. cit., p. 72.
31) Idem, p. 76.
32) Appel de la Coordination des comités d’action, s. d., CERMTRI.
33) Danielle Tartakowsky, « Les manifestations de mai-juin 68 en province », in René Mouriaux, Annick Percheron, Antoine Prost, Danielle Tartakowsky (dir.), 1968 : exploration du mai français, tome 1 : Terrains, Paris, L’Harmattan, 1992, p. 145.
34) Motion votée par l’assemblée générale, Sorbonne, 15 mai 1968, CERMTRI.
35) Xavier Vigna, op. cit., p. 49.
36) Mouvement du 22 Mars, op. cit., p. 31.
37) Daniel Bensaïd, Henri Weber, Mai 68 : une répétition générale, Paris, Maspero, 1968, p. 156.
38) François de Massot, op. cit., p. 82.
39) François de Massot, op. cit., p. 83.
40) Xavier Vigna, op. cit., p. 57.
41) XIe Congrès de l’UECF, Avant-projet de résolution, 4-7 avril 1968, Archives départementales de Seine-Saint-Denis, Fonds Roland Leroy, 263J4.
42) I.C.O. (Informations Correspondance Ouvrières), La grève généralisée mai-juin 68, juillet 1968, rééd. Spartacus, 2007, p. 57.
43) Cité in Fr. de Massot, op. cit., p. 149.
44) Les Échos, 17 mai 1968, cité ibidem, p. 93.
45) Cités in Maurice Rajsfus, Mai 68. Sous les pavés, la répression (mai 1968-mars 1974), Paris, Le Cherche Midi éditeur, 1998, p. 214.
46) Georges Marchais, « De faux révolutionnaires à démasquer », L’Humanité, 3 mai 1968.
47) Cité dans Le Monde, 28 mai 1968.
48) Le Monde, 25 mai 1968.
49) L’Humanité, 24 mai 1968.
50) Mouvement du 22 Mars, op. cit., p. 31.
51) D. Bensaïd, H. Weber, op. cit., p. 156.
52) La grève à Flins, Paris, Maspero, 1968, p. 42.
53) Xavier Vigna, op. cit., p. 83.
54) Interventions de René Piquet et de René Andrieu, Meeting à la Mutualité, 30 octobre 1968, Archives du PCF, Fonds Roland Leroy, 263J39.
55) Cité par Jacques Kergoat, op. cit., p. 63.
56) Cité in Xavier Vigna, op. cit., p. 65.
57) Ces expressions sont de l’historien Xavier Vigna (op. cit., p. 59).
58) Xavier Vigna, op. cit., p. 62.
59) Cité in Fr. de Massot, op. cit., p. 155.
60) Maurice Rajsfus, Mai 68. Sous les pavés, la répression (mai 1968-mars 1974), Paris, Le Cherche Midi éditeur, 1998, p. 18.
61) Philippe Labro, Ce n’est qu’un début, Paris, Publications Premières, 1968, p. 134.
62) Maurice Rajsfus, op. cit., p. 28.
63) I.C.O., La grève généralisée mai-juin 68, op. cit., p. 53-54.
64) La grève à Flins, op. cit., p. 39, 29 et 19.
65) Cité in Maurice Rajsfus, op. cit., p. 217.
66) Cité ibidem.
67) Cité in Maurice Rajsfus, op. cit., p. 219.
68) Stéphane Just, op. cit., p. 67.
69) « Le pays électoral et le pays réel », Lutte ouvrière, n°1, 26 juin 1963.
70) C’est la seule organisation politique « de gauche » à progresser ; c’est aussi le seul parti qui mène campagne en s’appuyant sur les thèmes nés durant la grève générale. « En revanche, le parti communiste et la FGDS mènent une campagne très classique, tout entière orientée autour du problème des responsabilités du pouvoir » (Serge Berstein, La France de l’expansion. La République gaullienne 1958-1969, Paris, Seuil, 1989, p. 320).
71) Kristin Ross, op. cit., p. 65.
72) Maurice Rajsfus, op. cit., p. 41-43.
73) Ibidem, p. 178.
74) Interventions de René Piquet et de René Andrieu, Meeting à la Mutualité, 30 octobre 1968, Archives du PCF, Fonds Roland Leroy, 263J39.
75) Cité in Xavier Vigna, op. cit., p. 247.
76) Jean-Guillaume Lanuque et Jean-Paul Salles, « Trotskismes », in Antoine Artous, Didier Epsztajn, Patrick Silberstein (dir.), La France des années 1968, op. cit., p. 790.
77) Rapport des renseignements généraux cité in Xavier Vigna, op. cit., p. 281.
78) François de Massot, op. cit., p. 29.
79) Xavier Vigna, op. cit., p. 283.
80) D’après Jean-Paul Salles, La Ligue communiste révolutionnaire (1968-1981). Instrument du Grand Soir ou lieu d’apprentissage ?, Rennes, PUR, 2005, p. 75.
81) Cf. Marnix Dressen, De l’amphi à l’établi. Les étudiants maoïstes à l’usine (1967-1989), Paris, Belin, 1999.
82) Comité central du PCMLF, « Vive la lutte des étudiants », L’Humanité nouvelle, 11 mai 1968.
83) « Solidarité avec Cohn-Bendit », Voix ouvrière, n°23, 30 avril 1968.
84) Catherine Olivier, « La lutte des étudiants », Voix ouvrière, n°25, 15 mai 1968.
85) Georges Kaldy, « Des émeutes de Mai 1958 aux Barricades de 1968 », Voix ouvrière, n°25, 15 mai 1968.
86) Christian Jung, « Les étudiants, l’opinion publique et la classe ouvrière », Voix ouvrière, n°24, 8 mai 1968.
87) « “Enragés” ? “Fils à papa” ? Ou première faille dans un régime qu’il fat changer ? », Voix ouvrière, n°24, 8 mai 1968.
88) Idem.
89) Manifeste de la Fédération des étudiants révolutionnaires, 27-28 avril 1968, CERMTRI.
90) Les maoïstes assignent deux tâches aux étudiants : « soutenir les bastions de la résistance prolétarienne comme Renault, Citroën, Peugeot ; aider le peuple à s’organiser dans les quartiers et les villages » (La Cause du peuple, n°16, 13 juin 1968).
91) Daniel Bensaïd, « Luttes étudiantes, luttes ouvrières », L’Avant-Garde Jeunesse, n°13, 18 mai 1968.
92) D. Bensaïd, H. Weber, op. cit., p. 142.
93) « Vivent les barricades de Paris ! En avant pour le révolution socialiste en Europe ! », Appel du Secrétariat unifié de la IVe Internationale, 20 mai 1968.
94) Pierre Frank, « Mai 68 : première phase de la Révolution socialiste française » (10 juin 1968), in Quatrième Internationale, juillet 1968, p. 15-16.
95) Le PCMLF en rend compte ainsi : « Pesant les risques, pensant que la répression serait d’une rare violence et sachant que les barricades étaient encerclées, {les militants de notre parti} n’en ont pas moins décidé de rester au combat jusqu’au bout. En effet, telle était la volonté unanime des dizaines de milliers de manifestants, travailleurs ou étudiants. Même si cette entreprise avait été une erreur, ce qui n’est pas le cas, aurions-nous dû nous retirer et regarder la mêlée de haut ? Non, notre devoir était d’être avec les masses, de combattre à leur côté, d’aider à leur organisation dans la lutte (…) Il faut dire que si le combat avait été mené suivant les principes de la guerre populaire de Mao Tsé-Toung, ils ne se seraient certainement pas déroulés de cette manière. En effet, les principes de la guerre populaire, dans une ville comme Paris avec une police suréquipée et nombreuse, ne consistent pas à se laisser encercler par l’ennemi, mais au contraire à former des groupes mobiles qui harcèlent l’ennemi, l’attaquent de différents côtés ». (« Des barricades au grandiose défilé du 13 mai », L’Humanité nouvelle, 11 mai 1968.
96) Cf. le passage qui y est consacré, François de Massot, op. cit., p. 53.
97) François de Massot, op. cit., p. 151.
98) François de Massot, op. cit., p. 30 et 32.
99) Cité in François de Massot, op. cit., p. 47.
100) François de Massot, op. cit., p. 49.
101) « Vigilance ! », La Cause du peuple, 23 mai 1968.
102) Éditorial, La Cause du peuple, 1er juin 1968.
103) Éditorial, La Cause du peuple, 25-26 mai 1968.
104) « Vigilance ! », La Cause du peuple, 23 mai 1968.
105) « Ouvriers, paysans, étudiants, arrachons le pouvoir à la base », L’Humanité nouvelle, 24 mai 1968.
106) « Le PCF et la CGT derrière Pompidou », Voix ouvrière, n°27, 24 mai 1968.
107) Christian Jung, « Le PCF et la crise. Les paradoxes d’une politique », Voix ouvrière, n°28, 28 mai 1968.
108) Voix ouvrière, n°28, 28 mai 1968.
109) Catherine Olivier, « Et pas pour rien », Voix ouvrière, n°27, 24 mai 1968.
110) « Pour garantir nos salaires et empêcher la hausse des prix Échelle mobile des salaires et contrôle ouvrier dans les entreprises », Voix ouvrière, n°30, 4 juin 1968.
111) « Accords entre gouvernement, patronat et syndicats pour tenter de liquider la grève », Voix ouvrière, n°30, 4 juin 1968.
112) Déclaration de Pierre Lambert, 15 juin 1968, cité in François de Massot, op. cit., p. 310-311.
113) « Quelle marge de manœuvre pour la bourgeoisie ? », Quatrième Internationale, n° 30, juin 1968.
114) Appel de l’OCI, 30 mai 1968, cité in François de Massot, op. cit., p. 248.
115) Éditorial, La Cause du peuple, 27-28 mai 1968.
116) « En avant pour un pouvoir révolutionnaire ! », L’Humanité nouvelle, 23-30 mai 1968.
117) F. Maignan, « L’État fort a dû baisser pavillon », Voix ouvrière, n°26, 20 mai 1968.
118) « Il faut occuper l’usine », Voix ouvrière, n° 26, 20 mai 1968.
119) S. Grenet, « Ce que fut juin 36 », Voix ouvrière, n°26, 20 mai 1968.
120) « La censure est dans la rue », Voix ouvrière, n°27, 24 mai 1968.
121) « La plus grande grève générale… », Voix ouvrière, n°28, 28 mai 1968.
122) Christian Jung, « Le PCF et la crise. Les paradoxes d’une politique », Voix ouvrière, n°28, 28 mai 1968.
123) « De Gaulle à la porte tout de suite », Tract du Parti communiste internationaliste (Section française de la IVe Internationale-Secrétariat Unifié), 29 mai 1968.
124) Appel du Secrétariat Unifié, « Vivent les barricades de Paris ! En avant vers la révolution socialiste en Europe ! », 20 mai 1968, numéro spécial de Quatrième Internationale, mai 1968.
125) Pierre Frank, « Mai 68 : première phase de la révolution socialiste française », Quatrième Internationale, mai 1968.
126) La Cause du peuple, 23 mai 1968.
127) Henri Vauquelin, « Le défi des étudiants », Voix ouvrière, n°25, 15 mai 1968.
128) « Grève générale et manifestations. La censure est dans la rue », Voix ouvrière, n°27, 24 mai 1968.
129) Appel des comités d’alliance ouvrière, 29 mai 1968, cité in François de Massot, op. cit., p. 304.
130) « Premières leçons de la montée révolutionnaire de mai 68 », Déclaration du Secrétariat unifié de la IVe Internationale, 10 juin 1968, Supplément au n° 29 de Quatrième Internationale.
131) Quatrième Internationale, n° 30, juin 1968.
132) Appel du Secrétariat Unifié, « Vivent les barricades de Paris ! En avant vers la révolution socialiste en Europe ! », 20 mai 1968, Quatrième Internationale, mai 1968.





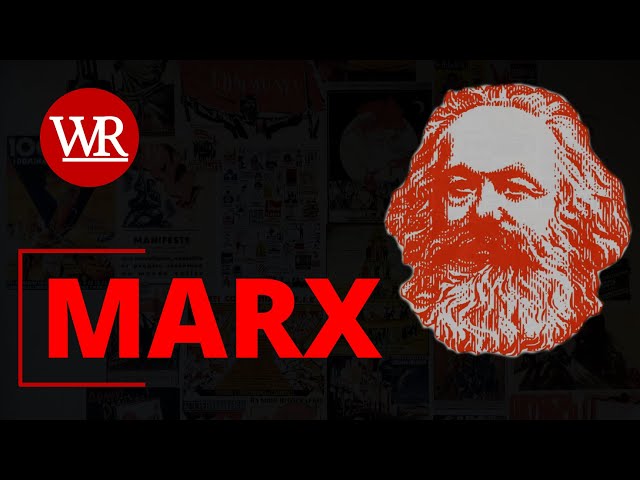

.jpg)
