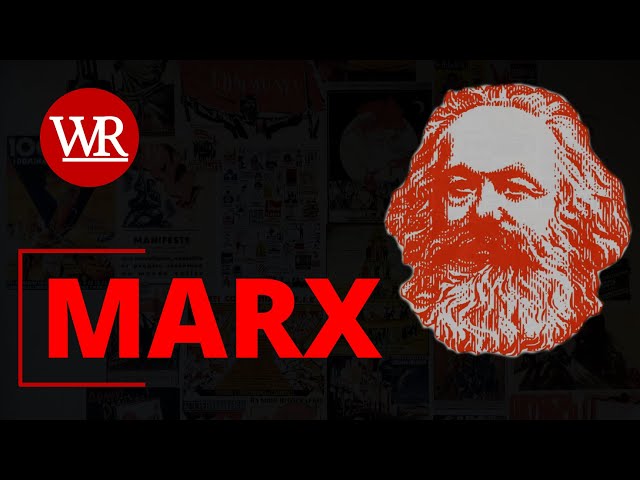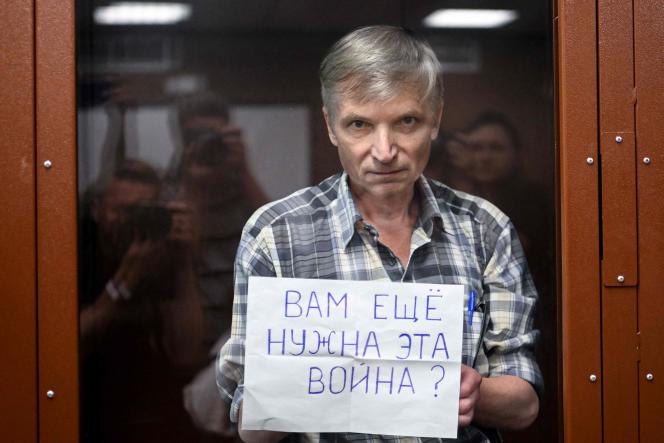Agenda militant
Ailleurs sur le Web
![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)
- « L’engagement politique à l’ère de l’inouï » avec Alain Deneault (31/10)
- Retraites : le GRAND ENFUMAGE du Rassemblement national (31/10)
- La guerre avec la Chine ? (30/10)
- Le plan Condor en procès (30/10)
- Budget : les macronistes ont le moral dans les chaussettes (29/10)
- Anora, le réel sans fracas : retour sur la Palme d’or (29/10)
- Nouveau record pour Ubisoft (29/10)
- Sur François Bazin, Le parrain rouge. Pierre Lambert, les vies secrètes d’un révolutionnaire, Plon, 2023 (29/10)
- La tête de l’emploi, ou l’allumeur de mèche de l’exécutif Macron/Barnier soutenu par Le Pen (29/10)
- La crise des Etats-Unis, centre de la multipolarité impérialiste (29/10)
- Le business des pompes funèbres et des assurances-obsèques (29/10)
- "ILS PRENNENT DE LA COCAÏNE À L’ASSEMBLÉE" : LA GRANDE HYPOCRISIE DES POLITIQUES (27/10)
- "VOUS NE DÉTESTEZ PAS LE LUNDI..." : L’ENFER DU MONDE DU TRAVAIL (NICOLAS FRAMONT) (27/10)
- Droite d’en haut, gauche d’en bas ? Dialogues autour de livre « La Droitisation française » (27/10)
- Dans les profondeurs du capital [Podcast] (27/10)
- Prendre la mesure de la gravité de la situation (27/10)
- La Rumeur : le rap au service de la révolte (24/10)
- Étienne Balibar : Mémorandum sur le génocide en cours à Gaza (24/10)
- C’était le congrès de la dernière chance pour Die Linke (24/10)
- La Moldavie sort profondément divisée après les élections (24/10)
- La valeur travail. Critique et alternative (24/10)
- Afrique : Hausse des températures… et des conflits (24/10)
- Mobilisation pour la libération de Georges Abdallah (24/10)
- Israël et le soutien des puissances impérialistes (24/10)
- Ubisoft: « La direction n’écoute pas les salariéEs et prend des décisions sans les consulter » (24/10)
Liens
- Notre page FaceBook
- Site de la france insoumise
- Site du NPA-Révolutionnaire
- Site anti-k.org
- Le blog de Jean-marc B
- Démocratie Révolutionnaire
- Fraction l'Étincelle
- Révolution Permanente (courant CCR)
- Alternative Communiste Révolutionnaire (site gelé)
- Ex-Groupe CRI
- Librairie «la Brèche»
- Marxiste.org
- Wiki Rouge, pour la formation communiste révolutionnaire
La révolution russe de 1917
Les événements de février et leur suite marquent le début de la révolution russe de 1917, son premier volet en quelque sorte, sa partie bourgeoise aussi, puisqu’en sortira un gouvernement dirigé par le parti de la bourgeoisie, les cadets. Cependant la force motrice de ce premier volet est déjà le prolétariat et ses institutions révolutionnaires : les soviets, qui réapparaissent douze ans après la révolution de 1905 (cf. les deux derniers numéros du CRI des travailleurs). Nous présentons ici un exposé qui repose essentiellement sur l’Histoire de la révolution russe de Trotsky.
Une bourgeoisie faible et incapable de prendre le pouvoir
L’un des traits essentiels de l’histoire de la Russie est la lenteur de son évolution, économiquement, socialement et culturellement. Sa situation, entre l’Orient et l’Occident, peut l’expliquer : elle subit le joug de l’Orient mais ne suit pas son modèle car elle reste toujours sous la pression militaire de l’Occident. Cependant, elle bénéficie de ce que Trotsky appelle le développement combiné, qui découle justement de l’inégalité des rythmes d’évolution.
En ce qui concerne l’industrie, en particulier, la Russie n’est pas passée par toutes les étapes de l’évolution économique de l’Europe capitaliste, elle s’y est insérée au fur et à mesure que celle-ci débordait des frontières nationales. Elle a ainsi profité d’effets de rattrapage. Une des conséquences en est que, de 1905 à la Première Guerre mondiale, la production industrielle a doublé. Cependant, l’économie russe reste handicapée par sa faible productivité du travail, et l’industrie reste très minoritaire : l’écrasante majorité de la population est paysanne et travaille encore comme les paysans français ou anglais du XVIIe siècle. Par contre, le développement brusque de l’industrie a donné naissance à des entreprises gigantesques comptant des milliers d’ouvriers. Ainsi les entreprises de plus de 1000 salariés emploient-elles 42 % des ouvriers, alors qu’elles en rassemblent seulement 18 % aux États-Unis par exemple. De plus, l’industrie russe est presque entièrement aux mains des banques, elles-mêmes contrôlées par la finance européenne, par l’intermédiaire de tout un réseau de banques auxiliaires et intermédiaires. En tout, 40 % des capitaux investis en Russie sont étrangers, et la proportion est encore plus forte dans l’industrie lourde (métaux, charbon, pétrole).
Cette situation économique a déterminé profondément la physionomie sociale et politique de la bourgeoisie russe : celle-ci est numériquement faible et s’en remet politiquement au tsar, donc à l’aristocratie et à la bureaucratie largement corrompue — ce régime politique étant d’ailleurs soutenu également par les bourgeoisies européennes, notamment française. En 1905, la bourgeoisie russe s’est ainsi montrée veule, incapable de se battre pour le renversement du tsar ou même l’instauration d’un régime parlementaire, tétanisée notamment par sa peur des ouvriers soulevés...
Un prolétariat puissant, dont la conscience se constitue rapidement
En effet, si la bourgeoisie russe n’est pas assez puissante pour prétendre au pouvoir, la classe ouvrière l’est elle-même déjà trop. Le prolétariat russe n’est pas lui non plus passé par toutes les phases de l’évolution occidentale, il n’a pas connu les corporations d’artisans, son développement à partir du vivier des masses paysannes, se fait par bonds, suivant les besoins de l’industrie. D’un côté, ce prolétariat, directement prélevé au village, a conservé des liens et des contacts avec ses origines sociales. Mais, d’un autre côté, lui aussi bénéficie du développement combiné de l’industrie russe : il est très concentré dans de grands établissements de quelques grandes villes, ce qui est facteur d’organisation et de culture ; de plus, sa conscience de classe s’enrichit rapidement, se nourrissant à la fois de l’histoire du prolétariat européen (notamment du développement du marxisme) et de sa propre expérience, où la révolution de 1905 et les soviets occupent évidemment une place fondamentale.
La guerre, meurtrière et grosse de révolte
La guerre impérialiste débutée en 1914 a pour cause la concurrence interimpérialiste pour la domination mondiale. Mais cet enjeu global dépasse les possibilités de la Russie : ses propres buts de guerre (détroit de Turquie, Galicie, Arménie...) doivent impérativement correspondre aux intérêts des principaux États en guerre, c’est-à-dire de ses alliés (la France et l’Angleterre). Pour cela, la Russie est en quelque sorte condamnée à payer ses alliances avec ces pays plus avancés : elle est contrainte d’importer leurs capitaux et de leur verser les intérêts ; comme l’écrit Trotsky, elle a « le droit d’être une colonie privilégiée de ses alliés »... Ainsi, même si elle a dans cette guerre des intérêts impérialistes de niveau mondial, la bourgeoisie russe peut être considérée comme à demi « compradore », dépendante de la finance étrangère et d’États plus puissants.
L’armée russe, fournie en hommes par le service militaire obligatoire, connaît les mêmes antagonismes sociaux que l’ensemble de la société. Les officiers ont les mêmes tares que les classes dominantes dont ils sont issus : passéisme, bureaucratisme, corruption, etc. Les soldats sont des paysans sont envoyés au front sans réelle instruction, sans avoir pu assimiler la technique militaire moderne importée des pays avancés... Comme l’industrie, l’armée russe dépend de ses alliés... qui sont trop éloignés pour pouvoir l’aider efficacement. De là ses défaites rapides sur le front allemand.
Or ces défaites entraînent la démoralisation, des désertions... et beaucoup de réflexion parmi les soldats. Les années passent et, sur le front comme à l’arrière, se fait sentir la lassitude de la guerre. Les classes les plus pauvres et les campagnes en ont assez de se faire prélever de la chair pour les canons. Dans le même temps, les industriels se mobilisent pour les besoins matériels de l’armée, ils leur consacrent jusqu’à 50 % de la production industrielle nationale, accroissant l’exploitation des ouvriers... et réalisant ainsi d’énormes bénéfices...
Tensions entre les classes
La guerre à son début a mis momentanément fin à un cycle montant de grèves. Les ouvriers sont eux aussi mobilisés pour le front : à Petrograd jusqu’à 40 % de la main d’œuvre est renouvelée. Mais les grèves reprennent à partir de 1915 et montent en puissance, changeant progressivement de nature, acquérant un caractère de plus en plus anti-guerre et politique. Pendant toute l’année 1916, avec la dégradation des conditions de vie des masses, les meetings se multiplient, les ouvriers, poussés à bout, sont nerveux et combatifs, ils se lancent dans des grèves dont les revendications ne sont plus simplement économiques, mais aussi politiques. Or, si le prolétariat russe est largement minoritaire, ses liens avec la paysannerie lui permettent de rencontrer un puissant appui parmi les masses paysannes, dont les forces actives et la jeunesse connaissent au front un bouleversement de leurs conditions d’existence et un brassage qui sont sources d’expériences et de réflexions. Les ouvriers avancés les aident à prendre conscience de la nature du tasrisme, clé de voûte de l’aristocratie foncière qui les pille, et de la veulerie de la bourgeoisie, incapable de conquérir le pouvoir et donc de régler la question agraire en donnant la terre aux paysans.
La monarchie comme la bourgeoisie tremblent devant les défaites militaires et les tensions intérieures. Pour essayer de contrôler la situation sans s’embarrasser de la Douma (Parlement croupion octroyé après la révolution de 1905), le tsar décide d’ajourner celle-ci. Les ouvriers répliquent par des grèves. Partagés entre sa peur panique des ouvriers et ses propres aspirations politiques, l’opposition bourgeoise réaffirme son soutien à la politique du tsar, tout en décidant d’utiliser la Douma pour critiquer en parole la monarchie — mais sans poser la question du pouvoir : de fait, ses critiques en restent à la question du ravitaillement des troupes, dont la désorganisation mène au désastre...
En ce qui concerne enfin les partis qui se réclament du socialisme, le début de la guerre a montré leurs faiblesses. Les socialistes révolutionnaires (parti paysan) et la plupart des mencheviks (sociaux-démocrates) ont refusé de combattre contre la guerre, beaucoup tombant dans le social-chauvinisme, comme l’écrasante majorité des partis sociaux-démocrates et des syndicats européens. Après la répression terrible dont il a été victime suite à la défaite de la révolution en 1905, le parti bolchevik s’est reconstitué sous la direction des émigrés, et il a beaucoup progressé notamment dans les années qui ont précédé la guerre. Mais il est infiltré de partout par la police : à Petrograd, par exemple, 3 des membres du comité du parti sur 7 sont des agents de l’Okhrana, la police secrète du tsarisme ! Politiquement, le parti bolchevik est le seul à avoir dénoncé et combattu la guerre dès 1914. Pendant la guerre, la police, qui suit de très près la politique et la pratique du parti bolchevik, écrit dans un rapport : « L’élément le plus énergique, le plus allègre, le plus capable de lutter infatigablement, de résister et de s’organiser constamment, se trouve dans les groupements et les individus qui se concentrent autour de Lénine ».
Cependant, la politique des bolcheviks n’a pas été sans ambiguïté dans certains cas, les conditions de la guerre s’ajoutant à celles de la clandestinité pour désorganiser le parti, et conduisant parfois à des prises de position opportunistes : c’est ainsi que, à la Douma, la fraction bolchevik a voté avec les mencheviks une motion s’engageant à défendre « les biens culturels du peuple contre toutes atteintes, d’où qu’elles vinssent »... Lénine, quant à lui, s’est battu pendant toute la guerre suivant une orientation connue sous le nom de « défaitisme révolutionnaire » : chaque parti marxiste national doit se battre avant tout pour la défaite de son propre impérialisme, pour la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile...
Les journées du 23 au 27 février
En février 1917, ni le parti bolchevik, ni personne ne s’attendaient à ce que la journée internationale des femmes, prévue pour le 23, soit la première journée d’une révolution. Nul n’a la moindre idée de ce qui se prépare, et les bolcheviks déconseillent la grève...
Pourtant, les ouvrières cessent le travail et manifestent massivement, allant d’usine en usine pour appeler les travailleurs à les suivre et à les soutenir. Les bolcheviks, comme les mencheviks et les socialistes–révolutionnaires emboîtent le pas à cette mobilisation spontanée des masses. Ces ouvrières du textile, pour une grande part femmes de soldats, constituaient certainement la fraction la plus exploitée du prolétariat. Ce sont elles qui déclenchent la révolution : la grève qu’elles ont impulsée s’étend, devient générale. Une gigantesque manifestation est convoquée...
Le comité central des bolcheviks hésite, avant d’appeler finalement à la grève générale le 25. Le comité de Petrograd est arrêté, mais c’est bien spontanément que la grève est devenue générale, tendant rapidement à se transformer en insurrection, car la masse prend conscience de sa force. Le gouvernement s’est préparé à la répression, mais les cosaques sont passifs et prennent parfois la défense des manifestants lorsque la police tire sur la foule. Les ouvriers interpellent les soldats et s’efforcent de fraterniser en les invitant à se joindre à eux. Lorsque la police intervient, les manifestants décident de résister et d’aller jusqu’au bout...
Malheureusement, aucun parti ne sait prendre la direction révolutionnaire, aucun n’appelle à l’organisation de l’insurrection armée. La direction bolchevik de Petrograd (Staline, Kamenev) manque d’initiative. Les dirigeant retardent considérablement sur les ouvriers, qui s’organisent eux-mêmes, mais manquent de direction politique. Le 26, c’est l’affrontement général dans la capitale. Les ouvriers se heurtent à la police et à l’armée. Tout va dépendre de l’attitude des soldats. Vers le soir, des mutineries éclatent. L’armée se soulève enfin. Dès lors, c’en est fini de la monarchie, privée de son bras armé : elle s’effondre, presque facilement. La capitale est conquise par les ouvriers et les soldats. Les prisons sont ouvertes. Les mencheviks se précipitent à la Douma pour négocier une solution politique avec les partis bourgeois ; les bolcheviks se rendent dans les casernes et les usines...
Le soir du 27, les soldats, les étudiants, les ouvriers et les habitants des quartiers populaires convergent vers le palais de Tauride dans lequel un état-major révolutionnaire s’est établi. En fait, cet état major s’est autoproclamé après l’insurrection et ne dirige rien : les dirigeants véritables de la révolution sont dans la rue et se montrent méfiants à l’égard de cette première tentative d’institutionnalisation : ce sont des ouvriers et des soldats de la base, qui ont cependant souvent un expérience de la lutte des classes et notamment la mémoire de 1905 et une culture révolutionnaire, qui leur permettent d’être l’avant-garde consciente de toute la classe. En fait, beaucoup d’entre eux ont été formés directement par les bolcheviks, qui se trouvent bien sûr parmi eux.
Double pouvoir et affrontement entre les classes. Les paradoxes de février
Pendant l’insurrection la bourgeoisie apporte son soutien au tsar et appelle la monarchie à la répression ; elle tente de négocier pour instaurer une dictature qui lui soit favorable. Mais l’insurrection triomphe et les soviets (conseils d’ouvriers et de soldats) se constituent. À Petrograd en particulier, le soviet de 1905 renaît de ses cendres : très vite, il concentre la réalité du pouvoir et devient le centre nerveux de la révolution. À la tête des soviets sont élus majoritairement des socialistes révolutionnaires et des mencheviks, partis « socialistes » majoritaires dans le mouvement révolutionnaire et ouvrier russe d’avant guerre. Les masses leur font confiance et leur remettent le pouvoir.
Or c’est là que gît le « paradoxe de février » : ces « socialistes » ne veulent pas du pouvoir ! Alors que la situation est révolutionnaire, ils prônent, au nom de la légalité, une orientation qui se ramène à l’abandon de leurs revendications de toujours : la paix, la république, la journée de 8 heures, la répartition des terres... ! Ils ne demandent plus que la liberté d’expression ! Pratiquement, ils cherchent à remettre le pouvoir entre les mains de la bourgeoisie, qui na pourtant joué aucun rôle dans l’insurrection et espérait sa défaite ! De fait, la bourgeoisie ne voulait pas non plus du pouvoir et aurait voulu rétablir la monarchie ! Mais cette solution n’est plus possible : les masses ne veulent évidemment pas du retour du tsar honni qu’elles viennent de faire chuter si facilement. Finalement, les cadets (parti bourgeois libéral), les socialistes-révolutionnaires et les mencheviks se mettent d’accord pour un gouvernement provisoire dirigé par le prince Lvov, reposant fondamentalement sur Milioukov, chef du parti cadet, véritable axe politique de ce gouvernement, et disposant d’une caution « socialiste » en la personne de Kerensky, nommé à la justice.
Le comité exécutif du soviet de Petrograd, dirigé par les socialistes-révolutionnaires et les mencheviks, impose le soutien des ouvriers et des soldats au nouveau pouvoir bourgeois-libéral. Ce comité exécutif n’est pas né de la lutte elle-même, comme il était apparu en 1905 pour déclencher et diriger l’insurrection : il s’est constitué pour contrôler et canaliser le mouvement des masses. Mais les différentes fractions des masses révoltées n’ont pas toutes le même niveau de conscience, et il manque de toute façon une réelle direction marxiste révolutionnaire qui ait une influence massive. Les soldats, en particulier, qui sont très majoritairement d’origine paysanne, élisent comme représentants des tribuns petits bourgeois : les « socialistes-révolutionnaires », dont le programme est de rendre la terre aux paysans, obtiennent de loin la majorité des délégués. Le parti cadet n’a en revanche aucun succès. Quant aux partis ouvriers, le parti menchevik a une réelle influence parmi les ouvriers de base. Le parti bolchevik n’a de succès que dans l’avant-garde, et il subit la pression : sous la direction de Staline et Kamenev (Lénine n’est pas encore rentré en Russie), au lieu de combattre fermement sur une ligne révolutionnaire, contre la canalisation-liquidation de la révolution, pour le pouvoir aux soviets, il se rapproche du parti menchevik, se contente d’une lutte de type parlementaire dans le soviet et apporte même dans un premier temps son soutien au gouvernement provisoire ! Sur le terrain des luttes, cependant, les bolcheviks sont sans conteste à l’avant-garde, notamment dans leur bastion du grand quartier ouvrier de Vyborg, et ils se renforcent. En effet, ils sont les seuls à ne pas abandonner les revendications du mouvement ouvrier, notamment la journée de huit heures — laquelle est finalement imposée par les ouvriers au gouvernement provisoire...
Situation de double pouvoir : tout est possible...
La situation politique réelle est donc celle d’un double pouvoir : dans les faits, il y a une concurrence tendancielle entre le gouvernement provisoire, pouvoir officiel et légal, dominé par la bourgeoisie libérale avec une caution « socialiste », d’une part, et le pouvoir du soviet de Petrograd, d’autre part. Si le comité exécutif du soviet, refusant le pouvoir des ouvriers et des soldats, assure dans un premier temps la mise en place du gouvernement provisoire bourgeois, la situation est profondément ambiguë et instable : les masses n’ont aucune intention de quitter la scène politique sur laquelle elles viennent de s’engouffrer avec une telle puissance et de tels succès. D’autant que la conquête de la journée de huit heures libère un temps précieux pour l’action et la réflexion politiques : on se met à se réunir partout, à discuter de tout, à lire ensemble les journaux... C’est une véritable explosion de l’activité et de la conscience politique du peuple...
Mais, pendant ce temps-là, la guerre continue. Partout, les soldats désertent en masse, les troupes se retournent contre leurs propres officiers, l’aspiration à la paix immédiate et sans conditions se déchaîne... Or le gouvernement provisoire, avec le soutien des dirigeants ouvriers et « socialistes », décide de poursuivre la guerre et d’ajourner en conséquence la réalisation des revendications : il veut épuiser la révolution.
Caractère paradoxal de la représentation au soviet
Nous avons vu que, malgré la victoire de la révolution sur le tsarisme, le comité exécutif du soviet soutient le gouvernement provisoire, gouvernement bourgeois qui continue la guerre et refuse de satisfaire les revendications du peuple. Mais la réalité du pouvoir est déjà aux mains du soviet, dans lequel se reconnaissent les soldats et les ouvriers, bien que les dirigeants du soviet ne pensent qu’à soutenir le gouvernement provisoire. C’est ainsi que le double pouvoir tend à se met en place : deux pouvoirs se font face, représentant deux classes opposées, la bourgeoisie et le prolétariat. Mais à la tête du soviet se trouvent encore « les lieutenants de la bourgeoisie dans le camp du prolétariat », comme dit Lénine. Ces conciliateurs ont peur des ouvriers, et ils influent sur la composition du soviet : à Petrograd, il y a quatre fois plus d’ouvriers que de soldats, et pourtant il n’y a au soviet que deux délégués d’ouvriers pour cinq délégués de soldats. Et, parmi les civils, tous ne sont pas élus par des ouvriers : les aventuriers et tribuns de toutes sortes, les journalistes et les avocats démocrates, les étudiants et les petits bourgeois radicaux, marquent de leur influence les décisions du soviet et surtout ses débats, face aux ouvriers silencieux et aux soldats irrésolus. Mais même si les soldats sont souvent sur-représentés et majoritaires dans les soviets, ils n’expriment pas, bien souvent, l’état d’esprit véritable des casernes : les dirigeants favorisent les officiers. — Or cette composition des soviets explique à ce moment une partie de leurs atermoiements patriotiques.
Errements dans la direction bolchevique
Mais le social-patriotisme n’infecte pas seulement les soviets et les conciliateurs. Les dirigeants bolcheviques eux-mêmes, notamment Kamenev et Staline, se rapprochent de l’aile gauche des mencheviques et penchent dangereusement vers la défense nationale, ligne qui domine dans la Pravda, au détriment du défaitisme révolutionnaire prôné par Lénine, lequel ne rentra d’émigration que le 3 avril.
À son retour, Lénine préconise le mot d’ordre « tout le pouvoir aux soviets », contre le gouvernement provisoire, pour mettre fin à la guerre et distribuer la terre aux paysans. Il est mis en minorité et même complètement isolé pour un moment, on qualifie ses thèses de « trotskystes », parce qu’il soutient que la révolution socialiste peut commencer en Russie avant l’Occident. Confiant en son parti, Lénine combat la direction droitière en s’appuyant sur les ouvriers du parti, qui avaient été formés pendant des années dans l’objectif de la prise du pouvoir par le prolétariat allié à la paysannerie. À la base, les militants combattent sur le front des revendications élémentaires, montrant que le gouvernement provisoire et les mencheviques refusent de les satisfaire malgré la situation révolutionnaire. À ce moment-là, le Parti bolchevique compte 79 000 membres dont 15 000 à Petrograd, notamment dans le quartier de Vyborg où les ouvriers bolcheviques se sont déjà opposés à Staline et Kamenev, allant jusqu’à les menacer d’exclusion...
A la conférence du Parti des 28 et 29 avril, Lénine parvient à faire passer sa ligne, l’opposition de droite est mise en minorité, Kamenev et Staline ne sont pas élus au bureau. Cela ne signifie pas que Lénine fut le grand démiurge de la révolution, mais qu’il sut s’insérer dans la chaîne des forces historiques où, comme le dit Trotsky, il fut un grand anneau... Quant au Parti bolchevique de l’époque, forgé dans et par le marxisme vivant pendant des années avant la guerre, son caractère démocratique est prouvé par ces débats animés et ces luttes politiques internes provoqués par la pression des événements.
Crise généralisée du pays et des rapports sociaux, collaboration de classe des mencheviques et des socialistes-révolutionnaires
En avril, trois solutions sont possibles : la reprise en main de la situation par la bourgeoisie — mais cela aurait provoqué une guerre civile que celle-ci n'était pas en mesure de remporter ; le passage de tout le pouvoir aux soviets — mais les conciliateurs ne le veulent évidemment pas et ils bénéficient encore de la confiance des masses (la résolution des bolcheviques proposant de donner tout le pouvoir aux Soviets est passée inaperçue) ; la coalition reste donc la seule solution : les mencheviques et les socialistes-révolutionnaires (S.R.) entrent au gouvernement, avec le soutien des soviets — seuls les bolcheviques et les mencheviques internationalistes s’y opposent.
Cependant, la situation en Russie ne cesse d’empirer et la guerre s’éternise. Bien que l’armée soit dans un profond état de décomposition, le gouvernement provisoire poursuit la guerre contre les Allemands. Les défaites sont cuisantes et ne font que renforcer à la fois la déliquescence généralisée et les motivations révolutionnaires des soldats. Du côté de la paysannerie, on assiste à une perte de confiance envers le gouvernement provisoire, qui refuse de lui donner la terre, bien que ce soit officiellement le nerf du programme du parti S.R., principale force populaire de soutien au gouvernement. Les paysans passent alors à l’offensive, en décidant de réaliser eux-mêmes l’expropriation de l’aristocratie foncière et le partage des terres... Enfin, la situation des villes est catastrophique, le ravitaillement n’est plus assuré, le coût de la vie monte en flèche, la production industrielle est au plus bas, d’autant plus que les patrons mettent en œuvre un lock-out larvé. Au même moment, les plus grosses entreprises travaillant pour la guerre engrangent des bénéfices énormes. La colère des ouvriers ne cesse de croître...
Le comité exécutif du soviet préconise en parole la réglementation de l’économie par l’étatisation, l’organisation rationnelle de la production et la fixation des prix de l’industrie par l’État. Mais jamais il ne va jusqu’à l’affrontement avec le gouvernement, qui doit toute son existence à ce soutien. Et, lorsque la cible des manifestations commence à devenir le gouvernement, le comité exécutif du soviet de Petrograd décide de ne plus manifester... Pendant ce temps-là, les forces de la contre-révolution se regroupent et se disposent pour passer à l’offensive contre les ouvriers et la révolution...
Évolution des rapports de force dans les soviets
À partir de juin, les rapports de force politiques dans les soviets commencent à changer. Les bolcheviques deviennent majoritaires au soviet de Moscou et dans la section ouvrière du soviet de Petrograd. Les ouvriers prennent conscience qu’ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes, radicalisent leur perspective politique et commencent à s’armer pour défendre et approfondir la révolution. Même dans l’armée, dont la composition est pourtant majoritairement paysanne, l’influence des bolcheviques se développe, grâce à leurs mots d’ordre liant les revendications élémentaires à la nécessité de la prise du pouvoir par les soviets. Dans la forteresse de Cronstadt, au large de Petrograd, le soviet décide de prendre en main tout le pouvoir : les officiers sont emprisonnés. Quant aux usines, la montée de l’influence bolchevique y est très puissante et rapide...
Cette influence reste cependant moindre que celle des mencheviques — qui restent très implantés dans les milieux ouvriers — et surtout que celle des S.R., qui ont le soutien d’une majorité de paysans et des petits bourgeois des villes, qui participent de plus en plus aux soviets. C’est ainsi que, lorsque le congrès pan-russe des soviets se réunit, sur 777 délégués, on compte 105 bolcheviques, 248 mencheviques et 285 socialistes-révolutionnaires. La situation dans la capitale, Petrograd, est cependant plus avancée que dans le reste du pays : la conférence des comités de fabriques et d’usines adopte ainsi une résolution disant que seul le pouvoir des soviets peut sauver le pays. La situation tend à devenir explosive : dans le quartier ouvrier de Vyborg, la villa de Dournovo, dignitaire du Tsar, est prise et occupée par les organisations ouvrières ; mais le comité exécutif du soviet de Petrograd exige qu’ils quittent le lieu ; les bolcheviques, majoritaires dans le quartier, lancent un appel à manifester — qu’ils annulent finalement après la décision du congrès des soviets saisi de l’affaire, et face à laquelle ils jugent opportun de s’incliner, malgré la fureur des ouvriers de Vyborg, déjà prêts à en découdre avec les collaborateurs, mais encore minoritaires dans la capitale...
L’épisode de la villa Dournovo conduit le gouvernement et ses collaborateurs qui dirigent les soviets à la conclusion qu’il est temps de désarmer les masses et de lancer une offensive d’envergure contre les bolcheviques. L’influence des bolcheviques continue de se développer, comme le montre le succès de ses mots d’ordre massivement soutenus et repris dans les manifestations et la multiplication d’initiatives d’ouvriers et de soldats défiant la direction des soviets et reprenant à leur compte de plus en plus massivement l’exigence de la prise du pouvoir.... C’est alors un acharnement général contre le Parti bolchevique, qui est déclaré hors-la-loi, plusieurs de ses dirigeants étant arrêtés et ses journaux saisis...
Avec l’été, une nouvelle alternative se dessine en Russie : le gouvernement provisoire soutenu par les dirigeants collaborateurs des soviets est de moins en moins capable de gérer la situation militaire, sociale, économique et politique ; dès lors, la situation se polarise, deux issues possibles se font jour : liquidation de la révolution par un coup d’État de type fasciste — ligne de la réaction et de la bourgeoisie, représentées par Kornilov —, ou transcroissance socialiste de la révolution à travers la prise du pouvoir par les soviets — ligne de la dictature du prolétariat, défendue par les bolcheviques...
Les journées de juillet
La période de fin juin-début juillet est marquée par une impatience grandissante des masses. La guerre coûte cher, les conditions économiques sont déplorables, sans compter le coût humain d’offensives hasardeuses. Le gouvernement, qui compte dix ministres bourgeois, est irrésolu et de plus en plus rejeté par le peuple.
À Petrograd, cette agitation est avivée par les anarchistes. Le Parti bolchevik considère que les ouvriers et les soldats les plus avancés de la capitale doivent attendre un soutien plus large des masses ; certains bolcheviks toutefois acceptent mal que leur rôle soit de réfréner l’ardeur de la population. Pour les bolcheviks, toute manifestation aurait dans les prochains jours un caractère nettement révolutionnaire, or les conditions ne sont pas prêtes.
Le 3 juillet, effectivement, sur l’initiative des régiments de mitrailleurs, des ouvriers et soldats en armes manifestent à Petrograd, sous des mots d’ordres révolutionnaires : tout le pouvoir aux soviets, départ des ministres bourgeois, non à l’offensive contre le prolétariat allemand, la terre aux paysans, pour le contrôle ouvrier. Les bolcheviks, dont la prudence n’est pas acceptée par ces masses les plus radicalisées, changent de tactique et encadrent les manifestations. Celles-ci recommencent le lendemain, encore plus puissantes. Les seules forces armées dont dispose le gouvernement sont les cosaques et les junkers, la plupart des autres régiments observant, dans le meilleur des cas pour le gouvernement, la neutralité. Ces forces, insuffisantes pour mater le mouvement, se livrent à des provocations : il y a des morts et des blessés. Le soir du 4 juillet, les manifestants font le siège du palais de Tauride, où sont rassemblés les comités exécutifs des soviets, ils réclament tout le pouvoir pour les soviets. Les conciliateurs continuent leurs atermoiements, et refusent le pouvoir que les masses veulent leur offrir. Celles-ci, découragées, cessent alors les manifestations.
C’est pendant cette retraite qu’arrivent enfin des renforts armés pour le gouvernement, venant principalement du front. Ces régiments ont été convaincus, « preuves » à l’appui, que les manifestations de Petrograd étaient un complot des bolcheviks, à la solde de l’Allemagne. Comme l’histoire l’a plusieurs fois montré (en France en 1848 et 1870, en Allemagne en 1919…), cette poussée révolutionnaire non menée à son terme (ce qui était inévitable selon l’analyse bolchévique, une grande partie des masses se faisant encore des illusions sur les conciliateurs) est suivie d’une période de reflux. Les insurgés sont désarmés, les calomnies se propagent contre les bolcheviks, accusés d’être à la solde du Kaiser, beaucoup sont arrêtés (dont Trotsky, Kamenev...) et Lénine doit se réfugier en Finlande.
La contre-offensive réactionnaire
Une fois la peur du soulèvement populaire passée, la période qui s’ouvre est pour les bourgeois de tout poils et leurs alliés conciliateurs l’occasion de réaffirmer leur pouvoir. Les conciliateurs ont qualifié le mouvement de juillet de contre-révolutionnaire (car dressé contre le pouvoir issu de la révolution de Février, aux mains d’une alliance de partis ouvriers et bourgeois). Les cadets profitent de cette aubaine pour réclamer une politique toujours plus libérale, voire réactionnaire : répression suite aux journées de juillet (dissolution des régiments les plus révolutionnaires, désarmement des ouvriers), soutien aux grands propriétaires fonciers contre les réquisitions de terre, allégeance guerrière envers les alliés impérialistes, rétablissement de la peine de mort pour les soldats réfractaires, rendus responsables de l’échec des offensives militaires… Les cadets posent aussi leurs conditions pour la constitution d’un nouveau gouvernement de coalition et, le 24 juillet, les comités exécutifs des soviets (toujours dominés par les conciliateurs) remettent intégralement le pouvoir à un nouveau gouvernement, plus proche de la juxtaposition de deux cliques (conciliatrice et militaire-bourgeoise) que d’une véritable coalition. Les cadets ont en particulier imposé le réactionnaire Kornilov comme nouveau généralissime, gage de discipline sur le front et d’émancipation vis-à-vis du pouvoir issu de Février. Quant aux conciliateurs, quoique numériquement majoritaires dans ce nouveau gouvernement, ils en sont réduits aux lamentations devant les mesures de plus en plus réactionnaires imposées par leurs alliés bourgeois sous prétexte de lutter contre l’anarchie (relaxe des commandos monarchistes des Cent-Noirs par exemple). Kerensky, le président de ce nouveau gouvernement, est raillé de toutes parts, mais semble être le seul capable de servir de trait d’union entre ces deux cliques alliées qui se craignent.
Vers la crise politique
Pour se donner une légitimité, le gouvernement convoque une conférence nationale à Moscou pour le 13 août. Il s’agit d’ « états généraux » de la nation tout entière, mais sans aucun pouvoir et dont le gouvernement fixe la composition : pour moitié des représentants des classes possédantes, pour moitié des délégués des soviets. Les bolcheviks, à qui le droit d’expression est dénié pour cette conférence, décident de la boycotter. Cette réunion est organisée à Moscou pour l’éloigner de Petrograd, considéré comme un îlot anarchique au milieu d’un pays qui réclame l’apaisement. Elle est l’occasion pour les couches les plus réactionnaires (clergé, aristocrates...), effrayées par Février et plus encore par les journées de juillet, de relever la tête. Cependant, la conférence provoque l’hostilité des ouvriers moscovites qui, avec l’appui de leurs syndicats, paralysent la ville pour entraver son déroulement. D’autres villes de province sont touchées par la grève générale. Mais, échaudés par les journées de juillet, les ouvriers n’organisent pas de manifestations, pour éviter une confrontation avec des troupes réactionnaires prêtes à en découdre. La conférence de Moscou se déroule finalement dans une atmosphère théâtrale, chacun des deux camps présents — les démocrates conciliateurs d’un côté, les bourgeois et les réactionnaires de l’autre — jouant son rôle et défendant ses positions tout en maintenant l’apparence d’une coalition. Son principal effet est de cristalliser l’existence des deux cliques, personnifiées respectivement par Kerensky et par le généralissime Kornilov. Celui-ci n’hésite pas à recourir à des mouvements de troupes, à tel point que les conciliateurs moscovites font appel aux bolcheviks pour créer un comité de défense, craignant un coup d’État militaire de Kornilov, ostensiblement soutenu par les bourgeois et les réactionnaires.
L’impatience de la bourgeoisie est fortement aiguisée dans les jours qui suivent. La chute de Riga face à l’armée allemande, « prédite » par Kornilov, rapproche le front de Petrograd. C’est un bon prétexte pour masser des troupes « sûres » (notamment les cosaques), au nom de la défense de la capitale. En fait, la conspiration contre-révolutionnaire se prépare : le Grand Quartier Général (état-major) déclare que la désorganisation de l’armée est la cause de la défaite de Riga, et prévient que tout nouveau désordre dans la capitale sera sévèrement réprimé. De son côté, Kerensky, conscient de l’impasse dans laquelle se trouve le régime de Février, se fait complice de Kornilov, avec lequel il décide de négocier en mettant à sa disposition de nouvelles troupes pour préparer une marche sur Petrograd. La perspective d’une dictature de la bourgeoisie, sous la forme d’un directoire associant Kerensky et Kornilov, est envisagée. Pendant ce temps, les bolcheviks mettent en garde contre toute provocation et tout soulèvement prématuré.
Le putsch de Kornilov et le soulèvement ouvrier et populaire
À partir du 26 août, l’alliance fragile entre les deux cliques vole en éclats. Kornilov passe à l’offensive : il envoie ses troupes sur Petrograd dans le but d’un putsch. Kerensky, qui comprend qu’il ne serait d’aucune utilité dans le cas d’un écrasement des Soviets, joue lui aussi sa carte personnelle : il destitue Kornilov de son poste de généralissime et demande à son gouvernement les pouvoirs personnels spéciaux pour contrer l’offensive. Mais les libéraux du gouvernement, par l’intermédiaire de Milioukov, lui font comprendre que la force est du côté de Kornilov. Celui-ci prélève encore de nouvelles troupes du front (la défense du pays contre l’envahisseur allemand lui importe peu en ce moment…). Kerensky et les conciliateurs prennent peur face à l’attitude de leurs alliés bourgeois, ils demandent alors l’appui des masses, ainsi que des bolcheviks qui sont majoritaires à Petrograd, pour défendre la capitale. Mais la base n’a pas attendu : les ouvriers prennent les armes, les cheminots détournent les convois korniloviens, les soldats se mobilisent, les matelots de la forteresse de Cronstadt (sur la mer baltique, au large de Petrograd) se dressent contre leurs officiers et libèrent les prisonniers de juillet... Le 30 août, Kornilov est défait, celui-ci et les principaux généraux conspirateurs sont arrêtés, abandonnés par le reste de la bourgeoisie après avoir été encouragés par elle…
Cette défaite de Kornilov par les masses elles-mêmes sera le point de départ d’une nouvelle radicalisation de celles-ci, et d’une montée en puissance des bolcheviks, qui ont été à l’avant-garde pour défendre la révolution de Février, participant au front uni contre la réaction (alors même que leurs principaux dirigeants étaient toujours contraints à l’exil ou maintenus en prison par le gouvernement provisoire), tout en préservant leur indépendance politique vis-à-vis des conciliateurs. Leur ascension sera dès lors irrésistible : ils gagneront rapidement la confiance de la majorité des soviets dans les semaines suivantes, jusqu’à la prise de pouvoir d’octobre. C’est ce que nous verrons dans le prochain numéro.
Montée en puissance des bolchéviks
Temporairement freinée par les calomnies dont ils ont été l’objet en juillet, l’influence des bolchéviks va de nouveau en s’accroissant à partir de fin août. Le putsch raté de Kornilov a entraîné une radicalisation des masses, due à une perspicacité accrue à l’égard des conciliateurs, qui continuent à affirmer que la coalition avec la bourgeoisie est indispensable, alors que celle-ci n’hésite pas à encourager un mouvement contre-révolutionnaire pour mettre fin aux soviets. L’attitude des bolchéviks pendant la crise d’août, comparée à celle des « patriotes » qui les avaient calomniés en juillet, met fin aux soupçons de beaucoup. Dans les soviets, les bolchéviks prennent de plus en plus d’importance, par le nombre croissant de leurs délégués, mais aussi, dans les régions où ils ne sont pas présents, par le caractère radical des décisions prises : malgré les moyens limités du parti (manque d’imprimerie, et d’orateurs hors des grandes villes), les idées bolchéviques circulent dans l’ensemble du pays. Ils reprennent également leur activité sur le front : le nouveau rapport de forces leur permet enfin de prendre la parole lors des meetings de soldats, ce qui leur était interdit de fait auparavant. Début septembre, les conciliateurs, plombés par leur indéfectible soutien au gouvernement Kérensky haï des masses, doivent abandonner la direction des soviets de Pétrograd et de Moscou aux bolchéviks.
S’ouvre une courte période où le parti, Lénine en tête, croit en la possibilité d’une transition pacifique vers un gouvernement des soviets. À la suite des journées de juillet, les bolchéviks avaient renoncé au mot d’ordre de « pouvoir aux soviets », ceux-ci étant dirigés par les conciliateurs dont la seule perspective était clairement de confier ce pouvoir à un gouvernement de coalition avec les bourgeois. Maintenant, il est de nouveau adéquat de réclamer le pouvoir pour les soviets, même si les conciliateurs refusent toujours une union avec les bolchéviks à l’intérieur de ces soviets.
Après une période où Kérensky détient de fait le pouvoir, à la tête d’un directoire de cinq personnes, s’ouvre le 14 septembre une « conférence démocratique », à l’initiative des conciliateurs, qui refusent le pouvoir aux soviets, mais qui veulent en même temps réfréner l’ambition de Kérensky. La composition de cette conférence doit assurer la majorité aux conciliateurs, les bolchéviks ont une représentation minoritaire mais non négligeable, des groupements petit-bourgeois sont également représentés. Mais cette conférence ne montre une fois de plus que son incapacité : ainsi se prononce-t-elle à la majorité pour une nouvelle coalition entre bourgeois et partis soviétistes, tout en ajoutant un amendement qui exclut de toute nouvelle coalition le parti cadet, parti bourgeois représentatif. La seule issue est la création d’une nouvelle instance, le Soviet de la République (ou Préparlement), constitué sur la base des forces présentes à cette conférence, auxquelles s’ajoutent des représentants des classes possédantes et des cosaques. Le Comité central du Parti bolchévique est divisé sur la participation à ce Préparlement, mais le congrès du parti se prononce finalement pour la participation, contre l’avis de Trotsky et Lénine qui y voient une manière de repousser la question de la prise de pouvoir révolutionnaire. Toutefois, cette décision du congrès est souvent contestée par les résolutions des organisations locales.
Il est également sorti de la « conférence démocratique » un nouveau gouvernement de coalition, caractérisé par les bolchéviks comme un gouvernement de guerre civile contre les masses. Mais cette lutte pour le pouvoir gouvernemental ne s’accompagne bien sûr d’aucune mesure pour mettre fin à une situation économique désastreuse. Dans les villes, beaucoup d’ouvriers se mettent en grève, mais les plus avancés considèrent déjà ce mode d’action comme dépassé et se rallient à l’objectif de l’insurrection.
Frustrations et combat des paysans et des peuples opprimés
Dans les campagnes, les mois de septembre et octobre marquent le summum de la révolte paysanne, qui touche l’ensemble du pays. Les paysans s’emparent des terres des grands propriétaires, il y a des violences et des destructions. Les masses les plus pauvres sont aussi les plus radicales, et les représentants locaux de l’État n’osent pas s’opposer à ce mouvement, malgré les plaintes des propriétaires qui voient dans l’anarchie la trace de l’influence des bolchéviks. En fait, ces derniers sont peu présents dans les campagnes, mais le mouvement échappe aussi largement aux socialistes-révolutionnaires, leur programme agraire ayant été abandonné de manière opportuniste pour cause de coalition. En revanche, par l’adéquation de leurs mots d’ordre aux revendications des paysans les plus pauvres, les bolchéviks parviennent à s’implanter peu à peu dans les campagnes, moins directement que par l’influence des soldats revenant du front, où ils ont été éduqués politiquement.
Au même moment, les différentes peuples opprimés de l’empire tsariste déchu se soulèvent eux aussi. Le renversement de la monarchie n’a pas impliqué pour eux de révolution nationale. La domination du pouvoir grand-russe, sous la pression de la bourgeoisie impérialiste, est toujours à l’œuvre. Les peuples opprimés ont simplement acquis une égalité des droits civiques, non l’indépendance qu’ils réclament. Dans les territoires les plus arriérés, où la domination grand-russe a pris les formes de la colonisation, les conciliateurs locaux, proches de la population, vont souvent plus loin dans les revendications que ne le veut le pouvoir central. Le Parti bolchévique est peu implanté parmi les peuples opprimés de l’ex-empire tsariste, mais la faillite des gouvernements de coalition sur la question nationale comme sur les autres, provoque le plus souvent de la bienveillance à son égard, d’autant plus quand il y a coïncidence des antagonismes sociaux et nationaux.
Les préparatifs de l’insurrection
Sous la pression des événements et de la radicalisation des masses, les bolchéviks ont rapidement évolué à gauche. Malgré l’opposition de Kamenev, il est décidé une sortie démonstrative du Préparlement (7 octobre), Trotsky y dénonçant la représentation exagérée des possédants, la politique économique du gouvernement, et en appelant au peuple pour la défense de la révolution et l’instauration du pouvoir des soviets. Ce Préparlement se montre de toute façon incapable de trancher les questions les plus graves selon lui, comme celle des moyens de rendre à l’armée son ardeur combative. Les bolchéviks consacrent leur énergie à l’agitation en faveur du pouvoir aux soviets. Les orateurs manquent (Lénine est toujours réfugié en Finlande, Kamenev et Zinoviev s’opposent à la perspective de l’insurrection qui se dessine…), mais l’agitation est efficace dans les masses.
Un congrès des soviets est convoqué pour le 20 octobre. Pour les bolchéviks, ce congrès doit marquer l’instauration du pouvoir des soviets. Les conciliateurs, qui s’étaient tout d’abord ralliés à ce congrès, le désavouent ensuite ; cette attitude ne fait qu’accélérer le ralliement à la ligne bolchévik des soviets les plus retardataires.
Après s’être battu pendant plusieurs semaines contre le Comité central du parti bolchévik (tout comme en avril), Lénine parvient enfin, le 10 octobre, à rallier une majorité à une motion qui met à l’ordre du jour immédiat la préparation de l’insurrection. Les conditions politiques sont maintenant mûres pour cette insurrection (en particulier grâce à l’attitude des paysans), il est donc urgent de s’atteler à la tâche.
Les opposants à cette perspective parmi les bolchéviks, principalement Kamenev et Zinoviev, mais qui se retrouvent à tous les échelons du parti, ont encore des illusions sur une transition institutionnelle vers un pouvoir des soviets : ils veulent attendre le Congrès des soviets, voire l’Assemblée constituante — dont les élections sont en préparation, le gouvernement les ayant longtemps repoussées, mais ayant décidé de les convoquer pour essayer de sauver le régime. Zinoviev et Kamenev, allant jusqu’à rompre la discipline du parti, parlent d’ « aventurisme », craignant qu’une insurrection fasse perdre aux bolchéviks la confiance des masses.
L’insurrection est malgré tout programmée, prévue initialement pour le 15 octobre, et en tout cas avant que ne se réunisse le congrès des soviets : forts de l’expérience historique de la Commune de Paris, les bolchéviks savent parfaitement que la bourgeoisie, toute démocratique qu’elle se prétende, ne se laissera pas prendre le pouvoir sans y être contrainte par la force. En outre, l’attitude des conciliateurs depuis février, refusant de rompre avec la bourgeoisie même quand celle-ci affichait le plus son caractère réactionnaire, montre qu’ils devront eux aussi être mis au pied du mur pour éventuellement accepter que les soviets prennent enfin tout le pouvoir.
Les antagonismes dus à la dualité des pouvoirs s’accentuent. Le soviet de Pétrograd décide la création d’un Comité militaire révolutionnaire (avec à sa tête un jeune socialiste-révolutionnaire de gauche, Lasimir), dans le but de contrôler la défense de la capitale (notamment pour empêcher la dispersion des troupes révolutionnaires par le gouvernement). Il est également créé une section de la garde rouge (ouvriers armés), placée avec la garnison sous la direction du Comité militaire. Le gouvernement s’inquiète de ces démonstrations de force, comprenant ce qui se prépare. Il réclame les troupes de Pétrograd pour le front, mais la délégation du soviet tient tête et refuse ce prélèvement.
Le Comité militaire poursuit ses préparatifs, avec en particulier des mesures préventives contre les forces contre-révolutionnaires (junkers, cosaques, cent-noirs). Pendant les jours qui précèdent le congrès des soviets (finalement repoussé au 25 octobre pour des raisons techniques), la presse bourgeoise annonce des manifestations des bolchéviks. Mais ceux-ci ne font que recenser leurs troupes en vue de l’insurrection, ils s’assurent que les masses de Pétrograd et des alentours leur sont acquises. Les meetings renforcent à la fois les masses et leurs dirigeants dans l’idée que tout est prêt pour l’insurrection. La dernière étape est la conquête politique, suite à un meeting de Trotsky, des soldats de la forteresse Pierre-et-Paul, jusque-là réfractaire à l’autorité du Comité militaire.
Le déroulement de l’insurrection
Le 23 octobre, l’état-major de l’armée officielle est définitivement relevé de son commandement sur les troupes de Pétrograd. Le Parti bolchévik n’attend plus que le gouvernement fasse le premier geste d’offensive comme signal de départ pour l’insurrection, qui sera d’autant plus efficace et suivie qu’elle se parera des couleurs de la défensive…
Dans la nuit du 23, le gouvernement décide des poursuites judiciaires contre le Comité militaire, et la mise sous scellés des imprimeries bolchéviques. Mais les ouvriers et soldats se mobilisent et font paraître les journaux, et ils demandent des ordres pour la défense du palais de Smolny (siège du Comité militaire). Le croiseur « Aurore » se met aussi à disposition.
La journée du 24 est occupée à la répartition des tâches pour les bolchéviks. Pendant ce temps-là, les défections de troupes continuent parmi celles qui étaient jusque-là contrôlées par le gouvernement, comme par exemple le bataillon de motocyclistes. Au Préparlement, Kérensky décrète des mesures contre les bolchéviks, mais les troupes qu’il a encore à sa disposition (junkers, cosaques) sont trop faibles par rapport à l’adversaire pour les exécuter.
Dans la nuit du 24, le Comité militaire fait occuper les centres névralgiques de Pétrograd. Des troupes de junkers et des officiers sont arrêtés et désarmés. Parfois, les bolchéviks font preuve d’une trop grande indulgence envers les ennemis : sûrs de leur force, ils espèrent le moins de violence possible ; ils auront plus d’une fois à le regretter par la suite, pendant la guerre civile. Quant aux conciliateurs du Comité exécutif des soviets, ils ne peuvent que constater l’insurrection ; ils n’ont désormais plus de place propre dans le conflit direct entre la bourgeoisie et le prolétariat.
Le matin du 25, le Comité militaire annonce qu’il a pris le pouvoir et que le gouvernement est démis. En fait, celui-ci siège toujours au Palais d’hiver, dont la prise a été retardée (le comité a bien des lacunes dans la science militaire). Dans la journée, le Préparlement est évacué sans arrestation. La prise de la capitale s’est globalement déroulée dans le calme, comme un relèvement de la garde…
La seule tâche qui reste est donc la prise du Palais d’hiver. Parmi les bolchéviks, on commence à s’agacer du retard : il faut que l’action soit menée avant l’ouverture du Congrès des soviets, afin de mettre les conciliateurs devant le fait accompli. Le dispositif de défense du Palais d’hiver est en déliquescence, les junkers et les cosaques ne savent pas quelle attitude adopter. Dans la nuit, suite à une canonnade purement démonstrative de l’ « Aurore », le Palais d’hiver tombe sans combat, et le gouvernement est arrêté sans effusion de sang, à l’exception de Kérensky qui a réussi à s’enfuir vers le front.
Ouverture du Congrès des soviets
Le Congrès des soviets est déjà réuni depuis le matin du 25, et les conciliateurs ne représentent qu’un quart des délégués. La première journée est consacrée aux réunions de fractions. Tous attendent le dénouement du siège du Palais d’hiver avant de commencer les discussions. Un bureau du Congrès est formé, avec 14 bolchéviks et 7 socialistes-révolutionnaires de gauche. Lénine, présent, n’apparaît pas encore publiquement.
Les conciliateurs refusent la proposition d’un front unique de la démocratie soviétique. Après l’annonce de la prise du Palais d’hiver, il ne reste au Congrès que les bolchéviks, les socialistes-révolutionnaires de gauche et les mencheviks internationalistes.
Le Congrès apprend que les troupes du front qui avaient été désignées par Kérensky pour réprimer l’insurrection se rangent du côté de celle-ci. Le matin du 26 octobre, on peut annoncer que le pouvoir est désormais aux mains des soviets.
Les premières mesures politiques du nouveau pouvoir sont prises par le Congrès lui-même, dans la nuit du 26 au 27. Il s’agit « d’édifier l’ordre socialiste », déclare Lénine, qui peut enfin apparaître publiquement, à la tribune. Les premières mesures prises par le Congrès sont donc un appel à tous les pays belligérants pour mettre fin à la guerre et discuter d’une paix juste et démocratique, un décret qui reconnaît que la terre appartient aux paysans, et la création du nouveau gouvernement : le « soviet des commissaires du peuple »…