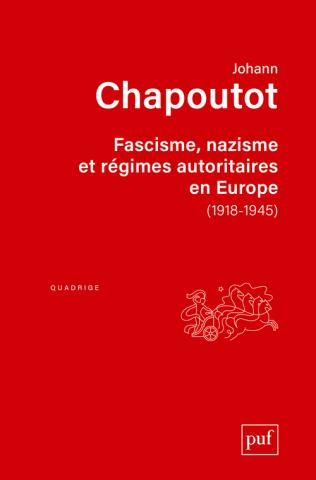Agenda militant
Ailleurs sur le Web
![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)
- Le Portugal mis à l’arrêt par la plus grande grève générale depuis 2013 (12/12)
- L’ARNAQUE DU "MANAGEMENT BIENVEILLANT" (11/12)
- Les Grandes Gueules : sur RMC, la petite bourgeoisie vous parle (11/12)
- Pourquoi la classe compte, et pourquoi il faut (re)lire Erik Olin Wright (11/12)
- Le PCF, l’eurocommunisme et la dictature du prolétariat. Extrait du livre de Laurent Lévy (11/12)
- La bulle de l’IA et l’économie étatsunienne (11/12)
- Une vie de doctorant (11/12)
- Non, les chars russes ne sont toujours pas à Paris ! (11/12)
- Dans les années 1970, la gauche a laissé passer une crise qui aurait pu tourner à son avantage (08/12)
- Audition de Mélenchon devant la commission d’enquête anti-LFI (07/12)
- France Info fait du CNews : Antoine Léaument explose le plateau (07/12)
- Action de mise à l’arrêt d’une usine de pesticides interdits : "bloquons BASF" (04/12)
- Organisation du Travail et Communisme - Bernard FRIOT & Frédéric LORDON (02/12)
- La « peur rouge » aux États-Unis, hier comme aujourd’hui (02/12)
- Le service militaire. - La chronique de Pierre-Emmanuel Barré (30/11)
- Décès d’Henri Benoits (30/11)
- Guerre et service militaire : les médias sonnent le tocsin (29/11)
- La meute médiatique, le retour ? Manuel Bompard, Rima Hassan et Paul Vannier publient leurs réponses à Belaich et Pérou (29/11)
- Le capitalisme comme totalité : une introduction rapide à son histoire (27/11)
- L’État contre les associations. Extrait du livre d’Antonio Delfini et Julien Talpin (27/11)
- SONDAGE MÉLENCHON - BARDELLA : C’EST PIRE QUE CE QUE VOUS CROYEZ !! (27/11)
- Contre-enquête sur le fiasco du Louvre (25/11)
- Mélenchon : Magouilles et trahisons à tous les étages (25/11)
- Face à la crise du capitalisme : la militarisation de l’enseignement (24/11)
- Russie. Depuis sa cellule, entretien avec Boris Kagarlitsky (24/11)
Étudier le nazisme pour comprendre l’extrême droite : Une nouvelle historiographie qui renseigne sur le fascisme (Partie 2)
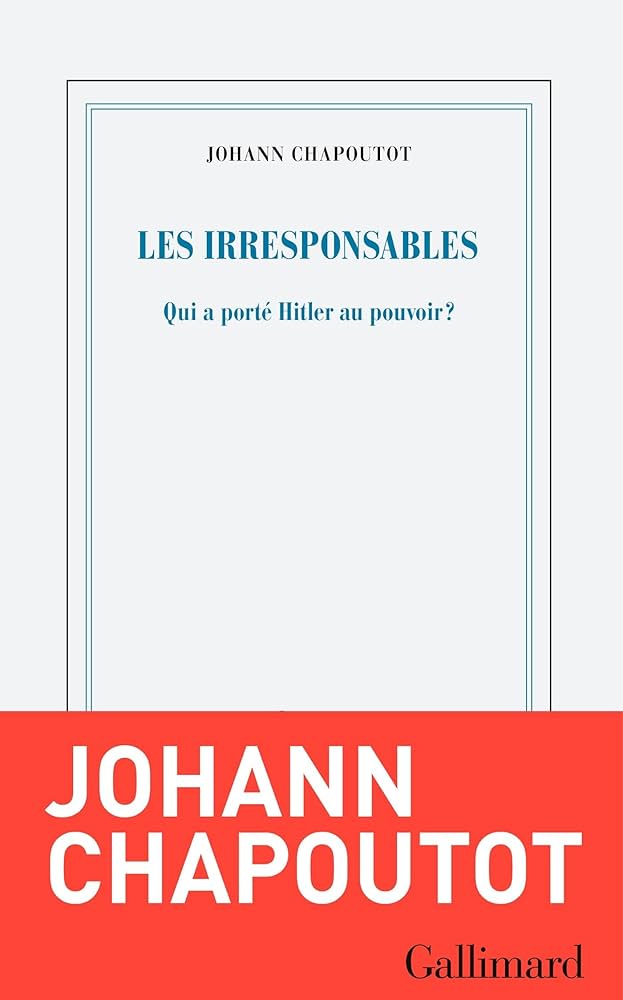
Après avoir évoqué les ancrages matériels et conceptuels du nazisme dans une première partie, cette deuxième partie, basée sur le livre de Johann Chapoutot Les irresponsables paru en 2025, vise à restituer le processus de leur accession au pouvoir au début des années 1930.
L’accession de l’extrême droite au pouvoir : phénomène « unique mais pas sans précédent »[1]
Comment les nazis ont-ils pu accéder au pouvoir ? La question n’a rien d’un exercice purement rétrospectif. Le philosophe Michael Foessel évoque à propos de notre époque une “récidive de l’histoire”, formule saisissante qui restitue sa dynamique au phénomène. Autrement dit, il y a des criminels, un mobile, et des victimes. Au delà des différences entre le début des années 1930 et aujourd’hui , il y a aussi des points communs frappants, qui donnent toute actualité à la réflexion sur la façon dont les nazis sont arrivés au pouvoir dans le cadre de la démocratie bourgeoise. »
Car Hitler n’accède pas vraiment au pouvoir de manière démocratique, dans le sens où cette accession n’est pas directement le résultat des élections. Mais plutôt celui d’un choix, délibéré, des dirigeants politique de la droite et du centre de la République de Weimar. Or il est primordial, pour tirer tous les enseignements de ce cas d’école historique, de procéder par analogie ou, comme dit Johann Chapoutot, par catégories fonctionnelles. Un certain nombre de facteurs, d’acteurs de la tragédie fasciste sont en réalité toujours à l’œuvre, transposés aujourd’hui sous des dénominations, des aspects différents mais fonctionnellement identiques.
Finalement, ce que les nazis appellent eux-mêmes « la prise de pouvoir » est assez rarement détaillé. Observée de près, cette prise de pouvoir n’est en réalité pas une conquête, mais un transfert. Les élites au pouvoir s’allient avec les nazis, qu’elles pensent pouvoir manipuler pour en garder le contrôle. C’est d’ailleurs un motif récurrent de la formation des gouvernements autoritaires : qu’on se souvienne du « c’est un idiot que l’on mènera » d’Adolphe Thiers désignant le futur Napoléon III. Ici, il se transforme en « je l’acculerai dans un coin jusqu’à le faire couiner », – propos de Von Papen parlant de Hitler.
En effet, s’ils bénéficient d’un soutien populaire réel, les nazis plafonneront au maximum autour de 40% des voix, même après le coup d’État constitutionnel de 1933. Derrière la progression électorale souvent présentée comme inexorable des nazis, il y a une tentative de disqualifier le suffrage universel, de laisser croire que le vote des masses mène à la catastrophe, faisant porter ainsi la responsabilité de l’avènement du nazisme à des masses égarées et ignorantes. Mais il faut insister sur ce point : ce ne sont pas les classes populaires qui sont la base électorale des nazis, mais d’abord les classes moyennes paupérisées, la petite bourgeoisie, et ensuite les élites économiques.
Le choix du nazisme
Face à l’instabilité politique croissante, à la montée électorale lente mais apparemment inexorable des partis se réclamant de la classe ouvrière (social-démocrates et communistes – SPD et KPD), les élites patrimoniales vont accepter de cèder la barre à l’extrême droite: un transfert de pouvoir, dans une logique de défense de classe, qui dépasse le suffrage et le Parlement. En même temps qu’ils améliorent leurs scores électoraux à partir de 1928 (notamment en participant à une coalition électorale contre le rééchelonnement des dettes de réparations de guerre), les nazis sont de plus en plus appuyés et financés par les élites : les grand propriétaires agrariens d’abord, dès 1928–1930, puis les représentants des PME, très influents en Allemagne, les banques et enfin ceux de l’industrie lourde en 1932.
Le contexte
La crise économique et culturelle de l’époque joue un rôle déterminant. Le krach de 1929 frappe particulièrement l’Allemagne, dont l’économie est dépendante des capitaux anglo-saxons. Le chômage explose, et la situation est aggravée par les politiques déflationnistes du Chancelier Brüning qui, à force de coupes budgétaires et de rigueur, finit par perdre même le soutien du patronat.
Dans le même temps, s’installe une fracture de plus en plus irrémédiable entre villes et campagnes : l’Allemagne est majoritairement urbaine dès 1881, soit près de cinquante ans avant la France. Ce bouleversement social et culturel constitue un fond de crise latent, conduisant par exemple Nicolas Patin à qualifier l’arrivée au pouvoir des nazis comme un « retour de bâton » d’une société rurale et conservatrice qui rejette la culture urbaine, cosmopolite et progressiste, de Weimar[2].
Le contexte médiatique, lui aussi, est structurant. Le cas d’Alfred Hugenberg est ici emblématique Chapoutot le décrit comme « le Bolloré de l’époque »[3]. Ancien magnat de l’industrie chimique, reconverti dans les médias, il investit dans les télécommunications, et fonde, après sa possession de plusieurs grands groupes de journaux influents, une sorte d’agence de presse qui vend des articles déjà rédigés à plus de 1 500 titres de presse. Hugenberg devient député, puis président du DNVP, le parti national-populaire allemand, une droite libérale conservatrice, qu’il radicalise, contribuant à l’union des droites autour d’un vocabulaire de plus en plus antisémite, de violences ad hominem, et d’une lutte à mort contre le « bolchevisme culturel ». Son rôle est déterminant dans la droitisation du champ médiatique et politique, et dans la recomposition des alliances parlementaires : le DNVP (parti de droite nationaliste), le Zentrum (parti catholique de centre-droit)… tous ces partis glissent vers une extrême droite de gouvernement.
À partir de 1930, la droite allemande cesse la coalition avec le SPD, notamment à l’occasion des débats sur l’assurance chômage qui prennent une ampleur inédite suite à la crise de 1929. Le régime évolue alors vers une inflexion autoritaire, permise par l’utilisation extensive de l’article 48-2 de la constitution, qui permet de gouverner par décrets-lois — un détournement de leur fonction d’exception, censée préserver l’État en cas de crise, mais qui sert désormais à voter des taxes sur la bière ou le tabac. On assiste alors à la dissolution du Reichstag sans contrôle parlementaire et à la mise en place de la Camarilla, c’est-à-dire du cabinet présidentiel, qui gouverne par signature de Hindenburg. La Camarilla, qui veut dire « petite chambre » est un cercle de barons représentant les secteurs performants de l’économie allemande : industrie, agriculture, commerce… Ils revendiquent représenter les meilleurs, et veulent une politique qui, pour « libérer les forces productives » vise la dérégulation, la facilitations des licenciements, l’affaiblissement des protections collectives.
Pour appliquer ces mesures austéritaires de plus en plus impopulaires, le régime opère une inflexion graduelle vers plus de présidentialisation, renforçant l’importance des intrigues de cour autour de Hindenburg et aggravant la déconnexion croissante entre le parlement et le pouvoir exécutif. En parallèle, la vie politique allemande se structure autour de trois blocs : un courant central descendant (jusqu’à 10 % en 1932), un courant « national », autour de 40 %, avec hégémonie des nazis jusqu’en novembre 1932, un courant de gauche très divisé, entre 25 % pour le SPD et 15–20 % pour le KPD.
Autre point important, souvent méconnu mais déterminant dans l’arrivée au pouvoir des nazis: la question de la « Osthilfe », c’est-à-dire les aides publiques massives aux propriétaires fonciers et féodaux de l’Est, largement en Prusse, qui renforcent la collusion entre la droite des propriétaires agraires, dont fait partie Hindenburg, et le pouvoir. La remise en cause de cette gabegie d’argent public est déterminante dans la chute du pouvoir de Schleicher, que désavoue Hindenburg, et la promesse des nazis de ne pas remettre en cause la Osthilfle sera primordiale dans leur nomination.
Les acteurs
Il faut analyser les stratégies électorales des acteurs pour accéder ou se maintenir au pouvoir.
Les nazis
Le mot d’ordre des nazis : « pain et liberté », met en sourdine leur antisémitisme, et leur grand axe : l’union nationale contre le plan Young de rééchelonnement de la dette allemande issue de la première guerre mondiale, légitime le parti en l’intégrant à la coalition nationale pour son rejet. Dans les Länder, les nazis participent à des gouvernements de coalition, ce qui contribue largement à les normaliser au sein de la droite.
Mais en parallèle, les nazis continuent à saper la démocratie, en jouant sur le rejet de la fragmentation politique (32 partis à l’époque), et radicalisent leur électorat, très masculin et jeune, avec la dénonciation constante de la « gérontocratie » de Weimar. En même temps qu’ils se notabilisent, les nazis occupent la rue avec leurs milices violentes et le soutien implicite d’une justice complaisante, ce qui produit un effet de partition sur l’espace public – défilés, saluts nazis… – leur permettant d’identifier adversaires et soutiens de leur montée en puissance. Au moment de leur prise de contrôle de l’appareil répressif d’Etat, ils ont déjà identifié leurs soutiens et opposants parmi la population.
À la fin de l’année 1932, la légère baisse électorale des nazis donne à la droite l’illusion qu’on peut « acheter les nazis à la baisse » [4], c’est-à-dire les domestiquer, les encadrer. C’est cette illusion qui alimente la volonté de procéder à une alliance.
Dans son discours au club de l’industrie à Düsseldorf, en 1932, Hitler synthétise le discours nazi, entre darwinisme et colonialisme, déployé pour séduire les élites patrimoniales : « Il existe deux manifestations intimes liées de la dégénérescence des nations. La première remplace la valeur de l’individu par le concept nivelant et purement quantitatif de la démocratie. La seconde nie la valeur intrinsèque de chaque peuple, les différences dans leur disposition biologique et dans leurs réalisations matérielles. L’internationalisme et la démocratie sont des concepts inséparables. »
La grandeur d’un peuple n’est pas la somme des réalisations individuelles, mais la somme des performances des meilleurs.(…) L’œuvre de quelques génies, bénis de Dieu. Donc, si ces génies sont placés sur le même niveau que tous les autres, on assiste à un nivellement du génie, de la compétence et de la valeur de l’individu, un nivellement que l’on nomme fautivement souveraineté populaire.
On constate donc une divergence croissante entre les conceptions qui régissent l’économie et celles qui président à la politique. Il faut donc tenter de réduire cette fracture en conformant les normes politiques aux normes de l’économie. »
Ce discours au patronat allemand articule culte de la performance, darwinisme social et autoritarisme, et la capacité de Hitler à effectuer la transposition de ces concepts, leur greffe, sur les préoccupations capitalistes, restera une caractéristique de tous les mouvements d’extrême droite contemporains.
Le SPD et le KPD
Un mot doit être dit ici sur la rivalité qui oppose le SPD et le KPD, une opposition violente qui remonte à la première guerre .Il ne fait jamais de mal de rappeler que les sociaux-démocrates soutiennent l’armée et la répression sanglante contre la révolution spartakiste en 1919 ou la « République des conseils » de Bavière en 1919. Cette opposition se perpétue tout au long de la période dans des combats de rue et particulièrement lors la fusillade du 1er mai 1929, où la répression menée par le SPD au pouvoir en Prusse contre un défilé communiste fait près de 100 morts. Ces affrontements meurtriers, accompagnés au parlement par une résolution du SPD à chercher une alliance à droite entérinent une fracture irrémédiable.
Ce contexte permet de comprendre les choix désastreux du SPD dans les dernières années de la République de Weimar, notamment le refus de voter les censures du gouvernement lorsque cela exigeait une coalition avec le KPD, et le refus de présenter un candidat contre Hindenburg en 1932, illustré par cette position qui résume toute la contradiction des dirigeants du SPD : « La social-démocratie a toujours, dans les combats internes à la classe dirigeante, pris le parti de la fraction la plus progressiste et la plus modérée de la bourgeoisie, et a concentré ses attaques contre les réactionnaires. Délivrez le peuple allemand du danger fasciste : battez Hitler, donc votez Hindenburg. » Or, comme l’explique Johann Chapoutot, dans Les irresponsables, « Hindenburg, non seulement n’aura jamais un mot de remerciement républicain pour les ancêtres de ces “castors” électoraux que l’on invite régulièrement à faire barrage à l’extrême droite, mais pire encore, il manifestera un mépris agacé à leur égard, et un véritable ressentiment envers [ le chancelier Brüning ] incapable de gouverner sans eux. »
Côté KPD, la ligne de « centrisme bureaucratique [5]»« classe contre classe » , un refus de toute alliance antifasciste, imposée depuis le Komintern malgré les appels de Trotsky en faveur du « front uni défensif », parachève le sacrifice des travailleurs allemands sur l’autel de la conciliation de Staline avec les impérialistes d’Occident.
Les libéraux autoritaires
Il faut ici insister sur ce syntagme forgé en 1932 : « libéraux autoritaires ». C’est ceux qu’on appelle aujourd’hui « l’extrême centre », pour reprendre la formule de Pierre Serna[6].Ce centre extrême se caractérise par un discours policé, aux apparences convenables mais à la radicalité camouflée par une idéologie post-partisane, qui prétend triompher des clivages traditionnels, en faisant des procédures démocratiques un obstacle à l’efficacité, en même temps qu’il repousse aux marges de la légalité tout discours hétérogène au sien.
Au début des années 1930 en Allemagne, ces libéraux autoritaires favorisent le triomphe des solutions libérales, en pleine crise du libéralisme, avec un renforcement inexorable du poids de l’exécutif, une multiplication des lois sécuritaires, et surtout un projet économique et social : celui du « Neue Staat » (« Nouvel État ») fait de dérégulation, de réduction des services publics, de désétatisation de l’économie.
Ces libéraux autoritaires gouvernent sans soutien populaire, et, à partir de 1932, sans soutien parlementaire. Leur stratégie est de « tenir bon », jusqu’à ce que la conjoncture économique se retourne, en misant sur un retour cyclique de la croissance espéré pour 1932-33.
Le transfert de pouvoir
Après Brüning, poussé à la démission en 1932 – officiellement pour des raisons personnelles, mais en réalité parce qu’il a perdu le soutien de Hindenburg –, ce dernier nomme Franz von Papen, un ancien du Zentrum qu’il affectionne. Von Papen n’a quasiment aucun soutien au Reichstag (10 %), mais il gouverne en s’appuyant sur le soutien tacite du NSDAP, le parti nazi. En même temps qu’il met en place une politique de l’offre pour séduire le patronat, Von Papen cherche à s’attirer les bonnes grâces de Hitler : il lève l’interdiction des SA et organise des élections alors que les nazis sont au plus haut dans les sondages, entrainant le meilleur score fédéral nazi en période démocratique : 37% des voix.
En juillet 1932, Von Papen franchit un pas décisif, en réalisant un coup de force contre le gouvernement régional de Prusse, tenu par les sociaux-démocrates : il utilise un prétexte de violence de rue pour destituer le gouvernement élu, et se nomme commissaire à la tête de la Prusse : c’est le « coup de Prusse » (Preußenschlag), c’est-à-dire un coup d’État légal, qui place la plus grande région d’Allemagne sous contrôle direct du gouvernement fédéral.
Les élections de juillet 1932 donnent 230 sièges sur 608 au NSDAP, qui devient la première force au parlement. Papen propose à Hitler le poste de vice-chancelier, qu’il refuse, exigeant la chancellerie. Le Reichstag, où nazis, communistes et socialistes se rejoignent en septembre, vote alors massivement la censure de Papen : 512 voix contre 42. Von Papen envisage alors de dissoudre le Parlement sans convoquer de nouvelles élections et de gouverner par la force, mais l’armée et Schleicher (un des favoris du président, ministre de l’armée, membre le plus influent de la Camarilla), le désavouent. Von Papen quitte la chancellerie en décembre 1932.
Hindenburg, par mépris des élections, refuse de nommer le premier groupe du parlement et c’est donc Schleicher qui lui succède. En tant que ministre de l’armée, Schleicher s’inquiète de la montée en puissance des milices SA et a conscience du danger représenté par les nazis. Il cherche donc à former une majorité alternative au parlement, tournée vers le centre et les sociaux-démocrates, ainsi qu’une partie du NSDAP qu’il cherche à fracturer, en discutant en secret avec Georg Strasser (équivalent du secrétaire général du mouvement) pour le nommer au gouvernement. Cette tactique est presque sur le point d’aboutir au moment de la révocation de Schleicher par Hindenburg. Car Schleicher manque de soutien, à la fois du côté du SPD qui se redécouvre dans l’opposition, et dans l’entourage du président, où sa tentative de réforme agraire et de remise en cause de la Osthilfe effraient les propriétaires terriens.
C’est ce revirement qui fait dire à Johann Chapoutot, dans un raisonnement contre-factuel, que les nazis auraient très bien pu ne jamais accéder au pouvoir. Il explique même que, selon le journal intime de Goebbels, ce dernier est pris de pensés suicidaires, en décembre 1932, quelques semaines avant la nomination de Hitler à la chancellerie...
Von Papen manœuvre alors auprès de Hindenburg pour se faire renommer, cette fois en coalition avec les nazis, au poste de vice-chancelier, en promettant que le gouvernement d’alliance avec le NSDAP ne toucherait pas à la réforme agraire et ne remettrait pas en cause la Osthilfe. Dans l’esprit de la Camarilla, Von Papen serait le vrai chef du gouvernement car il manipulerait Hitler, et la droite bourgeoise pense disposer, grâce à cette alliance, d’une armée de militants, de milices prêtes à l’affrontement avec les communistes et les sociaux-démocrates. C’est ainsi que se forme le cabinet Hitler-Von Papen, qui organise de nouvelles élections.
Une fois au pouvoir, Hitler ne fait pas mystère de son intention : ces élections de mars 1933 seront les dernières.
La mise au pas
Le 4 février, une ordonnance pour la protection du peuple allemand réduit les libertés de réunion et d’expression dans la presse. L’appareil d’État est désormais entièrement au service du NSDAP, qui bénéficie des moyens de la puissance publique, y compris la radiodiffusion. Le 17 février, le gouvernement procède à l’assouplissement des règles d’ouverture du feu, en autorisant explicitement à tirer sur les manifestants. Le 22 février, 50 000 policiers auxiliaires sont recrutés, principalement parmi les SA et la SS : la violence nazie devient légale. On assiste à la multiplication des lieux de détention improvisés, dans un climat de peur, de violence, d’intimidation.
La nuit du 27 au 28 février a lieu l’incendie du Reichstag, probablement, selon Johann Chapoutot à l’initiative d’un commando de SA, qui aurait manipulé le désigné incendiaire Van der Lubbe pour le faire accuser. Dès le matin du 28, le président Hindenburg signe l’«Ordonnance pour la protection du peuple et de l’État ». Il faut souligner que la rapidité de cette réaction s’explique en partie par le fait que l’ordonnance était prête : Hindenburg la trouve déjà rédigée par les conseillers du chancelier Schleicher, qui envisageait lui-même l’instauration d’un état d’urgence, selon un prétexte à définir. Les six articles de cette ordonnance suspendent tous les droits fondamentaux garantis par les articles 114 et suivants de la Constitution de 1919, jusqu’à nouvel ordre. La Constitution de 1919 n’a donc jamais été formellement abolie, mais les droits fondamentaux ont été suspendus dès le 28 février 1933, et le Reichstag est privé de ses pouvoirs législatifs à partir de la loi du 23 mars 1933. Parmi les droits suspendus figurent la liberté individuelle, l’inviolabilité du domicile, le secret des correspondances, la non-rétroactivité des peines, ainsi que les libertés d’expression, de réunion et d’association, désormais toutes placées sous le contrôle direct de l’administration, c’est-à-dire de la police. Cette dernière se voit conférer des pouvoirs incompatibles avec l’État de droit : elle peut désormais prononcer des incarcérations par simple décision administrative, sans autorité judiciaire. Un citoyen allemand peut désormais être privé de liberté sans passer devant un juge.
En dépit de ce climat d’intimidation généralisée, le NSDAP n’obtient que 43% des voix aux élections du 5 mars 1933. Cela ne suffit pas à gouverner seul. Pour concentrer le pouvoir législatif total, il faut modifier la constitution, ce qui exige une majorité des deux tiers des membres présents au moment du vote. Le plan du gouvernement est clair : faire voter une loi d’habilitation, qui donne au gouvernement le pouvoir de légiférer par décret, sans débat ni vote au Parlement. Il s’agit de rendre permanente la logique des ordonnances présidentielles, prévues à l’article 48 depuis 1930, et désormais étendues au chancelier.
Pour atteindre la majorité qualifiée, les nazis vont chercher le soutien du Zentrum – le parti catholique, qui n’est pas réfractaire à l’idée d’un pouvoir autoritaire, et qui cherche surtout à se prémunir d’un retour du Kulturkampf bismarckien (à la fin du XIXe siècle, lorsque les catholiques subissaient ostracisation et persécutions). Un accord est négocié et validé avec le Vatican, promulgué par le Concordat du 20 juillet 1933, qui protège les catholiques et les incite à soutenir le régime.
Un projet de loi d’habilitation est déposé par le gouvernement, et en l’absence des députés communistes, déjà en prison ou poursuivis, est voté à la majorité des deux tiers. C’est ainsi que le Parlement s’abolit lui-même.
À la mort d’Hindenburg en 1934, Hitler fusionne les fonctions de président et de chancelier du Reich, devenant le chef de l’État, du gouvernement, de l’armée, sans contre-pouvoir, sans recours, sans élection jusque sa mort en 1945.
Aujourd’hui
Que nous apprend le travail de Johann Chapoutot et ses collègues sur le cas historique de l’avènement du fascisme en Allemagne ? Plusieurs leçons s’imposent, à condition de regarder le présent avec les outils de l’histoire, c’est-à-dire d’identifier des fonctions structurelles et des dynamiques sociales comparables.
Il existe évidemment des différences fondamentales entre le nazisme historique et les mouvements d’extrême droite contemporains. Parmi elles, la place centrale de la première guerre mondiale et la brutalisation extrême qu’elle entraîne sur des millions de mobilisés. Il y a par exemple cinq millions d’armes de guerre en circulation en Allemagne en 1919, une culture de la violence incorporée et valorisée par l’Etat. À cela s’ajoute la singularité de la crise économique, de la crise inflationniste de 1924 au krach de 1929, crise d’une intensité inédite entraînant la destruction du tissu social et l’effondrement des classes moyennes. Il y enfin les traditions politiques propres à l’Allemagne du début du XXe siècle : celles d’un empire féodal, autoritaire et anti-démocratique.
Mais, si ces éléments diffèrent, certains mécanismes sont inaltérés, comme la capacité intacte de l’extrême droite à politiser les affects négatifs, à les transformer en solution eschatologique, en promesse positive de reprise de contrôle sur des processus dépeints comme aliénants, qui échappent à la supervision populaire Un talent certain à tordre les faits et l’histoire pour les mettre en récit, les ordonner et leur offrir un sens convaincant. Une habileté de ces politiciens à faire entrer en résonance la réalité de la vie des gens et leurs souffrances avec leurs propres obsessions identitaires, en même temps qu’à désigner des coupables. Ils arrivent à faire coexister la dimension populaire, de masse de leurs mouvements avec la préservation des intérêts capitalistes : les fascistes produisent un nouvel axe d’hégémonie sociale et politique[7], qui étend et approfondit le consensus capitaliste en le renouvelant et en le renforçant par la domination raciste et la violence désormais revendiquées.
Du point de vue de la structure étatique, comment ne pas comparer la dérive institutionnelle de la République de Weimar à partir des années 1930, qui n’a plus de république que le nom, et celle de notre propre Ve République, dont un des rédacteurs de la constitution de 1958, Réné Capitant, admirateur de Karl Schmidt, revendique s’inspirer? Comment ne pas voir un point commun dans la dissociation entre les résultats électoraux et la direction exécutive concentrée dans les mains présidentielles ?Dans l’acharnement des élites patrimoniales à faire appliquer des politiques dévastatrices et impopulaires, à les imposer par la force quand il le faut ?
À cela s’ajoute aujourd’hui la puissance inégalée de l’outil répressif d’État qui, en plus d’être maintenant fusionné et dépendant des entreprises vendeuses de solutions algorithmiques[8], dispose désormais de la capacité à s’immiscer dans toutes les sphères de la vie sociale et politique, y compris les plus intimes[9].
Face cette mécanique de progression de l’extrême droite et des risque de fusion avec la structure d’Etat, l’antifascisme est une nécessité vitale. Mais si l’alliance contre l’extrême droite est primordiale, elle ne se suffit pas à elle seule. Il ne s’agit pas seulement de « faire barrage », mais de proposer et d’assumer un projet politique radicalement alternatif.
Le cas historique de l’Allemagne des années 1930 constitue un traumatisme dont l’écho doit nous interpeller : comment une des gauches les mieux implantées, organisées et influentes du monde a-t-elle pu être réduite, d’abord à l’impuissance, puis à la disparition en quelques mois ?
Johann Chapoutot déconstruit la falsification du mythe de la conquête de pouvoir par l’extrême droite et montre qu’elle n’est pas inexorable, qu’il n’y a pas de fatalité : le fascisme est en dernier recours un choix délibéré, fait par des politiciens bourgeois, qui considèrent que c’est le prix à payer pour préserver la stabilité sociale.
Et si nous voulons que cette « récidive » ne s’accomplisse pas jusqu’au bout, il faut saisir chaque opportunité de résistance, occuper chaque position stratégique, qui seront autant de bastions depuis lesquelles mener les combats dans l’éventualité où l’extrême droite redeviendrait hégémonique. Car l’exemple historique nous informe que, lorsque les fascistes prennent le pouvoir, ils nous obligent à les en sortir les pieds devant. C’est Goebbels qui le disait en 1932 dans son journal intime: « Ces idiots nous donnent le pouvoir. Ce sont nos cadavres qu’il faudra sortir de là. »
[1] Paraphrase reprise de l’auteur Frederico Finchelstein, The wanna be fascist, 2024, University of California Press.
[2] Nicolas Patin, La catastrophe allemande : 1914-1945, 2014, Fayard.
[3] Johann Chapoutot, Les irresponsables, 2025, Gallimard.
[4] Johann Chapoutot, Les irresponsables, 2025, Gallimard.
[5] Trotsky Léon, Comment vaincre le fascisme. Écrits sur l’Allemagne 1930-1933, 1993. Éditions de la Passion
[6] Pierre Serna, La République des girouettes 1789-1815, 2005, Champ Vallon édition.
[7] Sur le concept d’hégémonie, voir Yohann Douet, L'hégémonie et la révolution. Gramsci, penseur politique, 2024, éditions Amsterdam.
[8] Voir Tréguer Félix, Technopolice : la surveillance policière à l’ère de l’intelligence artificielle, 2024, éditions divergences.
[9] aux Etats-Unis, sur les contrats entre ICE et Palantir voir
https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2025/08/usa-global-tech-made-by-palantir-and-babel-street-pose-surveillance-threats-to-pro-palestine-student-protestors-migrants/