Agenda militant
Ailleurs sur le Web
![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)
- Dans les années 1970, la gauche a laissé passer une crise qui aurait pu tourner à son avantage (08/12)
- Audition de Mélenchon devant la commission d’enquête anti-LFI (07/12)
- France Info fait du CNews : Antoine Léaument explose le plateau (07/12)
- Action de mise à l’arrêt d’une usine de pesticides interdits : "bloquons BASF" (04/12)
- Organisation du Travail et Communisme - Bernard FRIOT & Frédéric LORDON (02/12)
- La « peur rouge » aux États-Unis, hier comme aujourd’hui (02/12)
- Le service militaire. - La chronique de Pierre-Emmanuel Barré (30/11)
- Décès d’Henri Benoits (30/11)
- Guerre et service militaire : les médias sonnent le tocsin (29/11)
- La meute médiatique, le retour ? Manuel Bompard, Rima Hassan et Paul Vannier publient leurs réponses à Belaich et Pérou (29/11)
- Le capitalisme comme totalité : une introduction rapide à son histoire (27/11)
- L’État contre les associations. Extrait du livre d’Antonio Delfini et Julien Talpin (27/11)
- SONDAGE MÉLENCHON - BARDELLA : C’EST PIRE QUE CE QUE VOUS CROYEZ !! (27/11)
- Contre-enquête sur le fiasco du Louvre (25/11)
- Mélenchon : Magouilles et trahisons à tous les étages (25/11)
- Face à la crise du capitalisme : la militarisation de l’enseignement (24/11)
- Russie. Depuis sa cellule, entretien avec Boris Kagarlitsky (24/11)
- Abdourahman A. Waberi, Autoportrait avec Mélenchon : l’homme qui a sauvé la gauche (23/11)
- Glucksmann le loser (23/11)
- Convention Municipales de LFI - LE DIRECT (23/11)
- Ce journaliste a enquêté sur les liens secrets entre les grands patrons et le RN (23/11)
- Commission anti-LFI, agences de renseignements privées, sondages bidons, général bavard. (22/11)
- La critique marxiste de Rosa Luxemburg (21/11)
- Comment la gestion de la dette publique appauvrit l’État au profit du secteur privé (20/11)
- Moscou ne croit pas aux larmes : l’ambiguïté de la condition de la femme soviétique (20/11)
Etudier le nazisme pour comprendre l’extrême-droite : une nouvelle historiographie qui renseigne sur le fascisme
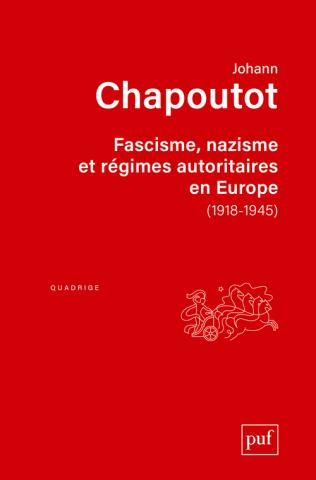
En ce début de XXIème siècle, une nouvelle génération d’historiens renouvellent la façon de faire l’histoire du nazisme, et dont Johann Chapoutot est une des figure de proue. A l’heure où l’extrême droite revient au pouvoir en plusieurs endroits du monde, cet article en deux parties vise à restituer un fragment de l’apport des historiens et de Johann Chapoutot en particulier, pour analyser ce processus et ses récurrences à travers le temps.
La deuxième partie de cet article restituera le processus de transfert de pouvoir entre la République de Weimar et la dictature nazie.
A priori, l’affaire du nazisme semblait classée. Unanimement honnie par les vainqueurs de la seconde guerre mondiale, l’idéologie semblait reléguée pour toujours aux franges les plus obscures de mouvements séditieux et marginaux.
Certes, après 1945, l’épuration des agents de l’appareil d’État national-socialiste en l’Allemagne de l’Ouest était toute relative, et nombre de ses membres ont fait de brillantes carrières dans la légion étrangère française ou à la NASA aux États-Unis, mais cette intégration s’opérait avec une honteuse et relative discrétion. Publiquement, impossible d’opérer une quelconque forme de réhabilitation. Cette répudiation allait jusqu’à leurs héritiers putatifs parmi l’extrême droite politique européenne, qui étaient contraints de concéder un caractère criminel et excessif à l’entreprise nazie, pour avoir l’opportunité de participer à la compétition électorale.
Il existe, dans le discours en tous cas, une forme de consensus structurant de nos sociétés occidentales contemporaines, ainsi que l’illustre le point Godwin : le nazisme, c’est mal.
Jusqu’à récemment du moins. Accompagnant la dérive autoritaire des institutions néo-libérales, les intellectuels organiques de ce qu’on appelle la « fascisation »[1] commencent à faire émerger une relecture de l’histoire valorisée par leurs membres les plus influents[2], où le fascisme devient l’avant-garde incomprise de la défense de l’Occident. Cette relecture légitime politiquement nombre des axiomes conceptuels et politiques du national-socialisme, et les actualise en les adaptant pour nos sociétés contemporaines[3].
Cette évolution devient manifeste avec les saluts nazis de Messieurs Musk et Bannon, leur soutien public aux figures les plus radicales de l’extrême droite racialiste, y compris lorsqu’elles sont derrière les barreaux[4], ou encore la reprise verbatim d’un discours de Goebbels par le chef de cabinet de la Maison Blanche, Stephen Miller[5].
Pourtant, en parallèle de cette résurgence longtemps insidieuse, les espaces médiatiques cessent d’effectuer leur travail d’élucidation, notamment quand ils échouent à analyser les conditions matérielles d’émergence du fascisme d’hier et d’aujourd’hui. Si la comparaison avec les années 1930 est omniprésente, au point de saturer le discours public, la plupart des acteurs du débat médiatique, par complaisance ou par paresse intellectuelle, se font les relais de contres-vérités et de discours biaisés qui rajoutent de la confusion et brouillent parfois délibérément la réflexion.
C’est à ce titre que le travail de Johann Chapoutot est particulièrement opportun, car il éclaire avec rigueur le phénomène du fascisme, du nazisme et de l’extrême droite en Europe, les conditions matérielles de leur accession au pouvoir, en même temps que la matrice conceptuelle dont ils sont issus.
La posture, courante, qui consiste à situer le nazisme à l’extérieur de la culture politique européenne, tend à singulariser le phénomène pour mieux s’exempter d’avoir à l’analyser et à en relever les liens avec la modernité occidentale. Par exemple en refusant de voir comment les nazis ont importé la violence raciste, jusque là confinée aux marges de l’Europe dans les empires coloniaux.
Une partie de l’historiographie a eu tendance à qualifier le système nazi d’« hitlérisme », ce qui illustre la propension à pathologiser le mouvement, à le réduire à la psyché déviante d’un seul homme qui aurait, grâce à un terrain propice, contaminé l’ensemble de la société depuis la tête malade de son concepteur. Cette tendance fait advenir l’histoire comme un enchaînement mécanique de causalités : la première guerre, la crise de 1929, le chômage qui mènent au nazisme ; elle offre l’image d’une histoire qui prend des allures de mouvements tectoniques, où la « marée brune » devient phénomène inexorable, participant à occulter les conditions précises de son avènement.
Cette posture mène à refuser de penser le nazisme comme un objet intelligible, c’est-à-dire à renoncer à comprendre ce qui constitue sa force d’attraction, hier comme aujourd’hui. À travers le cas historique du nazisme se donne à voir de façon paradigmatique et paroxystique la logique de l’extrême droite au pouvoir. Paradigmatique en cela que le mouvement formalise et adapte à la modernité les axiomes de la pensée réactionnaire, et paroxystique car il en pousse la réalisation plus loin qu’elle ne l’a jamais été.
C’est pour comprendre vraiment ce phénomène, notamment à hauteur d’homme, à travers les yeux de ses acteurs eux-mêmes, que Johann Chapoutot revendique une vision « internaliste », « compréhensive » de l’histoire. Il s’attache donc à restituer la cohérence de cette idéologie, de cette « espérance politique »[6], par les motivations des participants qui y adhèrent. Ce travail a un double effet, paradoxal : il rapproche l’idéologie nazie de nous, en soulignant son appartenance pleine et entière à la culture européenne contemporaine, en même temps qu’il souligne son éloignement radical.
Cette approche permet de dessiner un horizon de compatibilité entre les visions du monde des nazis et la nôtre, de comprendre les articulations systémiques et leur intégration dans notre contemporanéité. L’œuvre de Chapoutot s’applique à rattacher les nazis à la culture européenne et à en souligner les profondes interpénétrations. Car l’imbrication anthropologique du nazisme avec la modernité occidentale est puissante, il en constitue même une face à part entière. Pour le comprendre, le travail de Chapoutot assimile l’entièreté de leur production et de leur appareillage théorique.
Le nazisme en théorie
Le national-socialisme s’incarne notamment à travers la notion oxymorique de « modernité réactionnaire ». Il se situe en effet d’abord dans la mouvance conceptuelle de ce qu’on appelle la réaction. On appelle réaction tout le mouvement qui, en Europe, s’oppose aux conquêtes politiques et sociales de la Révolution française. Cette orientation défend et légitime l‘inégalité devant la loi, le rejet de la participation populaire, la permanence éternelle des structures sociales et politiques issues des sociétés médiévales.
La forme de cette réaction aristocratique et politique est relativement connue, notamment en Allemagne, où les historiens appellent aussi Restauration la période post-napoléonienne, lors de laquelle est promue une vision particulariste de la nation allemande contre l’universalisme impérial français qui a manqué de la dissoudre.
La réaction culturelle est plus rarement nommée en tant que telle. Selon Johann Chapoutot, ce mouvement artistique culturel, qui prendra le nom de « Romantisme » est une forme de réaction, une réaction philosophique et artistique profonde contre les Lumières et la Révolution française. Voici ce qu’il explique du romantisme dans Fascisme, nazisme et régimes autoritaires : « Contre la Raison, il s’est agi de réhabiliter le sentiment. Contre l’universalité du sujet rationnel, l’individualité égotiste du moi. Contre l’universalisme de la Déclaration des droits de l’homme et du Code civil, le particularisme de la nation. Contre la nation du contrat social, celle de la terre et des morts. » L’homme selon les Lumières est « autonome, doté par nature – c’est-à-dire par le fait même de sa naissance – de droits dits naturels. Il est essentiellement plastique et indéfini, radicalement libre de devenir ce qu’il veut. Il choisit librement une société, par adhésion au contrat social. Mais cette exaltation de la liberté est aussi, pour les nazis, synonyme de déliaison, de déliquescence, d’effondrement des communautés traditionnelles. Fascisme et nazisme, au XXe siècle, n’auront pas de mots assez durs contre cette rupture du lien inaugurée par 1789. »[7]
Le nazisme se situe donc dans une parentalité conceptuelle, pour ne pas dire dans une filiation, avec le romantisme : il constitue une synthèse politique, aboutie et radicale de celui-ci. D’ailleurs Goebbels dira, une fois la République de Weimar subvertie en 1933 : « C’est la fin de 1789. »
C’est que les idéologues nazis pensent l’histoire sur le temps long, qu’ils réinterprètent au prisme de leurs obsessions biologiques et raciales. Ainsi, les Romains deviennent des Germains descendus de leurs contrées septentrionales et acclimatés aux températures favorables du Sud de l’Europe. La chute de leur empire est expliquée par l’influence néfaste du christianisme, issu du judaïsme, perçu comme un élément corrupteur introduit au sein d’une culture romaine jusque là virile et expansionniste. La religion chrétienne est comparée à un virus qui provoque la dégénérescence du corps social, assimilé ici à un corps biologique[8].
Les valeurs d’amour, de charité du christianisme sont rejetées, analysées comme pervertissant l’esprit et le corps du Germain archétypal, en permettant la perpétuation des faibles et improductifs au sein de la société, entraînant la corruption – délibérée, par un complot, arme des faibles contre les forts – de la qualité physiologique de la race germanique dans son ensemble.
Les nazis vont également mettre en place un ordre juridique nouveau – notamment à travers le concept de race, auquel ils subordonnent les normes juridiques de l’individu et de la personne morale, en se faisant contempteurs des influences néfastes du droit de l’empire romain tardif par rapport aux droits coutumiers des tribus de Germains, dont ils voudraient se faire les résurrecteurs contemporains. Il pensent notamment la norme juridique comme une sorte de norme prescriptive plutôt que prohibitive[9] : il existe notamment une injonction à produire – produire des matériaux au travail ou produire de la matière biologique dans la famille (des enfants) – qui est faite aux jeunes Allemands.
Les nazis se révèlent également modernes parce qu’ils sont le produit des sciences des XIXe et XXe siècles, de la révolution industrielle et de la Première Guerre mondiale. Le monde qu’ils construisent est celui de la rationalité scientifique, de l’efficience économique productiviste, du racisme biologique appliqué. Ils transposent des concepts pseudo-scientifiques — de biologie, d’économie — dans la sphère politique, et ils se projettent dans les relations sociales et internationales à travers ce prisme biologisant.
Un exemple paradigmatique de ce transfert de la biologie vers la politique est l’emploi extensif du terme « Lebensraum » souvent mal traduit par « espace vital », alors qu’il serait, selon Johann Chapoutot, mieux traduit par le terme de « biotope », élément central dans l’articulation de la vision du monde et des relations internationales selon les nazis. Également, ces derniers rejettent systématiquement l’emploi du mot « société », « Gesellschaft » en allemand, terme issu de la révolution française, pour lui préférer « Gemeinschaft », « communauté », en lui conférant une dimension biologique et raciale.
Cependant, il faut rappeler qu’aucun des éléments constitutifs du nazisme — racisme biologique, eugénisme, colonialisme, capitalisme, impérialisme, nationalisme, darwinisme social — n’a été inventé par des Allemands. Par contre, ils en ont livré une synthèse transformée en doctrine politique aboutie, cohérente, conséquente et concrète.
Le nazisme concrètement
Comment décrire le régime nazi, tel qu’il se déploie historiquement ? Johann Chapoutot évite par exemple le terme de « Troisième Reich » souvent employé, car il reprend en réalité sa propre dénomination officielle, et participe à inscrire le développement nazi dans une continuité politique naturelle, ou logique, de l’Allemagne.
Le terme régulièrement employé pour qualifier le régime est celui de « totalitaire », abondamment usité dans les médias et jusque dans les programmes et les manuels scolaires. L’histoire de ce concept, qui a beaucoup circulé, remonte à l’Italien Giovanni Amendola pour décrire l’Italie fasciste dès 1923. Il a immédiatement été recyclé, dans un sens mélioratif, par Mussolini lui-même. S’il est régulièrement utilisé dans les années 1930, y compris par Trotsky, pour décrire les points communs apparents des États fascistes et de l’État stalinien, il doit en grande partie sa notoriété à Hannah Arendt, qui publie Les origines du totalitarisme en 1951 et il devient omniprésent dans les sciences politiques, une discipline normative et catégorielle.
Mais en réalité, le concept n’est pas utilisé par les historiens spécialistes de ces questions, qui lui reprochent un manque de validité épistémologique et heuristique. En effet, le totalitarisme est un concept qui tend à classer des faits historiques variés dans des catégories pré-établies, à simplifier des phénomènes complexes et parfois contradictoires afin de mieux les conformer à des principes normatifs pré-déterminés.
Dans le cas du nazisme, il ignore par exemple l’affaiblissement intentionnel des structures étatiques traditionnelles, le modèle d’archaïsme biologique promulgué par le régime ou l’application différentielle de la violence au sein de la population, en même temps qu’il exempte de penser les gradients de violence, les formes différenciées de contrôle ou les structures de pouvoir et de répression héritées du colonialisme au sein des « démocraties libérales » elles-mêmes.
Au delà de son caractère catégoriel, l’emploi du terme « totalitaire » révèle en fait souvent plus sur ceux qui l’utilisent systématiquement pour mettre en équivalence les régimes autoritaires du XXème siècle - donc disqualifier le marxisme, dont le stalinisme est présenté comme l’aboutissement logique. On trouve ainsi un emploi extensif de ce terme dans le contexte de guerre froide au Etats-Unis, ou chez François Furet et les « nouveaux philosophes » dans la France des années 1980, qui font de la Révolution Française la matrice des totalitarisme[10]. Et s’il existe certains points communs évidents entre les régimes fascistes et l’URSS stalinienne, ils ne doivent pas non plus évacuer les différences fondamentales de leurs bases sociales, comme Trotsky y insistait.
S’il est peu pertinent de qualifier le régime nazi de totalitaire, on peut en revanche parler de régime terroriste, d’un terrorisme du haut vers le bas. En l’occurrence, il ne faut pas surestimer la politique de terreur ou de contrainte uniforme : au contraire, le nazisme repose sur une application différenciée de la violence au sein de la population. Il s’agit à la fois d’une dictature violente, qui s’affranchit de l’État de droit pour frapper ses victimes, et d’un régime qui repose sur le consentement et l’adhésion d’une majorité de la population — à condition qu’elle ne fasse pas partie de ses cibles désignées. Les nazis ont en effet un vif interêt à éviter une dissociation de la population d’avec le régime, comme cela avait été le cas à la fin de l’empire allemand en 1918. Ils maintiennent comme obsession, tout au long de la guerre, de prévenir une éventuelle situation révolutionnaire ou insurrectionnelle, de préserver l’unité nationale. Ainsi, les Allemands pourront manger à leur faim jusqu’à l’invasion du territoire proprement dit en 1945.
À ce titre, un exemple est frappant : à la fin de la « mise au pas » de la société allemande (nom utilisé par les nazis pour désigner leur prise de contrôle de la société), 0,3 % de la population allemandes sont passés par un camp de concentration, qui sont encore à ce stade des lieux d’internement, différents de ce qu’ils deviendront à partir de 1938 et l’expansion territoriale, tannique q’un sixième de la population de l’URSS est passé par le Goulag entre 1930 et la fin des années 1940[11].
Autre exemple révélateur : en 1941, des catholiques notoirement critiques de certaines politiques nazies, comme la mise à mort des handicapés résistent et organisent des manifestations contre le retrait des crucifix des écoles. Ils obtiennent gain de cause, sans que leurs représentants ne subissent de répression[12]. Cela illustre bien que l’espace de négociation, de conflictualité, bien que restreint, n’est pas totalement effacé.
Mais surtout, les nazis mettent en place des politiques de gratification, pour sceller l’adhésion de la population : les biens spoliés aux Juifs et aux opposants sont ensuite redistribués à la population. Sont également menées des politiques d’ergonomie au travail, de comités d’entreprises, comme le programme « Kraft durch Freude » (« La force par la joie ») qui finance voyages, opéras, loisirs populaires. Ces politiques visent aussi à compenser la baisse du coût du travail : le salaire réel moyen ajusté à l’inflation reste inférieur à celui de 1929 jusqu’en 1938. Par la suite, la spoliation intérieure sera remplacée par la prédation extérieure, reportée sur les pays occupés par la Wehrmarcht pendant la guerre.
À cela s’ajoutent diverses politiques de relance, surtout dans l’armement et les infrastructures, ainsi que l’interdiction des syndicats ou des grèves. L’Allemagne devient ainsi un « espace optimal d’investissement », attirant les capitaux étrangers, particulièrement anglo-saxons, et impressionne beaucoup les contemporains, en particulier par la mise en scène experte que le régime fait de lui-même à travers ses défilés millimétrés, son cinéma, sa radio et sa propagande. Il y a là une projection déformée de la réalité, mais très efficace, qui marque les contemporains, et nous affecte encore aujourd’hui.
Quant à la structure du régime, il faut aller à rebours des stéréotypes mis en scène et artificiels, donc. Il faut s’éloigner du cliché d’un un appareil d’État structuré, rationnel et efficace. Le nazisme fonctionne comme une polycratie, avec une multiplicité d’institutions et d’agences para-étatiques, aux compétences souvent redondantes. Toutes travaillent en direction du Führer, arbitre ultime des politiques publiques, dans une forme de darwinisme institutionnel[13], dans le sens où ce dernier privilégie toujours la proposition la plus radicale et la plus ambitieuse, qui aura l’air la plus efficace. Hitler n’est donc pas un « dictateur faible » comme cela a pu être théorisé par l’historien allemand Hans Mommsen, qui essaie de comprendre le peu d’empreintes administratives des décisions de la chancellerie à travers l’histoire du régime. En fait, la structure dirigeante nazie met en oeuvre une pensée de la fin de l’État, de sa dissolution organisée dans des agences sous mission, entièrement tournées vers la personne de Hitler, qui arbitre souvent à l’oral entre les différentes options qui lui sont présentées.
Cette dissolution du status, que les nazis font remonter à l’Empire Romain, rénové par la Révolution française, se réalise avec un prétexte d’efficience managériale, contre les lourdeurs administratives, mais entraine en réalité une déperdition d’énergie et un chaos considérable à cause des nombreuses agences avec à leurs têtes des dirigeants en compétition les uns avec les autres.
La guerre génocidaire
Le régime nazi est également souvent présenté comme un régime génocidaire. Pour évoquer cet aspect, il faut se garder de faire de l’histoire téléologique, c’est-à-dire de l’écrire par la fin. Il faut reconsidérer le nazisme tel qu’il se construit, à l’instant où il advient, c’est-à-dire pas encore comme le régime mortifère, génocidaire, qui aboutira à l’extermination et à la mort. Au contraire, il est perçu par les contemporains, surtout en Allemagne même, comme une pulsion vitaliste, une exaltation de l’action immédiate, du présent, un culte du corps. Ce que nous savons, nous, avec le recul, à savoir que le fascisme naît de la guerre et retourne à la guerre ne deviendra une réalité qu’à partir de 1939, ou 1941 pour le génocide, voir 1944 pour les Allemands eux-mêmes, à partir de l’invasion du territoire allemand proprement dit.
De même, la politique génocidaire du régime est en réalité improvisée. Les politiques antisémites débutent par la persécution et s’organisent autour d’un objectif clair : faire émigrer les 800 000 Juifs d’Allemagne présents sur le territoire en 1933. Il existe une montée progressive, incrémentale de la violence à l’égard des adversaires que se choisit le régime : les lois raciales de Nuremberg évoluent vers les pogroms de 1938 (que l’on appelle trop souvent « Nuit de Cristal » terme qu’il convient d’éviter, tant il sert à euphémiser ce qui fut une campagne de terreur organisée). Parallèlement, les nazis imaginent déplacer les Juifs qui restent – et dont il accroissent le nombre par leur expansion territoriale – vers Madagascar, puis vers l’Oural. Ces solutions d’expulsion de masse sont cependant rendues inatteignables par l’entrée en guerre avec la Grande-Bretagne, puis avec l’URSS. C’est l’impossibilité de mettre en place ces politiques d’expulsion qui mène à ce que les nazis eux-mêmes appellent la « solution finale », délibérément cachée aux opinions publiques du monde entier, y compris en Allemagne dans une large mesure.
En dernière instance, la tendance génocidaire du régime se retourne contre les Allemands eux-mêmes. En effet, dans les derniers mois de la guerre, Hitler, qui refuse toute capitulation, affirme que le peuple allemand mérite de disparaître, étant incapable de faire preuve de sa force, au contraire des Slaves soviétiques capables de gagner la guerre.
D’une certaine manière, les nazis se retrouvent entraînés par leur propre radicalité, et leur détermination à rester cohérents avec leur racisme biologique et darwinien qui conduit l’Europe et ses peuples à la mort et la destruction.
Mais avant d’être appliquée jusqu’à sa pire extrémité, cette radicalité a été affiché et revendiquée. Par quel processus est-elle parvenue au pouvoir?
[1] Sur la pertinence des termes de « fascisme » et de « fascisation », voir Palheta Ugo, Comment le fascisme gagne la France, 2025, La découverte.
[2] Sur la réécriture et la valorisation du rôle des nazis lors de la seconde guerre mondiale, voir Faure Valentine, « Winston Churchill, victime du nouveau révisionnisme américain », Le Monde, août 2025.
[3] Sur la continuité de la pensée fasciste et « techno fasciste », voir Gressani Gilles, « Qu’est-ce que la pensée néoréactionnaire ? », Le Grand continent, 25 juin 2025.
[4] Voir Ducourtieux Cécile, « Elon Musk réclame la libération de Tommy Robinson », Le Monde, janvier 2025
[5] Voir Morrison Hamish, « We are the storm': Charlie Kirk memorial speech draws Nazi rally comparisons», the national.scot, septembre 2025.
[6] Johann Chapoutot, La révolution culturelle nazie, 2017, Gallimard.
[7] Johann Chapoutot, Fascisme, nazisme et régimes autoritaires en Europe : 1918-1945, 2013, PUF.
[8] Sur la relecture de l’Antiquité par les nazis, voir Johann Chapoutot, Le nazisme et l’Antiquité, 2008, PUF
[9] Sur l’élaboration des innovations juridiques nazies, voir Johann Chapoutot, La loi du sang, 2014, Gallimard.
[10] Furet François, Penser la Révolution française, 1999, Hachette Littérature
[11] Johann Chapoutot, Nicolas Patin, Christian Ingrao, Le monde nazi, 2024, Taillandier
[12] Idem.
[13] Sur la pensée de la fin de l’État ou l’élaboration du « management par délégation de responsabilité », voir Johann Chapoutot, Libres d’obéir, 2020, Gallimard.




