Agenda militant
Ailleurs sur le Web
![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)
- Rosa Meyer-Leviné. Vie et mort d’un révolutionnaire (12/01)
- Un fascisme tardif ? Entretien avec Alberto Toscano (12/01)
- Penser l’exil, ou la nécessaire histoire de l’anarchisme (12/01)
- La signification de l’anti-impérialisme aujourd’hui. Entretien avec Tariq Ali (12/01)
- "Macron démission: il n’y a pas d’alternative" (11/01)
- "Les luttes antiracistes sont réduites à des enjeux symboliques" – Entretien avec Florian Gulli (11/01)
- Le socialisme est-il un État providence offrant une égalité des chances ? (11/01)
- La crise du capitalisme chinois (11/01)
- Le bien mystérieux Pierre Lambert, parrain rouge de l’OCI avec François Bazin (11/01)
- Corée du Sud : après l’échec du coup d’Etat, les travailleurs doivent passer à l’offensive ! (08/01)
- Contre la privatisation de la RATP ! - interview d’Ahmed Berrahal (08/01)
- Contre l’austérité et les plans sociaux : la lutte des classes ! (08/01)
- Entretien avec Berivan Firat du CDKF (Conseil démocratique kurde en France) (08/01)
- Soudan, vers une paix pour les seigneurs de guerre ? (08/01)
- Le communisme qui vient, de Bernard Friot et Bernard Vasseur (08/01)
- Où va l’impérialisme allemand ? (05/01)
- L’économie mondiale en 2025 : année folle ou année tiède ? Par Michael Roberts (05/01)
- Ukraine : emprunter le douloureux chemin vers la paix (05/01)
- Où en sont les « socialistes » aux États-Unis ? (05/01)
- Pour gagner, la gauche doit-elle en revenir aux partis de masse ? (05/01)
- Narcotrafic : Darmanin et Delogu ne peuvent pas SE SNIFFER (05/01)
- Alma Dufour sur France Info (05/01)
- Diyarbakır : reconstruire une municipalité en ruines (28/12)
- Le marxisme aux paysans (28/12)
- Aux origines du socialisme japonais (28/12)
Les années 70, un âge d’or des luttes ?
À propos du livre de Lilian Mathieu
Pas question de « devoir de mémoire » ou de solennité de l’histoire. S’il est important de revenir sur les luttes qui ont marqué la décennie 1970, c’est pour saluer, bien sûr, leur intensité et leurs ponctuelles convergences, mais plus encore peut-être pour aider les militants révolutionnaires à tirer partie de leurs expériences et de leurs limites, de leurs conquêtes et de leurs échecs. À cet égard, le bref ouvrage de Lilian Mathieu (1), sociologue chargé de recherche au CNRS, membre de la revue Contretemps, militant de l’ex-LCR et du NPA, est une synthèse intéressante sur cette période.

L’auteur s’efforce de dresser un panorama de ce qu’il nomme l’« humeur contestataire » de l’époque. Il était sans doute difficile d’échapper à un tableau cloisonnant les champs de lutte (le « monde du travail », les « luttes des immigrés, » la « politisation de l’intime », l’opposition aux « autoritarismes »…). L. Mathieu est bien conscient de ce problème conduisant à figer les catégories (travailleurs, immigrés, femmes…) ; il est donc soucieux d’ind-iquer, sans approfondir cependant cette dimension importante, que des passerelles s’établissaient entre les secteurs et les acteurs. Au-delà, le point de vue qu’il adopte ici n’est pas marxiste ; ce n’est pas principalement en termes de lutte de classes qu’il aborde ces mobilisations. Et dès lors, plus qu’une question de structuration, ce plan séparant les lieux et moments des luttes s’explique aussi par l’absence d’une vision réellement unifiante, si ce n’est sous le terme assez vague de « contestation ».
C’est en suivant la thèse incontournable de Xavier Vigna que Lilian Mathieu aborde les luttes des travailleurs (2). Dans L’insubordination ouvrière, X. Vigna montre comment les ouvriers se réapproprient leurs usines au cours des nombreux combats de cette période, comment ils y prennent le pouvoir et la parole, avec de nouveaux répertoires d’action témoignant d’une inventivité sociale sur les « territoires de la grève » : grèves bouchons, grèves thromboses ou grèves tétanos - menées par une fraction d’ouvriers, elles s’en prennent à un maillon stratégique de la production au point de la paralyser -, mises à sac de bureaux, séquestrations, renouveau de la pratique du sabotage qui indique une véritable « virtuosité ouvrière retournée » - car il y faut beaucoup d’habileté et de savoir-faire. Les occupations, sans se banaliser, deviennent autant d’« actes ritualisés » qui offrent aux ouvriers la possibilité de se réapproprier le temps et l’espace de l’usine. Il faut souligner l’importance du combat des travailleuses dans ces luttes, révoltes contre leur double statut de dominées, comme ouvrières et comme femmes. Les ouvriers immigrés, pleinement partie prenante de ces différentes formes de grève, sont au cœur même de cette centralité ouvrière, occupant les postes les moins rémunérés et les moins qualifiés. Reprenant certaines descriptions faites par X. Vigna sur le monde de l’usine, Lilian Mathieu souligne l’archaïsme et la précarité des conditions de travail — pénibilité, usure physique, vieillissement prématuré, accidents nombreux… Le rejet de l’aliénation et de l’exploitation se combine alors avec la lutte contre les fermetures d’entreprises et les plans de licenciements. Le combat des travailleurs de Lip en est bien sûr le moment le plus marquant : dans cette entreprise horlogère de plus d’un millier de salariés, menacée de fermeture, la « grève productive » contourne l’évacuation par la police, puisque les travailleurs en ont rapidement soustrait le matériel indispensable à une production autonome. Il faudrait toutefois une réflexion d’une autre ampleur pour mesurer la force et les limites de cette lutte. Si les « Lip » veulent démontrer que l’usine peut tourner sans patrons – « On fabrique, on vend, on se paie, c’est possible » — , ils recherchent aussi et avant tout un repreneur – l’entreprise est finalement placée en liquidation en 1977.
Le livre n’a pas le format qui lui permettrait de revenir précisément sur le rôle joué par les syndicats dans ces luttes – il évoque, brièvement, « un certain modérantisme » de la CGT. On sait que, depuis 68, l’attitude du PCF, et par là même de la direction de la CGT, ne varie pas. Soucieux d’union de la gauche et d’électoralisme, ils voient dans toute affirmation d’une perspective révolutionnaire un obstacle au chemin qu’ils imaginent tout tracé vers la victoire électorale. Dès lors, ils taxent de « gauchisme » tout combat déterminé contre le patronat et tout regroupement de travailleurs soucieux de généraliser les grèves et de les faire converger. Une évolution similaire affecte la CFDT d’alors : traçant depuis la fin des années 1960 la perspective d’une autogestion aux contours cependant flous, la centrale syndicale effectue son « recentrage » à partir du milieu des années 1970, misant elle aussi sur la victoire du PS aux différentes étapes du processus électoral. Quant à FO, hormis les quelques bastions où sont actifs les militants trotskistes ou anarchistes, elle adopte une attitude soucieuse d’ordre et de conservation sociale.
On l’a dit, les luttes des travailleurs immigrés, celles des OS en particulier, très exposées à la répression patronale, sont à l’époque d’une grande intensité. Elles peuvent aussi être replacées dans le cadre de mouvements contre le racisme, pour le droit au logement et le droit de séjour. En cette fin de « Trente Glorieuses », les conditions de vie des étrangers en France sont tout particulièrement scandaleuses. De 1973 à 1981 a lieu une mobilisation d’une ampleur impressionnante des résidents des foyers Sonacotra qui, refusant une augmentation de 30 % de leurs « redevances », se lancent dans un refus illimité et collectif des paiements. Mais c’est aussi aux règlements intérieurs des résidences qu’ils s’opposent dans cette lutte, puisque les visites qu’ils reçoivent sont soumises à une autorisation préalable et qu’ils n’ont pas le droit de tenir des réunions politiques. Cette mobili-sation est remarquable aussi par sa structuration à l’échelle nationale, grâce à un système de comités et de délégués par foyer. Elle résiste à la répression (expulsions, fermeture de foyers) et finit par gagner sur la plupart de ses revendications. Cette lutte s’associe à la résistance plus générale aux expulsions et aux refus de renouvellement des titres de séjour, qui se multiplient, conduisant aux premières mobilisations des « sans papiers » (que l’on commence à appeler comme tels).
Croisant ces différentes luttes, tout en s’en autonomisant pour partie, les combats féministes et, plus largement, de genre occupent une place singulière. Un certain nombre de groupements féministes s’efforcent d’analyser avec une méthode marxiste les relations entre les sexes. Mais une divergence de fond apparaît entre les féministes accordant une priorité à la lutte de classe – « pas de socialisme sans libération des femmes, pas de libération des femmes sans socialisme » — et celles qui considèrent que la résistance au patriarcat, non réductible selon elles au capitalisme (3), doit primer. Il y a lieu de tirer les leçons de cette période car nombre de militantes féministes ont quitté les organisations d’extrême gauche parce qu’elles reproduisaient encore trop souvent les lois de la domination masculine ; ces militantes se sont orientées dès lors vers un féminisme moins soucieux de s’inscrire dans une lutte de classe frontalement anticapitaliste. La responsabilité en revient aux organisations se réclamant du communisme révolutionnaire. Incontestablement, la remise en cause de la domination masculine trouve un enracinement décisif au cours de ces années même si elle n’a pas suffi à en éradiquer toute trace jusqu’aujourd’hui. Il en va de même des mobilisations concernant les identités sexuelles : le Front homosexuel d’action révolutionnaire (FHAR) lutte d’abord lui aussi dans une perspective marxiste afin d’obtenir l’abolition de la législation discriminatoire à l’égard des homosexuels (classement de l’homosexualité parmi les maladies mentales, interdiction des rapports homosexuels avec des mineurs de plus de 16 ans alors que les rapports hétérosexuels au même âge sont autorisés…). Mais à partir de la fin de la décennie, le mouvement homo-sexuel tend à refluer d’un point de vue politique, « au profit d’une commer-cialisation des modes de vie que l’on commence à désigner comme gais ».
Outre la description de ces différentes luttes — il évoque également les causes régionalistes et écologistes, antimilitaristes et pacifistes —, l’ouvrage de Lilian Mathieu a l’intérêt d’analyser les interprétations sociologiques qui en ont été faites. C’est l’époque où un Alain Touraine, à la suite de Ronald Inglehart ou d’Alberto Melucci, croit pouvoir analyser ces luttes sous l’appellation de « nouveaux mouve-ments sociaux », identifiés par leur nature jugée plus éthique que matérielle et dès lors caractérisés comme post-matérialistes, moins centrés sur le rejet de l’exploitation, somme toute plus culturels que sociaux. Or Lilian Mathieu a raison de souligner l’aveuglement de cette analyse sociologique, à la fois « décon-nectée de la réalité des luttes sociales » et opposant artificiellement les dimen-sions éthique et matérielle. C’était en fait, pour Touraine et ses disciples, une façon de prétendre en finir avec les luttes de classes et avec le rôle central des luttes ouvrières jugées tout à la fois « intéressées » et dépassées.
L’émergence de ce courant sociologique est un symptôme parmi d’autres de la contre-offensive idéologique qui a eu lieu tout au long de ces mêmes années 1970. La presse bourgeoise, un grand nombre d’« intellectuels », parmi lesquels les autoproclamés « nouveaux philo-sophes » (A. Glucksmann, B.-H. Lévy), se jettent sur la traduction de L’Archipel du Goulag de Soljenitsyne parue en 1974 pour faire mine de découvrir les ravages du stalinisme, que Trotsky et l’Opposition de gauche, puis les organisations qui s’en sont réclamées, dénonçaient depuis les années 1920… Ils s’en servent en croyant siffler une fin de partie, affirmant sceller le terme d’une période et, avec elle, de toute espérance révolutionnaire.
Et dès lors, un certain nombre de militants révolutionnaires se reconvertissent vers un engagement plus spécifique, spécialisé, partiel, tandis que des organisations qui se réclamaient de la révolution se dissolvent (c’est le cas de Vive la Révolution en 1971 et de la Gauche prolétarienne en 1973). Ce qui intéresse donc Lilian Mathieu en achevant son ouvrage, c’est l’autonomisation des mouvements sociaux (luttes féministes, des immigrés, des prisonniers…) par rapport à l’engagement révolution-naire visant le renversement du système capitaliste. C’est aussi l’absorption de militants sur le terrain électoral décisif pour le PS et le PCF, puis dans la politique partisane et institutionnelle favorisée par leur arrivée au pouvoir en 1981.
La conclusion de l’auteur se veut pourtant à la fois optimiste et déterminée. Contre la vision servant les intérêts de la bourgeoisie — et défendue par les premiers concernés — selon laquelle les révolutionnaires des années 1970 s’en seraient « repentis », L. Mathieu note les continuités de vies consacrées aux luttes et à la résistance. Pour autant — et c’est un trait général du livre —, on ne sait plus bien quelle est la nature même de cette résistance et à quoi elle s’oppose, lorsqu’elle mêle les membres de la Confédération paysanne, d’Attac ou de la Ligue des droits de l’homme : en réalité, davantage à certaines formes revêtues par le capitalisme – le libéralisme – qu’au capitalisme lui-même. C’est le parti pris de l’auteur, et c’est aussi le reproche qu’on pourra lui faire, en tant que communistes révolution-naires : explicitement ou entre les lignes, et finalement de façon systématique, préférer la « contestation » à la révolution.
1) Paru chez Textuel en 2009.
2) Xavier Vigna, L’insubordination ouvrière dans les années 68. Essai d'histoire politique des usines, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007.
3) Christine Delphy, dans la revue Partisans en 1970, consacre à cette question un numéro important pour le féminisme français, intitulé « Libération des femmes, année zéro » ; elle y analyse le travail domestique non rémunéré des épouses au profit de leur mari comme relevant d’un mode de production économique qu’elle nomme patriarcat et qu’elle disjoint du capitalisme.





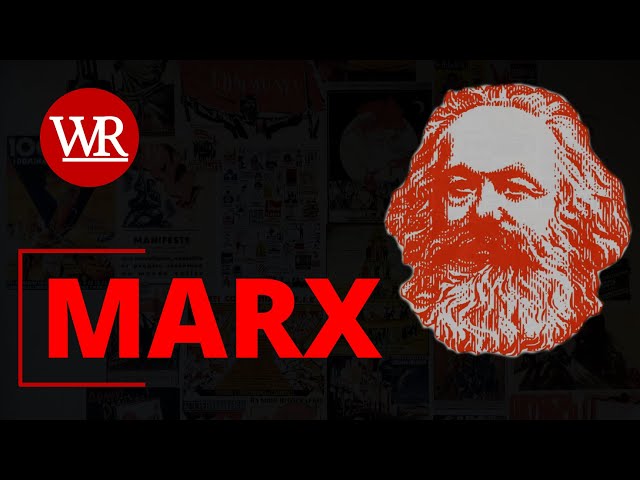

.jpg)
