Agenda militant
Ailleurs sur le Web
![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)
- Un mois de grèves et de luttes : Décembre 2024 (17/01)
- Syrie: La chute du régime (17/01)
- Iran. De la stratégie révolutionnaire au repli nationaliste (17/01)
- Serge Latouche : "Tout ce qui est beau et désirable se dévalue dès qu’il y a production de masse" (17/01)
- La fabrique du déficit public (17/01)
- Franz Fanon l’Algérien (17/01)
- La grève d’ID Logistics et le rôle de la CGT (17/01)
- L’hôpital grippé par les politiques libérales (17/01)
- Allemagne : Alstom, réduction de personnel, fermetures, délocalisations... (17/01)
- Impérialisme et ravages écologiques (17/01)
- Retour sur la condition ouvrière retraitée (17/01)
- Clémence Guetté - Censure de Bayrou : c’est l’heure de vérité (16/01)
- Benoît Coquard : "les classes populaires rurales et les sympathisants de gauche tendent à s’éloigner" (16/01)
- Un jeu d’ombres et de fausses dupes (16/01)
- Houria Bouteldja : RÊVER ENSEMBLE (15/01)
- Mélenchon: Avant veille de censure (14/01)
- "La loi du mort-mélanine" - La chronique de Pierre-Emmanuel Barré dans "La dernière" (12/01)
- Pour l’arrêt des poursuites contre Abdourahmane Ridouane (12/01)
- Rosa Meyer-Leviné. Vie et mort d’un révolutionnaire (12/01)
- Un fascisme tardif ? Entretien avec Alberto Toscano (12/01)
- Penser l’exil, ou la nécessaire histoire de l’anarchisme (12/01)
- La signification de l’anti-impérialisme aujourd’hui. Entretien avec Tariq Ali (12/01)
- "Macron démission: il n’y a pas d’alternative" (11/01)
- "Les luttes antiracistes sont réduites à des enjeux symboliques" – Entretien avec Florian Gulli (11/01)
- Le socialisme est-il un État providence offrant une égalité des chances ? (11/01)
Les révolutionnaires et les syndicats

Bref historique du syndicalisme
Une origine dans la résistance spontanée des travailleurs à l’exploitation
Les syndicats, tels qu’ils apparaissent au 19e siècle, sont une réponse organisée à l’exploitation capitaliste. Les prolétaires prennent conscience, par leur expérience concrète, qu’ils ne peuvent défendre la valeur de la force de travail, résister à l’augmentation de la journée de travail, a fortiori se battre pour sa limitation, sans s’organiser collectivement de façon durable et à l’échelle nationale. Cependant, fonctionnant par là même comme cadres d’organisation et écoles de formation pour la lutte des classes et la discussion politique, les syndicats sont devenus de plus en plus dangereux pour l’ordre capitaliste lui-même. Marx écrit ainsi :
« Les syndicats (...) originairement sont nés des essais spontanés des ouvriers luttant contre les ordres despotiques du capital, pour empêcher ou du moins atténuer les effets de cette concurrence faite par les ouvriers entre eux. (…) L’objet immédiat des syndicats est toutefois limité aux nécessités des luttes journalières du travail et du capital, aux questions de salaire et d’heures de travail. (…) D’un autre côté, les syndicats ont formé à leur insu des centres organisateurs de la classe ouvrière, de même que les communes et les municipalités du moyen âge en avaient constitué pour la classe bourgeoise. Si les syndicats, dans leur première capacité, sont indispensables dans la guerre d’escarmouches du travail et du capital, ils sont encore plus importantes dans leur dernière capacité, comme organes de transformation du système du travail salarié et de la dictature capitaliste. » (1)
Cela explique la réaction de la bourgeoisie : elle prétend au départ les interdire (ex : loi Le Chapelier en France en 1791, au nom de l’unité de la Nation : pas de corps intermédiaires entre les citoyens et l’État!), et l’État réprime les syndicats. Mais la bourgeoisie finit par prendre conscience qu’autoriser les syndicats est un moindre mal : clandestins, ils sont radicaux, violents, et développent spontanément une conscience de classe. Légaux, ils permettent l’intégration des représentants des travailleurs au système bourgeois.
En France, le droit de coalition (organisation ponctuelle de travailleurs lors d’un conflit) est reconnu en même temps que le droit de grève en 1864, et les syndicats sont légalisés en tant que structures permanentes en 1884 (avec quelques restrictions, notamment dans la fonction publique). Intéressant de noter ce que déclare un patron français au Sénat, en 1883 : « On ne s’entend pas, on ne contracte pas, on ne transige pas avec une foule » (la même année, des mineurs de Decazeville ont défenestré leur directeur). Il poursuit : « Un nouvel élément est donc nécessaire et cet élément, c’est l’organisation du travail, [...] c’est l’association professionnelle libre, ouverte, se constituant suivant les affinités, les besoins, les intérêts du moment ».
À l’avant-garde de la marche du capitalisme, la bourgeoisie anglaise était parvenue à la même conclusion dès 1824. Les trade-unions s’assagissent d’autant plus rapidement qu’une fraction des richesses provenant de l’expansion coloniale leur est attribuée. Leurs dirigeants s’embourgeoisent, autour d’eux se crée une « aristocratie du travail », réformiste et ne rassemblant que les travailleurs qualifiés. La grande masse des miséreux n’est pas syndiquée.
L’exemple britannique est repris par la plupart des gouvernements d’Europe occidentale, même les plus conservateurs. En Allemagne, Bismarck applique également cette méthode « du fouet et du bout de sucre ».
Radicalisations ponctuelles
Des vagues de radicalisations viennent cependant contrer cette intégration tendancielle. En temps de crise économique, la dégradation du niveau de vie des travailleurs les radicalise. Dans le même temps, la bourgeoise réduit les subsides qu’elle accorde à son « aristocratie du travail ». Il en résulte un infléchissement vers des positions plus radicales. Ainsi, avec première grande dépression (1873-1896) apparaissent toute une série de syndicats radicaux :
- Aux États-Unis, après que les premières grèves à l’échelle nationale aient fait cruellement ressentir le manque de structures syndicales d’envergure (grève des travailleurs du rail en 1877, grève pour la journée de 8h en 1886), apparaît en 1893 la Western Federation of Miners. Elle sera à l’origine de la fondation des Industrial Workers of the World, organisation syndicaliste révolutionnaire, en 1905.
- En France, la CGT est créée en 1895, sous l’impulsion des militants du Parti Ouvrier (marxiste) et des Bourses du Travail (anarchistes). Sa fameuse charte d’Amiens (1906) prône la lutte de classe et l’abolition du salariat.
- Création de la Commission Générale des Travailleurs Allemands (GGD) en 1892, dans l’orbite des socialistes du SPD.
- En Espagne, l’Union Générale des Travailleur est fondée en 1888 par Pablo Iglesias, dirigeant du Parti Ouvrier Socialiste et cofondateur de la IIe Internationale.
En dehors des périodes de crise, ces structures oscillent entre l’intégration et la marginalisation. La La CGT française et la GGD allemande s’alignent toutes deux sur leurs gouvernement respectifs en 1914, dans une Union Sacré chauvine et réactionnaire. Aux États-Unis, les IWW, qui restent sur une ligne révolutionnaire et s’opposent à l’entrée en guerre, déclinent rapidement au cours des années 20. A la même époque, l’UGT espagnole se compromet avec la dictature de Primo de Rivera.
C’est dans le contexte particulier de la révolution espagnole que perdurera le plus longtemps l’illusion qu’un syndicat puisse être à la fois massif et révolutionnaire. La CNT, organisation anarcho-syndicaliste crée en 1910, oscillera durant toute la guerre civile entre une politique révolutionnaire (collectivisation de la terre et des usines dans les zones qu’elle contrôle) et le soutien a l’ordre bourgeois (intégration des milices confédérales dans l’armée républicaine, entrée de ministres anarchistes dans le gouvernement de Front populaire républicain). Incapable d’opposer une stratégie claire face aux staliniens et aux sociaux-démocrates, elle se retrouve à défendre l’État bourgeois au moment où celui-ci est le plus faible.
État des lieux aujourd’hui en France
Une très forte intégration au système
Cette double nature des syndicats se retrouve dans leur organisation : d’un coté, des bases plus ou moins combatives mais sans grand pouvoir, de l’autre des bureaucraties hautement intégrées à l’ordre bourgeois, « partenaires sociaux » au service de l’État et du patronat.
Cette année, le rapport Perruchot (député Nouveau Centre) a mis en lumière à quel point les syndicats dépendent financièrement de ceux qu’ils sont censé combattre : tous syndicats confondus, leur budget annuel est estimé à 4 milliard d’euros, dont seulement 4% proviennent de ressources propres (cotisations). Le reste provient de du patronat, et surtout de l’État, sous différentes formes :
- Décharges d’horaires dans le privé (1,6 milliard) et détachements syndicaux dans le public (1,3). Aucun chiffre officiel sur le nombre total de personnes concernées. Le rapport estime que, pour la Fonction Publique, cela représente 28 000 équivalents temps-plein (essentiellement dans les secteurs fortement syndiqués que sont l’Éducation Nationale et la Police). De plus, les comités d’entreprise des grosses boites publiques ou semi-publiques (Air France, RATP, EDF, France Telecom...), regorgent de permanents syndicaux, le plus souvent nommés par leurs syndicats et non élus par les salariés.
- Subvention aux Comités d’Entreprises
- Cogestion des organismes sociaux (Sécu, formation professionnelle, 1% logement, UNEDIC)
- Mise à disposition de locaux
- Frais de formation et voyages d’études
Ce financement n’est pas condamnable en soi (2) : ce n’est jamais qu’une fraction de la valeur que le Capital vole au Travail qui est ainsi rendue. En revanche on comprend aisément qu’une telle manne doit être gérée par les travailleurs eux-mêmes et non par un petit cercle de permanents, comme c’est actuellement le cas. D’ailleurs, l’aspect financier n’est que le reflet des choix politiques des bureaucraties: accompagnement des contre-réformes, négociations permanentes (quand bien même ceux d’en face indiquent n’avoir rien à négocier!), journées d’actions sans perspectives... Se plaçant dans l’horizon indépassable du capitalisme, elles ne font qu’accompagner la crise du mouvement ouvrier au lieu de contribuer à la résoudre.
Il y a donc bien une collusion d’intérêts entre les bureaucraties syndicales et la bourgeoisie, une collaboration de classe. Derrière le spectacle de leur pseudo-affrontement, chacun sait bien où sont ses intérêts. C’est quelque chose dont la base se rend compte quand elle se radicalise, et qu’elle se retrouve abandonnée, voire freinée, par sa direction. Xavier Matthieu : « Les Thibault et compagnie, c’est juste bon qu’à frayer avec le gouvernement, à calmer les bases, Ils servent juste qu’à ça, toute cette racaille. »
D’ailleurs, la parution de ce rapport ne doit rien au hasard : la bourgeoisie n’avait aucun intérêt à remettre en cause ce système, d’une efficacité redoutable, avant la crise. Aujourd’hui, vu la chute de son taux de profit, elle ne veut plus payer (ou du moins payer autant) pour maintenir la paix sociale.
Une base réduite et sans contrôle
L’autre élément qui caractérise la situation française actuelle est le très faible taux de syndicalisation : sur 23 millions de travailleurs, seul 2 millions sont syndiqués (8%, contre 20% dans les années 70), très majoritairement dans le public. Cette baisse, générale dans les pays développés, montre une baisse de combativité, dans laquelle les directions ont un rôle écrasant : refus d’unifier les luttes éparses qui existent, pas de soutien aux luttes les plus avancées (ex : grève des raffineries lors du mouvement des retraites), transformation du mot d’ordre de « grève générale » en un synonyme de « journée d’action interprofessionnelle »...
Les bureaucraties échappent au contrôle de cette base, les appareils sont verrouillés. Ainsi l’opposition dans la CGT est-elle systématiquement bâillonnée par la direction (ex : Delannoy interdit de se présenter contre Thibaut au dernier congrès). On note cependant que la FSU, en reconnaissant le droit de tendance, permet aux courants oppositionnels de s’organiser: face à la majorité (Unité et Action, proche du PCF) et à ceux qui se compromettent avec elle (École Émancipée, dirigée par la Gauche Anticapitaliste), existe, entre autres, la tendance Émancipation (animée notamment par la gauche du NPA).
Il existe des sections d’entreprise (voir des UL ou des branches professionnelles) où des syndicalistes combatifs se sont émancipé de la bureaucratie par la lutte. Elles sont cependant très isolées, les directions faisant tout pour les marginaliser, à défaut de pouvoir les écraser.
Quelle politique ?
Un syndicalisme indépendant et unitaire
Le paysage syndical français est très marqué par l’héritage de la Charte d’Amiens, qui affirme l’indépendance syndicale par rapport aux partis et (fait dont on parle beaucoup moins) par rapport à l’État. Nous ne prônons aucunement un syndicalisme « apolitique » (l’apolitisme n’étant en général que le respect de l’idéologie dominante). Il y a toujours une influence politique dans les syndicats, plus ou moins reconnue et revendiquée. Un exemple extrême est le lien organique qui uni le Parti Travailliste et le TUC au Royaume-Uni (une proportion des sièges dans les organes directeurs de l’un est réservée aux représentant de l’autre). À l’opposé, il n’existe officiellement aucun lien entre le PS et la CFDT, même si les deux organisations sont largement sur la même ligne. Entre les deux, on peut noter le cas de la CGT (jusqu’en 1996, son SG était systématiquement membre du BP du PCF) ou de la FAI (créée dans le but explicite d’influer sur la CNT, et qui en prit effectivement la direction dans les années 30).
Corollaire de cette indépendance à l’égard des partis, nous ne voulons pas délimiter politiquement le syndicat. Indépendant des organisations politiques, il doit cependant permettre aux différentes sensibilités présentes en son sein de s’exprimer, de développer le combat d’idées. C’est dans un tel cadre large que les révolutionnaires peuvent par l’exemple démontrer la justesse de leur ligne. En limiter l’accès aux seuls militants ayant déjà acquis une conscience révolutionnaire (comme le veulent les anarcho-syndicalistes) les condamnerait à l’isolement et à la marginalité. En rassemblant des militants de divers partis et des inorganisés, le syndicat offre à la classe un précieux cadre unitaire. Cette unité est une menace pour les réformistes, qui poussent à la scission dès qu’ils perdent du terrain dans le syndicat. Exemple de la CGT: c’est la majorité réformiste qui, effrayée par la montée en puissance des révolutionnaires, pousse à la scission de la CGTU en 1921. En 1947, la rupture entre staliniens et sociaux-démocrates donne naissance à FO.
Militer dans les syndicats de masse... et combattre leur direction
Il nous faut militer dans les organisations ouvrières de masse (3), même si leur direction est soumise aux intérêts de la bourgeoise : la classe a encore une relative confiance dans ses organisations (ex du mouvement sur les retraites, où chaque « journée d’action » de l’intersyndicale était très suivie), et c’est vers elles qu’elle afflue en cas d’aggravation de la lutte des classes. À cet égard, l’isolationnisme dans un « syndicat rouge » est stérile.
En revanche, il convient d’affronter les directions de ces syndicats, opposer une ligne de classe à leur politique de cogestion. Notre intervention doit ainsi combiner différents combats :
- Une activité syndicale de classe partout où nous pouvons (souvent à l’échelle d’une entreprise, les échelons supérieurs étant étroitement contrôles par la bureaucratie). Nous devons faire nos preuves dans les syndicats, en menant des luttes victorieuses, en respectant la démocratie ouvrière. Cela seul est susceptible de renforcer les syndicats en tant qu’outils de défense des travailleurs. En aucun cas nous ne pouvons avancer par cooptation bureaucratique, par arrangements avec les directions.
- L’interpellation : il est important de demander publiquement aux directions syndicales de prendre une certaine position (condamner une décision politique, refuser de participer à une « négociation », appeler à la grève...). Si la direction refuse, elle se discrédite auprès de sa base. Si elle accepte, la lutte de classe monte d’un cran et la rupture entre réformistes et révolutionnaires s’approche d’autant plus.
- La dénonciation : quand une direction trahit au grand jour (appel à la reprise du travail pour casser une grève, signature d’un accord pourri...), il faut la dénoncer publiquement. Même en cas de faible combativité, il est important de ne pas se contenter de ne rien dire sous prétexte qu’il faut d’abord « être nombreux à la prochaine journée d’action ». Car c’est dialectique : sans perspective, les travailleurs et même les militants les plus combatifs vont vite penser que les promenades mensuelles, ça ne sert à rien – et en soi ils auront raison, même si souvent il est juste d’y participer pour pousser à leur dépassement dans une vraie lutte de classe.
- La lutte pour la démocratie interne du syndicat : les travailleurs ayant tendance à faire spontanément confiance aux bureaucraties en place, il est difficile de mobiliser la base sur des questions de principe. C’est l’expérience de la démocratie ouvrière (comité de grève impliquant syndiqués et non-syndiqués, AG souveraines, délégués révocables...) et de son efficacité dans les luttes qui fait progresser le niveau de conscience.
- Le dépassement du cadre corporatiste : les militants révolutionnaires dans les syndicats ne peuvent pas s’arrêter à la seule défense des cas individuels. Partout, ils relient les revendications particulières aux intérêts les plus larges des travailleurs.
- Le rassemblement des militants syndicaux combatifs de différentes sensibilités dans un courant intersyndical de lutte de classe antibureaucratique, pour mener une action coordonnée partout où cela est possible. C’est un outil que les révolutionnaires ont la responsabilité de construire. C’est l’un des combats que nous menons pour en convaincre les syndicalistes combatifs et notamment les camarades du NPA.
1) Rapport du Conseil général au premier congrès de l’Association Internationale des Travailleurs (Genève, 1866), rédigé par Marx.
2) Nous ne parlons pas ici des financements illicites, dont l’affaire de l’UIMM (syndicat patronal de la métallurgie, l’une des plus grosses fédération professionnelle du Medef) a révélé l’ampleur. Son ancien président, Gautier-Sauvagnac, a été mis en examen en 2008 pour abus de confiance : entre 2000 et 2007, il a retiré en liquide 19 millions d’euros. Il refuse de dire à qui ces sommes ont été versées, se contentant de dire qu’elles servaient à « fluidifier les relations sociales »...
3) Insistons sur ce critère qui disqualifie par exemple, parmi les syndicats étudiants, l’UNEF. Cette coquille vide revendique 30 000 adhérents, mais la plupart ne correspondent qu’à des cartes données avec les documents administratifs en début d’année et l’organisation ne compte qu’une poignée de véritables militants, pour la plupart intégrés à l’appareil bureaucratique lié au PS, à l’exception des camarades de la TUUD (minorité de gauche, autour de militants NPA et Front de Gauche).





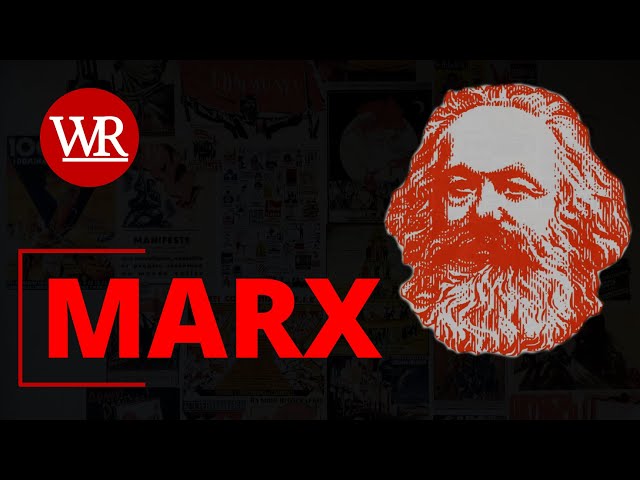

.jpg)
