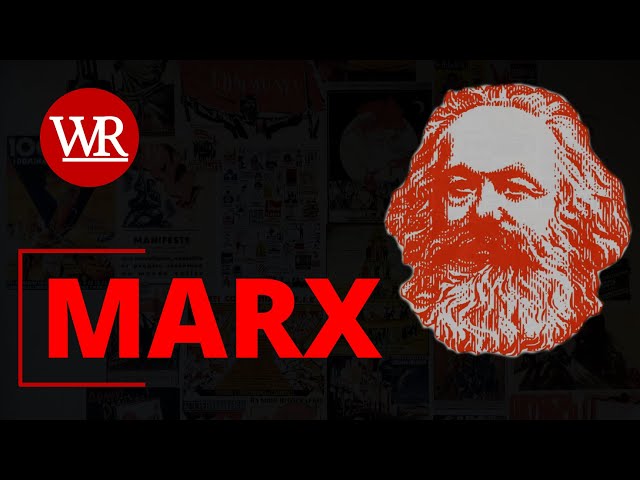Agenda militant
Ailleurs sur le Web
![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)
- Cuba : le mouvement du social (27/12)
- Procès de Georges Ibrahim Abdallah : la victoire est-elle proche ? (26/12)
- Île Maurice : la volonté de changement (26/12)
- Le socialisme dans un seul pays (26/12)
- Quel avenir pour la France insoumise ? (26/12)
- Les changements tectoniques dans les relations mondiales provoquent des explosions volcaniques (26/12)
- Un nouveau château de cartes (26/12)
- Le syndicalisme de Charles Piaget (26/12)
- Nabil Salih, Retour à Bagdad (26/12)
- La Syrie est-elle entre les mains d’Erdoğan ? (26/12)
- L’UE encourage l’exploitation du lithium en Serbie avec un grand cynisme (26/12)
- Le contrôle territorial d’Israël s’étend-il vers la Syrie ? (26/12)
- Scrutin TPE – Très Petite Élection (26/12)
- Une étudiante ingénieure déchire son diplôme en pleine cérémonie en protestation contre l’industrie d’armement (26/12)
- Des étudiants en lutte pour la paix : blocage historique à Tolbiac Paris I (24/12)
- Aurélie Trouvé sur RTL ce lundi (23/12)
- RÉVÉLATIONS DE MARC ENDEWELD SUR MACRON ET SON ENTOURAGE (23/12)
- La Grèce sous Kyriakos Mitsotakis: de la frustration sociale à la crise politique (23/12)
- Syrie : “Entre discours réformiste et répression réelle : Comment HTS a géré les manifestations à Idlib” (23/12)
- Contre les GAFAM, redécouvrir Jacques Ellul (23/12)
- Dialogue avec Benjamin Lemoine: les fonds vautours à l’assaut de la dette mondiale (23/12)
- Le cyclone Chido et la responsabilité de l’impérialisme français (22/12)
- Aurélie Trouvé sur France Info (22/12)
- Entretien avec Aymeric Caron - Palestine, antispécisme et journalisme (22/12)
- SNCF. Grèves partielles, unité de façade... : après l’échec du 12 décembre, tirer les bilans stratégiques (21/12)
Sous l’apparente inertie de la lutte des classes, les ingrédients d’une crise sociale et politique s’accumulent
Si on la compare à celle du premier semestre, la situation sociale de la rentrée semble avoir été dominée par l’atonie du côté des travailleurs. Pourtant, dès que l’on saisit les raisons politiques de cette situation, on peut comprendre à quel point la colère des travailleurs continue de gronder, même si elle est plus sourde aujourd’hui. C’est ce que prouvent à la fois le soutien massif à la lutte contre la privatisation de la poste ; l’émotion et l’identification générales suscitées par les révélations sur les suicides dus aux conditions de travail chez France Telecom ; la persistance, malgré le silence médiatique, de plusieurs centaines de conflits sociaux, notamment des grèves ouvrières, incluant parfois des occupations ; la montée du sentiment d’injustice, de l’hostilité au capitalisme et de la violence ouvrière et populaire sous diverses formes. Dans cette situation, l’accumulation des éléments pour une crise politique au niveau du gouvernement et du président lui-même, de plus en plus discrédités, pourrait devenir explosive…
La relative atonie sociale a des causes politiques
La fin de la grève des Freescale le 9 octobre apparaît comme le point d’orgue de la vague de grèves ouvrières plus ou moins dures et de portée nationale qui avait marqué l’année jusqu’à l’été, de Continental à Molex en passant par Caterpillar, Lear, Goodyear ou New Fabris (cf. ci-dessous notre article de bilan). Les « journées d’action » des directions syndicales, qui n’ont certes pas été sérieusement préparées par celle-ci, n’ont rencontré aucun écho chez les travailleurs. C’est le cas de la journée d’action de la CSI (Confédération Syndicale Internationale) pour le « travail décent » le 7 octobre (malgré l’appel de presque toutes les organisations). C’est le cas aussi des manifestations appelées le 22 par la CGT « pour une véritable politique industrielle » et pour « assurer le financement de la croissance des entreprises », même si des travailleurs combatifs et des équipes militantes ont réussi à imposer dans un certain nombre de cortèges une dynamique de lutte, notamment en scandant le mot d’ordre d’« interdiction des licenciements ». Même la grève des cheminots du 20 octobre contre la réforme du fret et la réorganisation globale de l’entreprise n’a rencontré qu’un faible succès, avec 23,75% de grévistes selon la direction et 31,6% selon la CGT.
La cause principale de cette situation, c’est le poids décisif des défaites du premier semestre, qui ont entraîné un grand découragement chez les millions de grévistes et de manifestants et parmi les équipes militantes elles-mêmes. Les travailleurs ne croient plus aux grandes journées d’action sans perspective appelées par les directions syndicales tous les deux, trois ou six mois, mais ne se voient proposer aucune alternative à une échelle de masse. En particulier, le sentiment d’impuissance face aux licenciements est fort : non seulement de nombreuses entreprises qui ferment ou annoncent des licenciements ne rencontrent pas de fortes résistances, mais là où il y a des luttes, la revendication dominante est celle de meilleures indemnités et la méthode principale reste une pression locale plus ou moins forte, mais sans initiative de convergence ou de coordination.
Rétrospectivement, des initiatives très importantes, comme la manifestation des New Fabris le 31 juillet, la rencontre de Blanquefort le 5 septembre ou la montée à Paris du 17 septembre, qui avait été préparée par les équipes militantes des entreprises en lutte et a rassemblé 3000 travailleurs particulièrement combatifs, apparaissent non comme les points de départ d’un nouveau souffle et d’une véritable coordination capable de s’affronter aux directions syndicales, mais plutôt comme les point d’orgue du cycle du printemps : elles confirment que cela aurait pu être fait avant, mais a été tenté trop tard. La principale leçon à en tirer est qu’une situation où les grèves et les luttes se multiplient appelle d’emblée la nécessité de les unifier, donc de prendre des initiatives politiques concrètes pour les coordonner en combattant frontalement la politique des directions syndicales collaboratrices et des réformistes, en promouvant l’auto-organisation et des rencontres entre travailleurs en lutte, sans attendre passivement que la convergence se fasse toute seule. C’est à cela que sert un parti anticapitaliste et révolutionnaire, que doit servir le NPA.
Dans l’immédiat, il est plus urgent que jamais d’avancer vers la construction d’un courant intersyndical lutte de classe antibureaucratique. Il y a des années que la contestation des directions syndicales par les militants n’avait pas été aussi forte. C’est surtout le cas dans la CGT après une année de luttes particulièrement intense et à la veille du 49e congrès : la candidature de Jean-Pierre Delannoy contre Bernard Thibault est d’une importance considérable car elle repose sur une base de lutte de classe claire et elle fédère d’ores et déjà les principaux collectifs de militants syndicaux oppositionnels, permettant un pas en avant important dans leur coordination nationale pour l’action commune. La Tendance CLAIRE soutient totalement cette campagne et appelle le NPA à faire de même en tant que tel (cf. ci-dessous notre contribution).

Le combat contre la privatisation de la poste et pour la grève générale des postiers est le combat central du moment
L’analyse de la situation actuelle ne saurait s’en tenir à l’apparence de l’inertie. Les défaites du printemps ont entraîné une certaine résignation, mais elles n’ont pas été un écrasement des travailleurs et n’ont fait qu’accroître leur colère, même si celle-ci est aujourd’hui plus sourde. En particulier, on ne peut comprendre l’échec des « journées d’action » syndicales depuis le début de l’année de façon unilatéralement négative : les travailleurs mobilisés en masse en début d’année ont eu raison de les boycotter, car il était évident qu’elles n’étaient ni conçues, ni utilisables pour engager une dynamique générale de lutte. A contrario, les travailleurs ont su se saisir des grèves qui, malgré leur durée fixée à 24 heures par les directions syndicales, pouvaient contribuer à faire avancer la combativité et la conscience, comme cela a été le cas à la poste le 22 septembre (35 à 40% de grévistes) et lors de la grève contre la réorganisation des services et la souffrance au travail des travailleurs Pôle Emploi le 20 octobre (35 à 40% de grévistes).
La question de la poste, avec le projet de privatisation du gouvernement, et celle de la souffrance au travail, avec l’indignation massive suscitée par la multiplication des suicides chez France Telecom ont dominé l’actualité sociale et politique, ouvrant les plus larges brèches dans la relative atonie globale. La « votation citoyenne », dont le cadre avait été fixé depuis un an par les bureaucraties syndicales et les partis de gauche pour substituer la demande d’un référendum au combat pour la grève des postiers, a finalement tendu à échapper à ses propres organisateurs, avec l’engagement de nombreux militants qui ont fait passer le curseur de la demande de référendum à Sarkozy au refus pur et simple de la privatisation, obtenant ainsi sans difficulté et sans surprise l’accord massif des travailleurs. Mais après les 2,3 millions de voix, le PS, les réformistes et les bureaucrates syndicaux ont voulu reprendre les choses en main en refusant de s’appuyer sur leur propre succès pour aller à l’affrontement avec le pouvoir : ils ont lancé la lamentable opération « cartes postales » envoyées au président (comme si la « votation citoyenne » ne suffisait pas !) et des actions purement symboliques devant le Sénat. Pour les militants et les travailleurs qui veulent réellement gagner sur cette question, il s’agit au contraire de tout faire pour imposer une manifestation nationale exigeant le retrait du projet de loi et une grève générale des postiers (cf. la contribution de la Tendance CLAIRE reproduite ci-dessous).
Sous la pression militante, le Comité national contre la privatisation de la poste appelle maintenant à une journée de manifestations décentralisées le 28 novembre et à une montée nationale à Paris mi-décembre. Il faut tout faire pour que ces manifestations soient effectivement préparées et réussies. Dans le même temps, la préparation de la grève reconductible des postiers avance, avec une motivation importante à la base. La journée de grève du 24 novembre sera sans nul doute un gros succès. Si la fédération CGT (premier syndicat à la Poste au niveau national) s’en tient pour le moment à une grève de 24 heures, SUD (2e syndicat au niveau national, 1er en région parisienne), la CFTC et FO au niveau national, SUD, FO, CFTC et CGT à Paris et l’intersyndicale du service des colis d’Île-de-France appellent à reconduire la grève après cette date jusqu’au retrait du projet de loi. Il est donc possible que les postiers s’engagent dans une épreuve de force décisive contre le gouvernement, avec le soutien massif de la population… Cela ouvrirait naturellement une tout autre situation sociale et politique…

Le scandale des suicides et de la souffrance au travail est d’autant plus explosif qu’il met en cause directement les rapports de production capitalistes
Au moment même où la question de la poste arrivait sur le devant de la scène, éclatait le scandale des suicides chez France Telecom, révélant la souffrance au travail qu’a provoqué la privatisation (préparée par un gouvernement PS en 1991 et achevée par le gouvernement Jospin-Buffet en 1997), il aurait pu servir lui aussi de catalyseur à une mobilisation sociale de grande ampleur si les directions syndicales et les réformistes l’avaient voulu. D’ailleurs, la direction de France Telecom a dû faire quelques gestes pour désamorcer tout risque d’explosion sociale dans cette entreprise qui reste une des plus grandes de France, avec 102 000 salariés (dont deux tiers sont encore fonctionnaires) : après avoir tenté de minimiser le problème du suicide au travail, elle a dû, sous la pression, faire quelques concessions et beaucoup de manœuvres. Elle a annoncé le gel des « mobilités forcées » (sauf pour les travailleurs des sites déjà vendus), la suspension des restructurations jusqu’à la fin de l’année et le recrutement de 380 salariés en CDI. Elle a aussi essayé de faire porter le chapeau aux cadres supérieurs, promis de revoir leurs méthodes et nommé pour cela un nouveau vice-président. Enfin, elle a lancé un questionnaire sur les conditions de travail, qui aurait été rempli massivement par les salariés. Tout cela n’aurait cependant pas suffi à endiguer le risque d’explosion ouvert par le scandale des 25 suicides depuis janvier 2008 si les directions syndicales n’avaient pas bloqué toute dynamique de lutte, préférant aller négocier des miettes pour se comporter en partenaires sociaux — et en l’occurrence en assistantes sociales — plutôt qu’en organisatrices de la lutte de classe.
C’est ainsi que le début d’incendie a été provisoirement circonscrit par des expédients, même s’il est clair qu’il repartira tôt ou tard avec d’autant plus de force. Mais la politique des directions syndicales et des réformistes est d’autant plus scandaleuse que le lien avec l’autre combat central du moment, la lutte contre la privatisation de la poste, était évident et pouvait donc entraîner une importante dynamique de lutte commune. De plus, le soutien de tous les travailleurs à ceux de France Telecom a été immédiat, tout simplement parce qu’ils se sont massivement reconnus dans la dénonciation publique de leurs conditions de travail, les suppressions de postes (22 000, soit près de 22%, entre 2006 et 2008), la mobilité forcée, l’intensification dramatique du travail.
En effet, si elle occupe aujourd’hui le devant de la scène sous sa forme mortelle, la plus spectaculaire, cette question de la souffrance au travail et du « stress » — euphémisme pour ne pas dire surexploitation — est extrêmement profonde : elle doit être centrale pour la lutte de classe et la défense d’une orientation anticapitaliste révolutionnaire. Comme le dit Bernard Salengro, médecin du travail et responsable de l’Observatoire du stress mis en place par la CFE-CGC en 2002, « le problème du stress met en question l’organisation du travail, les relations sociales, la hiérarchie, etc., qui constituent l’essence même du pouvoir de direction ». C’est en effet une méthode de management qui a été introduite dans les années 1980 et généralisée dans les années 1990 pour accroître l’intensité du travail. L’inventivité perfide du capitalisme a consisté à utiliser et détourner l’aspiration à l’autonomie des individus dans le travail qui, dans les années 1970, avait conduit à une forte mise en cause de la taylorisation et de la hiérarchie directe, en faisant prendre en charge par chaque individu sa propre surexploitation. C’est une sorte de retour au principe du salaire aux pièces sous une forme masquée. Le Monde du 22 octobre rappelle ainsi que Noël Goutard, patron de Valeo entre 1987 et 2000, exigeait une « implication du personnel » accrue comme l’un des principaux facteurs pour atteindre la baisse des coûts de 30% en deux ans (1992-1993) qu’il avait fixée ; et il ajoutait sans scrupule que « ceux qui n’étaient pas "formables" devaient partir ». Selon Thierry Weil, professeur à l’École des Mines de Paris, le « management par objectif », voire « par projet », consiste à « fixer des objectifs atteignables, mais suffisamment ambitieux pour que les gens se défoncent ».

Contre cette surexploitation, l’accord interprofessionnel signé en juillet 2008 par les « partenaires sociaux » n’est d’aucun secours, car il se borne à des vœux pieux et il n’a d’ailleurs été appliqué que dans un nombre infime d’entreprises. Ce n’est évidemment pas Xavier Darcos qui protègera les travailleurs : sa menace de… publier la « liste noire » des entreprises qui n’auraient pas ouvert des négociations pour appliquer cet accord d’ici février est d’autant plus hypocrite qu’il a lui-même supprimé 20 000 postes d’enseignants quand il était ministre de l’Éducation, accélérant la souffrance au travail des enseignants, parmi lesquels on compte l’un des plus grands nombres de dépressions et de suicides dus au travail. Mais les travailleurs ne peuvent pas compter non plus sur les réformistes et les bureaucrates syndicaux : pendant des années, ils ont complètement négligé cette question, empêchant toute réponse collective — c’est même l’un des facteurs de la crise du mouvement ouvrier. Et aujourd’hui ils prétendent pouvoir lutter contre la souffrance au travail en revendiquant quelques morceaux de sparadrap sur l’organisation capitaliste du travail ! Ils ne remettent pas en cause les objectifs mêmes de celle-ci, dont découlent pourtant rationnellement les mesures d’intensification — et ils ne mènent d’ailleurs même pas de luttes significatives pour en limiter les dégâts. Tout au contraire, les travailleurs ne doivent pas hésiter à se battre pour la baisse de l’intensité et de la durée du travail, l’embauche de travailleurs supplémentaires, l’organisation de vraies équipes de travail sans hiérarchie, le contrôle ouvrier sur les objectifs de production, la gestion ouvrière. Cela remet évidemment en cause le but et le cadre mêmes du capitalisme, qui ne peut pas être humanisé puisqu’il consiste précisément à déshumaniser le plus possible le travail pour faire un maximum de profit — même si les producteurs résistent toujours plus ou moins à son joug en tentant de garder une certaine maîtrise de leur métier, de leurs gestes et du sens social et individuel de ce qu’ils font.

La conflictualité sociale est moins visible et plus dispersée, mais reste importante et menaçante pour la bourgeoisie
Au-delà des grandes questions nationales, on remarque une myriade de luttes ouvrières dispersées dans tout le pays. Le Monde du 9 octobre parle lui-même de « centaines » de conflits sociaux en cours, y compris des grèves avec occupations d’usine. Un article de Rémi Barroux paru dans le même journal rend également compte d’une étude lucide de l’association Entreprise & Personnel, qui regroupe les dirigeants « ressources humaines » des plus grandes entreprises françaises, parue le 29 septembre sous le titre « Entre colères et fatalisme ». On y lit que « le climat social paraît relativement stable », car il n’y a pas de « collectivisation des actions », mais on constate en même temps « la dégradation des rapports sociaux dans la société elle-même, la montée des frustrations et des ressentiments ».
Cela entraîne d’abord un fort « sous-travail », sous la forme d’une montée de l’absentéisme et d’un « présentéisme contemplatif », c’est-à-dire d’une résistance individuelle d’une masse croissante de travailleurs contre les excès de l’exploitation et le manque de sens de leur travail. Mais surtout, selon cette étude décidément pertinente, il y a un risque que le leader du LKP, Élie Domota, ou le délégué des Continental, Xavier Mathieu, puissent « devenir pour certains des exemples ». Pour le moment, ce risque est certes limité à la fois par l’« activisme présidentiel » (dont nous verrons ci-dessous les limites) et par « la capacité de canaliser la colère » des syndicats, qui se livrent même à une « cogestion de la crise ». Mais il n’en reste pas moins que la « cohésion sociale » est menacée et que rôde notamment le spectre des émeutes des quartiers populaires de 2005 — d’autant plus, faut-il ajouter, que le licenciement des centaines de milliers d’intérimaires de l’industrie, souvent des jeunes de ces quartiers, augmente encore la possibilité d’une telle révolte.
De plus, l’étude souligne que, avec les premiers signes de reprise économique, la question salariale pourrait revenir sur le devant de la scène, devant celle de l’emploi. Les négociations salariales risquent d’être tendues, d’autant que la bourse a repris son envol et que les primes tombent pour les actionnaires, patrons et cadres supérieurs. Dès lors, « toute mesure pouvant susciter un sentiment d’injustice ou d’incompréhension pourrait servir de détonateur à un conflit ». C’est ce que confirme une étude Viavoice réalisée pour la FSU du 9 au 12 septembre, qui montre que la première raison pour laquelle les Français « seraient prêts à se mobiliser » est celle des salaires. Un quart serait prêt à participer à « au moins un mode d’action », 12% des salariés parlent de grève, 19% dans le public.
De son coté, le médiateur de la République, Jean-Paul Delevoye, tire un signal d’alarme dans Le Monde du 22 octobre pour alerter le gouvernement sur les effets explosifs de l’augmentation des souffrances sociales en général, mais aussi de la violence. « Le sentiment d’injustice chez nos concitoyens, écrit-il, m’inquiète par son ampleur, son intensité, son mode d’expression autant que par les réactions et les actions qu’il déclenche. » Selon lui, ce sentiment ne concerne plus seulement les plus pauvres, mais gagne jusqu’aux classes moyennes, voire supérieures. De plus, chez les plus démunis, avec la crise, « la violence de ces situations engendre la violence des réactions. Le recours à la violence physique et psychologique, ayant prouvé son efficacité, se systématise : séquestrer un patron est l’assurance de voir les caméras arriver, le débat porté sur la place publique, l’opinion sensibilisée, l’action publique déclenchée ». Or cela « fragilise le pacte social qui veut que la République protège le plus faible du plus fort et assure les conditions premières du vivre ensemble. Si les membres de la société ne croient plus en leurs institutions et leurs représentants, ils envisagent alors de faire respecter eux-mêmes leurs droits ou se tournent vers d’autres aux discours séducteurs. Lorsque je ne crois plus à la force du droit, je revendique le droit de la force. Je n’ai pas le droit de séquestrer mon patron. Oui, mais j’ai le droit de nourrir ma famille. Je n’ai pas le droit de conduire sans permis. Oui, mais j’ai le droit d’aller travailler pour gagner ma vie. L’apparition de certaines officines proposant des formations à la désobéissance civile et gangrenant certains professions n’a rien de rassurant. Que penser alors de la crainte des responsables syndicaux et associatifs d’être bientôt dépassés par leur base ? » Là encore, nous avons affaire au constat lucide d’un tenant de l’ordre bourgeois qui s’inquiète pour sa pérennité. D’ailleurs, les réformes institutionnelles qu’il propose ensuite sont tellement risibles qu’il semble faire partie lui-même de ceux qu’il décrit comme doutant des institutions ! Il se contente de demander des nouvelles structures et une attitude générale des institutions pour permettre… une plus grande « écoute des citoyens », un plus grand « respect de l’individu », plus de « dialogue » et autres fadaises contradictoires avec le capitalisme. Mais il n’en a pas moins conscience de leur fonction : « Notre société a besoin de soupapes de décompression pour endiguer cette violence physique et psychologique née du sentiment d’injustice. » Autant dire que, pour les révolutionnaires, la situation ainsi décrite n’appelle aucune décompression, mais au contraire la libération de toute l’énergie contenue dans la colère ouvrière et populaire et sa concentration contre le pouvoir du capital et de l’État.
Enfin, au-delà des signes de la conflictualité actuelle et à venir, au-delà du sentiment d’injustice, on constate le progrès d’un anticapitalisme diffus et plus ou moins aigu. Il s’explique par la force historique du mouvement ouvrier en France, malgré ses directions réformistes et sa décomposition actuelle, par les grands mouvements sociaux depuis 1995, malgré leur caractère défensif, par l’influence croissante des organisations d’extrême gauche ces dernières années, mais plus encore par le développement de la crise en cours. Le Monde du 21 octobre cite ainsi un sondage Euro RSCG C & O montrant que la façon dont les Français comprennent la crise est très différente de celle des Britanniques ou des États-uniens. Alors même que leur consommation a globalement bien résisté, puisqu’elle ne baisse que dans les deux ou trois derniers mois, 62% des Français choisissent l’image de la pauvreté pour désigner la crise, contre 11% des Britanniques et 19% des Américains, dont le pouvoir d’achat a pourtant été beaucoup plus affecté. De plus, 71% estiment que les jeunes sont les plus touchés, contre 28% et 27% des Britanniques et des États-uniens. Et surtout, les Français estiment à 37% qu’il s’agit d’une crise du capitalisme et à 21% d’une crise de la société, alors que pour 56% des Britanniques et 54% des États-uniens, c’est une crise financière…
Mises bout à bout, on constate donc que bien des analyses lucides de la bourgeoisie établissent elles-mêmes que les conditions pour la mise en avant d’une orientation anticapitaliste cohérente et conséquente, n’hésitant pas à articuler les luttes immédiates à l’objectif d’en finir avec ce système, avancent chaque jour davantage. Réciproquement, une telle orientation contribuerait à accélérer la maturation de la conscience anticapitaliste des travailleurs et par là même à dynamiser les luttes.
Les ingrédients d’une crise gouvernementale s’accumulent
Si un nouveau cycle de luttes majeures s’ouvrait, la situation politique serait particulièrement propice pour un affrontement décisif avec le gouvernement. En effet, les ingrédients pour une crise gouvernementale se sont accumulés depuis la rentrée à une vitesse accélérée. Des scandales éthiques et démocratiques ont été soulevés par les propos racistes du ministre Hortefeux, les révélations sur l’exploitation sexuelle pratiquée par Frédéric Mitterrand, l’affaire de népotisme en faveur de Jean Sarkozy ou les méandres nauséabonds de l’affaire Clearsteam passée au crible du tribunal.
De plus, les opérations de communication qui avaient fait le succès du président sont discréditées les unes après les autres, du choix d’ouvrières de petite taille pour poser derrière le président en Normandie au refus de celui-ci d’aller rencontrer les ouvriers de Gandrange en Moselle pour s’expliquer sur ses promesses non tenues, en passant par le coût astronomique de la visite à l’hôpital de Villejuif…
En outre, la fronde des élus UMP, de la base au sommet, se fait de plus en plus forte à l’approche des régionales : refus massif du projet de réforme de l’administration territoriale, notamment du nombre et du mode d’élection des élus, résistance contre la suppression de la taxe professionnelle (un temps relayée avec virulence par Juppé lui-même), plus désormais toute une polémique, emmenée par l’ancien Premier ministre Raffarin, sur le montant de l’emprunt que l’État voudrait concocter pour renflouer ses caisses vidées par les cadeaux colossaux offerts aux riches contribuables, aux banques et aux trusts de l’automobile.
Enfin, la remontée des chiffres de la délinquance affaiblit le crédit de Sarkozy aux yeux de son électorat et surtout de celui qu’il avait gagné au FN, avec un fort risque de remontée de l’extrême droite aux régionales. De ce point de vue, les mesures particulièrement ignobles que sont la fermeture des zones de transit pour les migrants à Calais, l’expulsion des sans-papiers afghans ou l’ouverture du prétendu débat sur l’« identité nationale » ne sont que des manœuvres pour tenter de regagner la confiance de la fraction xénophobe et réactionnaire de la population, qui croît avec la crise.
Bref, comme le note Arnaud Leparmentier dans Le Monde du 9 octobre, « à mi-mandat, la méthode de Nicolas Sarkozy s’essouffle » et, si des voix s’élèvent pour changer le Premier ministre, tout le monde est bien conscient que cela ne suffirait pas à relancer un président dont la méthode a précisément consisté à concentrer sur sa personne le feu des caméras, la réalité du pouvoir gouvernemental, mais aussi par là même les risques d’être la principale cible d’une explosion de colère des travailleurs.
Enfin, Sarkozy ne peut même plus redorer son blason en se prévalant de succès internationaux comparables à ceux qu’il avait revendiqués lorsqu’il présidait l’Union européenne ou lors du G 20 l’an passé, où il avait dit vouloir moraliser le capitalisme et supprimer les paradis fiscaux, tout en faisant croire qu’il avait réussi à faire évoluer Obama lui-même… Aujourd’hui, au contraire, les États-Unis laissent Sarkozy à la juste place qui revient au chef médiocre d’un impérialisme de second rang, en bloquant la négociation sur le climat — alors que Sarkozy voulait passer pour un champion mondial de l’écologie — et en snobant le président français, comme l’a fait Obama lors du sommet de Pittsburgh…

Quant au chef de la Commission européenne, Manuel Barroso, il menace la France de sanctions en raison de ses déficits publics particulièrement importants : acceptés l’an passé par toutes les bourgeoisies pour sauver le système bancaire et financier, ils sont jugés dangereusement élevés en France car ils atteignent 8,2% du PIB, certes inférieurs à des pays beaucoup plus durement touchés par la crise comme le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Espagne et la Grèce, mais nettement supérieurs à ceux de l’Italie (5,3) et surtout de l’Allemagne (3,7). Or le bouclier fiscal et le fléchissement de la consommation depuis juillet empêchent d’augmenter les recettes. Le gouvernement doit donc avant tout limiter les dépenses et préparer un « grand emprunt », mais il n’a aucune stratégie de sortie de crise, contrairement à ses homologues européens, qui présentent des plans rigoureux. Dans les rangs de l’UMP et dans la presse pro-UE, notamment Le Monde, on critique l’excès du déficit et on presse Sarkozy d’agir, alors que lui ne voudrait pas avoir à revenir aux critères de Maastricht avant 2012, à la fois parce que la croissance ne peut revenir avant 2011 au mieux et parce que cela pourrait lui coûter sa réélection. Du coup, Barroso accuse la France (ainsi que l’Allemagne) de « nationalisme économique », contraire aux règles de la concurrence européenne, et menace la France de sanctions, tout en n’osant pas aller très loin sous peine d’affaiblir Sarkozy, ce qui aurait des effets dangereux à la fois en France et dans le rapport de force international entre les pays de l’UE et les États-Unis.
Il est donc clair que les conditions d’une crise politique s’accumulent parallèlement à celles, moins visibles mais plus profondes, d’une explosion sociale. Sous l’atonie apparente du champ social, la vieille taupe révolutionnaire s’est mise à creuser de plus belle…