Agenda militant
Ailleurs sur le Web
![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)
- Où va l’impérialisme allemand ? (05/01)
- L’économie mondiale en 2025 : année folle ou année tiède ? Par Michael Roberts (05/01)
- Ukraine : emprunter le douloureux chemin vers la paix (05/01)
- Où en sont les « socialistes » aux États-Unis ? (05/01)
- Pour gagner, la gauche doit-elle en revenir aux partis de masse ? (05/01)
- Narcotrafic : Darmanin et Delogu ne peuvent pas SE SNIFFER (05/01)
- Alma Dufour sur France Info (05/01)
- Diyarbakır : reconstruire une municipalité en ruines (28/12)
- Le marxisme aux paysans (28/12)
- Aux origines du socialisme japonais (28/12)
- Sauvons Kobané, sauvons le Rojava ! (28/12)
- Quelles perspectives pour les Kurdes au Moyen-Orient ? (27/12)
- Cuba : le mouvement du social (27/12)
- Procès de Georges Ibrahim Abdallah : la victoire est-elle proche ? (26/12)
- Île Maurice : la volonté de changement (26/12)
- Le socialisme dans un seul pays (26/12)
- Quel avenir pour la France insoumise ? (26/12)
- Les changements tectoniques dans les relations mondiales provoquent des explosions volcaniques (26/12)
- Un nouveau château de cartes (26/12)
- Le syndicalisme de Charles Piaget (26/12)
- Nabil Salih, Retour à Bagdad (26/12)
- La Syrie est-elle entre les mains d’Erdoğan ? (26/12)
- L’UE encourage l’exploitation du lithium en Serbie avec un grand cynisme (26/12)
- Le contrôle territorial d’Israël s’étend-il vers la Syrie ? (26/12)
- Scrutin TPE – Très Petite Élection (26/12)
« Identité nationale »… ou racisme d’État ?
« Il est temps qu’on réagisse parce qu’on va se faire bouffer », « y en a déjà dix millions » ; ainsi s’exprimait début décembre le maire UMP de Gussainville (Meuse), André Valentin. Le « débat sur l’identité nationale » sert à ça : diviser, susciter la peur et la haine, déjouer et briser les solidarités, raffermir la fameuse « cohésion » sociale et nationale sur la base du rejet de l’étranger. Or un tel débat, pas plus que la création du « ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire » en mai 2007, n’ont surgi ex nihilo tels des objets politiques non identifiés. Ce sont des traductions institution-nelles d’une xénophobie structurelle à la république bourgeoise, d’un véritable racisme d’État (1).
Tout a été dit sur le fait que ce débat est organisé dans un contexte pré-électoral, avec l’objectif, parfois ouvertement affiché par le gouvernement, de reconquérir le terrain perdu sur le Front national — Martin Hirsch a ainsi affirmé qu’il s’agissait d’une opération « 100 % politique ». Mais au-delà, c’est aussi une façon de faire diversion pour éviter que la colère populaire ne se concentre sur les contre-réformes destructrices et la situation socioéconomique difficile voire dramatique d’un nombre toujours croissant de travailleurs et de jeunes. C’est en outre l’occasion d’utiliser le bon vieux mais toujours efficace stratagème du « diviser pour mieux régner », en pointant du doigt un « autre » (étranger, enfant d’étranger, descendant d’étranger, mais toujours Étranger) qu’il s’agit de stigmatiser pour mieux faire oublier la source de toute véritable oppression, l’hégémonie économi-que, sociale et politique d’une classe dominante et exploiteuse.
Le ministre Éric Besson, familier des rafles et des expulsions, contempteur des « mariages gris », a proposé sa propre définition de « l’identité nationale » : « la foi en l’émancipation des peuples, l’idée républicaine d’un citoyen éclairé, cartésien, qui a le culte de la république et est attaché aux trois valeurs de notre devise : liberté, égalité, fraternité ». Cet article entend contribuer à montrer combien l’emploi de ces termes, dans la bouche et sous la plume des représentants de l’État bourgeois, n’est rien de moins qu’ignominieux par son hypocrisie.
Le racisme au sommet de l’État
Quelle France ?
« De race blanche, de culture gréco-latine et de religion chrétienne » (De Gaulle)

Le débat sur l’identité nationale lancé par le pouvoir puise son idéologie dans un vieux fonds moralo-chrétien que l’État français n’a cessé d’entretenir, malgré les avancées de la laïcité, exprimant de manière plus ou moins sous-jacente, le rejet de l’autre, du non-Blanc et du non-chrétien, comme envahisseur. Avide de soutenir le président et son propre gouvernement aux abois face aux critiques, le premier ministre François Fillon a récemment prétendu que le débat était nécessaire en revendiquant pour la France « un vieil héritage chrétien qui ne saurait être ignoré par les autres religions installées plus récemment sur notre sol ». Fillon n’a fait là que reprendre ce qu’avait déclaré Sarkozy, peu de temps auparavant, dans un discours prononcé le 12 novembre à La Chapelle en Vercors — la France est avant tout chrétienne —, comme il l’avait fait en allant rendre visite au pape : « On est Français parce qu’on regarde la chrétienté et les lumières comme deux versants d’une même civilisation », avait-il asséné. Tous deux s’inscrivent eux-mêmes dans un sillon que de Gaulle contribua, avec d’autres, à tracer : la France ne peut être que « de race blanche, de culture gréco-latine et de religion chrétienne » (2).
Cette vision ethniciste explique les plus offensives des déclarations racistes de la part des chefs d’État qui se sont succédé à la tête de la Cinquième République. À commencer par De Gaulle lui-même, dont le racisme ne s’exprimait certes pas en public mais éclatait en privé, comme en témoignent les propos que lui a prêtés son conseiller Jacques Foccart : « Vous savez, cela suffit comme cela avec vos nègres […] il y a des nègres tous les jours à l’Elysée, vous me les faites recevoir, vous me les faites inviter à déjeuner. Je suis entouré de nègres ici. […] Foutez-moi la paix avec vos nègres (3). » On connaît aussi la sortie immonde de Jacques Chirac, le 19 juin 1991 : « Notre problème, ce n’est pas les étrangers, c’est qu’il y a overdose. C’est peut-être vrai qu’il n’y a pas plus d’étrangers qu’avant la guerre, mais ce n’est pas les mêmes et ça fait une différence. Il est certain que d’avoir des Espagnols, des Polonais et des Portugais travaillant chez nous ça pose moins de problèmes que d’avoir des musulmans et des Noirs […] Comment voulez-vous que le travailleur français qui travaille avec sa femme et qui, ensemble, gagnent environ quinze mille francs, et qui voit sur le palier à côté de son HLM, entassée avec un père de famille, trois ou quatre épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne cinquante mille francs de prestations sociales sans naturellement travailler… Si vous ajoutez à cela le bruit et l’odeur, eh bien le travailleur français sur le palier il devient fou. Et ce n’est pas être raciste que de dire cela ». Sarkozy joue parfaitement de cette odieuse partition lorsqu’il multiplie les déclarations en ce sens. Lorsque, ministre de l’intérieur, il présente son projet de loi sur la délinquance des mineurs, il affirme : « Les mineurs de 1945 n’ont rien à voir avec les géants noirs des banlieues d’aujourd’hui, qui ont moins de 18 ans et qui font peur à tout le monde (4). » On se souvient également du discours tenu à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, le 26 juillet 2007 : « Le drame de l’Afrique, c’est que l’homme africain n’est pas assez entré dans l’Histoire. […] Jamais l’homme ne s’élance vers l’avenir. Jamais il ne lui vient à l’idée de sortir de la répétition pour s’inventer un destin. »

À l’occasion de la votation suisse qui, le 29 novembre, a statué sur l’interdiction de construire de nouveaux minarets, Sarkozy se « lâche » une fois de plus dans une tribune publiée dans Le Monde du 8 décembre 2009. Il s’autorise à faire un parallèle entre le vote ignominieux d’une partie des Suisses contre les minarets et des « préoccupations » qui selon lui seraient « largement partagées en France ». Il se souvient, en ces veilles d’élections, que ce fut, avec la sécurité, son fond de commerce lors de la présidentielle. Ce faisant, il justifie cette idée méprisable et invite l’opinion publique à s’inscrire dans ses dérives racistes donc à stigmatiser, discriminer ceux qui ne portent pas le christianisme en sautoir ou pratiquent une culture différente de la référence occidentale. Moralisateur, il proclame : « Au lieu de condamner sans appel le peuple suisse, essayons aussi de comprendre ce qu’il a voulu exprimer et ce que ressentent tant de peuples en Europe, y compris le peuple français », qui « sont accueillants, sont tolérants mais ne veulent pas que leur cadre de vie, leur mode de pensée et de relations sociales soient dénaturés ». Cette stigma-tisation est une véritable « fatwa » lancée à l’encontre du monde arabo-musulman. Pour tenter de masquer son racisme nauséabond, Sarkozy recourt au traditionnel paternalisme colonial puisqu’il assure aux Français musulmans qu’il fera « tout pour qu’ils se sentent des citoyens comme les autres ». Mais, dans le même temps, le chanoine de Latran avertit que « dans notre pays où la civilisation chrétienne a laissé une trace aussi profonde [...] tout ce qui pourrait apparaître comme un défi lancé à cet héritage et à ces valeurs condamnerait à l’échec l’instauration si nécessaire d’un islam de France ».
Le débat sur l’identité nationale et le vote suisse ont ainsi ouvert une brèche dans laquelle se sont engouffrés bon nombre de politiciens, s’en servant comme d’un défouloir à leur propre xénophobie, camouflée derrière le cache-sexe de l’anti-islamisme. Le maire de Nice et ministre de l’industrie Christian Estrosi a proclamé : « Il n’y aura pas de minaret à Nice ; il n’appartient pas à l’architecture française ». La présidente du Parti chrétien démocrate Christine Boutin a de son côté renchéri : « Les minarets symbolisent la terre d’islam et la France n’est pas une terre d’islam ».
Oppression et intégration, oppression de l’intégration
Mais xénophobie et racisme ne sont pas propres à ce gouvernement en particulier, lequel ne fait que pousser d’un cran les politiques menées par la droite comme la « gauche » depuis des décennies : oppression et ségrégation à l’égard des peuples colonisés, dévalorisation systématique des immigrés, surveillance et violence policières, fermeture des frontières, « immigration choisie », rejets sans cesse croissants des demandes d’asile et de regroupements familiaux, placements en rétention de catégories toujours plus nombreuses (familles et enfants), expulsions par charters, traque des sans-papiers, criminalisation des actes de solidarité, etc. Toute une pratique politique, incluant discours et actes, vise à faire croire qu’au non-Français « de souche » — l’expression étant elle-même des plus incongrues au vu de la diversité des origines composant la « population française » — sont nécessairement et par essence associées des différences irréductibles : charge économique et délinquance, combattue avec des moyens de flicage et de répression dignes d’une guerre civile — quadrillage, couvre-feu, appels à la délation, dispersions, tabassages, « bavures » policières (5)…
Le gros mot d’« intégration » n’est rien d’autre que cette stigmatisation elle-même, en ce qu’il a pour but d’assigner à ces « autres » un statut, une différence de nature, une extériorité. Cette politique « d’intégration » a été régulièrement brandie par l’État depuis plusieurs dizaines d’années. L’un de ses principaux acteurs a été François Mitterrand qui, lorsqu’il était ministre de l’intérieur, prônait en 1954 la « politique d’intégration du gouvernement » tandis qu’il se joignait à la répression colonialiste aussi bien en Algérie qu’ailleurs dans l’« Empire français » ; trente ans plus tard, il évoquait « un certain type de caractère, une forme d’intelligence, une marque de culture que chacun dans le monde peut appeler français sans crainte de se tromper » tout en mettant en place, en 1989, un Haut Conseil à l’Intégration (6). Ainsi dans les années 1990 les associations devaient-elles, pour obtenir des subventions de la part du Fonds d’action sociale, faire figurer le terme d’« intégration » dans leur statuts ou dans leur charte… Au cœur du mot « intégration » se niche en fait l’exigence d’être discret, invisible, de ne pas se faire remarquer, en somme une assignation à la non-politisation. La logique de l’« intégration » somme de choisir la culture dominante (7). Elle est une injonction à faire plus et mieux que les autres pour « mériter » sa place. Dans sa condescendance, elle classe ses archétypes de prédilection, le « bon Noir », la « beurette » ou le « musulman laïc », censés démontrer leur « adaptabilité ». Elle perpétue de la sorte les stéréotypes pour mieux entériner les stigmates et les repoussoirs, tels la femme voilée, nécessairement passive, soumise et à civiliser, ou le « garçon arabe » — « sauvageon » ou « racaille » —, nécessairement violent, voleur, violeur, voileur (8) et incivilisable. Ces figures, érigées en ennemis de l’intérieur, démontrent dans le même mouvement la proximité du racisme et du sexisme : en portant l’accent sur la musulmane voilée comme victime absolue de l’oppression des femmes, l’État bourgeois en exonère les Français « de souche » et en vient à relativiser la généralité de cette oppression (9).

Racisme institutionnel et discriminations légales
Discriminations sur le marché du travail
Certes, officiellement, le racisme est banni des politiques d’État. Un conformisme bienséant l’empêche de s’exprimer ouvertement. Certes encore, le racisme né de théories biologisantes, au XIXe siècle, est tout aussi officiellement rejeté. Il l’est cependant au profit d’un racisme culturaliste qui ne dit pas son nom mais trouve son expression dans une politique de discrimination systématique, en toute légalité. Qu’il s’agisse là d’un racisme post-colonial s’indique dans le fait que l’expression « immigrés de la 2e ou 3e génération » s’applique avant tout aux enfants d’immigrés maghrébins ou africains, évidemment guère aux Européens. Au-delà, les interdits anti-étrangers sont inscrits directement dans la loi « républicaine » française, à commencer par la discrimination sur le marché du travail (10).
Le nombre de postes statutairement fermés aux étrangers — non ressortissants de l’Union européenne — n’a en effet pas cessé d’augmenter ; il s’élève aujourd’hui à 7 millions, ce qui représente un tiers des emplois disponibles. Il s’agit d’abord des postes de la Fonction publique, auxquels les personnes qui ne sont pas membres de l’UE ne peuvent avoir accès soit 5,2 millions d’emplois dans les trois fonctions publiques (d’État, territoriale et hospitalière) ; cela n’empêche nullement l’État d’avoir recours dans ces services à des étrangers contractuels ou auxiliaires, dès lors sous-payés et surexploités, au summum du cynisme propre à l’État capitaliste. Viennent ensuite les emplois des entreprises sous statut gérant des services publics, des établissements publics industriels et commerciaux : encore plus d’un million d’emplois. Enfin, les non-ressortissants de l’UE sont proscrits, de par la loi, d’une cinquantaine de métiers dans le secteur privé, telles les professions de médecins, de chirurgiens, de sages-femmes et de vétérinaires, de géomètres et d’architectes, d’experts-comptables, et toutes les professions juridiques, soit plus de 600 000 emplois. Cette liste date des années 1930 et avait été à l’époque justifiée par des besoins dits « de moralité publique », de dévouement des « nationaux » supposé plus élevé, en bref de réflexes corporatistes qui ont donc toujours cours aujourd’hui.
Ces discriminations ne touchent réglementairement que les « étrangers » au sens civil du terme, ceux qui n’ont pas la nationalité française. Mais elles encouragent et légitiment d’autres types de discriminations, officiellement illégales quant à elles mais plus que tolérées par la République bourgeoise. Celles-ci s’adressent à toute personne, française ou non qu’importe, dont la couleur est trop foncée ou le nom trop compliqué. Dans cette veine, le code BBR (pour bleu blanc rouge) sert aux agences d’intérim pour signifier que leurs entreprises clientes ne veulent pas d’autres employés que des Français blancs. À qualification égale, un jeune Français d’origine maghré-bine a cinq fois moins de chances d’obtenir un emploi qu’un jeune Français blanc de peau (11). Et la justice « républicaine » n’est pas prompte à punir ces discriminations « illéga-les » : on recense en moyenne chaque année de zéro à trois condamnations pour discrimina-tions à l’embauche (12).
Ghettoïsation et stigmatisa-tion dans l’attribution des logements sociaux
Un « racisme institutionnel » s’opère tout autant dans les attributions de logements sociaux. Des politiques de quotas, demeurées secrètes et informelles, se traduisent par des recomman-dations en termes de populations étrangères (ou supposées telles) considérées comme indésirables dans certains immeubles (13). « De façon générale, le locataire “normal”, désirable, appartient de toute évidence à la majorité ethnique : il est présent, dans le discours des acteurs, sous les expressions “Français de souche”, “parfaits Français”, ou encore “salarié lambda, très européanisé”. […] C’est ensuite au nom de ces barrières culturelles que sont légitimées différentes pratiques de gestion des “équilibres”. D’une part, des limites sont fixées à l’accueil de certains groupes ethniques sur certains ensembles ou cages d’escalier, au nom du respect d’un supposé “seuil de tolérance”. D’autre part, est organisée la concentration de certains groupes ethniques sur certains territoires, afin d’éviter de disséminer des populations labellisées “à risques” dans l’ensemble du parc (14) ». La discrimination ethnique et le marquage social fonctionnent ainsi à plein dans le secteur du logement social. Lorsqu’ils obtiennent une réponse favorable, 28 % des ménages immigrés ont déposé leur demande depuis au moins trois ans, soit près de deux fois plus que pour l’ensemble de la population en attente. Les ménages immigrés sont en outre contraints d’accepter des logements dans le parc social le plus ancien : 75% vivent dans des immeubles construits avant 1975 (15).

La longue histoire du racisme « républicain »
Le racisme comme composante historique de l’État bourgeois
Ce racisme institutionnalisé s’inscrit dans une histoire longue de plusieurs siècles. Le Code Noir de 1685, édicté par Colbert, a constitué l’une de ses racines étatiques. Légalisant la négation du droit des « Noirs », il a permis d’asseoir le socle raciste de l’État qui perdure après avoir été adapté aux besoins de l’évolution de la société capitaliste. Si, dans l’esprit, il a pu se perpétuer, c’est que, depuis, rares sont les intellectuels ou dirigeants politiques qui l’ont remis en question ; l’écrasante majorité a préféré « souffler la lampe, afin de se coucher dans les ténèbres » (Baudelaire). Aujourd’hui comme hier, c’est toujours sur ce support qu’est étayée la politique nationale et internationale française. Tout au long de ces quatre siècles, il a fallu la crédibiliser afin de permettre la constitution de la société esclavagiste dont le capitalisme naissant a été le fondement. Le discours religieux et les intellectuels en ont été les piliers permettant au racisme de devenir l’outil idéal de l’exploitation.
Il faut souligner en effet que ce racisme n’est pas accidentel, mais structurel. Ce n’est certes pas une spécificité du capitalisme : le racisme se rencontre dans toutes les sociétés connues antérieures à lui. Mais il constitue une composante de l’État bourgeois, quelles que soient les formes qu’il a revêtues depuis plusieurs siècles : monarchie, empire ou république. Plus encore, c’est bien la République bourgeoise qui s’avère directement raciste depuis ses origines et en ses bases mêmes. L’historien Gilles Manceron a pu parler à ce sujet d’un « paradoxe républicain (16) » : car la République n’a eu de cesse de brandir les « droits de l’homme » pour les bafouer, d’utiliser ce prétexte — répandre son universalisme sur la Terre entière — pour coloniser, asservir, exploiter, discriminer. Les droits de l’homme de la République n’ont été longtemps rien d’autre que les droits de l’homme blanc. Pendant des décennies, les peuples colonisés n’ont jamais été considérés comme des hommes à part entière, c’est-à-dire, dans le vocabulaire républicain, comme des « citoyens », mais comme des « indigènes », « sujets » ou « protégés » de la France et, à ce titre, privés de droits. Sartre avait raison d’ironiser dans sa préface aux Damnés de la terre de Frantz Fanon : « la Terre comptait deux milliards d’habitants, soit cinq cent millions d’hommes et un milliard cinq cent millions d’indigènes » ; il avait raison de dire qu’il s’agissait d’appliquer « au genre humain un numerus clausus ».
C’est à partir des années 1880 que s’est ouverte pour les puissances impérialistes européennes la phase de plus grande expansion coloniale. En France, ce fut donc sous la Troisième République. Or cette République bourgeoise a institué, dès ses commencements, un racisme officiel fondé sur la croyance en l’inégalité et la hiérarchie des races : « Une race de travailleurs de la terre, c’est le nègre : soyez pour lui bon et humain, et tout sera dans l’ordre ; une race de maîtres et de soldats, c’est la race européenne. Que chacun fasse ce pour quoi il est fait et tout ira bien (17) », écrivait en 1871 l’historien et penseur de la République Ernest Renan. Les pères fondateurs de la Troisième République ont laissé à cet égard un héritage décisif. C’est le cas de Gambetta ou de Ferry qui, tous deux et parmi d’autres du même acabit républicain, proclamaient le « droit des races supérieures vis-à-vis des races inférieures ». Elles sont de Jules Ferry, ces sentences d’un racisme pourri de morgue : « Si nous avons le droit d’aller chez les barbares, c’est parce que nous avons le devoir de les civiliser […] ; il faut non pas les traiter en égaux, mais se placer du point de vue d’une race supérieure qui conquiert (18) ».
Pour mieux justifier auprès de l’opinion publique la nécessité de se tailler un Empire, d’y surexploiter la main-d’œuvre et d’y réaliser de juteux profits, la bourgeoisie républicaine a eu recours à une véritable fabrique du « sauvage ». Mise en scène, jeu sur les émotions, la peur, la terreur, tout a été bon pour présenter les peuples colonisés comme des sous-hommes proches de l’animalité. C’est ainsi qu’ont vu le jour, dans les années 1880-1890 et jusqu’aux années 1930 incluses, de véritables zoos humains où étaient exhibés, à la manière d’animaux en cage, des « spécimens » indigènes que l’on avait forcés à revêtir des tenues « barbares » ou à rester demi-nus, conformément à l’image qu’il s’agissait de véhiculer (19). Les manuels scolaires officiels de la République ont propagé d’abondance les plus infâmes clichés ; ainsi, entre cent exemples, celui de Dupuis, quinze fois réédité à partir de la Première Guerre mondiale : « Les races qui peuplent la Mélanésie […] sont des nègres, dont quelques-uns, tels les anciens habitants de l’Australie, sont affreusement laids ; ils habitent des cabanes infectes et sont pour la plupart lâches, poltrons et traîtres (20). »
L’horreur colonialiste et son accompagnement raciste
Ce rejet dans l’altérité et dans la sous-humanité a aussi permis que s’accomplissent les pires horreurs, massacres, tortures, destructions, mises au pas, assujettissement, le plus souvent au nom de l’universalité républicaine, de sa défense et de sa nécessaire extension. L’extermination des indigènes a même constitué « un acte de purification » pour certains colonisateurs. L’appropriation des terres par les colons était de la même manière légitimée par cette déshumanisation des colonisés, censés ne pas avoir « le désir de maintenir le bien commun et la propriété » et ne pas comprendre l’obéissance à une loi extérieure (21). C’est ainsi que le droit républicain a institutionnalisé la spoliation des indigènes — par exemple, en 1871, le Parlement français concède cent mille hectares de terres aux colons d’Algérie sans jamais mentionner les Algériens qui y vivent (22). À la même période, le Parlement décrète l’appropriation par la France de vastes espaces en Nouvelle-Calédonie pour en faire un domaine pénitentiaire et des terres cultivables pour les colons, tout en mettant en œuvre une politique de cantonnement des habitants dans des réserves, très comparables aux réserves indiennes d’Amérique du Nord. L’ensemble se condense dans le Code de l’indigénat promulgué en 1881, qui confirme et officialise les pénalités et sanctions particulières pour les autochtones et organise la dépossession continue de leurs terres.

Cette politique se perpétue durant plusieurs décennies. Sous le Front populaire, aucune avancée ne peut être constatée ; un unique projet, le plan Blum-Viollette, qui prévoyait l’accession de 60 000 Algériens (sur près de 8 millions !) à la citoyenneté française, est retiré par le gouvernement, du fait de l’opposition des députés français d’Algérie et de l’Association des maires d’Algérie. Nommé sous-secrétaire d’État chargé des services de l’immigration et des étrangers, en 1938, le géographe et « expert » Georges Mauco n’a cessé de diffuser, dans la dernière décennie de la Troisième République, des thèses validées au sommet de l’État : défense des caractéristiques françaises (« raison, esprit de finesse, prudence, sens de la mesure ») contre « l’abâtardis-sement » de la population française, préservation de « l’avenir de la race » (23). Pareilles expertises ne s’arrêtent pas avec le premier XXe siècle, elles se poursuivent et continuent à recevoir validation des autorités étatiques après la Seconde Guerre mondiale, telles celles de Robert Debré et Alfred Sauvy, directeur de l’INED depuis sa fondation en octobre 1945, invitant à tout faire pour « garder au caractère français ses meilleures qualités (24) ». C’est au nom de ces théories racialistes pseudo-scientifiques, mais en réalité, plus fondamentalement, pour la préservation des intérêts les plus sordides de l’impérialisme français, que se justifient, aux yeux de l’État, les pires massacres : la répression du mouvement de révolte algérien en mai 1945, qui fait entre 15 000 et 50 000 victimes, celle de l’insurrection malgache en 1947 — villages incendiés et rasés, exécutions sommaires, prisonniers chargés en avion puis lâchés vivants au-dessus de villages insurgés, tortures : au total environ 80 000 morts (25) —, enfin ce même emploi systématique de la torture, des exécutions sommaires et des destructions de villages entiers lors de la guerre d’Algérie.
Racisme et chauvinisme criminels du stalinisme et de la social-démocratie
Le soutien du PCF et de la SFIO aux crimes colonialistes
Or ces monstrueuses pratiques ont été l’œuvre non seulement de gouvernements « républicains », mais en leur sein de dirigeants prétendument « socialistes » et « communistes » : sous les gouvern-ements « tripartites » composés de ministres PCF, SFIO et MRP entre 1945 et 1947, sous la présidence d’un dirigeant SFIO, Vincent Auriol, jusqu’en 1954, et sous le gouvernement du « socialiste » Guy Mollet en 1956-57.

Il y a lieu de souligner tout particulièrement l’attitude criminelle du Parti communiste français, détournant la lutte de classe internationaliste au profit d’un soutien chauvin à la grande nation française — le tournant date de la stratégie de front populaire, décidée par Staline en 1934. Dans les pires moments de la répression colonialiste, la position du PCF a été à la défense de la République bourgeoise et de l’Empire français. En mai 1945, L’Humanité invente de toutes pièces un rôle joué par les fonctionnaires de Vichy dans le soulèvement des Algériens pour justifier son écrasement (26). Un mois plus tard à peine a lieu le Congrès du PCF ; le représentant du Parti communiste algérien, Caballero, y affirme : « Ceux qui réclament l’indépendance de l’Algérie sont des agents conscients ou inconscients d’un autre impérialisme. Nous ne voulons pas changer un cheval borgne pour un cheval aveugle. » Et les congressistes applaudissent. Maurice Thorez affirme alors que les populations d’Afrique du Nord « savent que leur intérêt est dans l’union avec le peuple de France (27) ». À la fin des années 1940, le parti communiste condamne « la pseudo-indépendance qui ne pourrait que renforcer l’impérialisme américain (28) ». Après les dizaines de milliers de victimes de Madagascar, en 1947, le dirigeant communiste Georges Cogniot, dans L’Humanité, continue de vouloir sauver l’Union française (29). Pendant toute la durée du conflit algérien, le PCF réclame, certes, la « paix en Algérie » ou encore le « règlement pacifique de la question algérienne », mais en oubliant la revendication primordiale : l’indépendance. Et les députés communistes votent en 1956 les pouvoirs spéciaux au gouvernement Mollet/Mendès-France/Mitterrand.
Au nom de la « civilisation »
Cette monstrueuse dérive au sein même du mouvement ouvrier trouve son origine dans le ralliement à la doctrine raciale républicaine, affermie par la croyance en la « mission civilisatrice » de la France et en son « devoir » d’« émancipation » Jaurès y a cédé. Il déclare par exemple, en 1884 : « Quand nous prenons possession d’un pays, nous devons amener avec nous la gloire de la France, soyez sûrs qu’on lui fera bon accueil, car elle est pure autant que grande, toute pénétrée de justice et de bonté […] Là où la France est établie, on l’aime ; là où elle n’a fait que passer, on la regrette ; partout où sa lumière resplendit, elle est bienfaisante ; là où elle ne brille plus, elle a laissé derrière elle un long et doux crépuscule où les regards et les cœurs restent attachés (30). » En somme, ceux qui ne sont pas Français n’ont rien d’autre à espérer que de le devenir. Quatorze ans plus tard, Jaurès persiste et signe : « Si quelques fous songeaient à dépouiller la France de son domaine colonial, toutes les énergies françaises et toutes les consciences droites dans le monde se révolteraient contre pareille tentative (31). »
Blum s’inscrit parfaitement dans cette continuité lorsqu’il affirme, lors d’une déclaration à la Chambre des députés en 1925 : « Nous admettons le droit et même le devoir des races supérieures d’attirer à elles celles qui ne sont pas parvenues au même degré de culture (32). » Des traces de ce racisme ont perduré dans la social-démocratie, comme en témoignent ces propos, tout à la fois racistes et misogynes, de Jules Moch,l’un des dirigeants de la SFIO, en 1944 : « Je refuse que la reine Makoko puisse un jour renverser le gouvernement français (33) », justifiant ainsi le refus du droit de vote aux peuples colonisés. Cette pratique discriminatoire conduit, sur le territoire « hexagonal », aux pratiques les plus abjectement anti-ouvrières. Au début des années 1980, plusieurs élus PCF, soutenus par la direction de leur parti, s’opposent à la construction de foyers de travailleurs immigrés ; l’un d’eux fait même détruire un foyer au bulldozer.
La « gauche », la défense républicaine et la sécurité nationale
Le patriotisme brandi durant des décennies par les dirigeants sociaux-démocrates et staliniens au nom, toujours des droits de l’homme et des valeurs universalisantes de la République française, n’a cessé de confiner au nationalisme pétri de chauvinisme et de xénophobie. Mitterrand n’est rien moins qu’un maillon de cette chaîne. En 1989, il n’hésite pas à évoquer un « seuil de tolérance dépassé » au sujet des immigrés ; ses propos n’ont donc rien à envier dans ce registre à ceux de Chirac parlant d’« overdose d’immigrés » ou de Valéry Giscard d’Estaing stigmatisant une « invasion ». Différents ministres socialistes se sont illustrés dans cette veine honteuse. Lorsque des « intellectuels » comme Régis Debray, Max Gallo, Mona Ozouf ou Paul Thibaud lancent dans Le Monde un appel intitulé « Républicains n’ayons plus peur ! » en septembre 1998, proposant de « refonder » la République en « restaurant » l’autorité par toute une série de mesures sécuritaires et discriminatoires (tolérance zéro à l’égard de toutes les petites infractions, jusqu’aux « tenues provocantes » des élèves, incarcération des mineurs, suppression des allocations familiales pour les « parents des délinquants », contrôle plus strict des « flux migratoires », attribution « plus exigeante » de la nationalité française), Jean-Pierre Chevènement les félicite ; il estime qu’ils « incarnent la forte persistance de l’idée républicaine en France ».
Outre ses propos sur les « sauvageons », Chevènement se fait maintes fois l’avocat de la police lorsqu’elle violente et torture des « jeunes-des-cités-issus-de-l’immigration ». Pour exemple, en 1991, Ahmed Selmoun subit lors d’une garde à vue des violences policières (coups, blessures, menaces avec un chalumeau et une seringue, viol à la matraque) reconnues comme « particulière-ment graves et cruelles » par la Cour européenne des Droits de l’Homme, qui condamne la France pour torture. Lorsque le tribunal correctionnel de Versailles condamne, huit ans après les faits, les policiers mis en cause à deux et quatre ans de prison ferme, une manifestation de protestation de policiers reçoit l’approbation du ministre de l’intérieur Chevènement, qui dit « com-prendre leur inquiétude ». La Cour d’appel de Versailles est alors saisie, les policiers rejugés et leur peine abaissée à 18 mois de prison dont 15 avec sursis (34) ! Dans ce sillage, en décembre 2001, le ministre de l’intérieur « socialiste » Daniel Vaillant poursuit pour « diffamation contre la police nationale » le Syndicat de la magistrature qui n’avait fait que constater : « les contrôles d’identité au faciès, bien qu’illégaux, se sont multipliés » (35). Aujourd’hui, Ségolène Royal applaudit au débat sur l’identité nationale, le jugeant « fonda-mental » pour « reconquérir les valeurs de la nation ». La secrétaire du PS Martine Aubry, quant à elle, affirme certes que ce débat est « mal posé » ; elle ne l’en juge pas moins « un vrai sujet ».
Sarkozy, avec l’identité nationale, ne fait que perpétuer cette arrogance à la française de la xénophobie et de la stigmatisation de « l’autre », en les faisant renaître sous une forme encore plus hypocrite. Tout cela dans une indifférence quasi-totale (politique ou intellectuelle de « gauche ») sans doute pour ne pas être tricard dans un milieu consensuel puisque tout le milieu du gotha politico-culturel — Ferry, Finkielfraut, Frêche, d’Encausse… — met son discours au service de cette affligeante ignominie raciste et xénophobe, essayant d’emporter toutes les digues de la raison. Instillées et diffusées par tous les commerces médiatiques, leurs réflexions sentencieuses font des ravages dans l’opinion publique notamment en période de crise où il faut trouver un bouc émissaire à son mal vivre. C’est ce racisme institutionnel qui exprime sa continuité, aiguillonnée par les besoins du capitalisme. De leurs postes d’observation ou de direction, ils distribuent, stigma-tisent, lancent des anathèmes, des appréciations sur les faits et gestes du monde arabo-musulman et africain qu’ils caricaturent sans vergogne. C’est le moyen trouvé pour établir un cordon sanitaire de jugements déformants. Nous sommes là dans la droite ligne de l’idéologie qui s’est développée depuis le XVIe siècle et qui est le fil conducteur de ce racisme d’État. Il tient en une thèse unique : la supériorité du blanc occidental, de sa culture et de ces monothéistes réactionnaires qui devraient conduire « l’autre » à s’y soumettre.
Pour accréditer ce dogme, ses utilisateurs ont recours aux discours moralo-religieux — bons/méchants — porté jusqu’à l’hystérie dans le cas de Sarkozy. Plus une thèse est faible, plus elle a besoin du terrorisme intellectuel et de la caricature pour s’imposer. Telle est la démarche entreprise par Sarkozy qui insiste sur le « besoin d’appartenance » exprimé par le vote suisse, pour justifier une nouvelle fois le débat sur l’identité nationale, comme un « antidote au tribalisme et au communau-tarisme ». Rarement chef d’État aura été aussi loin dans l’abject et le populisme pour comparer l’entité arabo-musulmane au tribalisme à laquelle il faudrait administrer un contrepoison pour la rendre « civilisée ». L’énormité de cette allégation et le chapelet d’assertions virulentes passent comme une lettre à la poste. C’est le vertige dans le délire.
À l’heure du débat organisé par le gouvernement sur l’identité nationale, le premier communautarisme à combattre, c’est la fiction d’égalité instaurée par un État bourgeois qui se prétend républicain mais est en réalité oppresseur, xénophobe et raciste !
- Retrait du projet de loi sur l’identité nationale !
- Régularisation de tous les sans-papiers !
- Abrogation de toutes les lois anti-immigrés, fermeture des camps de rétention, liberté de circulation et d’installation !
- Abolition de toutes les mesures interdisant l’accès des étrangers à certains emplois !
1) Par xénophobie, on entendra un ensemble de « discours et d’actes tendant à désigner l’étranger comme un problème, un risque ou une menace pour la société d’accueil » (Jérôme Valluy, « Quelles sont les origines du ministère de l’Identité nationale et de l’Immigration », Cultures et conflits. Sociopolitique de l’International, n° 69, printemps 2008, p. 12) et donc à tout faire pour lui imposer une oppression particulière et différentes formes de discriminations ; le racisme admet la même définition, en y incluant un différentialisme d’exclusion fondé sur l’ethnicité.
2) De Gaulle cité par Nicolas Bancel, Pascal Blanchard, Françoise Vergès, La République coloniale, Paris, Hachette Littératures, 2006, p. 41.
3) Jacques Foccart, Mémoires, tome 2, entretien avec Ch. de Gaulle le 8 nov. 1968, cité par Odile Tobner, Du racisme français. Quatre siècles de négrophobie, Paris, Les Arènes, 2007, p. 199.
4) Propos tenus au Conseil des ministres, rapportés par Le Canard enchaîné le 7 juin 2006, cités ibidem, p. 290.
5) Pour lesquelles les policiers ne sont pratiquement jamais sanctionnés par la justice (acquittements, non-lieux) ou tout au plus de peines légères avec sursis. « Bref, pour les “bavures” mortelles, “il est rare que des peines de prison soient effectivement purgées.” C’est ce que signalent les rapport annuels d’Amnesty International, qui dénoncent régulièrement l’inertie du Ministère public et les “délais déraisonnables” des enquêtes et des poursuites. Un récent rapport de l’association parle d’une “impunité de fait”. » (Pierre Tévanian, Le ministère de la peur. Réflexions sur le nouvel ordre sécuritaire, Paris, L’Esprit frappeur, 2003, p. 114-115).
6) Cité par Vincent Geisser, « L’intégration républicaine : réflexion sur une problématique post-coloniale », in Pascal Blanchard, Nicolas Bancel (dir.), Culture post-coloniale 1961-2006. Traces et mémoires coloniales en France, Paris, Autrement, 2005, pp. 152 et 157.
7) Exemple anecdotique, à la fois ridicule et symptomatique de cette violence symbolique, Nadine Morano, secrétaire d’État à la famille, vient d’enjoindre le « jeune musulman » à ne pas parler verlan et à ne pas porter sa casquette à l’envers…
8) Nacira Guénif-Souilamas, « La Française voilée, la beurette, le garçon arabe et le musulman laïc. Les figures assignées du racisme vertueux », in Nacira Guénif-Souilamas, La république mise à nu par son immigration, Paris, La Fabrique, 2006, p. 111.
9) Cf. Christine Delphy, « Antisexisme ou antiracisme ? Un faux dilemme », in Nacira Guénif-Souilamas, La république mise à nu par son immigration, op. cit., p. 99.
10) Cf. Mouna Viprey, « Les discriminations raciales sur le marché du travail français », Confluences Méditerranée, n° 48, hiver 2003-2004.
11) Laetitia Van Eeckout, L’immigration, Paris, Odile Jacob, 2007.
12) Pierre Tévanian, Le ministère de la peur, op. cit., p. 102.
13) Sylvie Tissot, « Logement social : une discrimination en douceur », Plein droit, n° 68, avril 2006, p. 27.
14) Valérie Sala Pala, « Le racisme institutionnel dans les attributions de logement social. Une comparaison franco-britannique », Hommes et migrations, n° 1264, novembre-décembre 2006, p. 111.
15) Sylvie Tissot, « Logement social : une discrimination en douceur », article cité, p. 25.
16) Gilles Manceron, Marianne et les colonies, Paris, La Découverte, 2003, p. 18.
17) Cité ibidem, p. 135.
18) Intervention de Jules Ferry à la Chambre des députés, 27 mars 1884, cité ibidem, p. 102.
19) Nicolas Bancel, Pascal Blanchard, Sandrine Lemaire, Zoos humains. Au temps des exhibitions humaines, Paris, La Découverte, 2004.
20) Cité par Gilles Manceron, Marianne et les colonies, op. cit., p. 131.
21) Nicolas Bancel, Pascal Blanchard, Françoise Vergès, La République coloniale, op. cit., p. 51.
22) Ibidem, p. 54.
23) Olivier Le Cour Grandmaison, « Colonisés-immigrés et “périls migratoires” : origines et permanences d’un racisme et d’une xénophobie d’État (1924-2007) », Cultures et conflits. Sociopolitique de l’International, n° 69, printemps 2008, p. 24.
24) Cité ibidem, p. 31.
25) Nicolas Bancel, Pascal Blanchard, Françoise Vergès, La République coloniale, op. cit., p. 158.
26) Dans la même veine, le journal de la SFIO, Le Populaire du 12 mai, parle d’ « agitateurs ».
27) Cité par Yves Benot, Massacres coloniaux. 1944-1950 : la IVe République et la mise au pas des colonies françaises, Paris, La Découverte et Syros, 1994, 2001, p. 59.
28) Marc Ferro, « En Algérie : du colonialisme à la veille de l’insurrection », in Marc Ferro (dir.), Le livre noir du colonialisme XVIe-XXIe siècle : de l’extermination à la repentance, Paris, Robert Laffont, 2003, p. 510.
29) Yves Benot, Massacres coloniaux, op. cit., p. 131.
30) Jean Jaurès, Conférence tenue à l’Alliance française, 1884, citée par Nicolas Bancel, Pascal Blanchard, Françoise Vergès, La République coloniale, op. cit., p. 152.
31) Cité in Gilles Manceron, Marianne et les colonies, op. cit., p. 226.
32) Cité ibidem, p. 235.
33) Cité ibidem, p. 119. Moch a ainsi féminisé le roi Makoko, souverain téké du XIXe siècle régnant sur des territoires situés dans les actuels Gabon, Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa.
34) Pierre Tévanian, Le ministère de la peur, op. cit., p. 117-118.
35) Ibidem, p. 106. De ce point de vue, les « socialistes » n’ont rien à envier à Sarkozy, qui poursuit depuis plusieurs années en diffamation le chanteur Hamé du groupe de rap La Rumeur pour des constats tels que celui-ci : « Les rapports du ministère de l’intérieur ne feront jamais état des centaines de nos frères abattus par les forces de police sans qu’aucun des assassins n’ait été inquiété. »





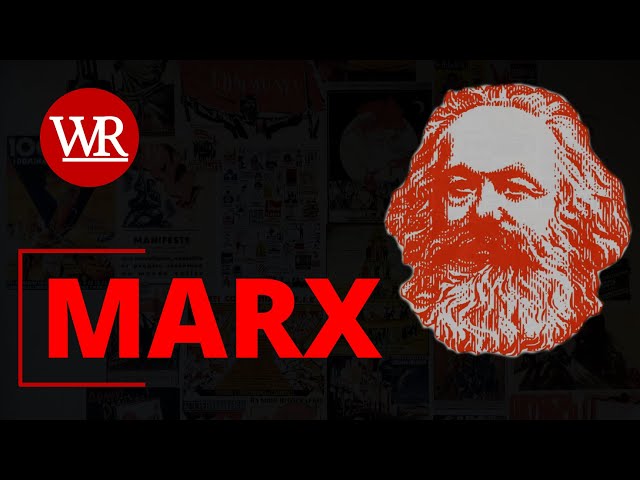


.jpg)