Agenda militant
Ailleurs sur le Web
![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)
- Lordon : Boulevard de la souveraineté (15/01)
- L’affaire d’État Alstom : l’étau se resserre autour de la responsabilité de Macron (15/01)
- Coquerel sur France 2 mercredi 14 janvier (14/01)
- Le "moment eurocommuniste" ou la déstalinisation ratée du PCF (14/01)
- Etats-Unis : comprendre la « nouvelle doctrine de sécurité nationale » et ses implications (14/01)
- La loi du plus fort - La chronique de Pierre-Emmanuel Barré (12/01)
- Retour sur le blocage du périph’ - A propos de la résistance à l’accord UE-Mercosur et à la politique d’abattage total. (12/01)
- Venezuela : des médias intoxiqués par la propagande de guerre (12/01)
- Où vivent les plus riches ? Ce que la géographie des hauts revenus dit des fractures françaises (11/01)
- Une récompense pour les criminels ! Le prix Nobel de la « paix » (11/01)
- La crise de la gauche portugaise. Entretien avec Catarina Príncipe (11/01)
- Victor Klemperer, critique impitoyable du sionisme (11/01)
- USA - VENEZUELA : UNE OPÉRATION MAFIEUSE SALUÉE PAR LES "COLLABOS" - Maurice Lemoine (11/01)
- Le paradoxe de la Sécurité sociale : et si, pour faire des économies, il fallait l’étendre ? (11/01)
- LFI : Soutien au peuple venézuélien contre l’agression de Trump ! (10/01)
- Du militarisme à gauche. Réponse à Usul et à Romain Huët (09/01)
- Face à l’impérialisme trumpiste : ne rien céder (08/01)
- Attaque américaine au Venezuela : ce que révèle le "zéro mort" de franceinfo (08/01)
- Que signifie "abolir la monnaie" ? (08/01)
- Abject dessin antisémite dans Marianne contre le député LFI Rodriguo Arenas (08/01)
- "ILS FONT LE SAV DE TRUMP !" CE QUE DISENT LES MÉDIAS FRANÇAIS SUR LE VENEZUELA (08/01)
- VENEZUELA : CE QUE NE DIT PAS LA PROPAGANDE DE TRUMP (08/01)
- Les États-Unis prennent d’assaut le territoire et le gouvernement du Venezuela (08/01)
- Les systèmes militaro-industriels, noyau totalitaire du capitalisme contemporain (08/01)
- LE KIDNAPPING DE MADURO - LE BANDITISME D’ÉTAT AMÉRICAIN (08/01)
Liens
Daniel Bachet: comment dépasser le modèle de l’entreprise capitaliste
Ces articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » sont publiés à titre d'information et n'engagent pas la Tendance CLAIRE.
Comment dépasser le modèle de l'entreprise capitaliste ? – Entretien avec Daniel Bachet (lvsl.fr)
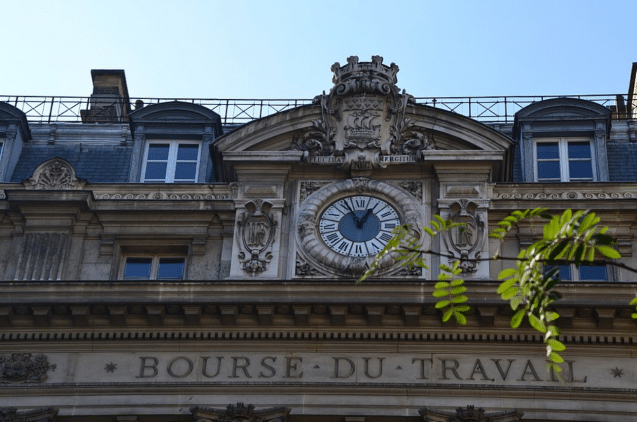
Aux côtés de l’association d’éducation populaire Réseau Salariat, le sociologue Daniel Bachet et l’économiste Benoît Borrits ont organisé un séminaire autour du thème de l’entreprise et son monde afin de proposer des voies de dépassement des logiques écocidaires de profitabilité. Le statut juridique de l’entreprise, la socialisation du crédit, le pouvoir des salariés dans l’entreprise, ou encore la comptabilité : autant de thèmes abordés dans l’ouvrage retranscrivant les présentations du colloque. Nous avons rencontré Daniel Bachet pour discuter de leurs constats et de leurs propositions pour mieux organiser les entités productives. Entretien réalisé par Romain Darricarrère.
Le Vent Se Lève – Pour commencer, pouvez-vous revenir sur les apports et sur l’importance de l’approche comptable dans les domaines du travail et de l’entreprise ? C’est une dimension concrète bien que souvent impensée. Ne s’agit-il pas d’une manière de présenter et d’interpréter le réel socio-économique ?
Daniel Bachet – La façon de compter oriente chaque jour des décisions stratégiques qui ont des effets immédiats sur le travail, l’emploi et la qualité des modes de développement et de vie. On peut penser que la comptabilité financière constitue aujourd’hui le cœur de notre système socio-économique. Ainsi, dans la comptabilité sont repliés les rapports sociaux fondamentaux du capitalisme (rapport salarial, rapport monétaire et financier, rapports de propriété, etc.).
Depuis les années 1980, un droit comptable international inique et dangereux a été institué par les États à l’échelle de la planète. Les normes IFRS – International Financial Reporting Standard, sont devenues la référence internationale pour les grandes sociétés auxquelles elles imposent un modèle de gestion appelé « juste valeur ». Ces normes conduisent les PDG de ces sociétés à satisfaire en priorité les intérêts à court terme des actionnaires. Une entreprise est appréhendée comme un actif qui s’évalue à sa valeur potentielle de vente sur un marché. Les bénéfices sont déterminés sur la base d’un taux de rentabilité exigé de l’ordre de 10 à 15 %, parfois plus, qui contribue à mettre en danger notre vie commune sur la planète eu égard à sa finitude. Autrement dit, les États instituent de manière intentionnelle et irresponsable une véritable constitution économique mondiale fondée sur ces normes comptables, qui n’ont rien de naturel.
C’est pourquoi adopter un langage comptable plutôt qu’un autre, c’est adopter une représentation de l’entreprise, de sa finalité, de son efficacité et des rapports de pouvoir. Aussi, il est possible de penser et de compter différemment en vue de proposer une alternative cohérente et opératoire à l’entreprise capitaliste, notamment pour que les décisions économiques soient prises à l’aune d’autres considérations : c’est le cœur du pouvoir.
LVSL – Plus techniquement, en quoi peut donc consister cette manière alternative de compter ?
D. B. – Dans cet ouvrage collectif nous présentons les comptes de valeur ajoutée et de valeur ajoutée directe – VAD[1] ainsi que l’approche CARE – comptabilité adaptée au renouvellement de l’environnement [2]. Ce sont les outils de gestion les plus appropriés pour faire exister l’entreprise comme structure productive dont la finalité est d’abord de produire et de vendre des biens et/ou des services. Ils ont également pour mission d’empêcher les atteintes aux fonctions environnementales essentielles à la survie de la biosphère et de prévenir les dégâts collatéraux du développement économique sur les humains : risques socio-psychologiques, accidents, coût de l’insécurité environnementale, etc.
« Adopter un langage comptable plutôt qu’un autre, c’est adopter une représentation de l’entreprise et de sa finalité plutôt qu’une autre. »
Dans cette nouvelle logique, le travail devient une source de valeur et de développement et non un coût ou une charge à réduire sans cesse.
L’intérêt social est alors celui de l’ensemble des parties constitutives de l’entreprise qui sont toutes aussi légitimes les unes que les autres pour agir et être impliquées dans les processus de création et de décision. Cette représentation de l’intérêt social remet en question le droit issu de la propriété qui donne habituellement tous les pouvoirs aux seuls détenteurs de capitaux et à leurs mandataires, les dirigeants des sociétés.
Les outils comptables que nous proposons sont dès aujourd’hui opératoires mais il faut les généraliser et se positionner sur un plan macro-institutionnel. C’est à un niveau politique qu’il faut agir pour les faire exister, là où se construisent, se fabriquent et s’organisent les langages légitimes, les conventions et les systèmes d’information qui permettent l’exercice du pouvoir. L’objet de notre livre était de mettre en évidence le caractère essentiellement normatif et performatif de la construction des conventions comptables, mais aussi de souligner la possibilité d’ensembles cohérents alternatifs.
LVSL – Comment analysez-vous la fermeture de l’espace de la social-démocratie, évoquée tant à plusieurs reprises dans l’ouvrage, mais aussi par d’autres économistes comme Frédéric Lordon par exemple ? L’impossibilité d’agir dans ce cadre ne légitime-t-elle pas d’autant plus un changement de paradigme profond ?
D. B. – Le mode de gouvernement de la social-démocratie s’est rapidement aligné sur les règles du néo-libéralisme à la fin des années 1970 : libéralisation du commerce des biens et des services, dérégulation financière avec suppression du contrôle des capitaux et mise en place de la gouvernance actionnariale ou corporate governance. On peut même rappeler que la social-démocratie a initié les premières mesures qui ont conduit à la libéralisation financière. C’est un Ministre socialiste de l’Économie et des Finances, Pierre Bérégovoy, qui met en place avec son équipe une nouvelle architecture institutionnelle : la loi bancaire de 1984-1985, la suppression de l’encadrement du crédit, la disparition de la plupart des prêts bonifiés – et puis, petit à petit, la levée du contrôle des changes, pour faire revenir les investisseurs internationaux.
Il faut donc reconstruire le cadre institutionnel si l’on veut sortir du libre-échange et de la dérégulation financière. Cela suppose de mettre en place des zones de protection en fixant par les lois et par la négociation internationale le degré de liberté du commerce qui reste compatible avec la souveraineté des peuples quant au choix de leur modèle de société. De même, seule une politique résolue de contrôle sur les mouvements de capitaux est capable de remettre le système sur ses pieds et d’assurer que la finance serve aux activités productives et non à la spéculation.
Dans notre ouvrage, nous n’avons traité que du thème de l’entreprise et de sa refondation, tout en montrant que le modèle de la social-démocratie était totalement disqualifié y compris sur ce sujet. Aucun gouvernement social-démocrate n’a proposé un véritable partage du pouvoir dans les organes de direction des sociétés. Le projet de faire valoir un soupçon de codétermination dans les entreprises françaises n’a jamais abouti. Sous la Présidence « socialiste » de François Hollande, le nombre d’administrateurs salariés dans un conseil d’administration était de 2 lorsque le nombre total des administrateurs était supérieur à 12 (et de 1 lorsque le nombre d’administrateurs était inférieur ou égal à 12). C’est dire que la social-démocratie n’a offert rien d’autre qu’un strapontin aux représentants des travailleurs dans l’entreprise. Du point de vue de l’organisation des pouvoirs, la puissance du capital n’a jamais été entamée par les gouvernements socio-démocrates. Le dépassement du modèle social-démocrate et social-libéral est un impératif qui s’impose pour construire de nouvelles règles du jeu. Si le cadre économique, social et politique pose de plus en plus problème pour mettre en place une authentique démocratie délibérative, il convient de le transformer en profondeur voire, à terme, de sortir du cadre lui-même.
LVSL – Comment s’opposer efficacement aux réformes successives du code du travail qui font primer les accords d’entreprise sur la négociation collective ? Cela n’implique-t-il pas, précisément, de dépasser le cadre de l’entreprise capitaliste pour la négociation et la fixation des salaires ?
D. B. – L’enjeu politique des différents gouvernements qui se sont succédés depuis plus de 30 ans est bien d’affaiblir la loi et les conventions de branches, au profit de la négociation collective d’entreprise qui est la plus déséquilibrée.
Les défenseurs de l’inversion de la hiérarchie des normes considèrent que le projet qui consiste à renforcer la primauté des accords d’entreprise sur les accords de branche puis à étendre ces dérogations à d’autres domaines introduit de la souplesse dans les relations de travail. En fait, il s’agit de favoriser le dumping social en fragilisant les salariés.
Le fait de se replier sur l’entreprise renforce le pouvoir des propriétaires et des dirigeants qui ont déjà la maîtrise du contrat de travail. Ce contrat de travail est le produit du droit de propriété qui lui-même reproduit la séparation des salariés des moyens de production. Les salariés se retrouvent donc isolés face à des entités juridiques dominées par les propriétaires qui, disposant de tous les pouvoirs, sont globalement en mesure de fragmenter et d’atomiser le salariat.
Il ne faut donc pas enfermer les espaces de délibération sur les salaires à l’intérieur des seules unités de production. Cela suppose au contraire de concevoir des formes institutionnelles méso et macro sociales qui soient à même de définir les niveaux de salaires dans les entreprises mais également les choix d’orientation des investissements ou les niveaux de qualification. Bernard Friot propose ainsi d’instituer des caisses de salaires et d’investissement pour socialiser les salaires au-delà de chaque entreprise prise individuellement. Benoît Borrits souhaite, lui, mettre hors marché une partie de la production privée, puis la redistribuer afin de garantir des revenus décents à toutes celles et ceux qui ont participé à cette production. La rémunération de chaque travailleur ne serait plus garantie par l’entreprise mais, de façon mutualisée, par l’ensemble des entreprises. Ce sont là des institutions encore inédites qui devraient permettre une intervention politique à plusieurs niveaux de façon à garantir des meilleures rémunérations pour tous.

Daniel Bachet est Professeur de sociologie à l’Université d’Evry-Paris Saclay et membre du conseil scientifique d’Attac. Proche des thèmes chers à Réseau Salariat, il a organisé, avec Benoît Borrits, un séminaire pour penser le dépassement de l’entreprise capitaliste.
LVSL – Vous rappelez dans l’ouvrage que seule la rémunération du capital est totalement rivale de celle du travail. Comment exploiter efficacement cet énoncé basique pour faire évoluer les représentations des discours de droite classique, notamment dans la perspective d’outiller le mouvement social ?
D. B. – Dans les représentations dominantes véhiculées par les théories néoclassiques – théorie de l’agence, théorie des marchés efficients, seul l’actionnaire de contrôle est censé prendre des risques. Il est rémunéré par des dividendes. On l’appelle le créancier résiduel car il peut ne pas recevoir de dividendes et tous les autres créanciers d’une entreprise sont rémunérés avant lui en cas de difficultés. Dans la mesure où l’actionnaire peut être considéré, en tant que propriétaire d’une entreprise, comme un créancier résiduel, le droit des sociétés assigne dans la plupart des pays au conseil d’administration le devoir de surveiller les dirigeants pour protéger les intérêts des actionnaires, dans le cadre de procédures de contrôle internes. Le statut de créancier résiduel donne à l’actionnaire la légitimité pour s’approprier le profit résiduel, mais aussi pour dicter les objectifs à atteindre par la firme.
Or, cette représentation est arbitraire et inexacte. Les actionnaires et les financiers sont parvenus à faire croire qu’ils avaient le monopole de la détermination des intérêts de l’entreprise. Ce n’est là qu’une tentative de détournement du pouvoir car personne n’est propriétaire de l’entreprise du fait que cette entité n’existe pas en droit. L’actionnaire de contrôle n’est propriétaire que des parts sociales ou des actions de la société (entité juridique). Néanmoins les actionnaires de contrôle se comportent comme s’ils disposaient de tous les pouvoirs dans l’entreprise et sur l’entreprise.
La seule limite à ces pouvoirs relève des droits sociaux accordés aux salariés. Or, comme chacun le sait, ce sont de très faibles contrepouvoirs. Ainsi, les droits des salariés, lorsqu’ils sont en confrontation directe avec le droit des propriétaires dans une structure telle que la société de capitaux, arrivent en derniers quand il s’agit de fixer les règles du jeu et en particulier les salaires. Les propriétaires sont les agents dominants qui occupent au sein de l’entité juridique qu’est la société une position telle que cette entité agit systématiquement en leur faveur. De plus, les salariés ne sont pas des associés comme les propriétaires des actions, ce sont des tiers vis-à-vis de la société et des coûts dans la comptabilité capitaliste. N’ayant pas le statut d’associés, c’est-à-dire de propriétaire ou d’actionnaires, les salariés ne sont pas membres de la société alors qu’ils font partie de l’entreprise en tant que collectif de travail.
Pour sortir de la logique de domination imposée au travail par le capital, il ne faut plus penser en termes de propriété mais de pouvoir. L’entreprise fait partie du rapport capital/travail sans toutefois se confondre ni avec le capital ni avec le travail. C’est une unité institutionnelle qui dispose d’une autonomie relative. Au sein du capitalisme, elle est le support de création collective qui engage des agents et des collectifs aux intérêts multiples. C’est pourquoi l’entreprise est une entité profondément politique qui transforme le monde social.
« Il ne serait pas logique d’avoir pour ambition de mieux rétribuer le travail sans remettre en question le niveau de rémunération du capital. »
Le fait d’assigner à l’entreprise un autre objectif que le seul profit permet de remettre en question la notion, non fondée en droit, de propriété de l’entreprise, et de faire en sorte que le pouvoir d’entreprendre ne provienne plus de la seule propriété des capitaux.
De fait, l’entreprise est un ensemble composé de la société (entité juridique) et de la structure productive. L’existence de la structure est assurée par la société qui seule dispose d’une personnalité morale. La finalité de la société est de faire exister l’entreprise comme structure productive en vue de produire et de vendre des biens et/ou des services. Le revenu qui en découle, la valeur ajoutée, est la contrepartie économique de la production et de la vente des biens et des services. Elle représente le revenu commun des parties constitutives de l’entreprise et à ce titre, il doit être partagé équitablement.
Il ne serait pas logique d’avoir pour ambition de mieux rétribuer le travail sans remettre en question le niveau de rémunération du capital. La valeur ajoutée est à la fois le véritable revenu de l’entreprise et la source des revenus des ayants droit entre lesquels la valeur ajoutée est répartie. Cette grandeur économique est essentielle, car elle permet de financer les salaires, de rémunérer les intérêts des banques, les impôts et les taxes demandés par l’État, mais également d’assurer l’autofinancement – amortissements + parts réinvesties du résultat, et de verser les dividendes. C’est donc la valeur ajoutée qui permet de couvrir le coût global de la structure qu’est l’entreprise – salaires du personnel, amortissement de l’outil de production et rémunération des capitaux engagés, alors que le profit – l’excédent brut d’exploitation, ne représente qu’une partie de la valeur ajoutée. Cette grandeur est une expression comptable qui reflète l’augmentation de la valeur des marchandises apportée par le travail humain. En termes d’outils comptables, la prise en compte de la valeur ajoutée ouvre la possibilité de définir une autre finalité à l’entreprise que la maximisation du profit. De plus, les consommations intermédiaires des entreprises devraient dorénavant intégrer et prendre en compte la conservation et la protection des êtres humains et du patrimoine naturel.
LVSL – Dans l’ouvrage, Olivier Favereau défend la codétermination, c’est-à-dire un partage du pouvoir entre salariés et actionnaires. Cette idée est séduisante, mais comment se prémunir des pièges qui se sont refermés sur la cogestion allemande pour finalement l’étouffer – lois Hartz, mini-jobs… ?
D. B. – Le principe de codétermination que défend, par exemple, le Collège des Bernardins [3] se révèle impuissant face à la mondialisation des chaînes de valeur. Olivier Favereau en est conscient, contrairement à certains de ses collègues qui pensent qu’un simple partage des pouvoirs dans les conseils d’administration ou de surveillance serait une avancée décisive pour le monde du travail. Dans un monde où la concurrence des systèmes sociaux et fiscaux est extrêmement féroce et où priment des objectifs de rentabilité, la participation des salariés aux décisions stratégiques dans l’entreprise les conduiraient à des contradictions paralysantes. Ils pourraient être conduits eux-mêmes à réduire les effectifs pour répondre aux injonctions des marchés et donc à s’auto-exploiter. C’est ce qui s’est passé avec le système de cogestion allemande qui a cohabité avec des politiques économiques régressives pour les travailleurs les plus fragiles et les moins formés. Ce système dual ne peut que généraliser de la précarité sociale.
« Dans un monde où la concurrence des systèmes sociaux et fiscaux est extrêmement féroce et où priment des objectifs de rentabilité, la participation des salariés aux décisions stratégiques dans l’entreprise les conduiraient à des contradictions paralysantes. »
C’est pourquoi, au-delà de la révision complète de la comptabilité capitaliste, qu’il ne faut plus caler sur des critères financiers, il convient simultanément de socialiser les marchés. Il peut exister des échanges marchands sans pour autant que les forces du marché dominent la vie économique et sociale en imposant une concurrence déchaînée. Le marché, si l’on admet cette fiction performative, est injuste dès lors qu’il oriente les décisions des investisseurs vers les catégories sociales solvables et non en fonction des besoins sociaux les plus urgents.
Une démocratie économique radicale constituerait un moyen de dépasser le marché capitaliste. Elle impliquerait de maîtriser les conditions de production et d’écoulement des produits tout en suscitant encore plus de liberté, d’initiative et d’inventivité que le capitalisme n’en est capable. Car il faudrait mobiliser des procédures plus économes – matières premières, humains, que les moyens utilisés sans discernement par le capitalisme qui ont conduit aux gaspillages et aux désastres écologiques que l’on connaît.
La codétermination n’est donc pas une fin en soi, surtout avec des règles du jeu économique inchangées. Sinon elle se trouvera enkystée localement dans un certain nombre d’entreprises sans pouvoir mettre en place les principes d’une véritable démocratie économique à l’échelle du pays.
LVSL – François Morin défend un intéressant système qui met en avant différents collèges délibérants avec des représentants des apporteurs du capital et des apporteurs du travail. Au-delà de la potentielle complexité de cette formule pour les PME, les apporteurs de capitaux y sont souvent aussi travailleurs. N’est-ce pas là un risque pour que le capital conserve toujours l’avantage ?
D. B. – François Morin a pour projet d’instituer juridiquement l’entreprise et de sortir de la confusion entreprise/société. L’assimilation de l’entreprise à la société conduit à exclure de la réflexion sur le gouvernement d’entreprise les salariés. F. Morin pense d’abord au statut des sociétés-mères des groupes de sociétés actuels. L’entreprise, conçue comme nouvelle unité institutionnelle devient une personne morale alors que ce statut n’est, jusqu’à aujourd’hui, conféré qu’à la société (entité juridique).
L’entreprise se substitue à la société qui n’est plus présente dans la nouvelle entité juridique. Au sein de cette dernière cohabitent deux collèges – actionnaires et salariés, un président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et un directeur général du directoire ou du comex. Le représentant légal de l’entreprise, nouvelle personne morale instituée juridiquement est le président qui peut être un salarié ou bien un représentant des actionnaires. Dans cette perspective, le contrat de subordination entre salariés et capital n’existe plus. Le fait d’attribuer à l’entreprise le statut de personne morale peut concerner quasiment toutes les entreprises, PME comme grands groupes. Dans l’approche que défend François Morin, les actionnaires ne seront que des apporteurs de fonds ou des prestataires de services qui possèdent des parts. Ils n’auront plus le pouvoir de créanciers résiduels et leurs voix ne seront plus prépondérantes dans la prise de décision. C’est une étape dans la démocratisation générale de l’économie qui concerne, comme on l’a indiqué plus haut, la nouvelle conception d’un marché socialisé mais également la création monétaire qui doit être, elle aussi, adossée à des instances démocratiques.
François Morin propose, comme il le dit lui-même, un « point de bascule » pour aller beaucoup plus loin par la suite. Il présuppose que les salariés puissent acquérir une culture gestionnaire et critique de façon à éviter l’emprise de la comptabilité capitaliste sur les choix économiques et sur leur vie.
LVSL – Peut-on penser le dépassement de l’entreprise capitaliste non plus simplement en aménageant une nouvelle gouvernance des entités productives, mais en dessinant les voies qui permettront de se passer des apporteurs de capitaux, et donc de leur pouvoir sur notre travail, selon le modèle mortifère du capitalisme contemporain ?
D. B. – Je pense qu’on ne peut passer directement de la situation actuelle à un modèle dépassant l’organisation capitaliste où la rentabilité, le secteur bancaire et le crédit auraient été supprimés. Il faut au moins au préalable construire les rapports de force significatifs pour faire bifurquer les institutions existantes. La proposition consistant à virer les actionnaires peut apparaître comme radicale mais elle n’est pas très opératoire. Quelles sont les institutions qui vont définir et redéfinir l’organisation des pouvoirs en supprimant les détenteurs de capitaux ? Dans tous les cas de figure se poseront des problèmes de financement. Si une crise systémique de la finance survient bientôt comme c’est le plus probable, ne conviendrait-t-il pas à ce moment-là de nationaliser les banques puis de les socialiser ainsi que l’avait déjà proposé Frédéric Lordon en 2010 à travers un système socialisé du crédit ? [4]
Les concessionnaires de l’émission monétaire ne pourront plus être dans ce cas des sociétés privées par actions mais des organisations à profitabilité encadrée. Les banques seront soumises à un contrôle public par les parties prenantes que sont les salariés, les représentants des entreprises, les associations, les collectivités locales, les professionnels du risque de crédit et les représentants locaux de l’État. La démocratisation radicale des banques n’est-elle pas un projet plus facilement défendable dans un premier temps que l’éviction pure et simple des actionnaires ?
« La démocratisation radicale des banques est un projet facilement défendable. »
Une contre hégémonie politique, économique et culturelle est susceptible de se mettre en place sur ce thème d’actualité si elle parvient à toucher le plus grand nombre de groupes sociaux et si les affects qu’elle véhicule sont plus puissants et plus crédibles que les discours des projets concurrents. Ce sont les populations mobilisées qui, sur le long terme, sont les plus à même de faire levier pour des transformations radicales. Mais le dépassement de l’entreprise capitaliste est indissociable de la socialisation des banques et des marchés. Il s’agissait dans cet ouvrage de contribuer à transformer les représentations concernant les finalités et les structures d’une entité centrale du capitalisme. Néanmoins, il reste encore une longue marche théorique et politique vers une véritable remise en cause de la monopolisation des pouvoirs pour parvenir à la souveraineté des producteurs sur le travail.
LVSL – Les réflexions autour du concept de « propriété » ne devraient-elles pas suggérer que le dépassement du capitalisme n’est pas l’abolition de la propriété mais sa mutation profonde ?
D. B. – Ce qui pose problème au sein du capitalisme, c’est le droit issu de la propriété, c’est-à-dire le pouvoir de prendre des décisions qui vont avoir des effets directs sur la vie professionnelle des salariés tels que choix d’investissements restructurations d’entreprise, délocalisations, licenciements, etc. Ce n’est pas le droit à la propriété, qui permet, par exemple, de disposer de l’usage permanent de son téléphone portable, de sa voiture ou de son appartement.
Sachant qu’il n’y a pas d’entreprise sans le véhicule juridique qu’est la société, le plus important est de donner à cette dernière une orientation politique. C’est une entité spécifique à dissocier de la propriété et de la rentabilité. Le nouveau statut de l’entreprise que nous proposons ne pourra plus se couler dans la forme actuelle de l’appropriation actionnariale ou patrimoniale. En lui assignant une autre finalité que la rentabilité immédiate, le collectif de travail sera en mesure de jouer son rôle. Ce n’est pas l’acte d’entreprendre qu’il faut combattre mais le principe d’accaparement qui le conditionne aujourd’hui comme hier.
Plus généralement, il s’agit de se déprendre des formes de domination qui n’ont aucune légitimité dans un monde dit démocratique. C’est dire la nécessité de sortir de l’actuelle asymétrie des pouvoirs qui est fondée, à la fois sur le droit issu de la propriété et sur un rapport de subordination dans l’entreprise. Le rapport d’autorité ou de commandement hiérarchique dans les organisations est incompatible avec la démocratisation des rapports de travail qui privilégie en priorité un espace institutionnel auto-organisé et auto-gouverné. C’est par un nouveau cadre juridique et règlementaire que pourra être instituée la gestion démocratique de la production et de la redistribution des ressources. Dans ce nouveau cadre, les notions de pouvoir et de démocratie délibérative seront essentielles et à ce titre elles devront être dissociées de tout régime exclusif de propriété. La propriété ne peut plus conférer à un détenteur de ses droits un pouvoir supérieur à celui des autres agents pour orienter la production et la répartition des revenus et des richesses. Le projet est bien de sortir de la propriété lucrative orientée profit tout en rappelant que la propriété d’usage relève avant tout de la maîtrise du travail par les salariés-producteurs au sein d’unités institutionnelles qui conçoivent, produisent et vendent les biens et/ou les services.
Notes :
[1] Brodier Paul-Louis, « La logique de la valeur ajoutée, une autre façon de compter », L’Expansion Management Review, 2013/1, n° 148, p.20-27.
[2] Jacques Richard, Alexandre Rambaud, Révolution comptable, pour une entreprise écologique et sociale, Ivry-sur-Seine, Les éditions de l’Atelier, 2020.
[3] Le Collège des Bernardins se définit comme un espace de réflexion pluridisciplinaire où, régulièrement, sont organisés débats, séminaires de recherche et autres ateliers de création artistique.
[4] La crise de trop, Reconstruction d’un monde failli, Paris, Fayard, 2009.
Pour en savoir plus :
Dépasser l’entreprise capitaliste. Editions du croquant – Collection Les cahiers du salariat.
Sous la direction de Daniel Bachet et Benoît Borrits, avec les contributions de Thomas Coutrot, Hervé Defalvard, Olivier Favereau, François Morin et Jacques Richard. Introduction générale de Bernard Friot.




