Agenda militant
Ailleurs sur le Web
![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)
- C’est quoi le "marxisme classique" et le "marxisme occidental" ? (10/03)
- “Le socialisme est la maison commune de tous les combats justes.” – Entretien avec Joseph Andras (10/03)
- Sur Franceinfo : Brigitte Boucher et les irresponsables (10/03)
- Ce que révèle l’affaire Epstein (10/03)
- Au Liban, d’une guerre coloniale à l’autre et du droit de résister (10/03)
- POUR UN FRONT ANTIFASCISTE AU SECOND TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES (10/03)
- Meeting de la campagne municipale LFI à Lille (10/03)
- Meeting avec Jean-Luc Mélenchon et Sophia Chikirou à Paris ! (09/03)
- Colombie : la gauche de Gustavo Petro valide le dernier test des législatives avant la présidentielle (09/03)
- Penser l’émancipation autrement, discuter l’apport de marxistes hétérodoxes [Podcast] (09/03)
- Terrorisme d’Ultra-droite (08/03)
- "L’Iran est sur le point d’obtenir l’arme nucléaire" : trente ans de prophéties démenties (08/03)
- Hommage au chercheur marxiste Michael Parenti – Compilation d’entretiens (08/03)
- La guerre de trop : les Américains et les Israéliens n’ont rien compris à l’Iran ! (08/03)
- Poutou annonce un probable soutien du NPA-A à Mélenchon en 2027 (07/03)
- Attaques en série contre LFI (07/03)
- Des maires insoumis pour tout changer | Clip officiel - Municipales 2026 (07/03)
- Romaric Godin : "La force fondamentale du capitalisme le pousse vers le néofascisme" (07/03)
- Quentin Deranque était en première ligne dans la bagarre (06/03)
- Tirer une balle dans la tête sans intention de donner la mort (06/03)
- Les États-Unis et Israël nous entraînent dans une barbarie suicidaire (06/03)
- Clémence Guetté sur RTL ce jeudi (06/03)
- Annuler LFI : le dangereux fantasme du PS (06/03)
- L’Iran est-il un "régime des mollahs" ? (05/03)
- BAYLET, notable p*docriminel ? | Documentaire | OFF (05/03)
Liens
La décroissance, une opposition inoffensive voire contre-productive (par Riesel & Semprun)
Ces articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » sont publiés à titre d'information et n'engagent pas la Tendance CLAIRE.
Parce qu'il est important de dénoncer l'idéologie de la décroissance et les problèmes qu'elle pose, notamment en ce qu'elle ne s'oppose pas mais soutient l'existence (voire le renforcement) de l'Etat (et de toutes les nuisances associées, dont celles auxquelles la décroissance prétend s'attaquer), en voici une critique, tirée de l'excellent livre "Catastrophisme, administration du désastre et soumission durable", écrit par René Riesel et Jaime Semprun, et publié aux éditions de l'Encyclopédie des nuisances en 2008:
L’extinction finale vers laquelle nous entraîne la perpétuation de la société industrielle est devenue en très peu d’années notre avenir officiel. Qu’elle soit considérée sous l’angle de la pénurie énergétique, du dérèglement climatique, de la démographie, des mouvements de populations, de l’empoisonnement ou de la stérilisation du milieu, de l’artificialisation des êtres vivants, sous tous ceux-là à la fois ou sous d’autres encore, car les rubriques du catastrophisme ne manquent pas, la réalité du désastre en cours, ou du moins des risques et des dangers que comporte le cours des choses, n’est plus seulement admise du bout des lèvres, elle est désormais détaillée en permanence par les propagandes étatiques et médiatiques. Quant à nous, qu’on a souvent taxés de complaisance apocalyptique pour avoir pris ces phénomènes au sérieux ou de « passéisme » pour avoir dit l’impossibilité de trier parmi les réalisations et les promesses de la société industrielle de masse, prévenons tout de suite que nous n’entendons rien ajouter ici aux épouvantables tableaux d’une crise écologique totale que brossent sous les angles les plus variés tant d’experts informés, dans tant de rapports, d’articles, d’émissions, de films et d’ouvrages dont les données chiffrées sont diligemment mises à jour par les agences gouvernementales ou internationales et les ONG compétentes. Ces éloquentes mises en garde, quand elles en arrivent au chapitre des réponses à apporter devant des menaces aussi pressantes, s’adressent en général à « l’humanité » pour la conjurer de « changer radicalement ses aspirations et son mode de vie » avant qu’il ne soit trop tard. On aura remarqué que ces injonctions s’adressent en fait, si l’on veut bien traduire leur pathos moralisant en un langage un peu moins éthéré, aux dirigeants des États, aux institutions internationales, ou encore à un hypothétique« gouvernement mondial » qu’imposeraient les circonstances. Car la société de masse (c’est-à-dire ceux qu’elle a intégralement formés, quelles que soient leurs illusions là-dessus) ne pose jamais les problèmes qu’elle prétend « gérer » que dans les termes qui font de son maintien une condition sine qua non. On n’y peut donc, dans le cours de l’effondrement, qu’envisager de retarder aussi longtemps que possible la dislocation de l’agrégat de désespoirs et de folies qu’elle est devenue ; et on n’imagine y parvenir, quoi qu’on en dise, qu’en renforçant toutes les coercitions et en asservissant plus profondément les individus à la collectivité. Tel est le sens véritable de tous ces appels à une« humanité » abstraite, vieux déguisement de l’idole sociale, même si ceux qui les lancent, forts de leur expérience dans l’Université, l’industrie ou l’expertise (c’est, comme on s’en félicite, la même chose), sont pour la plupart mus par des ambitions moins élevées et rêvent seulement d’être nommés à la tête d’institutions ad hoc ; tandis que des fractions significatives des populations se découvrent toutes disposées à s’atteler bénévolement aux basses œuvres de la dépollution ou de la sécurisation des personnes et des biens.
Nous n’attendons rien d’une prétendue « volonté générale » (que ceux qui l’invoquent supposent bonne, ou susceptible de le redevenir pour peu qu’on la morigène avec assez de sévérité pour corriger ses coupables penchants), ni d’une « conscience collective des intérêts universels de l’humanité » qui n’a à l’heure actuelle aucun moyen de se former, sans parler de se mettre en pratique. Nous nous adressons donc à des individus d’ores et déjà réfractaires au collectivisme croissant de la société de masse, et qui n’excluraient pas par principe de s’associer pour lutter contre cette sursocialisation. Beaucoup mieux selon nous que si nous en perpétuions ostensiblement la rhétorique ou la mécanique conceptuelle, nous pensons par là être fidèles à ce qu’il y eut de plus véridique dans la critique sociale qui nous a pour notre part formés, il y a déjà quarante ans. Car celle-ci, indépendamment de ses faiblesses par trop évidentes avec le recul du temps ou, si l’on préfère, avec la disparition du mouvement dans lequel elle se pensait inscrite, eut pour principale qualité d’être le fait d’individus sans spécialité ni autorité intellectuelle garantie par une idéologie ou une compétence socialement reconnue (une « expertise », comme on dit de nos jours) ; d’individus, donc, qui, ayant choisi leur camp, ne s’exprimaient pas, par exemple, en tant que représentants d’une classe vouée par prédestination à accomplir sa révolution, mais en tant qu’individus cherchant les moyens de se rendre maîtres de leur vie, et n’attendant rien que de ce que d’autres, eux-mêmes « sans qualités », sauraient à leur tour entreprendre pour se réapproprier la maîtrise de leurs conditions d’existence.
[…] Cependant, à côté du marché, certains proposent d’autres fictions, plus théoriques ou politiques, pour « donner à rêver » sur l’écroulement d’un monde. Ces spéculations sur la catastrophe salvatrice ont leur version douce chez les idéologues de la « décroissance » qui parlent de « pédagogie des catastrophes ». Mais chez les plus valeureux des marxistes on veut croire aussi que « l’autodestruction du capitalisme » laissera un « vide », fera table rase pour mettre enfin le couvert du banquet de la vie. On reste là dans le cadre de la dénégation, puisqu’on ne reconnaît le délabrement unifié du monde et de ses habitants que pour s’en débarrasser immédiatement par la grâce de« l’autodestruction », et se bercer de ce conte fantastique : une humanité sortant immaculée de sa plongée dans la modernité industrielle, plus que jamais prête à raviver son amour inné de la liberté, sans même – Wifi aidant ? – se prendre les pieds dans les fils de sa connectique.
Il existe néanmoins des théorisations plus hard, authentiquement extrémistes dans leur conception du salut par la catastrophe, où celle-ci ne se voit pas seulement chargée de produire les « conditions objectives » de l’émancipation, mais aussi ses « conditions subjectives » : le genre de matériel humainnécessaire à de tels scénarios pour y personnifier un sujet révolutionnaire. Le synopsis des fictions en question peut être trouvé chez le Vaneigem de 1967 : « Quand une canalisation d’eau creva dans le laboratoire de Pavlov, aucun des chiens qui survécurent à l’inondation ne garda la moindre trace de son long conditionnement. Le raz de marée des grands bouleversements sociaux aurait-il moins d’effets sur les hommes qu’une inondation sur des chiens? » Seule différence, de taille il est vrai, les « miracles » alors attribués au « choc de la liberté » le sont maintenant à celui d’un effondrement catastrophique, c’est-à-dire plutôt à la dure nécessité. L’un attend ainsi des conditions de survie matérielles se délabrant encore qu’elles entraînent, dans les zones les plus dévastées, ravagées, empoisonnées, un dénuement si absolu et de telles épreuves qu’aura lieu alors, de façon d’abord chaotique et épisodique, puis universellement avec la multiplication de ces enclaves où l’insurrection deviendra une nécessité vitale, une « véritable catharsis », grâce à laquelle l’humanité se régénérera et accédera à une nouvelle conscience, qui sera à la fois sociale, écologique, vivante et unitaire. (Ceci n’est pas une satire, mais un résumé fidèle du chapitre final du dernier livre de Michel Bounan, La Folle Histoire du monde, 2006.) D’autres, qui se déclarent plus portés à l’organisation et à « l’expérimentation de masse », voient dès maintenant dans la décomposition de toutes les formes sociales une « aubaine » : de même que pour Lénine l’usine formait l’armée des prolétaires, pour ces stratèges qui misent sur la reconstitution des solidarités inconditionnelles de type clanique, le chaos « impérial » moderne forme les bandes, cellules de base de leur parti imaginaire, qui s’agrégeront en « communes » pour aller vers l’insurrection (L’insurrection qui vient, 2007). Ces songeries catastrophiles s’accordent à se déclarer enchantées de la disparition de toutes les formes de discussion et de décision collectives par lesquelles l’ancien mouvement révolutionnaire avait tenté de s’auto-organiser : l’un daube sur les conseils de travailleurs, les autres sur les assemblées générales.
Pour avoir une vue plus exacte de ce qu’il est possible d’attendre d’un effondrement des conditions de survie matérielles, comme du retour à des formes de solidarité clanique, il paraît préférable de regarder vers le jardin d’essai moyen-oriental, cette façon d’éclosoir infernal où chacun dépose tour à tour ses embryons monstrueux sur fond de désastre écologique et humain outrepassé.
 On peut facilement, à la façon d’une certaine sociologie semi-critique, rapporter les diverses modalités du catastrophisme à des milieux sociaux hiérarchiquement distincts, et pointer comment chacun d’eux développe la fausse conscience qui lui correspond, en idéalisant en guise de « solution » l’activité gestionnaire, professionnelle ou bénévole qui est déjà la sienne dans l’administration du désastre. Cependant une telle perspicacité à courte vue laisse de côté le plus remarquable : le fait qu’il n’est presque personne pour refuser de souscrire à la véritableproscription de la liberté que prononcent unanimement les divers scénarios catastrophistes, quelles que soient par ailleurs leurs variantes ou contradictions. Car même là où on n’est pas directement intéressé à la promotion de l’embrigadement, et où l’on parle d’émancipation, c’est pour postuler que cette émancipation sera imposée comme une nécessité, non pas voulue pour elle-même et recherchée consciemment.
On peut facilement, à la façon d’une certaine sociologie semi-critique, rapporter les diverses modalités du catastrophisme à des milieux sociaux hiérarchiquement distincts, et pointer comment chacun d’eux développe la fausse conscience qui lui correspond, en idéalisant en guise de « solution » l’activité gestionnaire, professionnelle ou bénévole qui est déjà la sienne dans l’administration du désastre. Cependant une telle perspicacité à courte vue laisse de côté le plus remarquable : le fait qu’il n’est presque personne pour refuser de souscrire à la véritableproscription de la liberté que prononcent unanimement les divers scénarios catastrophistes, quelles que soient par ailleurs leurs variantes ou contradictions. Car même là où on n’est pas directement intéressé à la promotion de l’embrigadement, et où l’on parle d’émancipation, c’est pour postuler que cette émancipation sera imposée comme une nécessité, non pas voulue pour elle-même et recherchée consciemment.
Telle est en effet la rigueur de l’incarcération industrielle, l’ampleur du délabrement unifié des mentalités à quoi elle est parvenue, que ceux qui ont encore le ressort de ne pas vouloir se sentir entièrement emportés par le courant et disent songer à y résister échappent rarement, quelque condamnation qu’ils profèrent contre le progrès ou la technoscience, au besoin de justifier leurs dénonciations, ou même leur espoir d’une catastrophe salvatrice, à l’aide des données fournies par l’expertise bureaucratique et des représentations déterministes qu’elles permettent d’étayer. Tout cela pour rhabiller les lois de l’Histoire — celles qui faisaient inéluctablement cheminer du règne de la nécessité à celui de la liberté — en démonstration scientifique ; selon laquelle, par exemple, la loi de Carnot viendra à bout de la société « thermo-industrielle », l’épuisement des ressources énergétiques fossiles la contraignant — ou au moins ses décideurs — à la décroissance conviviale et à la joie de vivre.
Notre époque, par ailleurs si attentive aux ressources qu’elle se connaît, et à l’hypothèse de leur tarissement, n’envisage jamais d’avoir recours à celles, proprement inépuisables, auxquelles la liberté pourrait donner accès ; à commencer par la liberté se penser contre les représentations dominantes. On nous opposera platement que personne n’échappe aux conditions présentes, que nous ne sommes pas différents, etc. Et certes, qui pourrait se targuer de faire autrement que de s’adapter aux nouvelles conditions, de « faire avec » des réalités matérielles aussi écrasantes, même s’il ne pousse pas l’inconscience jusqu’à s’en satisfaire à quelques réserves près ? Personne n’est en revanche obligé de s’adapter intellectuellement, c’est-à-dire d’accepter de « penser » avec les catégories et dans les termes qu’a imposés la vie administrée.
Au début de ses Considérations sur l’histoire universelle, Burckhardt notait que la connaissance de l’avenir, si elle était possible (ce que, selon lui, elle n’était pas), entraînerait « une confusion de toute volonté et de toute ambition, car celles-ci ne se développent complètement que si elles agissent “à l’aveuglette”, c’est-à-dire en suivant leur propre impulsion ». Notre époque, quant à elle, croit pouvoir lire son avenir dans les modélisations de ses ordinateurs, sur les écrans desquels le calcul des probabilités, à moins que ce ne soient les lois de la thermodynamique, trace son Mané, Thécel, Pharès.Mais sans doute faut-il voir là, à l’inverse de l’intuition de Burckhardt, l’effet plutôt que la cause de l’engourdissement de l’énergie historique, de la perte du goût de la liberté et de l’intervention autonome ; ou du moins considérer que c’est là où l’humanité a perdu un certain ressort vital, l’impulsion d’agir directement sur son sort, sans certitudes ni garanties, qu’elle se laisse fasciner et accabler par les projections du catastrophisme officiel.
Pour parodier une fois encore un fameux incipit, on pourrait dire que toute la vie de la société industrielle devenue mondiale s’annonce désormais comme une immense accumulation de catastrophes. Le succès de la propagande pour les mesures autoritaires inévitables (« Demain il sera trop tard », etc.) repose sur le fait que les experts catastrophistes se posent en simples interprètes de forces qu’on peut prédire. Mais la technique de la prédiction infaillible n’est pas la seule reprise de l’ancien prophétisme révolutionnaire. Cette connaissance scientifique de l’avenir sert en effet à introduire la vieille image rhétorique de la croisée des chemins, où « l’humanité » se trouverait face à l’alternative ainsi posée, sur le modèle « socialisme ou barbarie » : sauvetage de la civilisation industrielle ou effondrement dans un chaos barbare. (« L’écologisme récupère tout cela, et y ajoute son ambition technobureaucratique de donner la mesure de toute chose, de rétablir l’ordre à sa façon, en se transformant, en tant que science de l’économie généralisée, en une nouvelle pensée de la domination. “Nous ou le chaos”, disent les écolocrates et experts recyclés, promoteurs d’un contrôle totalitaire exercé par leurs soins, pour prendre de vitesse la catastrophe en marche. Ce sera donc eux et le chaos. » (Encyclopédie des Nuisances, n° 15, avril 1992.))
L’artifice de la propagande consiste à affirmer à la fois que l’avenir est l’objet d’un choix conscient, que l’humanité pourrait faire collectivement, comme un seul homme, en toute connaissance de cause une fois instruite par les experts, et qu’il est régi par un implacable déterminisme qui ramène ce choix à celui de vivre ou de périr ; c’est-à-dire de vivre selon les directives des organisateurs du sauvetage de la planète, ou de périr parce qu’on sera resté sourd à leurs mises en garde. Un tel choix se ramène donc à une contrainte qui règle le vieux problème de savoir si les hommes aiment la servitude, puisque désormais ils seraient contraints de l’aimer. Comme le constate le désarmant Latouche, avec une simplicité qui n’est peut-être pas volontaire : « Au fond, qui s’élève contre la sauvegarde de la planète, la préservation de l’environnement, la conservation de la faune et de la flore ? Qui préconise le dérèglement climatique et la destruction de la couche d’ozone? » (Le Pari de la décroissance, 2006.) Selon Arendt, le problème de la domination totale était « de fabriquer quelque chose qui n’existe pas : à savoir une sorte d’espèce humaine qui ressemble aux autres espèces animales et dont la seule “liberté” consisterait à “conserver l’espèce” »(Le Totalitarisme). Sur la terre ravagée, devenue effectivement, par l’artificialité technique de la survie qui y restera possible, comparable à un « vaisseau spatial », ce programme cesserait d’être une chimère de la domination pour devenir une revendication des dominés. (Pages 40-46)

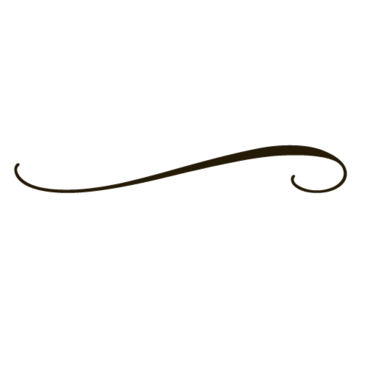
Ici, c’est parmi les concepteurs et les agents des programmes de développement mis en place depuis l’après-guerre qu’est apparue une minorité de dissidents maison – certains se feront même« objecteurs de croissance » – qui commenceront à « lancer l’alarme » sans cesser de garder un pied, ou de placer leurs amis, dans les institutions, leurs colloques, séminaires et think tanks. S’y sont pragmatiquement agrégés les partisans d’une critique écologique expurgée de toute considération liée à la critique sociale. […]
Si l’on s’en tenait à la formule de Nougé (« L’intelligence doit avoir un mordant. Elle attaque un problème »), on serait tenté de n’accorder qu’une intelligence fort médiocre à Latouche, principal penseur de la « décroissance », cette idéologie qui se donne pour une critique radicale du développement économique et de ses sous-produits « durables ». Il fait montre en effet d’un talent bien professoral, confinant parfois au génie, pour affadir tout ce qu’il touche et faire de n’importe quelle vérité critique, en la traduisant en novlangue décroissante, une platitude insipide et bien-pensante. Il ne faudrait pas cependant lui attribuer tout le mérite d’une fadeur doucereusement édifiante qui est surtout le résultat d’une sorte de politique : celle par laquelle la gauche de l’expertise cherche à mobiliser des troupes en rassemblant tous ceux qui veulent croire qu’on pourrait « sortir du développement » (c’est-à-dire du capitalisme) tout en y restant. Ce n’est donc pas en tant qu’œuvre personnelle que nous évaluerons les écrits de Latouche (à cet égard, le génie de la langue est plus cruel que n’importe quel jugement : sa prose lui rend justice). Qu’une telle eau tiède, sur laquelle surnagent tous les clichés du citoyennisme écocompatible, puisse passer pour porteuse d’une quelconque subversion — fût-elle « cognitive » —, voilà qui donne seulement la mesure du conformisme ambiant. En revanche, pour ce qui nous intéresse ici, Latouche est parfait : il sait magistralement flatter la bonne conscience et entretenir les illusions du petit personnel qui s’affaire déjà à « tisser du lien social », et qui se voit accédant bientôt à l’encadrement dans l’administration du désastre. C’est ce qu’il appelle lui-même, en tête de son dernier bréviaire (Petit Traité de la décroissance sereine, 2007), fournir « un outil de travail utile pour tout responsable associatif ou politique engagé, en particulier dans le local ou le régional« .
Le programme de la décroissance, tel que Latouche le propose donc au citoyennisme décomposé comme à l’écologisme en quête de recomposition, n’est pas sans évoquer celui tracé en 1995 par l’Américain Rifkin, dans son livre La Fin du travail. Il s’agissait déjà« d’annoncer la transition vers une société post-marchande et post-salariale » par le développement de ce que Rifkin nomme le « tiers secteur » (c’est-à-dire en gros ce qu’on appelle en France « mouvement associatif » ou « économie sociale »), et pour ce faire de lancer un« mouvement social de masse », « susceptible d’exercer une forte pression à la fois sur le secteur privé et sur les pouvoirs publics », « pour obtenir le transfert d’une partie des énormes bénéfices de la nouvelle économie de l’information dans la création de capital social et la reconstruction de la société civile ». Mais chez les décroissants, on compte plutôt sur les dures nécessités de la crise écologique et énergétique, dont on se propose de faire autant de vertus, pour exercer « une forte pression » sur les industriels et les États. En attendant, les militants de la décroissance doivent prêcher par l’exemple, se montrer pédagogiquement économes, en avant-garde du rationnement baptisé « simplicité volontaire ».

Précisément parce que les décroissants se présentent comme porteurs de la volonté la plus déterminée de « sortir du développement », c’est chez eux que se mesurent le mieux à la fois la profondeur du regret d’avoir à le faire (renversé en autoflagellation et en commandements vertueux) et l’enfermement durable dans les catégories de l’argumentation « scientifique ». Le fatum thermodynamique soulage heureusement du choix de l’itinéraire à emprunter : c’est la « loi d’entropie » qui impose comme seule « alternative » la voie de la décroissance. Avec cet œuf de Colomb, pondu par leur « grand économiste » Georgescu-Roegen, les décroissants sont sûrs de tenir l’argument imparable qui ne peut que convaincre industriels et décideurs de bonne foi. À défaut de quoi, les conséquences, prévisibles et calculables, sauront les contraindre à faire les choix qui s’imposent (comme dit Cochet, dont Latouche aime à citer le livre Pétrole apocalypse : « À cent dollars le baril de pétrole, on change de civilisation ».).
Qualifier la société de thermo-industrielle permet aussi de négliger tout ce qui d’ores et déjà s’y produit en matière de coercitions et d’embrigadement, sans contribuer, ou si peu, à l’épuisement des ressources énergétiques. On passe d’autant plus volontiers là-dessus qu’on y trempe soi-même, à l’Éducation nationale ou ailleurs. Attribuer tous nos maux au caractère« thermo-industriel » de cette société est donc assez confortable, en même temps qu’assez simpliste pour combler les appétits critiques des niais et des crétins arrivistes, déchets ultimes de l’écologisme et du « mouvement associatif », qui font la base de la décroissance. C’est le souci de ne pas brusquer cette base avec des vérités trop rudes, de lui faire miroiter une transition en douceur vers « l’ivresse joyeuse de l’austérité partagée » et le « paradis de la décroissance conviviale » qui amène Latouche, lequel n’est tout de même pas si bête, à de telles pauvretés volontaires, prudences de tournée électorale ou d’encyclique pontificale : « Il est de plus en plus probable qu’au-delà d’un certain seuil, la croissance du PNB se traduise par une diminution du bien-être » ; ou encore, après s’être aventuré jusqu’à imputer au « système marchand » la désolation du monde : « Tout cela confirme les doutes que nous avions émis sur l’écocompatibilité du capitalisme et d’une société de décroissance ». (Le Pari de la décroissance, 2006.)

Ce que les idéologues officiels de la décroissance n’osent soutenir, là où ils craignent de s’aventurer, et pour certains, ce à quoi ils s’opposent…
Car, même si la plupart des décroissants ont jugé prématuré ou maladroit de créer formellement un« Parti de la décroissance », et préférable de « peser dans le débat », il y a bien là une sorte de parti qui ne dit pas son nom, avec sa hiérarchie informelle, ses militants de base, ses intellectuels et experts, ses dirigeants et fins politiques. Tout cela baigne dans les vertueuses conventions d’un citoyennisme qu’on se garde de choquer par quelque outrance critique : il faut surtout ne froisser personne au Monde diplomatique, ménager la gauche, le parlementarisme (« Le rejet radical de la « démocratie » représentative a quelque chose d’excessif », ibid.), et plus généralement le progressisme en se gardant de jamais paraître passéiste, technophobe, réactionnaire. La« transition » vers la « sortie du développement » doit donc rester assez vague pour ne pas interdire les combinaisons et les arrangements de ce que l’on dénonce rituellement sous le nom de « politique politicienne » : « Les compromis possibles sur les moyens de la transition ne doivent pas faire perdre de vue les objectifs sur lesquels on ne peut transiger ». (Petit traité de la décroissance sereine, 2007.) Ces objectifs sont psalmodiés par Latouche dans un style digne de l’école des cadres du Parti : « Rappelons ces huit objectifs interdépendants susceptibles d’enclencher un cercle vertueux de décroissance sereine, conviviale et soutenable : réévaluer, reconceptualiser, restructurer, redistribuer, relocaliser, réduire, réutiliser, recycler ». (Ibid.) Quant à réutiliser et recycler, Latouche donne sans attendre l’exemple en rabâchant et ressassant d’un livre à l’autre les mêmes vœux pieux, statistiques, indices, références, exemples et citations. Tournant en rond dans son « cercle vertueux », il cherche cependant à innover et a ainsi enrichi son catalogue de deux « R » (reconceptualiser et relocaliser) depuis l’époque où le fier projet de« défaire le développement, refaire le monde » s’élaborait sous l’égide de l’Unesco (cf. Survivre au développement, 2004). On comprend dès lors assez mal l’absence d’un neuvième commandement, (se) réapproprier, désormais récuré de tout relent révolutionnaire (l’antique« Exproprions les expropriateurs! ») ; ainsi décontaminé, il va pourtant comme un gant fait main à l’expéditive entreprise de récupération à laquelle se livrent les décroissants pour se bricoler, vite fait, une galerie d’ancêtres présentables (où figure maintenant « une tradition anarchiste au sein du marxisme, réactualisée par l’École de Francfort, le conseillisme et le situationnisme », Petit traité…).
Selon Latouche, le « pari de la décroissance (…) consiste à penser que l’attrait de l’utopie conviviale combiné au poids des contraintes au changement est susceptible de favoriser une « décolonisation de l’imaginaire » et de susciter suffisamment de « comportements vertueux en faveur d’une solution raisonnable : la démocratie écologique » (Le Pari de la décroissance). Si, en fait de « contraintes au changement », on voit bien à quoi peuvent servir les décroissants — à relayer par leurs appels à l’autodiscipline la propagande pour le rationnement, afin que, par exemple, l’agriculture industrielle ne manque pas d’eau pour l’irrigation —, on discerne en revanche assez mal quel attrait pourrait exercer une « utopie » dont le « programme quasi électoral » fait une place au bonheur et au plaisir en proposant d’impulser « la « production » de biens relationnels ». Certes on se méfierait de trop lyriques envolées sur les lendemains qui décroissent. On n’y est guère exposé lorsque ces besogneux, coiffés de leur bonnet de nuit, exposent avec un entrain d’animateur socioculturel leurs promesses de « joie de vivre » et de sérénité conviviale. […] Le bonheur semble une idée si neuve pour ces gens, l’idée qu’ils s’en font paraît tellement conforme aux joies promises par un festin macrobiotique, qu’on ne peut que supposer qu’ils se font eux-mêmes mourir d’ennui ou que quelque casseur de pub leur en a fait la remarque. Ils s’emploient désormais, notamment dans leur revue « théorique » Entropia, à montrer qu’ils raffolent de l’art et de la poésie. On voit déjà l’affichette et les flyers (« Dimanche après-midi à la Maison des associations de Moulins-sur-Allier, de 15 h 30 à 17 heures, le club des poètes locaux et l’association des sculpteurs bretons se livreront à une amusante performance, suivie d’un goûter bio »).

Ceci n’est pas la couverture du prochain livre de Serge Latouche.
L’idéologie de la décroissance est née dans le milieu des experts, parmi ceux qui, au nom du réalisme, voulaient inclure dans une comptabilité « bioéconomique » ces « coûts réels pour la société » qu’entraîne la destruction de la nature. Elle conserve de cette origine la marque ineffaçable : en dépit de tous les verbiages convenus sur le « réenchantement du monde », l’ambition reste, à la façon de n’importe quel technocrate à la Lester Brown, « d’internaliser les coûts pour parvenir à une meilleure gestion de la biosphère ». Le rationnement volontaire est prôné à la base, pour l’exemplarité, mais on en appelle au sommet à des mesures étatiques : redéploiement de la fiscalité (« taxes environnementales »), des subventions, des normes. Si l’on se risque parfois à faire profession d’anticapitalisme — dans la plus parfaite incohérence avec des propositions comme celle d’un « revenu minimum garanti », par exemple — on ne s’aventure jamais à se déclarer anti-étatiste. La vague teinte libertaire n’est là que pour ménager une partie du public, donner une touche de gauchisme très consensuel et « antitotalitaire ». Ainsi l’alternative irréelle entre « écofascisme » et « éco-démocratie » sert surtout à ne rien dire de la réorganisation bureaucratique en cours, à laquelle on participe sereinement en militant déjà pour l’embrigadement consenti, la sursocialisation, la mise aux normes, la pacification des conflits. Car la peur qu’exprime ce rêve puéril d’une « transition » sans combat est, bien plus que celle de la catastrophe dont on agite la menace pour amener les décideurs à résipiscence, celle des désordres où liberté et vérité pourraient prendre corps, cesser d’être des questions académiques. Et c’est donc très logiquement que cette décroissance de la conscience finit par trouver son bonheur dans le monde virtuel, où l’on peut sans se sentir coupable voyager « avec un impact très limité sur l’environnement » (Entropia, n° 3, automne 2007) ; à condition toutefois d’oublier qu’en 2007, selon une étude récente, « le secteur des technologies de l’information, au niveau mondial, a autant contribué au changement climatique que le transport aérien » (Le Monde, 13-14 avril 2008).
Aussi éloigné de toute outrance Latouche sache-t-il se montrer dans l’accomplissement de son« devoir d’iconoclastie », la décroissance n’en a pas moins ses révisionnistes, qui l’invitent à oser paraître ce qu’elle est et à remiser une fois pour toutes un accoutrement subversif qui lui va si mal : « Une première proposition pour consolider l’idée d’une décroissance pacifique serait un renoncement clair et sans équivoque à l’objectif révolutionnaire. Casser, détruire ou renverser le monde industriel me semble non seulement une lubie dangereuse, mais un appel caché à la violence, tout comme l’était la volonté de supprimer les classes sociales dans la théorie marxiste ». (Alexandre Genko, « La décroissance, une utopie sans danger? », Entropia n° 4, printemps 2008.) Même un Besset, pourtant porte-plume de Hulot et défenseur du « Grenelle de l’environnement » comme« premier pas dans une démarche de transition vers la mutation écologique, sociale et culturelle de la société », a du mal après cela à surenchérir de modération : « Face à l’ampleur et à la complexité de la tâche, ce ne sont certainement pas les projections verbeuses ou les catéchismes doctrinaires qui s’avéreront d’un grand secours. (…) On a beau habiller la décroissance d’adjectifs sympathiques —conviviale, équitable, heureuse —, l’affaire ne se présente pas avec le sourire (…) les transitions vont être redoutables, les arrachements douloureux ». (Ibid.) Ces vertes remontrances disent à leur façon assez bien en quoi les recommandations décroissantes ne constituent d’aucune façon un programme dont il y aurait lieu de discuter le contenu, et quelle est la partition imposée sur laquelle elles essaient de jouer leur petite musique (decrescendo cantabile), en guise d’accompagnement de fin de vie pour une époque de la société industrielle : un « nouvel art de consommer » dans les ruines de l’abondance marchande.
L’image que se faisait de lui-même ce que l’on appelait naguère le « monde libre » n’avait en fait guère varié depuis Yalta : ce conformisme démocratique, bardé de ses certitudes, de ses marchandises et de ses technologies désirables, avait certes été brièvement ébranlé par des troubles révolutionnaires autour de 1968, mais la « chute du mur » avait semblé lui assurer une sorte d’éternité (on avait expéditivement parlé de « fin de l’histoire »), et l’on croyait pouvoir se féliciter de ce que les cousins pauvres veuillent accéder à leur tour et au plus vite à semblables délices. Il a cependant fallu par la suite commencer à s’inquiéter du nombre des cousins, surtout des plus lointains, et à se demander s’ils faisaient vraiment partie de la famille, quand ils se sont mis à accroître inconsidérément leur« empreinte carbone ». Ce dont tout le monde s’alarme désormais, ce n’est plus seulement du scénario classique de surpopulation, où, en dépit des gains de productivité, les ressources alimentaires s’avéreraient insuffisantes à pourvoir aux besoins des surnuméraires, mais d’une configuration inédite dans laquelle, à population constante, la menace provient d’un trop-plein de modernes vivant de façon moderne : « Si les Chinois ou les Indiens doivent vivre comme nous… » Face à ce « réel catastrophique », les panacées technologiques que l’on fait encore miroiter (fusion nucléaire, transgénèse humaine, colonisation des océans, exode spatial vers d’autres planètes) n’ont guère l’allure d’utopies radieuses, sauf pour quelques illuminés, mais plutôt de palliatifs qui viendraient de toute façon beaucoup trop tard. Il reste donc à prêcher « âpres renoncements » et « arrachements douloureux » à des populations qui vont devoir « descendre de plusieurs degrés dans l’échelle de l’alimentation, des déplacements, des productions, des modes de vie » (Besset) ; et, vis-à-vis des nouvelles puissances industrielles, à revenir au protectionnisme au nom de la lutte contre le « dumping écologique », en attendant qu’émerge là aussi une relève plus consciente des « coûts environnementaux »et des mesures à prendre (réorientation qu’incarne en Chine le désormais ministre Pan Yue).
src="http://partage-le.com/wp-content/uploads/2015/03/andy-singer-green-false1.jpg" style="height:636px; width:535px" />
A propos de l’inutilité, de l’ineptie et des éco-nuisances que sont les alternatives soi-disant vertes : http://partage-le.com/2015/03/les-illusions-vertes-ou-lart-de-se-poser-les-mauvaises-questions/
Les « contraintes du présent » que se plaît à seriner le réalisme des experts sont exclusivement celles qu’imposent le maintien et la généralisation planétaire d’un mode de vie industriel condamné. Qu’elles ne s’exercent qu’à l’intérieur d’un système des besoins dont le démantèlement permettrait de retrouver, sous les complications démentes de la société administrée et de son appareillage technologique, les problèmes vitaux que la liberté peut seule poser et résoudre, et que ces retrouvailles avec des contraintes matérielles affrontées sans intermédiaires puissent être, en elles-mêmes, tout de suite, une émancipation, voilà des idées que personne ne se risque à défendre franchement et nettement, parmi tous ceux qui nous entretiennent des immenses périls créés par notre entrée dans l’anthropocène. Quand quelqu’un se hasarde à évoquer timidement quelque chose dans ce sens, que peut-être ce ne serait pas un renoncement bien douloureux que de se priver des commodités de la vie industrielle, mais au contraire un immense soulagement et une sensation de revivre enfin, il s’empresse en général de faire machine arrière, conscient qu’il sera taxé de terrorisme anti-démocratique, voire de totalitarisme ou d’écofascisme, s’il mène ses raisonnements à leur terme ; de là cette profusion d’ouvrages où quelques remarques pertinentes sont noyées dans un océan de considérations lénifiantes. Il n’y a presque plus personne pour concevoir la défense de ses idées, non comme une banale stratégie de conquête de l’opinion sur le modèle du lobbying, mais comme un engagement dans un conflit historique où l’on se bat sans chercher d’autre appui qu’un « pacte offensif et défensif avec la vérité », selon le mot d’un intellectuel hongrois en 1956. Ainsi on ne peut qu’être atterré par l’unification des points de vue, l’absence de toute pensée indépendante et de toute voix réellement discordante. Si l’on considère l’histoire moderne, ne serait-ce que celle du siècle dernier, on est pris de vertige à constater d’une part la variété et l’audace de tant de positions, d’hypothèses et d’avis contradictoires, quels qu’ils aient été, et d’autre part ce à quoi tout cela est maintenant réduit. Au lavage de cerveau auquel se sont livrés sur eux-mêmes tant de protagonistes toujours vivants répondent au mieux des travaux historiques parfois judicieux, mais qui semblent relever plutôt de la paléontologie ou des sciences naturelles, tant ceux qui les mènent paraissent loin d’imaginer que les éléments qu’ils mettent au jour pourraient avoir quelque usage critique aujourd’hui.
Le goût de la conformité vertueuse, la haine et la peur panique de l’histoire, sinon comme caricature univoque et fléchée, ont atteint un point tel qu’à côté de ce qu’est aujourd’hui un citoyenniste, avec ses indignations calibrées et labellisées, son hypocrisie de curé, sa lâcheté devant tout conflit direct, n’importe quel intellectuel de gauche des années cinquante ou soixante passerait presque pour un farouche libertaire débordant de combativité, de fantaisie et d’humour. À observer une telle normalisation des esprits, on en arriverait à croire à l’action d’une police de la pensée. En fait l’adhésion au consensus est le produit spontané du sentiment d’impuissance, de l’anxiété qu’il entraîne, et du besoin de rechercher la protection de la collectivité organisée par un surcroît d’abandon à la société totale. La mise en doute de n’importe laquelle des certitudes démocratiquement validées par l’assentiment général – les bienfaits de la culture par Internet ou ceux de la médecine de pointe – pourrait laisser soupçonner une déviation par rapport à la ligne de l’orthodoxie admise, peut-être même une pensée indépendante, voire un jugement portant sur la totalité de la vie aliénée. Et qui est-on pour se le permettre ? Tout cela n’est pas sans rappeler d’assez près la maxime de la soumission militante, perinde ac cadaver, ainsi que l’avait formulée Trotski : « Le Parti a toujours raison ». Mais alors que dans les sociétés bureaucratiques totalitaires la contrainte était ressentie comme telle par les masses, et que c’était un redoutable privilège des militants et des apparatchiks de devoir croire à la fiction d’un choix possible – pour ou contre la patrie socialiste, la classe ouvrière, le Parti –, c’est-à-dire d’avoir à mettre constamment à l’épreuve une orthodoxie jamais assurée, ce privilège est maintenant démocratisé, quoique avec moins d’intensité dramatique : pas question de s’opposer au bien de la société, ou à ce qu’elle y déclare nécessaire. C’est un devoir civique que d’être en bonne santé, culturellement à jour, connecté, etc. Les impératifs écologiques sont l’ultime argument sans réplique. Qui ne s’opposerait à la pédophilie, certes, mais surtout qui s’opposerait au maintien de l’organisation sociale qui permettra de sauver l’humanité, la planète et la biosphère ? Il y a là comme une aubaine pour un caractère « citoyen » déjà assez bien trempé et répandu.
En France, il est notable que la soumission apeurée prend une forme particulièrement pesante, quasi pathologique ; mais il n’est pas besoin pour l’expliquer de recourir à la psychologie des peuples : c’est tout simplement qu’ici le conformisme doit en quelque sorte travailler double pour s’affermir dans ses certitudes. Car il lui faut censurer le démenti que leur a infligé par avance, il y a déjà quarante ans, la critique de la société moderne et de son « système d’illusions » que portait la tentative révolutionnaire de Mai 1968, et qu’elle a fait fugitivement accéder à la conscience collective, en l’inscrivant dans l’éphémère espace public qu’avait créé son existence sauvage. Un rival décroissant de Latouche, qui s’affirme plus nettement « républicain » et « démocrate », c’est-à-dire étatiste et électoraliste, redoute ainsi que des « thèses et des pratiques extrémistes, maximalistes » viennent renforcer dans la jeunesse des travers qui lui seraient propres, « comme la haine de l’institution ou le rejet en bloc de la société »(Vincent Cheynet, Le Choc de la décroissance, 2008). (Pages 72-85)
René Riesel & Jaime Semprun




