Agenda militant
Ailleurs sur le Web
![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)
- Au cœur du capital (12/03)
- Le débat des représentants des partis, avec Paul Vannier (12/03)
- Meeting avec Bagayoko, Coquerel et Mélenchon à Saint-Denis ! (11/03)
- Ludivine Bantigny, "La Bourse ou la vie. Le Front populaire, histoire pour aujourd’hui" (11/03)
- C’est quoi le "marxisme classique" et le "marxisme occidental" ? (10/03)
- “Le socialisme est la maison commune de tous les combats justes.” – Entretien avec Joseph Andras (10/03)
- Sur Franceinfo : Brigitte Boucher et les irresponsables (10/03)
- Ce que révèle l’affaire Epstein (10/03)
- Au Liban, d’une guerre coloniale à l’autre et du droit de résister (10/03)
- POUR UN FRONT ANTIFASCISTE AU SECOND TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES (10/03)
- Meeting de la campagne municipale LFI à Lille (10/03)
- Meeting avec Jean-Luc Mélenchon et Sophia Chikirou à Paris ! (09/03)
- Colombie : la gauche de Gustavo Petro valide le dernier test des législatives avant la présidentielle (09/03)
- Penser l’émancipation autrement, discuter l’apport de marxistes hétérodoxes [Podcast] (09/03)
- Terrorisme d’Ultra-droite (08/03)
- "L’Iran est sur le point d’obtenir l’arme nucléaire" : trente ans de prophéties démenties (08/03)
- Hommage au chercheur marxiste Michael Parenti – Compilation d’entretiens (08/03)
- La guerre de trop : les Américains et les Israéliens n’ont rien compris à l’Iran ! (08/03)
- Poutou annonce un probable soutien du NPA-A à Mélenchon en 2027 (07/03)
- Attaques en série contre LFI (07/03)
- Des maires insoumis pour tout changer | Clip officiel - Municipales 2026 (07/03)
- Romaric Godin : "La force fondamentale du capitalisme le pousse vers le néofascisme" (07/03)
- Quentin Deranque était en première ligne dans la bagarre (06/03)
- Tirer une balle dans la tête sans intention de donner la mort (06/03)
- Les États-Unis et Israël nous entraînent dans une barbarie suicidaire (06/03)
Liens
Coupables d’être victimes: la lutte contre la traite des femmes
Ces articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » sont publiés à titre d'information et n'engagent pas la Tendance CLAIRE.
http://www.contretemps.eu/merteuil-traite-femmes-jaksic/
À propos de : Milena Jakšić, La traite des êtres humains en France. De la victime idéale à la victime coupable, Paris, CNRS éditions, 2016.
À lire un extrait ici.
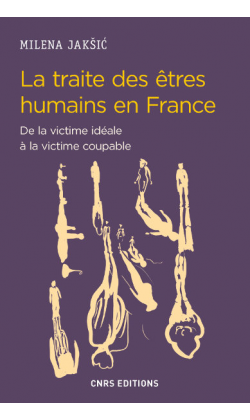
Le 18 octobre dernier, le ministère des familles de l’enfance, et droits des femmes, lançait à l’occasion de la journée européenne de la lutte contre la traite des êtres humains (TEH) une campagne, rappelant aux clients des travailleur.se.s du sexe qu’ils étaient pénalisés depuis l’entrée en vigueur de loi votée en Avril 2016, et que « 93% [des prostituées] sont étrangères et victimes de la traite des êtres humains ». L’entrée en vigueur de la loi mentionnée, tout comme cette campagne, viennent donc nous rappeler l’investissement politique de l’Etat français dans la lutte contre cette TEH à des fins d’exploitation sexuelle. Notamment initié avec la signature de la Convention de l’ONU pour la répression de la TEH et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, en 1960, cet investissement n’est par récent ; le nombre de procès pour traite des êtres humains reste cependant étonnamment faible. C’est ce paradoxe, celui de de l’absence des victimes au nom desquelles le phénomène est pourtant institué en cause, qui constitue le point de départ de l’enquête sociologique menée par Milena Jakšić et récemment publiée sous le titre La traite des êtres humains en France. De la victime idéale à la victime coupable.
En nous invitant à suivre le fil du parcours institutionnel qui attend celles qui prétendent au statut de victime de la TEH, en nous transmettant son point de vue original sur un terrain difficile, Milena Jakšić s’emploie à produire une sociologie de la victimisation, aux conclusions clairement politiques, et qui s’éloigne volontairement de la grammaire couramment utilisée avec ce sujet : c’est que « tant qu’on regardera la traite à travers le seul prisme de la prostitution, on se trompera d’objet ». Aussi, contrairement à ce que son titre peut indiquer, il ne s’agit pas d’un ouvrage « sur la traite », encore moins « sur la prostitution », mais bien plutôt sur l’investissement politique, sur la constitution de la traite des êtres humains, en « cause qui parle », et surtout sur les processus par lesquels cet investissement échoue in fine, à bénéficier à celles au nom de qui la cause est instituée.
De la garde-à-vue à la préfecture : parcours d’une victime non idéale.
La première partie de l’ouvrage, « reconnaitre », nous invite à suivre le parcours de ces prostituées étrangères qui tentent de se faire reconnaître comme victimes de TEH afin d’obtenir un titre de séjour.
La première étape est celle qui se déroule lors de la garde-à-vue qui suit l’arrestation – en général, pour racolage ou suite à un contrôle de papiers – par l’USIT, brigade associant des équipes de la BAC de différents arrondissements, spécialement créée lors de l’instauration du délit de racolage passif en 2003. On rappellera que l’instauration du délit de racolage avait été justifiée par la possibilité qu’elle ouvrait, pour les victimes de la traite, de dénoncer leurs exploiteurs… pendant leur garde-à-vue, cette dénonciation étant la condition de leur accès à une protection. Dans ce contexte peu favorable à un climat de confiance qui permettrait la confidence des potentielles victimes, on ne s’étonnera pas d’apprendre l’échec de la mesure quant à son but affiché : en 2004 par exemple, sur 2800 procédures pour racolage, seules une dizaine de dénonciations ont donné lieu à des poursuites pour proxénétisme ; sur 47 réseaux démantelés, seuls 4 l’ont été grâce à des dénonciations de prostituées. C’est aussi que la supposée mission de protection des agents de police entre en conflit avec une pratique influencée par un ensemble de préjugés souvent racistes : ainsi, une victime dénonçant des violences aura plutôt tendance à être prise au sérieux si elle est originaire d’Europe de l’Est, puisque, selon un policier interrogé, « c’est leur culture ». Mais surtout, il faut compter avec le soupçon de détournement de procédure, qui constitue une entrave majeure à la possibilité, pour ces prostituées déjà arrêtées en tant que délinquantes (pour racolage et/ou pour défaut de papiers), d’être appréhendées comme des victimes.
La seconde étape de l’enquête nous mène dans les locaux des associations où les prostituées viennent chercher un accompagnement pour effectuer les démarches en vue d’obtenir une titre de séjour. Pour le personnel associatif, il s’agit d’évaluer les requérantes, d’identifier qui pourra bénéficier d’un soutien dans ses démarches. En fonction des association, la décision se fonde sur différents critères : soit le mérite (Mouvement du Nid), soit le besoin (Amis du Bus des femmes). Mais au-delà de ces critères de distribution de l’aide, reflets des idéologies distinctes qui motivent l’action de ces associations, se met en place un même régime de contrôle. Parce que la Loi sur la Sécurité Intérieure ne prévoit de fournir une assistance qu’aux victimes dénonçant leurs exploiteurs, il revient aux victimes de se prémunir contre le soupçon d’inauthenticité et de détournement de procédure, face à des travailleur.se.s associatif.ve.s qui assument entre autres rôles celui de « police des étrangers ». La coordinatrice de l’antenne parisienne du Nid expliquera par exemple qu’avant d’accompagner une femme à la préfecture, celle-ci doit se montrer résistante dans la durée. Si cette résistance – entendue ici comme véritable volonté de cesser la prostitution – est estimée trop faible, la sanction tombe, comme l’illustre cet entretien rapporté avec une bénévole de la même association :
« Je l’ai accompagnée à la préfecture, et moi, comme je connais bien les femmes qui travaillent à la préfecture, je leur ai dit : « non » […] donc, il ne fallait pas lui redonner de papiers surtout. […] elle dit : « vous pensez qu’elle a cherché du travail ? » je lui dis : « peut être que oui mais je n’en suis pas très sure quoi » et j’ai dit « mais il y a d’autres activités ». et elle a compris. […] moi je lui ai dit, écoute, t’as pas eu de papiers c’est que tu l’as bien cherché, t’as pas travaillé ! ».
Une prostituée interviewée confiera également avoir reçu des menaces d’expulsion dans un foyer d’hébergement – qu’elle qualifie de « second slavery » – pour s’être montrée réticentes à répondre à certaines questions.
La troisième étape, à laquelle accèderont les victimes qui ont passé l’identification associative, est la plus décisive : c’est celle de la préfecture, qui délivrera ou non un titre de séjour. L’entretien a lieu dans des bureaux réservés, éloignés des guichets ouverts du rez-de-chaussée où le ton monte aisément. Dans ces bureaux au contraire, l’émotion est mise à distance, on ne demande pas à la requérante d’étaler son récit de vie, qui est déjà présupposé par sa présence dans ce bureau particulier. Pudeur et discrétion permettent de mieux se concentrer sur le formel, sur le critère décisif de l’entretien, à savoir l’activité professionnelle actuelle de la requérante : celle qui se présente comme victime a-t-elle bien arrêté la prostitution ? Il convient ici de rappeler que contrairement au contexte induit par la loi votée en Avril 2016 qui exige l’arrêt de la prostitution par les victimes souhaitant bénéficier d’une protection et d’un accompagnement vers la réinsertion sociale et professionnelle, le cadre de la LSI, au sein duquel a pris place l’enquête menée par Milena Jakšić, ne comportait pas cette condition : la loi de 2016 n’a donc finalement qu’officialisé une pratique déjà officieusement en vigueur. Au-delà de cette conditionnalité, ce qui apparaît ici, c’est la nature certificative du travail de la préfecture : c’est par la délivrance du titre de séjour que s’établit officiellement le statut de victime de la traite.
La « reconnaissance » du statut de victime est donc un parcours semé d’entraves, dont l’issue est essentiellement déterminée par la capacité de la potentielle victime à correspondre à une certaine image, idéale : préférablement originaire d’Afrique ou des « pays de l’Est », méritante, ayant cessé de se prostituer. Ce processus de reconnaissance prend donc essentiellement la forme d’un processus de suspicion, durant lequel la potentielle victime reste suspecte, et peut à tout moment être qualifiée de coupable. En cela, ces dispositifs de reconnaissance ne sont pas si différents de ceux que doit affronter une victime de viol : dans les deux cas, la victime idéale est ainsi « celle qui reste abstraite, malgré les incarnations concrètes ».
La traite comme cause humanitaire : succès politique et échec judiciaire.
La production d’une figure-type de la « victime idéale », supposée mobiliser pour sa cause, est donc également production d’exclusion de ce statut pour la plupart des victimes – réelles – qui prétendraient à une reconnaissance. Au travers de l’analyse des mobilisations politiques autour de cette figure idéale, il s’agit alors pour Milena Jakšić de « dévoiler », dans la seconde partie de son ouvrage, les ressorts de cette production, jusqu’à la dissolution de la victime dans les priorités (sécuritaires) nationales.
Si deux grandes organisations se disputent principalement l’arène internationale de « la lutte contre la traite », la CATW – à la grammaire et au répertoire d’action principalement ancré dans le registre de la domination masculine – et la GAATW – privilégiant une action par le droit – la promotion de leur cause repose sur les mêmes procédés de surgénéralisation et de sous-spécification : dans un cas, il s’agit de dire que les femmes, prostituées, migrantes, le sont toujours à la suite d’une réduction à une position de victime passive malmenée et exploitée contre son gré ; dans un autre, que c’est essentiellement un certain contexte législatif qui cause des préjudices à des femmes avant tout caractérisées par l’agentivité dont elles font preuve dans les stratégies qu’elles mettent en place pour répondre à leur désir originel de migrer. Dans les deux cas, le discours de ces organisations participe donc de la production d’une certaine idéalité de la victime, une idéalité qui a surtout pour effet d’exclure de ce statut les véritables victimes, qui n’apparaissent à peu près jamais sous cette forme idéale lors du processus de reconnaissance.
Ces deux conceptions divergentes de ce que doit être une victime de la traite seront également au cœur de l’implosion de la plate-forme française de lutte contre la traite, racontée au chapitre 5. Les différentes associations qui la composaient ne purent en effet parvenir à s’unir autour d’une figure commune qui serait capable d’incarner tant la prostituée étrangère que la travailleuse domestique réduites à des conditions d’esclavage, également concernée par la « lutte contre la traite », mais qui parvient bien moins à mobiliser dans l’arène politique.
L’arène politique, justement, fait l’objet de l’analyse du chapitre 6. La mobilisation parlementaire contre la traite s’organise autour d’un certain consensus tant sur le fond que sur la forme, puisque l’ambition de protection des victimes s’énonce aisément accompagnée de l’idée qu’il faut donc lutter contre le déplacement de ces victimes. D’ailleurs, comme le remarque un député, « qui peut prétendre préférer vivre à l’étranger plutôt que dans le pays où sont ses racines ? Personne ». La stratégie déployée pour lutter contre la traite peut donc se résumer ainsi : pour protéger les femmes de l’exploitation sexuelle, il convient avant tout qu’elles ne quittent pas leur pays. Ce faisant, la discussion du détail des dispositions légales à adopter peuvent subordonner les principes universels de défense des victimes aux nécessités nationales de protection de l’ordre public et de lutte contre l’immigration irrégulière.
À la suite de ces deux longs processus, intervenant dans des temporalités distinctes, que sont la « reconnaissance » et le « dévoilement », c’est au procès pour traite que nous donne accès Milena Jakšić. Comment nous l’avons mentionné plus haut, le chapitre 7 qui y est consacré se positionne comme une annexe. C’est que, comme ses retranscriptions nous le donnent à avoir, ces procès constituent, effectivement, des annexes vis-à-vis du parcours des victimes qu’il s’agit avant tout d’investir politiquement. Des annexes dans leurs parcours, également car il ne s’agit pas pour elle d’espérer un bouleversement positif à l’issue de ce procès : quand elle ne fait pas simplement office de témoin, la victime présumée ne saurait échapper au soupçon qui la vise depuis le début de la procédure qu’en attestant de cet attribut de la victime idéale qu’est le désintéressement : il ne s’agit pas pour elle de demander réparation, mais de bénéficier d’une leçon, voire d’obtenir une rédemption : ainsi la présidente s’adressant à une victime nigériane contrainte à la prostitution à son arrivée en France : « vous avez compris que ce vaudou n’est qu’une escroquerie ? Ce n’est que pour vous contraindre à vous prostituer. Si vous n’avez pas compris ça, alors je ne vois pas à quoi sert ce dossier ». Finalement, la qualification de proxénétisme – moins couteuse – l’emporte souvent sur celle de traite, marquant ainsi l’échec de ces affaires : en dépit des discours politiques et de la mobilisation associative, la reconnaissance ultime n’advient pas, ou presque pas. Le souffle de la « lutte contre la traite » retombe dans le lieu même qui symbolise pourtant l’institution dont dépend la définition de la traite, l’institution judiciaire.
La lutte contre la traite : un dispositif fémonationaliste.
Il sera plus difficile, après lecture de l’enquête de Milena Jakšić, de continuer à soutenir, sans même un regard critique, les discours politiques légitimant la lutte contre la prostitution par la lutte contre la traite. Tout d’abord, parce qu’en nous donnant accès à des terrains – des commissariats aux bureaux de la préfecture – au sein desquels ce qui se passe n’a pas vocation à en franchir les murs, la réalité des scènes qui s’y déroulent en vertu du régime de suspicion généralisé sur les étrangères se révèle dans toute son injustice. Ensuite, parce que ce qui apparaît au fil de l’enquête, ce sont, plus que de simples obstacles à la reconnaissance des victimes, ou une mauvaise application de lois fondamentalement justes, un ensemble de dispositifs qui convergent vers la disparition des victimes, qui produisent leur absence.
Le statut de victime n’apparait donc pas comme une caractéristique absolue liée à une expérience : il est au contraire tout relatif, produit d’une relation sociale entre celles qui prétendent à ce statut, et doivent donc faire leurs preuves, et les différentes instances chargées de leur protection/contrôle, dans un contexte qui tend justement à dissoudre ces victimes dans d’autres « priorités nationales ». Les dispositifs de lutte contre la TEH sert effectivement tant à contrôler les personnes que les territoires. Ainsi s’instaure une tension entre logique humanitaire – se référant à la protection des personnes ayant subi des violences, et appréhendant la traite avant tout comme une menace pour le corps vulnérable des femmes – et logique sécuritaire – renvoyant à la protection de l’ordre publique et à la lutte contre l’immigration dite clandestine, et qui, associant traite, prostitution, et immigration, appréhende le problème en termes de menace pour la souveraineté de l’Etat. À travers ces tensions, c’est aussi une certaine convergence qui apparaît entre l’agenda d’un certain féminisme, hégémonique, et celui de l’Etat et de ses politiques anti-immigration : c’est dans ce cadre que l’on peut qualifier les politiques de lutte contre la traite, à travers le discours qui les alimentent, comme relevant d’une forme de fémonationalisme.
Évidemment, on pourra toujours nous répondre que les conclusions que l’on peut tirer de la lecture de l’ouvrage de Milena Jakšić sont de toutes manières dépassées, en ce qu’elles se fondent sur un terrain lié à un cadre législatif qui n’est plus en vigueur. Pour autant, vu le consensus établi entre les différents partis lors des discussions sur la loi de 2016, vu les conditions du « parcours de sortie », prévu pour être coordonné par un comité associant notamment préfecture, officiers de police, et associatifs, vu la nécessité pour les associations d’être désormais « agrées », et vu encore la nécessité pour la requérante d’avoir « cessé » la prostitution pour bénéficier de ce parcours, il est à craindre que ces dynamiques de contrôle, qui participent de la production de l’absence de victimes, se renforcent plutôt qu’elles ne s’atténuent. Comme nous l’avons déjà souligné, cette production ne victimes coupables n’est pas spécifiques aux victimes de la traite, le soupçon de culpabilité pesant en réalité sur toute femme qui dénonce des violences (sexuelles) dont elle a été victime : le combat féministe et anti-raciste trouvera ainsi dans le livre de Milena Jakšić toutes les bonnes raisons pour intégrer l’arrêt des politiques actuelles de lutte contre la traite et la prostitution à son programme, et repenser cette lutte en des termes véritablement progressistes.




