Agenda militant
Ailleurs sur le Web
![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)
- L’amitié pour faire peuple (17/01)
- Chikirou : La nourriture est une affaire politique (16/01)
- Entretien avec Emmanuel Todd (16/01)
- Un mois de grèves et de luttes : Décembre 2025 (16/01)
- Lordon : Boulevard de la souveraineté (15/01)
- L’affaire d’État Alstom : l’étau se resserre autour de la responsabilité de Macron (15/01)
- Coquerel sur France 2 mercredi 14 janvier (14/01)
- Le "moment eurocommuniste" ou la déstalinisation ratée du PCF (14/01)
- Etats-Unis : comprendre la « nouvelle doctrine de sécurité nationale » et ses implications (14/01)
- La loi du plus fort - La chronique de Pierre-Emmanuel Barré (12/01)
- Retour sur le blocage du périph’ - A propos de la résistance à l’accord UE-Mercosur et à la politique d’abattage total. (12/01)
- Venezuela : des médias intoxiqués par la propagande de guerre (12/01)
- Où vivent les plus riches ? Ce que la géographie des hauts revenus dit des fractures françaises (11/01)
- Une récompense pour les criminels ! Le prix Nobel de la « paix » (11/01)
- La crise de la gauche portugaise. Entretien avec Catarina Príncipe (11/01)
- Victor Klemperer, critique impitoyable du sionisme (11/01)
- USA - VENEZUELA : UNE OPÉRATION MAFIEUSE SALUÉE PAR LES "COLLABOS" - Maurice Lemoine (11/01)
- Le paradoxe de la Sécurité sociale : et si, pour faire des économies, il fallait l’étendre ? (11/01)
- LFI : Soutien au peuple venézuélien contre l’agression de Trump ! (10/01)
- Du militarisme à gauche. Réponse à Usul et à Romain Huët (09/01)
- Face à l’impérialisme trumpiste : ne rien céder (08/01)
- Attaque américaine au Venezuela : ce que révèle le "zéro mort" de franceinfo (08/01)
- Que signifie "abolir la monnaie" ? (08/01)
- Abject dessin antisémite dans Marianne contre le député LFI Rodriguo Arenas (08/01)
- "ILS FONT LE SAV DE TRUMP !" CE QUE DISENT LES MÉDIAS FRANÇAIS SUR LE VENEZUELA (08/01)
Liens
Livre: Yalla Seddiki, Guy Debord automytographe
Ces articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » sont publiés à titre d'information et n'engagent pas la Tendance CLAIRE.
https://dissidences.hypotheses.org/12157
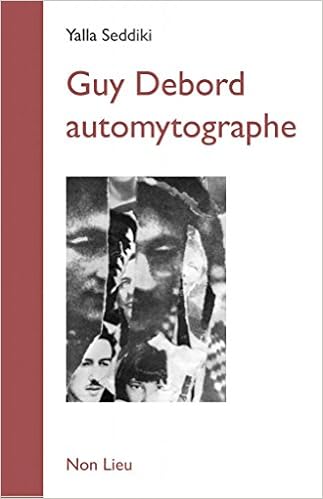
Yalla Seddiki, Guy Debord automytographe, Paris, Non Lieu Éditions, 2018, 395 pages, 24 €.
Un compte rendu de Frédéric Thomas
Ce livre s’intéresse au « mythe de soi » – mythe entendu comme « un ensemble d’images ou de représentations » (p. 19) – que Guy Debord (1931-1994), principal théoricien de l’Internationale situationniste (IS), a conçu, entretenu et développé au cours de sa vie. Et ce en lien avec son rapport particulier à l’histoire, et, plus encore, avec la postérité : « pour Guy Debord, la conquête de la postérité dépend de la mise en place d’un mythe autour de soi » (p. 378). Dès lors, comme le remarque judicieusement Yalla Seddiki, le travail d’écriture de l’auteur de la Société du spectacle, à partir des années 1980, « ne vise pas la connaissance mais la justification » (p. 155).
Guy Debord automythographe offre, au fil des pages, une réflexion sur l’influence du surréalisme, qui « se révèle comme le mythe qui a orienté sa [celle de Debord] sensibilité artistique », même si « c’est une influence parfois dissimulée » (p. 63). L’auteur éclaire également tout un pan de l’analyse de l’IS, célébrée et reprise de manière a-critique ; la domination masculine. Et de le faire à partir de la célébration de Jack l’Éventreur et de photos et tracts situationnistes des années 1960 (p. 218 et suivantes). Dans ces dernières, selon l’auteur, « la critique sociale des situationnistes se confond avec la célébration de la domination sexuelle » (p. 94 et suivantes). Quand à Jack l’Éventreur, Yalla Seddiki rappelle que les victimes de Jack l’Éventreur « furent toutes issues des marges du prolétariat anglais : ouvrières occasionnelles, chômeuses, pour certaines en rupture audacieuse avec le mode de vie conventionnel de la famille anglaise, d’autres s’adonnant à une prostitution de survie. À ces femmes, Guy Debord a préféré leur assassin » (p. 220).
Ce livre entend appréhender Debord sous l’angle artistique et politique, en regrettant, à juste titre d’ailleurs, la séparation de ces deux dimensions dans nombre d’études qui lui sont consacrées, étroitement liées pourtant au sein de l’IS. Cependant, son appréciation d’Anselm Jappe – affirmant se désintéresser de la stratégie personnelle (p. 31) de Debord – est à revoir, sinon à nuancer. Comme le montre Yalla Seddiki lui-même, la construction du mythe se développe à partir – et même devrait-on rajouter : en fonction – de la fin de l’Internationale situationniste (IS). « La dissolution de l’Internationale situationniste en 1972 a dirigé Debord dans une nouvelle direction, celle d’une automythographie ostensible » (p. 250). Ainsi, s’il est possible d’affirmer que le nouage entre art et politique a toujours existé au sein du parcours de Debord, il ne s’agit pas du même art, de la même politique ni des mêmes liens. Or, ce qui intéresse prioritairement Anselm Jappe, c’est la reconfiguration du marxisme à l’œuvre au sein de l’IS et des écrits de Debord ; reconfiguration qui participe des « mouvements historiques d’avant-gardes », tels que Peter Burger les a définit (Théorie de l’avant-garde, Questions théoriques, 2013). Et Debord ne peut construire son mythe que sur les ruines du marxisme ; d’un marxisme qu’il abandonne à partir de la fin des années 19701.
De manière générale, il semble que Yalla Seddiki manque d’ailleurs parfois de distance critique par rapport à cette automythographie. En tous les cas, nous ne pouvons que nous inscrire en faux par rapport à la prétendue incapacité de Socialisme ou Barbarie de prendre en compte « l’affirmation de l’individualité » (p. 280 et suivantes), et plus encore par rapport à l’affirmation : « Que ce soit dans le surréalisme, dans le lettrisme, Socialisme ou Barbarie, ou l’Internationale lettriste et l’Internationale situationniste, une autorité unique s’est imposée » (p. 293). C’est, à notre sens, céder au mythe de Debord et, au-delà, à celui du génie. Un double mythe auquel Debord a largement contribué d’ailleurs, comme l’analysait Mustapha Khayati dans une lettre du 2 décembre 2012 à Gianfranco Sanguinetti : « Tout se passe comme s’il [Debord] avait décidé d’orienter toute recherche sur les groupes qu’il a animés (l’IL [Internationale Lettriste] et l’IS) en vue d’imposer sa propre version des choses. La volonté de minimiser le rôle de ses compagnons est de lui ; Alice [Debord] dans son zèle a compris ou arbitrairement et bêtement décidé qu’il fallait effacer leurs traces. Voilà son crime probablement aggravé par son côté « avida dollars » ! Cela n’empêche pas de faire la mise au point nécessaire ! »2. C’est enfin et surtout passer à côté d’une des dimensions fondamentales des « mouvements historiques d’avant-gardes » (auxquels, d’ailleurs, il n’est pas certain, selon Burger, que le lettrisme participe) : l’aventure collective. Soit une manière de travailler collectivement et librement dans des regroupements révolutionnaires3 – en ce sens aussi que ceux-ci devaient préfigurer la société libérée –, et où se réinventaient, au quotidien, l’art et le politique, au prisme de nouveaux rapports de solidarité, d’amitié et d’amour.
1Sur la lecture de Marx de Debord, on lira Anselm Jappe, « Debord, lecteur de Marx, Lukacs et Wittfogel », dans Laurence Lebras et Emmanuel Guy (coord.), Lire Debord, Paris, L’échappée, 2016, pages 281-293.
2« Correspondance », http://julesbonnotdelabande.blogspot.com/2013/04/correspondance.html. Anna Trespeuch-Berthelot a, pour sa part, bien mis en évidence, à partir de la fin des années 1980, la double dynamique de « patrimonalisation de l’œuvre debordienne » et de « personnification du mouvement situationniste », L’Internationale situationniste. De l’histoire au mythe, Paris, Presses universitaires de France, 2015 (voir le compte-rendu sur ce blog, https://dissidences.hypotheses.org/6786 ).
3Patrick Marcolini rapproche ainsi la conception de l’IS « d’une nouvelle forme politique », correspondant à « un nouveau type d’organisation révolutionnaire » aux « groupes affinitaires inventés par les anarchistes à la fin du XIXe siècle », in Le mouvement situationniste. Une histoire intellectuelle, Paris, L’échappée, 2012 (pages 317-318).




