Agenda militant
Ailleurs sur le Web
![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)
- Un mois de grèves et de luttes : Décembre 2025 (16/01)
- Lordon : Boulevard de la souveraineté (15/01)
- L’affaire d’État Alstom : l’étau se resserre autour de la responsabilité de Macron (15/01)
- Coquerel sur France 2 mercredi 14 janvier (14/01)
- Le "moment eurocommuniste" ou la déstalinisation ratée du PCF (14/01)
- Etats-Unis : comprendre la « nouvelle doctrine de sécurité nationale » et ses implications (14/01)
- La loi du plus fort - La chronique de Pierre-Emmanuel Barré (12/01)
- Retour sur le blocage du périph’ - A propos de la résistance à l’accord UE-Mercosur et à la politique d’abattage total. (12/01)
- Venezuela : des médias intoxiqués par la propagande de guerre (12/01)
- Où vivent les plus riches ? Ce que la géographie des hauts revenus dit des fractures françaises (11/01)
- Une récompense pour les criminels ! Le prix Nobel de la « paix » (11/01)
- La crise de la gauche portugaise. Entretien avec Catarina Príncipe (11/01)
- Victor Klemperer, critique impitoyable du sionisme (11/01)
- USA - VENEZUELA : UNE OPÉRATION MAFIEUSE SALUÉE PAR LES "COLLABOS" - Maurice Lemoine (11/01)
- Le paradoxe de la Sécurité sociale : et si, pour faire des économies, il fallait l’étendre ? (11/01)
- LFI : Soutien au peuple venézuélien contre l’agression de Trump ! (10/01)
- Du militarisme à gauche. Réponse à Usul et à Romain Huët (09/01)
- Face à l’impérialisme trumpiste : ne rien céder (08/01)
- Attaque américaine au Venezuela : ce que révèle le "zéro mort" de franceinfo (08/01)
- Que signifie "abolir la monnaie" ? (08/01)
- Abject dessin antisémite dans Marianne contre le député LFI Rodriguo Arenas (08/01)
- "ILS FONT LE SAV DE TRUMP !" CE QUE DISENT LES MÉDIAS FRANÇAIS SUR LE VENEZUELA (08/01)
- VENEZUELA : CE QUE NE DIT PAS LA PROPAGANDE DE TRUMP (08/01)
- Les États-Unis prennent d’assaut le territoire et le gouvernement du Venezuela (08/01)
- Les systèmes militaro-industriels, noyau totalitaire du capitalisme contemporain (08/01)
Liens
Du colonialisme à la "rénovation urbaine", le pouvoir des cartes
Ces articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » sont publiés à titre d'information et n'engagent pas la Tendance CLAIRE.
https://www.contretemps.eu/colonialisme-france-espace-geographie-pouvoir-cartes/
Cosimo Lisi vient de publier Paris capitale coloniale (éditions Eterotopia), livre dans lequel il donne à voir la manière dont le colonialisme a façonné l’organisation urbaine de la capitale française. Nous vous proposons d’en lire l’introduction.
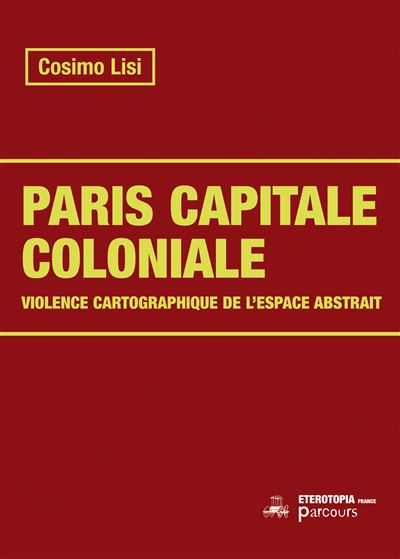
Introduction
Dans cet ouvrage, nous proposons une analyse critique de la conception et de l’organisation de l’espace pour comprendre comment ces deux notions servent d’instruments à l’exercice du pouvoir à l’époque moderne. Les sociétés ont toujours organisé leurs espaces de vie, mais la modernité se démarque par le recours à un outil spécifique : la cartographie. Cette discipline s’inscrit dans un processus d’abstraction qui tend à homogénéiser les espaces pour les rendre fonctionnels. Elle organise leur planification et leurs connexions dans le but de gouverner les populations.
Nous retraçons ici l’histoire de l’aménagement de la région parisienne, de ses premières transformations au XIXe siècle par Haussmann, aux modifications dans les années gaullistes. Nous proposons ainsi de montrer comment les expériences et les développements techniques de cette période influencent encore aujourd’hui la planification régionale et les politiques du logement en France. Cela vaut en particulier pour la dite rénovation urbaine, dont nous retraçons une genèse critique.
Notre hypothèse est la suivante : l’intervention de l’État sur la sphère urbaine est le résultat de ce que Franco Farinelli appelle la « raison cartographique »[1] et, surtout, de l’histoire coloniale. Paris, ville-objet d’étude de ce livre, illustre le mieux cette double articulation. Définissons quelques concepts et thématiques préliminaires à ce travail.
L’espace abstrait
En 1974, Henri Lefebvre publie La production de l’espace. Ses analyses, commencées quelques années plus tôt avec Le droit à la ville (1968) et La révolution urbaine (1970), ont participé au « spatial turn »[2] de la théorie cri- tique des années 1980. L’espace n’est alors plus pensé comme une donnée à priori (dans le sens kantien). Arraché à sa prétendue neutralité, il est remis au cœur des rapports de production, de domination et de pouvoir.
La thèse principale de La production de l’espace est que « le mode de production organise – produit – en même temps que certains rapports sociaux – son espace et son temps. C’est ainsi qu’il s’accomplit. »[3] L’espace social doit donc être considéré comme le résultat des rapports de force directement liés aux modes de production.
L’espace social se caractérise par trois aspects fondamentaux. Lefebvre les décrit ainsi : les représentations de l’espace (l’espace pensé par les scientifiques, les planificateurs, les urbanistes, les technocrates, l’espace « dominant dans une société »), la pratique sociale (l’espace perçu, qui lie étroite- ment réalité quotidienne et réalité urbaine) et les espaces de représentation (l’espace du point de vue des « habitants » et des « usagers », mais aussi des artistes, philosophes et écrivains, qui prend forme à travers les images et les symboles auxquels il est associé). Ces derniers correspondent à des espaces dominés, ceux que l’imagination peut s’approprier et modifier.
Dans La production de l’espace, Lefebvre revient dans un premier temps sur la critique de l’espace moderne — l’espace de la « modernisation » — puis sur son évolution au cours de l’histoire. Il définit ainsi l’espace produit par la modernité capitaliste comme un espace abstrait.
L’espace abstrait est à la fois homogène, hiérarchisé et fragmenté. C’est l’instrument privilégié du capital pour affirmer son hégémonie dans la société. Lefebvre emprunte le concept d’hégémonie à Antonio Gramsci. Il écrit que « l’hégémonie s’exerce par le moyen de l’espace en constituant par une logique sous-jacente, par l’emploi du savoir et des techniques, un “système”. »[4] Cet espace formel et quantifié finit par nier les différences naturelles, temporelles voire même corporelles propres aux territoires, en les rendant abstraites.
L’État est le principal producteur de l’espace abstrait. Si la représentation de cet espace est rendue neutre par la mise en scène de plans, de maquettes et d’images, elle n’en reste pas moins structurellement violente : « il existe une violence inhérente à l’abstraction, à son usage pratique (social). »[5] Cette violence, comme nous allons le montrer dans cet ouvrage, est celle de l’accumulation primitive du capital — violence et accumulation primitive sont, entre autres, constitutives du capitalisme. La violence de la prédation détruit des mondes incompatibles ou résistants à la logique capitaliste de l’accumulation. L’espace politique et économique produit peut alors être considéré comme « le berceau de l’État moderne, son lieu de naissance. »[6]
L’espace abstrait, constitué par l’État, n’est pas en soit homogène, mais il a pour but et moyen d’action l’homogénéité. Celle-ci « sert d’instrument aux puissances qui font table rase de ce qui leur résiste et de ce qui les menace – en bref, des différences. Ces puissances broient sur leur passage, elles écrasent ; l’espace homogène leur sert à la manière d’un rabot, d’un bulldozer. »[7]
Le pouvoir des cartes
L’espace abstrait prend forme dans la cartographie moderne. Les cartes ont pu être un moyen de se représenter l’espace et de construire le monde pour de nombreuses sociétés humaines, mais c’est seulement avec la modernité que la cartographie a joué un rôle fondamental, permettant l’aménage- ment, l’organisation et la gouvernance des territoires.
La carte cesse alors d’être une forme symbolique des espaces de représentation (comme c’était le cas par exemple au Moyen-Âge), et devient un instrument de domination et de structuration violente à l’échelle du territoire. C’est ainsi qu’elle inaugure la représentation de l’espace moderne. En bref, l’essor de la cartographie permet le développement de l’appareil d’État moderne tout en étant lié à la naissance du capitalisme. La cartographie est donc indissociable des principales formes du pouvoir dans la modernité.
Selon Brian Harley, géographe critique et premier penseur des relations entre cartes, modernité et pouvoir, la cartographie — qui a toujours été la « science des princes », donc celle du pouvoir, joue le rôle de « territoire juridique » : « elle facilite la surveillance et le contrôle. »[8] Pour l’État moderne, « une société sans carte ne serait pas politiquement concevable. »[9]
La carte est donc « un médiateur silencieux du pouvoir. »[10] Bien qu’elle semble être au premier abord une représentation fidèle et objective du territoire, la cartographie réduit progressivement le territoire à la carte. Farinelli écrit que « l’image cartographique constitue un pronostic sur la réalité. »[11] Elle est la condition nécessaire à l’émergence de la planification, puis au développement de la machine bureaucratique et son besoin d’imposer un ordre à la nature et à la société.
L’État moderne est donc l’incarnation de la rationalisation géométrique des relations humaines. La raison géométrico-cartographique est à l’origine du pro- jet hobbesien, comme le montre cet extrait de l’épître dédicatoire du De Cive :
« Certes, les géomètres ont admirablement accompli leur tâche. Quelle que soit l’aide apportée à la vie humaine par l’observation des astres, par la description de la terre, par la notation des temps, par les navigations lointaines ; toute la beauté des édifices, toute la solidité des fortifications, toute l’efficacité des machines, tout ce qui enfin distingue le temps d’aujourd’hui de l’ancienne barbarie, tout cet avantage, nous le devons à la géométrie. Car ce que nous devons à la Physique, la Physique elle-même le doit à la géométrie. Si les Moralistes avaient accompli leur tâche avec le même bonheur, je ne vois pas ce qui aurait pu être ajouté de plus par l’industrie des hommes à leur bonheur en cette vie. »[12]
La couverture de la première édition du Léviathan incarne parfaitement ce projet. Le corps monstrueux du prince, à l’intérieur duquel se retrouvent ses sujets, est un corps qui affirme son pouvoir sur les villes et les campagnes et témoigne de la transformation de la justice. Considérée comme une vertu essentielle et un principe d’action politique, cette dernière finit par devenir juridiction. Elle devient donc une solution formelle au problème de la diversification des droits clairement déterminés ou déterminables.
La justice se confond alors avec un ordre urbain géométriquement déterminé, représenté de la meilleure des manières par une carte. Les sujets abandonnent leurs droits au profit de la protection du Léviathan, l’appareil moderne d’État qui gouverne par l’organisation et la planification des territoires. L’individu de l’anthropologie négative hobbesienne est le produit d’une accumulation primitive qui détruit toute forme de relation qui n’est pas dictée par la mécanique de la maximisation du profit, et qui produit finalement un sujet intrinsèquement compétitif. Le Léviathan est l’État moderne ; il est une reconfiguration politique qui permet au nouvel ordre socio-économique de subsister.
Entre le XVIe et le XVIIIe siècle, les cartographes et les arpenteurs ont également été au service des propriétaires terriens, participant aux opérations d’enclosure, condition nécessaire à l’émergence du capitalisme agricole dans les campagnes européennes.
Ces fameux « enclosure plans » ont précédé les plans cadastraux de Napoléon et se sont d’abord répandus en Angleterre dans la seconde moitié du XVIe siècle[13], puis en France à partir du XVIIIe siècle[14]. Dans ce contexte, la cartographie a servi de technique de contrôle de l’espace, tout comme l’horloge mécanique contrôlait le temps[15]. D’après Brian Harley : « Les cartographes fabriquent le pouvoir : ils créent une conception de l’espace. C’est un pouvoir incorporé dans le texte de la carte. »[16]
L’organisation inhérente aux cartes participe à la structuration de l’État : l’isomorphisme, l’homogénéité et la continuité territoriale deviennent des principes de structuration de l’État moderne. Le développement de la cartographie moderne permet la construction du réseau routier, instrument de l’organisation territoriale de l’État-nation.
C’est le cas notamment avec la carte des Cassini, « première carte véritablement scientifique »[17] et premier exemple de triangulation à l’échelle étatique. Commencée sous Louis XIV, cette carte a été achevée par le dernier Cassini en 1789, à la veille de la Révolution. La carte des Cassini a contribué de manière décisive au contrôle de l’administration étatique sur l’ensemble du territoire national. De plus, les techniques cartographiques et les méthodes d’arpentages utilisées par Cassini ont joué un rôle déterminant dans la topographie militaire et la cartographie cadastrale à l’époque napoléonienne, ce qui in fine a permis de contrôler l’en- semble de l’Europe[18]. Paraphrasons donc le titre du premier numéro de la revue Hérodote : une carte, « ça sert d’abord à faire la guerre. »[19]
La production de l’espace colonial
La cartographie moderne, la topographie militaire en particulier, a été l’un des premiers vecteurs du processus colonial. La transformation des lieux dans le monde en un espace homogène unique (mais hiérarchiquement structuré) a été la condition préalable aux conquêtes impériales et coloniales. Les cartes transforment les territoires colonisés : elles détruisent les toponymes indigènes et réduisent les perceptions directes de l’espace à des perceptions déterminées de façon cartographique, comme en Europe. L’espace blanc des cartes, considéré comme vide, était déjà une première forme de colonisation, même à l’échelle de la carte seulement.
Harley écrit : « Les cartes sont les armes de l’impérialisme en anticipant la formation des empires coloniaux et en les légitimant […]. Elles facilitent les guerres, mais aussi atténuent la culpabilité, car les lignes silencieuses sur le papier favorisent l’idée d’un espace socialement vide. »[20]. Les savoirs sur l’espace, les représentations de l’espace abstrait — pour reprendre le concept de Lefebvre — ont été un élément central de la formation et de l’exercice du pouvoir colonial. Comme nous l’avons évoqué précédemment, la cartographie a joué un rôle décisif dans la délimitation des frontières et la modification du nom des lieux.
Ces pratiques sont une expropriation symbolique qui s’ajoute à l’expropriation physique des territoires appartenant aux populations indigènes colonisées. D’autres sciences, comme la géographie et l’urbanisme, ont contribué à la diffusion de certains paysages stéréotypés et à la catégorisation des populations indigènes. Elles sont ainsi devenues des instruments de la construction et de la gestion des territoires coloniaux et impériaux.
En 1978, Edward Saïd montre à quel point connaissance de l’espace et expansion coloniale sont liées. À partir de l’analyse d’une certaine littérature européenne, Saïd révèle la « géographie imaginaire » produite par les colonisateurs, c’est-à-dire une image des espaces coloniaux déterminée par les peurs et les désirs de l’Occident[21]. Parce qu’étroitement lié à la culture européenne dominante des XIXe et XXe siècles, Saïd décrit l’impérialisme comme un « acte de violence géographique, par lequel la quasi-totalité de l’espace mon- dial est explorée, cartographiée et finalement annexée. »[22]
Stefan Kipfer[23] l’a clairement montré, le rôle de la ville dans le processus de colonisation est au centre des réflexions de Lefebvre sur la question coloniale. Jusqu’aux années 1960, l’engagement anticolonial de Lefebvre reste marginal. À partir des années 1970, ce dernier analyse le colonialisme dans sa spécificité, c’est-à-dire à l’aide d’un registre lexical plus explicitement anticolonial.
D’une part, « l’observation participante » propre à mai 68 — le rôle décisif des banlieues (banlieues-dortoirs, usines et bidonvilles) notamment, et les recherches sur l’urbanisme du début des années 1970 d’autre part ont conduit Lefebvre à décrire la colonisation comme un processus « d’organisation des relations territoriales de domination entre les centres et les périphéries »[24] et « une stratégie particulière, liée à l’État, de production d’un espace abstrait, c’est-à-dire de relations territoriales entre espaces sociaux dominés et dominants. »[25] Ses analyses se préciseront dans les quatre tomes de De l’État, publiés entre 1976 et 1978.
L’opposition entre centre et périphérie existe autant dans les pays colonisés que dans les métropoles. Elle sous-tend une définition formelle de la colonisation que Lefebvre expose dans le chapitre « Colonisations et colonisateurs » du quatrième tome de De l’État :
« Il y a colonisation dès qu’un pouvoir politique (celui d’un féodal, d’un conquérant, mais aussi celui d’une autorité militaire ou d’une ‘puissance d’argent’) affecte un territoire, donc une activité et une fonction productrice, à un groupe social faible, en organisant la domination en même temps que la production. L’utilité (usage productif) n’est que l’indice de l’assujettissement du groupe “inférieur” au groupe “supérieur”, et par conséquent de l’espace dominé à l’espace dominant, généralement centralisé autour d’un point fort, ville château, forteresse, camp militaire… Là où s’engendre un espace dominé, organisé et maîtrisé par un espace dominant – là où il y a périphérie et centre – il y a colonisation. »[26]
Au centre de ses analyses sur la colonisation se trouve aussi « la reproduction des rapports de domination avec tous ses aspects humiliants et dégradants qu’éludent parfois les analyses économiques de l’impérialisme. »[27] La colonisation est donc « une partie du rôle que joue l’État dans la reproduction des rapports de production et de domination : coordonner l’espace abstrait “pulvérisé” du capital et contrer les forces d’opposition avec des stratégies de séparations hiérarchiques de l’espace social. »[28] Cette dernière idée lui permet de montrer que les mécanismes de domination étatique opèrent à plusieurs niveaux. Ce faisant, ceux-ci influencent directement la vie quotidienne, organisée par un niveau médian qui est l’urbain. L’urbain est donc au centre des stratégies coloniales et néocoloniales.
Frantz Fanon[29] analyse également le racisme ordinaire comme une relation spatiale aliénante. La colonisation est une organisation spatiale multiscalaire qui confirme la centralité de l’urbain et le rapport entre ville « indigène » et « européenne ». Cette dualité est au centre de l’urbanisme colonial. Dans Les damnés de la terre[30], Fanon évoque le monde colonial comme étant compartimenté. Cette frontière de l’espace urbain, matérielle et symbolique, est accompagnée de la présence violente de la police et de l’armée. À l’autre extrémité, la dimension spatiale de la lutte anticoloniale est considérée comme une réappropriation de l’espace urbain.
Le rapport entre la ville, l’urbain et le pouvoir colonial est par ailleurs déterminé par la non-reconnaissance du statut de citadin des colonisés et du type d’urbanité qui en découle. Dans son analyse sur le statut de la « ville » pendant la colonisation française de l’Afrique subsaharienne[31], Odile Georg montre comment les colons, en monopolisant la définition officielle de la ville, en ont conditionné l’accès littéral et symbolique. La négation des formes d’urbanité indigène et précoloniale, ou formulé autrement, l’assignation des Africains à la ruralité, a privé les colonisés du statut de citadin, limitant de fait leur accès à la « ville » :
« En s’appuyant sur la prétendue nature rurale de l’Afrique, et donc sur la négation d’une urbanité endogène, l’idéologie coloniale française construit une ville basée sur un modèle dichotomique, défini par un espace administrativement borné, exclusif et hiérarchisé juridiquement. »[32]
Cependant, le besoin de main-d’œuvre a encouragé la construction d’espaces informels en banlieue. Plus radicalement, certains espaces non urbains sont apparus à l’intérieur même de la ville :
« La ville, telle qu’elle est pensée alors, se limite à une portion de l’agglomération, c’est-à-dire à la partie habitée essentiellement par les Européens, le “centre”. Dans le contexte colonial, cette notion est avant tout politique, sociale et raciale et non géographique. »[33]
La ville, ainsi définie, devient l’interface privilégiée entre la métropole et les colonies. Plus précisément, la ville coloniale française, conçue comme un espace délimité et structuré, est un espace défini par l’État, par le pouvoir militaire et non par ses habitants. De ce point de vue, les colonies doivent être considérées comme des laboratoires de production de l’espace abstrait, et comme des formes de contrôle urbain et de gestion de la population. Ces techniques seront par la suite importées en métropole.
Paris et l’universalisme colonial
Le passé colonial est présent dans chaque rue de Paris. Les noms des protagonistes de la colonisation, de la traite négrière, des villes, des batailles et des conquêtes résonnent dans la toponymie de la capitale française.
Dans son livre édité avec l’artiste Semboy Vrainom, Françoise Verges analyse le « triangle colonial » de la Porte Dorée comme un condensé de l’histoire coloniale, culturelle, économique et raciale française. Dans cet espace, le Paris colonial est « lisible dans l’architecture, les monuments, la représentation féminine des continents colonisés, les marques de produits, la publicité, les noms de boutiques, de bars et de restaurants. Visible, avec ses statues, monuments et noms de rues qui magnifient la conquête coloniale, l’esclavage, le travail forcé, les massacres, la domination, la négation d’une humanité. »[34]
La statue en bronze d’Athéna Nike est l’une des pièces maîtresses de l’espace créé à l’occasion de l’Exposition coloniale de 1931, période marquant l’apogée de l’Empire français. La statue, actuellement située au sommet de la fontaine de la Porte Dorée, occupait initialement le péristyle de l’ancien musée des colonies et s’intitulait La France apportant la paix et la prospérité aux colonies. La statue d’Athéna, alors symbole du lien entre l’exploration et l’armée, incarnait la fiction de l’universalisme colonial.
En réalité, l’universalisme abstrait est au cœur de l’idéologie coloniale. Le projet colonial se revendique comme une grande « mise en ordre », fondée sur l’abstraction du sensible de l’espace colonisé, considéré comme amorphe. Enrique Dussel, philosophe argentin et figure centrale du « tournant décolonial », a montré comment la colonisation, la conquête des Amériques et du monde extra-européen, la traite négrière et l’expansion capitaliste sont les conditions d’existence de l’ego cogito cartésien et de la modernité elle-même.
Dans un article publié en 2008, Dussel montre la dette de Descartes envers des philosophes et théologiens espagnols du XVIe siècle (Francisco Sanchez, Suarez, Fonseca, Antonio Robio). Dussel montre également comment les transformations produites par la conquête des Amériques sont à l’origine de la pensée cartésienne, révélatrice des effets de la domination coloniale sur le savoir européen. L’ego cogito est pour Dussel la traduction philosophique de l’ego conquiro. La distinction entre pensée et corps/matière, res cogitans et res extensa, traduirait le rapport entre colonisateurs et sujets colonisés. Les distinctions à l’origine de la pensée moderne se fondent, selon Dussel, sur une différence anthropologique et coloniale entre conquérants et conquis. L’autre occulté est réduit à une figure du même à éduquer :
« La conquête est un processus militaire, pratique, violent, qui inclut dialectiquement l’Autre, en tant que “Le même”. L’Autre dans sa spécificité est nié comme autre et il est aliéné, obligé, contraint de s’incorporer à la totalité dominatrice comme une chose, comme un instrument, comme un opprimé. […] La première relation fut donc violente : une relation militaire de conquistadors à conquis. […] La première expérience moderne fut celle de la supériorité quasi divine du “moi” européen sur l’autre primitif, rustre, inférieur. C’est un “moi” militaire et violent qui convoite, qui désire la richesse, le pouvoir et la gloire. »[35]
Le je cartésien qui se pense comme universel est pour Dussel la conséquence de l’ordre colonial. La pensée bourgeoise européocentrée et coloniale s’autoproclame universelle, ignorant ainsi ses propres conditions de production. L’universalisme est étroitement lié à la trajectoire de la France moderne, surtout depuis le XVIIIe siècle, siècle des Lumières et de la formation de concepts européens dessinant un espace politique et mental en pleine construction qui résonneront avec la Révolution.
Les Lumières, en forgeant les concepts de Liberté, d’Égalité, de Fraternité, forment aussi celui de Civilisation. L’humanité entière est jugée à la lumière de l’identité bourgeoise européenne, élevée au rang d’identité universelle. Le grand récit universaliste se présente alors comme un pseudo- mythe émancipateur et sert à légitimer l’expansion coloniale française entre les XIXe et XXe siècles. Sa véritable valeur réside dans son travail symbolique et politique de réduction et de délégitimation systématique des différences.
L’universalisme colonial français est en lui-même aporétique. Comme l’a bien montré Olivier Le Cour Grandmaison[36], au moment de la grande expansion coloniale de la Troisième République (1871-1913), un régime d’exception déjà précédemment pratiqué au moment de la conquête de l’Algérie est mis en place dans les territoires coloniaux. Le code de l’indigénat et les différentes législations coloniales (enlèvement forcé, travail forcé, répression comme méthode de punition fondée sur la responsabilité collective) constituent une contradiction radicale avec les valeurs universelles dites républicaines au nom desquelles le parti colonial légitimait l’expansion impériale.
Le Cour Grandmaison note comment « Jules Ferry, l’une des figures les plus importantes de la IIIe République loue, dans les colonies, ce qu’il abhorre en métropole en se faisant l’avocat d’une sorte de monarchie absolue. »[37] Le racisme d’État et l’autoritarisme représentent l’autre face de l’universalisme républicain colonial français.
Dans ce livre, nous étudierons comment l’universalisme colonial produit un espace homogénéisant — dicté par l’expropriation physique et symbolique des territoires et la suppression de toutes les formes d’appropriation par les communautés et les classes subalternes. Il construit parallèlement une verticalité hiérarchique qui s’accompagne de la multiplication des régimes d’exception.
Ce livre défend ainsi la thèse suivante : le modèle de l’aménagement du territoire est un modèle colonial importé des espaces coloniaux vers la métropole et utilisé pour gouverner les classes populaires. Paris est à la fois le centre de l’Empire et l’objet d’un colonialisme interne.
Les chapitres suivants analyseront la genèse de la rénovation urbaine, soit la construction d’un dispositif spatial d’intervention de l’État sur les classes subalternes. Ce dispositif est une forme d’accumulation primitive, hypothèse avancée par le premier chapitre, étayée par l’analyse des « grands travaux » d’Haussmann dont l’origine coloniale est mise en évidence. L’accumulation primitive, constante du capitalisme, ne se réduit pas au rapport entre capital et travail (comme le prétend une certaine vulgate marxiste), mais constitue un dispositif violent de prédation qui traverse, produit et transforme les rapports modernes de race, de classe et de genre. L’accumulation primitive est fondée sur des relations coloniales présentes à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’Occident. Elle traverse tout autant la redéfinition constante du territoire, la colonisation des corps, la production des subjectivités et des différentes identités sociales qui structurent la division sociale du travail.
Ce processus est visible dans les politiques hygiénistes françaises de la fin du XIXe siècle, qui feront l’objet de notre deuxième chapitre. Le dispositif hygiéniste est une forme de biopolitique et de nécropolitique. Le biopouvoir investit la vie dans le détail des corps individuels des travailleurs et dans les effets globaux des populations en tant que corps collectif. La biopolitique apparaît alors comme un dispositif de séparation au sein des classes subalternes. Elle prend ainsi la forme d’une nécropolitique. Les processus de racialisation sont liés à l’accumulation primitive du capital, mais sont aussi une réponse à la lutte des classes et à la résistance des subjectivités à la domination du capital.
Ce processus se manifeste spatialement, à travers la construction de différents espaces qui interviennent sur ce que les hygiénistes appellent la « classe dégénérée », distinguant ainsi les classes laborieuses des classes dangereuses. Les politiques d’investissement sur la vie s’accompagnent de politiques d’abandon, de nécropolitique. Ce sont les deux faces d’une même logique de domination.
Le troisième chapitre analysera l’origine et l’affirmation de l’urbanisme fonctionnaliste, un modèle qui, bien que partiellement supplanté par la gouvernance néolibérale, structure encore certaines institutions et pratiques de l’aménagement du territoire. Ce chapitre explicitera l’origine coloniale de ce modèle et analysera sa mise en œuvre en région parisienne pendant les Trente Glorieuses. Le modèle fonctionnaliste est une stratégie spatiale qui cherche à définir le rapport entre centre et périphérie comme une technique de gestion de l’urbain. Ce modèle est la manifestation de la raison cartographique en tant que planification verticale du territoire.
La rénovation urbaine apparaît finalement comme une bataille continue entre l’État et Paris — le Paris ouvrier, le Paris de la Commune — visant à transformer progressivement la ville en « capitale », centre du système cartographique et de l’appareil d’accumulation du capital. Le Paris ouvrier, qui s’est toujours montré ingouvernable au cours de l’histoire, doit être dominé, dompté ou expulsé.
Notes
[1] F. Farinelli, La crisi della ragione cartografica, Turin, Einaudi, 2009.
[2] Le « spatial turn » a été initié par Edward Soja, voir. E. W. Soja, Postmodern Geographies. The Reassertion of Space in Critical Social Theory, Londres/New York, Verso Book, 1989.
[3] H. Lefebvre, La production de l’espace (1974), 4e éditions, Paris Ed. Antrophos, 2000, p. XXV.
[4] Ibid, p. 18.
[5] Ibid, p. 333.
[6] Ibid, p. 322.
[7] Ibid, p. 328.
[8] P. Gould, A. Bailly (sous la direction de), Le pouvoir des cartes : Brian Harley et la cartographie, Paris, Anthropos, 1995, p. 81.
[9] Ibidem
[10] Ibid, p. 83.
[11] F. Farinelli, La crisi della ragione cartografica, op. cit., p. 72.
[12] T. Hobbes, De cive ou les fondements de la politique (1642), Publication de la Sorbonne Série Documents n°32, Université de Paris IV (Paris-Sorbonne), Paris, éditions Sirey, 1981, p. 55.
[13] J. Beauroy, « La représentation de la propriété privée de la terre, Land Surveyors et Estate Maps en Angleterre de 1570 à 1660 » in G. Brunel, O. Guyot Jeannin, J.-M. Moriceau (dir.), Terriers et plans terriers du XIIIe au XVIIIe siècle, actes du colloque de Paris 23-25 septembre 1998, Bibliothèque d’histoire rurale, vol. 5, Mémoire et documents de l’École des chartes, vol. 62, 200, p. 79-101.
[14] A. Soboul, « De la pratique des terriers à la veille de la Révolution », Annales. Éco- nomie, société, civilisation, 1964, vol. 19, n°6, p. 1049-1065.
[15] Sur le sujet, voir E. Thompson, Temps, discipline du travail et capitalisme industriel, Paris, La Fabrique éditions, 2004.
[16] P. Gould, A. Bailly (sous la direction de), Le pouvoir des cartes : Brian Harley et la cartographie, op. cit. p. 81.
[17] L. Gallois, « L’Académie des sciences et les origines de la carte de Cassini », Annales de Géographie, XVIII, 1909, p. 307.
[18] H. M. A. Berthaut, La carte de France, 1750-1898, étude historique, 2 tomes, Paris, Imprimerie du Service Géographique, 1898-1899
[19] Y. Lacoste, « La géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre », Hérodote, n° 1, 1976.
[20] P. Gould, A. Bailly (sous la direction de), Le pouvoir des cartes : Brian Harley et la cartographie, op. cit. p. 36.
[21] E.W. Said, Orientalism, New York, Vintage, 1978.
[22] E.W. Said, Culture et impérialisme, (1993), 2000, p. 320.
[23] S. Kipfer, Le temps et l’espace de la (dé)colonisation. Dialogue entre Frantz Fanon et Henri Lefebvre, Paris, Eterotopia France, 2019.
[24] Ibid, p. 10.
[25] Ibid, p. 47.
[26] H. Lefebvre, De l’État IV, Paris, Union générale des éditions, 1978, p. 173-174.
[27] S. Kipfer, op. cit., p. 37-38.
[28] Ibid, p. 38.
[29] L’œuvre de Fanon est analysée dans le livre de Kipfer pour en souligner la centralité de la question urbaine.
[30] F. Fanon, Les damnés de la terre (1961), Paris, La Découverte, 2004.
[31] O. Georg, « Domination coloniale, construction de “la ville” en Afrique et dénomination », dans Afrique & histoire, 2006/1 (vol. 5), Verdier, Lagrasse, p. 15-45
[32] Ibid, p. 26.
[33] Ibid, p. 35.
[34] Ibid, p. 21.
[35] E. Dussel, L’occultation de l’autre, Paris, Les éditions ouvrières, 1992, p. 41, 44.
[36] O. Le Cour Grandmaison, De l’indigénat. Anatomie d’un « monstre » juridique : le droit colonial en Algérie et dans l’Empire français, Paris, La Découverte (Zones), 2010.
[37] Ibid, p. 8-9.




