Agenda militant
Ailleurs sur le Web
![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)
- L’amitié pour faire peuple (17/01)
- Chikirou : La nourriture est une affaire politique (16/01)
- Entretien avec Emmanuel Todd (16/01)
- Un mois de grèves et de luttes : Décembre 2025 (16/01)
- Lordon : Boulevard de la souveraineté (15/01)
- L’affaire d’État Alstom : l’étau se resserre autour de la responsabilité de Macron (15/01)
- Coquerel sur France 2 mercredi 14 janvier (14/01)
- Le "moment eurocommuniste" ou la déstalinisation ratée du PCF (14/01)
- Etats-Unis : comprendre la « nouvelle doctrine de sécurité nationale » et ses implications (14/01)
- La loi du plus fort - La chronique de Pierre-Emmanuel Barré (12/01)
- Retour sur le blocage du périph’ - A propos de la résistance à l’accord UE-Mercosur et à la politique d’abattage total. (12/01)
- Venezuela : des médias intoxiqués par la propagande de guerre (12/01)
- Où vivent les plus riches ? Ce que la géographie des hauts revenus dit des fractures françaises (11/01)
- Une récompense pour les criminels ! Le prix Nobel de la « paix » (11/01)
- La crise de la gauche portugaise. Entretien avec Catarina Príncipe (11/01)
- Victor Klemperer, critique impitoyable du sionisme (11/01)
- USA - VENEZUELA : UNE OPÉRATION MAFIEUSE SALUÉE PAR LES "COLLABOS" - Maurice Lemoine (11/01)
- Le paradoxe de la Sécurité sociale : et si, pour faire des économies, il fallait l’étendre ? (11/01)
- LFI : Soutien au peuple venézuélien contre l’agression de Trump ! (10/01)
- Du militarisme à gauche. Réponse à Usul et à Romain Huët (09/01)
- Face à l’impérialisme trumpiste : ne rien céder (08/01)
- Attaque américaine au Venezuela : ce que révèle le "zéro mort" de franceinfo (08/01)
- Que signifie "abolir la monnaie" ? (08/01)
- Abject dessin antisémite dans Marianne contre le député LFI Rodriguo Arenas (08/01)
- "ILS FONT LE SAV DE TRUMP !" CE QUE DISENT LES MÉDIAS FRANÇAIS SUR LE VENEZUELA (08/01)
Liens
Trump, la guerre et le capitalisme de la finitude
Ces articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » sont publiés à titre d'information et n'engagent pas la Tendance CLAIRE.
https://www.contretemps.eu/trump-guerre-capitalisme-finitude/
A l’heure où les affaires mondiales sont profondément secouées par la politique commerciale de Donald Trump, Norbert Holcblatt propose d’en esquisser les racines à partir d’un ouvrage récemment paru – « Le monde confisqué » de l’économiste Arnaud Orain (aux éditions Flammarion).
Il montre ici comment ce dernier aide à saisir les recompositions du capitalisme, mais pointe aussi les limites de cet ouvrage largement ancré dans une lecture idéaliste de l’histoire, et le discute par rapport à des travaux marxistes récents portant sur le capitalisme mondial et l’impérialisme contemporain.
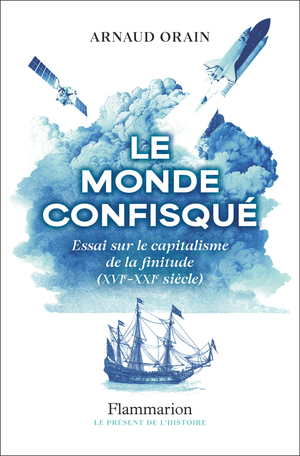
Donald Trump est en train de créer dans le monde un effet de sidération. Au-delà des spécificités psychologiques du personnage, il importe d’essayer d’analyser ce à quoi son arrivée au pouvoir correspond par rapport à la phase actuelle du capitalisme : de quoi Trump est-il le nom ? Une autre question s’impose dans les écrits récents : la guerre (une guerre supplémentaire, ou plutôt une « grande guerre » impliquant directement les centres capitalistes) est-elle une perspective inévitable ?
Est récemment paru un livre qui ne traite que par la bande du trumpisme mais vise à fournir un cadre d’analyse de la géopolitique mondiale et donc un éclairage des bouleversements actuels : Le monde confisqué. Essai sur le capitalisme de la finitude de Arnaud Orain[1]. L’ouvrage a un écho important dans les milieux intellectuels plus ou moins à gauche. Nous y consacrerons la première partie de cet article.
La fin du néolibéralisme ?
A. Orain explique que le capitalisme, depuis le 16e siècle, a vu se succéder deux types différents : un type plus ou moins libéral (1815-1880 et 1945-2010) et un « capitalisme de la finitude » dont le moteur est le « sentiment angoissant suscité par des élites » (page 9) que le monde est fini, borné, limité et qu’il faut s’accaparer tout ce qu’il est possible d’avoir.
Cela se manifeste sur trois plans : fermeture et privatisation des mers (cette partie est assez fastidieuse), relégation au second plan des mécanismes du marché, prise de contrôle d’espaces matériels et immatériels. D’après Orain, nous serions à nouveau dans une telle période après celles du 15e-18e siècle et de 1880-1945. Arnaud Orain s’aventure ainsi avec une approche originale sur un terrain défriché par de nombreux économistes et historiens. Avant de discuter sa problématique, il est nécessaire de reprendre les étapes du capitalisme telles qu’il les expose.
La première phase du capitalisme a vu la compétition féroce entre Espagnols et Portugais dans un premier temps, puis entre les principales puissances européennes pour le contrôle des routes maritimes vers les ressources des Amériques et de l’Asie. C’est la première phase de l’expansion coloniale où chaque État colonisateur cherche à s’arroger le monopole des échanges avec les territoires dont il a pris le contrôle par la violence.
Avec la deuxième phase, celle du capitalisme industriel, s’implante progressivement, sous hégémonie britannique, le libéralisme économique et le multilatéralisme commercial. David Ricardo fonde la théorie du commerce international et démontre que l’échange international accroit le bien être de toutes les parties prenantes. Si le libre commerce permet d’accéder aux ressources, la possession directe de territoires n’est plus nécessaire. La poussée colonisatrice connait une accalmie avec des exceptions, dont deux importantes : l’Algérie et l’Inde. Orain qualifie cette situation d’« impérialisme informel » (page 265). Ce qui en fait n’exclut pas, néglige curieusement l’auteur, les démonstrations militaires pour imposer l’ouverture commerciale (de la Chine, du Japon, etc.).
Le troisième phase voit le retour des affrontements entre nations et du protectionnisme. Ce capitalisme de la finitude, contrairement au libéralisme économique, ne croit pas que le marché libre puisse conduire à la croissance universelle des richesses et au bien-être généralisé. Le rapport de force est son horizon naturel. Le colonialisme connait une nouvelle poussée et de nouveaux acteurs veulent s’imposer, notamment l’Allemagne. La monopolisation de l’économie permet de contourner les mécanismes concurrentiels. Le monde se fragmente et deux guerres mondiales déchirent la planète.
Sous hégémonie américaine, la période d’après 1945 est d’abord celle d’un libéralisme encadré par l’État. Peu à peu le commerce international revient au libre-échange : l’Organisation mondiale du commerce (OMC) est ainsi créée en 1995. Les empires coloniaux disparaissent au profit de liens commerciaux (inégaux) et d’interventions (éventuellement militaires) ponctuelles mais non exceptionnelles.
Il faut toutefois rappeler, ce que ne fait pas l’auteur, que les métropoles ne se résignent à l’indépendance des colonies que parce qu’elles sont confrontées à des mouvements indépendantistes souvent d’abord férocement réprimés. A partir des années 1980, les institutions de l’État-providence sont remises en cause : c’est l’époque du néolibéralisme : le marché libre est supposé conduire à la généralisation de la prospérité. La Chine adhère à l’OMC en 2001.
Autour de 2010, le monde bascule dans une nouvelle époque de confrontation ; sa description est la partie la plus intéressante de l’ouvrage. Face à des ressources limitées, se développe à nouveau la lutte du chacun pour soi : le « gâteau » n’est pas indéfiniment extensible, c’est à chacun de préserver ou d’agrandir sa part de surfaces maritimes, éventuellement de territoires, de ressources naturelles, etc. La sécurité des chaines d’approvisionnement devient une préoccupation majeure : la « sécurité alimentaire » conduit certains pays à la prise de contrôle de terres agricoles outre-mer (et à exploiter les fonds marins au risque de leur épuisement).
On assiste enfin à une ruée vers les métaux nécessaires à la « transition énergétique ». L’hégémonie américaine s’érode et la Chine a des ambitions maritimes de plus en plus affirmées, elle investit dans diverses régions du monde et met en place les « nouvelles routes de la soie » (depuis rebaptisées) visant, par le rachat ou la mise en place d’infrastructures, à asseoir son accès aux ressources et sa sphère d’influence économique et politique.
À l’instar des Compagnies des Indes néerlandaise et britannique qui, aux 17e et 18e siècles, étaient des firmes commerciales dotées de pouvoirs politiques, se sont constituées sur la base des nouvelles technologies des entreprises qui, de fait, disposent d’un pouvoir d’influence pratiquement incontournable sur de larges pans de l’économie, sur les activités des individus.
La logistique et le capital marchand dominés par des entreprises géantes jouent aussi désormais un rôle essentiel : Orain en tire la conclusion que ce « capitalisme d’entrepôt » rétrograde la production à un rôle subordonné, ce qui est loin d’être évident. Enfin, les guerres ont toutes les raisons de proliférer sans que cela dégénère forcement en un affrontement direct entre les deux puissances essentielles : les États-Unis et la Chine (page 316). Nous reviendrons sur ce point.
L’élection de Donald Trump est intervenue au moment de la fin de rédaction du livre. Trump semble s’inscrire tout à fait dans ce capitalisme de la finitude. Ainsi qu’en témoignent diverses positions développées dans sa campagne électorale et reprises depuis (et donc après la publication du livre) : droits de douanes brandis tous azimuts, dédain vis-à-vis des partenaires traditionnels des États-Unis, mépris de la souveraineté de certains États (Canada, Danemark à propos du Groenland), chantage sur les « terres rares » de l’Ukraine, et jusqu’ à la prétention de rebaptiser le Golfe du Mexique « Golfe de l’Amérique ».
Le site de Libération du 26 février dernier accuse Trump de réhabiliter « une version archaïque et impérialiste des rapports de force ». « Archaïque » ? pas vraiment si l’on accepte la thèse du capitalisme de la finitude. L’archaïsme de Trump est cependant évident sur d’autres plans avec d’abord son obstination à nier la crise environnementale au profit des intérêts immédiats des USA (« drill, baby, drill »). On peut y ajouter la reprise plus ou moins sincère des positions des chrétiens fondamentalistes sur l’avortement et les LGBTQI+.
Quant à l’Union européenne, telle qu’elle est, elle apparaît assez démunie face au monde qui s’esquisse mais pourrait, elle aussi, sauf choix résolu d’une alternative, adopter pour accéder aux ressources, un « chemin nationaliste et fossile » (p. 318) dont on peut considérer que le démantèlement annoncé de mesures (par ailleurs insuffisantes) du « Pacte vert » et les annonces de hausse des budgets militaires constituent les prémisses.
Le livre d’Arnaud Orain fournit donc un éclairage intéressant sur le monde actuel même si la succession des phases du capitalisme telles qu’il le décrit est loin d’être convaincante. Par ailleurs, certains points apparaissent particulièrement problématiques. Ainsi, le raisonnement d’Arnaud Orain est sous-tendu par une vision de l’histoire largement idéaliste : il énonce ainsi que le capitalisme de la finitude a pour moteur un « sentiment angoissant suscité par les élites » (page 9) ; c’est pour le moins léger. D’ailleurs, les conflits sociaux et les mouvements de libération nationale n’interviennent pas dans l’Histoire telle qu’il la présente.
L’affirmation brutale des pages 20-21 : « ce sont les soutiens du capitalisme qui s’opposent le plus souvent au libéralisme économique » apparaît fort contestable. Certes, la bourgeoisie est souvent plus empirique en matière de pensée économique que ses idéologues et, comme le souligne plus loin Orain (page 124), est prête à se rallier aux dispositifs propres à préserver ses profits même s’ils comportent une dose d’étatisme et de limitation de la concurrence.
On l’a vu dans de nombreux cas, de l’Allemagne nazie à la Corée du Sud d’après la Seconde Guerre mondiale en passant par la Russie actuelle. De même si, durant le premier mandat de Trump, certains géants de la nouvelle économie avaient manifesté des réticences ouvertes, ce n’est plus le cas aujourd’hui où ils donnent des gages, non seulement à la personne du président, mais à son idéologie anti-diversité (qui remet en cause les mesures visant à l’inclusion des groupes discriminées, notamment racialement). Mais on ne peut tirer de tout cela la conclusion d’Arnaud Orain quant à leur opposition au libéralisme économique.
Il y a matière à discussion dès la première phrase du livre : « Le néolibéralisme est terminé ». En effet, si au niveau théorique, le néolibéralisme est une construction à peu près cohérente, il n’en est pas de même au niveau de sa mise en œuvre où, comme le souligne David Harvey dans sa « Brève histoire du néolibéralisme » (republié en français en 2024 par les éditions Amsterdam), on se trouve face à un fouillis des pratiques étatiques, souvent divergentes et très disparates » (Harvey, page 152), notamment en matière de commerce extérieur, mais pas seulement.
Dans les différents États, subventions publiques et dispositifs protecteurs des entreprises sont souvent des béquilles nécessaires pour le capital qui continuera simultanément à réclamer la poursuite des réformes néolibérales de précarisation des salariés, d’économies sur les programmes sociaux et de privatisations. En tout cas, il est évident que « ceux d’en bas » aux États-Unis et ailleurs vont subir le « talon de fer » de la jungle de capitalisme de la finitude, dont l’action du DOGE d’Elon Musk fournit une première illustration.
Enfin, un point essentiel est éludé par Arnaud Orain : celui de la causalité des alternances entre phases libérales et phases marquées par la finitude. Ceci alors que l’étude des facteurs de retournement des cycles ou des « ondes longues » est un point essentiel de la compréhension des dynamiques économiques ainsi que l’ont montré les travaux d’Ernest Mandel. C’est une lacune importante de l’ouvrage.
Beaucoup de choses ont été écrites ou dites sur Trump et le « trumpisme » mais les commentaires politiques et électoraux, aussi intéressants soient-ils n’abordent généralement que secondairement la question énoncée ci-dessus : de quoi Trump est-il le nom ? Dans un ouvrage écrit en 2017 (lors du premier mandat de Donald Trump), Le moment Trump, une nouvelle phase du capitalisme mondial, Daniel Tanuro[2] visait à s’y confronter. Tanuro décrivait le moment Trump comme correspondant à une double réalité.
Tout d’abord, une réaction de certains segments de la société et du capital américains face à une nouvelle phase du capitalisme mondial (marquée notamment par la montée de la Chine) et à ses incertitudes. Le capitalisme étasunien est encore dominant, mais son leadership économique est menacé. L’impérialisme US garde une suprématie militaire écrasante mais la Chine s’arme à une vitesse accélérée.
Par ailleurs, Trump s’appuie sur une « révolte réactionnaire » de certains segments populaires (à composante anti-establishment, anti-immigrés et raciste) notamment dans la petite bourgeoisie, révolte instrumentalisée par des secteurs du capital pour leur objectifs propres. Pour Tanuro, comme pour Orain, mais sur la base d’une analyse marxiste, Trump n’est pas un « accident de parcours » mais vraiment le « signe de l’entrée dans une ère nouvelle » dont ceux qui en doutaient doivent aujourd’hui réviser leurs analyses.
Ère nouvelle et renouveau des impérialismes
Divers travaux récents essayent d’appréhender la nature de cette ère nouvelle. Ils convergent sur le fait que l’élément déclencheur essentiel en est la montée de la Chine. Benjamin Bürbaumer s’est particulièrement penché sur cette question dans son ouvrage paru en 2024 : Chine/USA, le capitalisme contre la mondialisation[3].
Dans un premier temps (de la fin du 20e siècle au début du 21e), celui de l’intégration de la Chine au marché mondial, l’interdépendance entre Chine et États-Unis apparaissait relativement solide pour le plus grand bien du capitalisme (les revenus des exportations de la Chine contribuant à financer la dette américaine) au point qu’avait été forgée l’expression « Chinamerica » (ou « Chimamerica »). Ce temps est révolu. Pour le comprendre, souligne Bürbaumer il faut revenir aux motivations divergentes des États-Unis et de la direction de l’État chinois lors de l’engagement des réformes en Chine.
Pour les États-Unis, il s’agit d’une victoire du capitalisme occidental qui élargit le champ d’action et les possibilités de profit des multinationales et va donner à la Chine une place spécifique et subordonnée dans le cadre d’une mondialisation sous leadership américain. Pour les dirigeants chinois, l’objectif est d’accélérer le développement national tout en préservant la stabilité de l’État chinois et, à terme, sa capacité à influencer les règles du jeu international. D’une certaine façon, on peut faire une analogie entre cette démarche et celle du Japon de l’ère Meiji au 19e siècle. Et de fait, « sa participation à la mondialisation sous égide étatique donne à la Chine les outils pour passer du statut de simple fournisseur des multinationales américaines au statut de concurrent, voire de précurseur » (Bürbaumer, page 11).
Un document récent de la direction du Trésor du ministère de l’économie[4] illustre tout à fait les développements de Bürbaumer : la part de la Chine dans le commerce mondial est passée de 4,7% en 2002 à 12,7% en 2022 et la Chine est devenue le 1er partenaire commercial de plus de 120 pays et régions dans le monde. Un grand nombre de pays « émergents » sont également liés financièrement à la Chine à travers des prêts commerciaux et souverains. Les principaux secteurs (énergie, mines, transport) et régions destinataires (Asie et Afrique pour près de 60 % des prêts) reflètent les priorités stratégiques chinoises, notamment en matière d’approvisionnement. Ces relations sont loin de se limiter à l’initiative des « nouvelles routes de la soie » (ou Belt and Road Initiative).
La Chine cherche à renforcer le rôle international du Yuan (officiellement dénommé Renminbi) et les manifestations de son ascension sont nombreuses, et pas uniquement économiques. Sur le plan militaire, elle renforce ses capacités et les déploie largement en mer de Chine méridionale mais aussi plus loin de ses côtes. Elle commence aussi à se mêler des affaires du monde, d’abord en Asie mais pas seulement, tendant à se poser en porte-parole de la Périphérie. Aucune des deux puissances ne remet en cause les échanges commerciaux internationaux, « mais ils veulent les contrôler et en prélever une part croissante » (page 17).
De par son propre développement, la Chine est donc portée à la remise en cause d’un ordre fonctionnant d’abord au profit des États-Unis. Ceux-ci sous Trump comme sous Biden se sont efforcés de préserver leurs atouts géopolitiques et technologique qui restent importants. Joe Biden n’a d’ailleurs pas remis en cause les mesures douanières protectionnistes instaurées par son prédécesseur (et désormais successeur). Les autorités américaines ont souhaité aussi restreindre certains investissements ou exportations US en Chine susceptibles d’aider au progrès technologique de ce pays. Dans un discours d’avril 2023, la secrétaire américaine au Trésor a été claire : face à la Chine, il est essentiel de préserver « le leadership économique des États-Unis »[5].
La conclusion de Bürbaumer est simple : la montée des tensions entre la Chine et les USA ne tient pas à la mauvaise volonté ou au ressentiment de tel ou tel dirigeant mais à « l’interpénétration des intérêts économiques et des stratégies politiques » (page 9) dont la dynamique sous-jacente renvoie à la formule de Rosa Luxembourg : « l’expression politique de l’accumulation capitaliste se manifestant par la concurrence entre les capitalismes nationaux » (p. 294). Bürbaumer reprend d’ailleurs dans ce dernier ouvrage un point important sur lequel il avait insisté dans des écrits précédents : le caractère transnational d’une firme ne signifie pas qu’elle soit détachée d’un territoire souverain particulier (page 33).
Le développement capitaliste de la Chine, la réaction américaine entraînent donc des tensions commerciales et conduiront vraisemblablement à des frictions militaires dans la région indo-pacifique. D’où le titre maladroit de l’ouvrage de Bürbaumer : « le capitalisme contre la mondialisation ». Ce titre et certaines formules comme « le capitalisme mine la mondialisation » (page 9) ont été critiqués dans une recension de l’ouvrage[6] comme porteurs d’équivoque car semblant opposer mondialisation et capitalisme comme « s’il s’agissait de deux réalités indépendantes et antagoniques. » Effectivement, la Chine n’est pas contre la mondialisation, ne veut pas la saper. Au contraire d’ailleurs, elle a comme posture ces derniers temps de se poser en championne du libre commerce face aux mesures protectionnistes américaines.
Au-delà de formulations au moins maladroites, il serait plus clair de résumer ainsi l’axe essentiel du livre : le développement capitaliste de la Chine, sa volonté de ne pas se laisser imposer des règles qui fonctionnent au profit des États-Unis et, d’autre part, les réactions que cela suscite du bénéficiaire de ces règles, sont de nature à amener des formes de recloisonnement du monde.
Enfin, on notera le titre de la conclusion de Bürbaumer » : « Le souffle du canon » (page 291). Le renforcement des moyens militaires chinois en premier lieu dans la région indo-pacifique remet en cause, selon des analystes américains, des décennies de prééminence des États-Unis dans la région. Pourtant, d’après les dernières données de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri)[7], les sommes que Washington affecte à la défense augmentent et représentent plus du tiers (37 %) des dépenses militaires du monde entier (celles de la Chine en représentent 12%). Conclusion prudente de Benjamin Bürbaumer : « les frictions entre les machines de guerre américaine et chinoise sont donc amenées à croître » (page 294).
L’apport de Bürbaumer est réel sur l’aspect géopolitique (la montée de la Chine et les réactions des États-Unis) mais il est plus limité sur les évolutions sous-jacentes du capitalisme, y compris américain (on a parfois du mal à le suivre dans ses allusions aux rapports de ses différentes fractions : « capitalisme transnational » et « capitalisme « national »). Costas Lapavitsas a coordonné un ouvrage collectif sur l’état du capitalisme[8] et publié postérieurement divers textes reprenant des éléments de sa contribution au livre. Nous reprenons ici de larges développements d’un texte publié dans Jacobin en septembre 2024[9].
Le premier point essentiel est l’affirmation selon laquelle les tensions et les conflits armés actuels renvoient à l’état de l’économie mondiale et à ses transformations structurelles. Ce qui ne signifie pas, souligne-t-il que des calculs économiques soient derrière toutes les éruptions. Lapavitsas rejette les explications non-économiques de l’impérialisme mais souligne que la théorie canonique d’Hilferding et Lénine mérite d’être réexaminée même si la géopolitique du monde actuel pourrait rappeler celle d’avant 1914. On sait que Lénine définissait ainsi l’impérialisme :
« L’impérialisme est le capitalisme arrivé à un stade de développement où s’est affirmée la domination des monopoles et du capital financier, où l’exportation des capitaux a acquis une importance de premier plan, où le partage du monde a commencé entre les trusts internationaux et où s’est achevé le partage de tout le territoire du globe entre les plus grands pays capitalistes ».
Le capital financier, issu de la fusion du capital industriel et du capital bancaire, et le commerce des matières premières et le prêt d’argent jouant un rôle essentiel. Lapavitsas voit deux différences majeures entre la situation présente et ce qui vient d’être résumé. La première est l’internationalisation du capital productif :
« de grands volumes de production se réalisent au-delà des frontières nationales dans des chaînes généralement dirigées par des multinationales qui exercent leur contrôle soit directement par le biais de droits de propriété sur des filiales, soit indirectement par le biais de contrats avec des capitalistes locaux ».
Il en résulte une expansion considérable du commerce mondial. La deuxième différence est le développement d’institutions financières non-bancaires qui tirent leurs profits du « trading » et de la détention de titres. Ces institutions ne fusionnent pas avec le capital productif et Lapavitsas affirme qu’il est difficile de soutenir qu’elles dominent les multinationales qui détiennent aujourd’hui d’importantes réserves financières. Les grandes institutions financières, surveillent l’évolution des cours des bourses et détiennent d’importants droits de vote qui leur permettent jouer un rôle dans l’élaboration des décisions de ces sociétés, mais, selon Lapavitsas, elles n’en dictent pas les termes. Ce point mériterait certainement d’être étayé par des études empiriques.
L’impérialisme contemporain tire sa force et du capital industriel internationalisé et de la finance elle aussi internationalisée. Le fonctionnement de ce capitalisme renouvelé nécessite d’abord des règles claires pour régir l’investissement, les échanges commerciaux et les flux de capitaux. Il a aussi besoin d’une forme fiable de monnaie internationale pour servir d’unités de compte, de moyens de paiement et de réserve de valeur. Enfin, le soutien des États lui est indispensable. Tous ces développements avec d’autres travaux (une étude des théories de l’impérialisme et des débats récents a été élaboré par Claude Serfati[10]) sont de nature à nourrir la réflexion nécessaire sur l’impérialisme renouvelé auquel nous sommes confrontés.
Les États-Unis ont été la puissance hégémonique pendant presque trois décennies après la chute de l’URSS. Leur devise nationale est en même temps la monnaie mondiale. Leur prédominance est à la fois économique et militaire. Ils détiennent une position dominante dans les institutions économiques internationales (FMI, Banque mondiale, etc.).
Ils créent aussi l’environnement qui permet aux « vieux » impérialismes de faire leurs affaires sans remettre en cause l’agencement de l’ordre américain : aucun des challengers potentiels des États-Unis ne vient des anciennes puissances impérialistes, ils sont issus de la périphérie. Comme l’avait déjà souligné Perry Anderson (cité par Bürbaumer), les États-Unis exercent une hégémonie à double fonction : favoriser les intérêts des multinationales américaines et garantir l’ordre économique international du capital en général.
Avec le temps, ils ont cependant commencé à payer le prix de leur propre succès. L’internationalisation des processus productifs et les politiques néolibérales ont eu des conséquences sur le tissu industriel américain et entretenu la désespérance sociale. L’internationalisation a par ailleurs a favorisé le développement d’autres centres d’accumulation capitaliste au premier rang desquels la Chine. Cette situation est le soubassement des présentes tensions inter-impérialistes « dans un moment de sous-performance historique du cœur de l’économie mondiale » ce qui semble désigner les pays de l’OCDE.
Cependant, pour Lapavitsas, qui n’hésite pas à souligner la menace de guerre, les États-Unis qui n’acceptent pas le nouvel état du monde sont la principale menace pour la paix. Mais « leurs challengers sont tout sauf porteurs d’une meilleure promesse pour l’humanité. »[11] À l’instar, ajouterons-nous, des compétiteurs germanique et japonais des vieux impérialismes français et britannique au début du 20e siècle.
La « première mondialisation » (pour reprendre l’expression de Suzanne Berger), celle de la seconde moitié du 19e siècle, a en effet également buté sur les rivalités entre puissances installées et puissances ascendantes. Claude Serfati a beaucoup écrit sur les questions militaires et les rapports entre puissances. Dans Un monde en guerres, il qualifie la Chine d’« impérialisme émergent »[12] (page 229) qui combine une force industrielle dont on a déjà signalé l’ampleur avec une puissance financière détentrice d’importantes réserves en devises et se manifestant de plus en plus comme un important investisseur international.
Enfin, la Chine accroît année après année ses capacités militaires. Contrairement à l’URSS, dont la compétition avec le monde capitaliste était avant tout politique et militaire, la Chine s’érige en rivale globale et se présente même, surtout dans la période récente (et face aux initiatives de Donald Trump) comme un facteur de stabilité dans le cadre non contesté du marché international.
Ainsi que le résume Serfati dans un texte de 2024[13] : le monde actuel est celui d’une « multipolarité capitaliste » et donc de rivalités inter-impérialistes. Ces rivalités semblent nouvelles après la période de domination écrasante des États-Unis mais elles furent une caractéristique majeure de l’ère pré-2014 ; dans le contexte postérieur à la grande crise financière de 2007-2008, on constate à nouveau « une forte proximité entre la concurrence économique et les rivalités politico-militaires ».
Dans son analyse des dynamiques actuelles, Serfati prend comme point d’appui l’analyse marxiste de l’impérialisme ainsi que l’hypothèse du développement inégal et combiné formulée par Trotsky à propos de la Russie tsariste. Celle-ci « implique que la combinaison (ou l’amalgame) de plusieurs étapes de développement et de diverses formes sociales permet à un pays de provoquer une « compression du temps » qui est rendue possible grâce au rétrécissement de l’espace provoqué par le marché mondial qui agit alors comme « un fouet externe » (Serfati, page 212). Mais « la possibilité de sauter par-dessus les degrés intermédiaires n’est pas, on l’entend bien, tout à fait absolue : en fin de compte, elle est limitée par les capacités économiques et culturelles du pays »[14] .
Serfati précise ce dernier point : « l’implication forte de l’État est une condition nécessaire » (page 215) et celui-ci doit être doté des capacités et instruments nécessaires. Au total, l’analyse héritée de Trotsky fournit une clef de lecture adéquate pour comprendre l’ascension de la Chine et les spécificités de sa formation sociale qui combine les formes les plus modernes avec d’autres héritées du passé. Conclusion de Serfati : l’hypothèse formulée par Trotsky « invite donc à ne pas considérer de façon statique les critères utilisés par Lénine pour définir l’impérialisme ».
D’ailleurs, on sait que Lénine lui-même pouvait faire preuve d’une certaine souplesse et reconnaissait la possibilité de combinaison de plusieurs formes, encore à propos de la Russie :
« en Russie, l’impérialisme capitaliste du type moderne s’est pleinement révélé dans la politique du tsarisme à l’égard de la Perse, de la Mandchourie, de la Mongolie ; mais ce qui, d’une façon générale, prédomine en Russie, c’est l’impérialisme militaire et féodal. »[15]
Contrairement à ce que soutiennent divers auteurs dogmatiques, inclinés à ne voir d’impérialistes que les États-Unis, caractériser la Chine et la Russie comme des États impérialistes ne signifie pas l’adoption d’un éclectisme sans principes. Mais ce débat est évidemment secondaire par rapport à la réalité des tensions et guerres actuelles.
Finalement, quel que soit le terme que l’on choisit (« capitalisme de la finitude », « fin de la mondialisation », « conflits inter-impérialistes »), il est clair, que l’ordre international supposé inclusif et marqué par la suprématie des États-Unis est révolu » (p. 240). Quant à une guerre, « il serait déraisonnable de ne pas se poser la question » (Serfati page 242). D’autant que de vraies guerres font rage : en Palestine, en Ukraine, au Congo… Ce qui alimente la tentation de reprendre une fois de plus la formule souvent galvaudée de Gramsci :
« La crise consiste justement dans le fait que l’ancien meurt et que le nouveau ne peut pas naître : pendant cet interrègne on observe les phénomènes morbides les plus variés. »[16]
Ainsi que l’écrivait Gilbert Achcar en 2018 :
« Ces phénomènes portent au paroxysme la dérive mondiale vers la droite enclenchée par la régression néolibérale des années 1980. La Grande Récession a accéléré dramatiquement cette dérive, qui porte à présent les visages de Donald Trump […], ainsi que ceux d’une grande gamme de personnes dans le monde entier… »[17].
Notes
[1] Arnaud Orain, Le monde confisqué. Essai sur le capitalisme de la finitude (XVI°-XXI° siècle), Paris, Flammarion, 2025.
[2] Daniel Tanuro, Le moment Trump, une nouvelle phase du capitalisme mondial, Paris, Démopolis, 2018.
[3] Benjamin Bürbaumer, Chine/États Unis, le capitalisme contre la mondialisation, La Découverte, 2024
[4] https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/a3f6fbf2-d16e-4e68-a271-4d4503040377/files/80a301cc-f9d3-4422-a059-14544c555070
[5] Remarks by Secretary of the Treasury Janet L. Yellen on the U.S. – China Economic Relationship at Johns Hopkins School of Advanced International Studies | U.S. Department of the Treasury
[6] Baptiste Galais-Marsac, « La guerre économique Chine/États-Unis menace-t-elle la mondialisation ? », LVSL, 20 octobre 2024 La guerre économique Chine/États-Unis menace-t-elle la mondialisation ?
[7] https://www.sipri.org/sites/default/files/2024-04/2404_fs_milex_2023.pdf
[8] “The State of Capitalism” by The EReNSEP Writing Collective and Costas Lapavitsas, Verso, 2023
[9] Costas Lapavitsas, Jacobin, 5 septembre 2024, Today’s Imperialist Clashes Are Driven by Economic Rivalry
[10] Claude Serfati, Guide de lecture] Les théories marxistes de l’impérialisme, 7 mai 2018 [Guide de lecture] Les théories marxistes de l’impérialisme – Période
[11] Costas Lapavitsas, « Drifting towards World war »”, 1er avril 2024, Costas Lapavitsas – Drifting toward world war – Brave New Europe
[12] Claude Serfati, Un monde en guerres, éditions Textuel, 2024.
[13] Claude Serfati, État du monde : crise économique et rivalités géopolitiques – Europe Solidaire Sans Frontières, 2024
[14] L. Trotsky, Histoire de la révolution russe, cité par Cl. Serfati.
[15] Lénine : le socialisme et la guerre (2), 1915
[16] Antonio Gramsci, Cahiers de prison, Éditions Gallimard.
[17] Gilbert Achcar, « Phénomènes morbides » : qu’a voulu dire Gramsci et quel rapport avec notre époque ? » Contretemps, 11 juin 2018




