Agenda militant
Ailleurs sur le Web
![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)
- Coquerel sur France 2 mercredi 14 janvier (14/01)
- Le "moment eurocommuniste" ou la déstalinisation ratée du PCF (14/01)
- Etats-Unis : comprendre la « nouvelle doctrine de sécurité nationale » et ses implications (14/01)
- La loi du plus fort - La chronique de Pierre-Emmanuel Barré (12/01)
- Retour sur le blocage du périph’ - A propos de la résistance à l’accord UE-Mercosur et à la politique d’abattage total. (12/01)
- Venezuela : des médias intoxiqués par la propagande de guerre (12/01)
- Où vivent les plus riches ? Ce que la géographie des hauts revenus dit des fractures françaises (11/01)
- Une récompense pour les criminels ! Le prix Nobel de la « paix » (11/01)
- La crise de la gauche portugaise. Entretien avec Catarina Príncipe (11/01)
- Victor Klemperer, critique impitoyable du sionisme (11/01)
- USA - VENEZUELA : UNE OPÉRATION MAFIEUSE SALUÉE PAR LES "COLLABOS" - Maurice Lemoine (11/01)
- Le paradoxe de la Sécurité sociale : et si, pour faire des économies, il fallait l’étendre ? (11/01)
- LFI : Soutien au peuple venézuélien contre l’agression de Trump ! (10/01)
- Du militarisme à gauche. Réponse à Usul et à Romain Huët (09/01)
- Face à l’impérialisme trumpiste : ne rien céder (08/01)
- Attaque américaine au Venezuela : ce que révèle le "zéro mort" de franceinfo (08/01)
- Que signifie "abolir la monnaie" ? (08/01)
- Abject dessin antisémite dans Marianne contre le député LFI Rodriguo Arenas (08/01)
- "ILS FONT LE SAV DE TRUMP !" CE QUE DISENT LES MÉDIAS FRANÇAIS SUR LE VENEZUELA (08/01)
- VENEZUELA : CE QUE NE DIT PAS LA PROPAGANDE DE TRUMP (08/01)
- Les États-Unis prennent d’assaut le territoire et le gouvernement du Venezuela (08/01)
- Les systèmes militaro-industriels, noyau totalitaire du capitalisme contemporain (08/01)
- LE KIDNAPPING DE MADURO - LE BANDITISME D’ÉTAT AMÉRICAIN (08/01)
- Le Moment politique de Mélenchon (06/01)
- In memoriam Mohammed Harbi (1933-2026) (05/01)
Liens
La première année du pouvoir soviétique
Ces articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » sont publiés à titre d'information et n'engagent pas la Tendance CLAIRE.
La première année du pouvoir soviétique - CONTRETEMPS
Les Éditions critiques ont publié en 2024 le livre important de l’historien Alexander Rabinowitch, qui aborde un épisode crucial de l’histoire du communisme au 20e siècle, à savoir la première année au pouvoir des bolcheviks, après la Révolution d’octobre. Nous en publions un compte-rendu de Kevin Murphy.
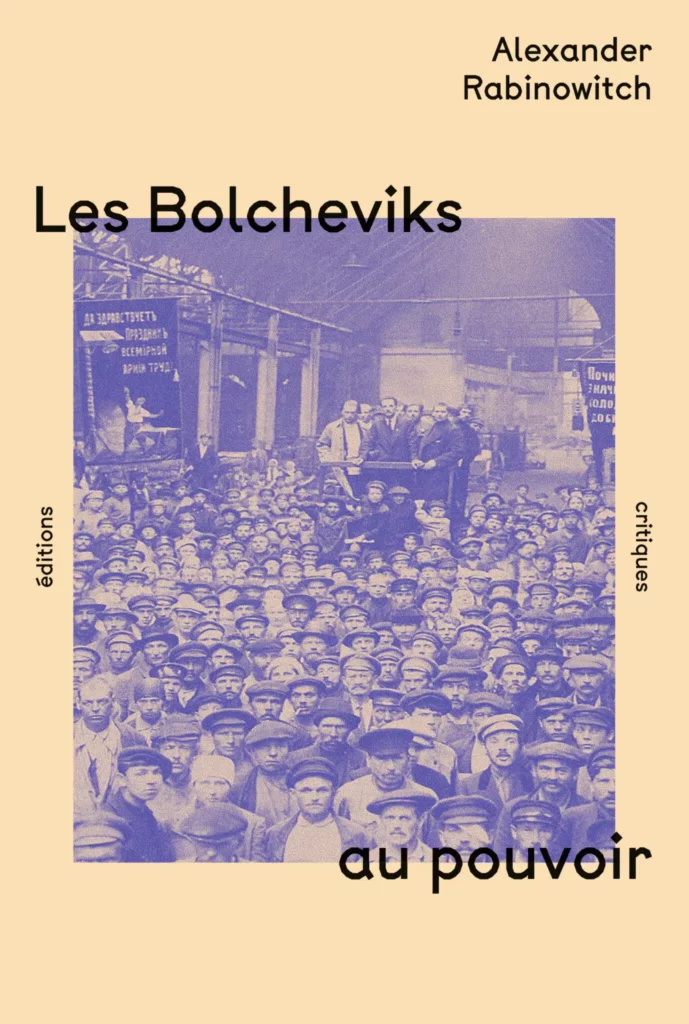
Alexander Rabinowitch, Les bolcheviks au pouvoir : La première année du régime soviétique à Petrograd, Paris, Éditions critiques, 2024.
L’auteur de la plus importante étude universitaire sur la révolution russe de 1917 vient de produire l’étude d’archives la plus sérieuse sur le premier régime révolutionnaire. Fruit de plus de vingt années de travail, Les bolcheviks au pouvoir constitue le prolongement logique de Les bolcheviks prennent le pouvoir (La Fabrique), d’Alexander Rabinowitch (né en 1934).
Il est difficile de rendre justice à l’ampleur et à la richesse de cet ouvrage novateur. Des premiers jours turbulents du pouvoir soviétique aux vives divisions autour de la paix de Brest Litovsk avec l’Allemagne, jusqu’à la Terreur rouge de 1918, Rabinowitch explore toutes les pistes et mobilise l’ensemble des sources disponibles pour brosser un tableau saisissant d’une révolution constamment au bord du gouffre.
Le récit captivant de Rabinowitch sur les débats concernant la paix avec l’Allemagne ou la guerre révolutionnaire montre à quel point le nouveau régime était proche de l’effondrement. Face à la désintégration des forces armées, Lénine (1870-1924) affirmait que le régime révolutionnaire n’avait d’autre choix que de signer un traité de paix défavorable, cédant de vastes territoires aux Allemands.
Mais Lénine était en minorité, opposé aux discours enflammés des Socialistes Révolutionnaires de gauche (SR) et de certains bolcheviks, partisans de la guerre révolutionnaire. Rabinowitch conclut à juste titre qu’« il existe peu de meilleurs exemples de la ténacité et de la force de volonté légendaires de Lénine que sa détermination farouche à vaincre ses adversaires à ce moment critique de l’histoire du bolchevisme et de la Révolution russe ».
Les bolcheviks au pouvoir prolonge également un thème majeur de l’œuvre précédente de Rabinowitch sur 1917 : : la vitalité des discussions démocratiques au sein du Parti bolchevique tout au long de l’année 1918 sur chaque décision politique majeure. Par exemple, les partisans bolcheviques de la guerre révolutionnaire non seulement pouvaient exprimer leur position dans les soviets — les conseils d’ouvriers, de soldats et de paysans — mais disposaient aussi de leur propre journal. Cette description d’une démocratie bolchevique vivante contredit de manière flagrante l’image véhiculée par les manuels d’un appareil rigide, bureaucratique, soumis aux diktats de son Comité Central avec Lénine à la barre.
Rabinowitch documente également avec rigueur les activités contre-révolutionnaires à Petrograd et la Terreur rouge qui s’ensuivit. Selon lui, la terreur bolchevique de Petrograd prenait racine dans le radicalisme de l’organisation locale et dans « l’anxiété sincère de perdre, à un moment d’extrême faiblesse organisationnelle, face à la contre-révolution intérieure soutenue par les agents alliés ». Il ne s’agissait pas de menaces imaginaires : la stratégie « Sang pour sang » de l’automne 1918 faisait suite à l’assassinat de Moïsseï Uritsky (1873-1918), le 30 aout 1918 et à la tentative d’assassinat de Lénine, le même jour.Il s’agissait également d’une terreur de classe, nourrie par « l’impatience d’une partie des ouvriers de Petrograd à régler leurs comptes avec leurs ennemis présumés ».
Rabinowitch ajoute un nouveau chapitre important à l’histoire des débuts du régime soviétique : celui de la Commune du Nord, qui gouverna de fait l’oblast de Petrograd pendant une grande partie de l’année 1918[1]. Face à la famine, aux fermetures d’usines et aux invasions étrangères, la Commune et les soviets de district – et non le parti bolchevique – organisèrent la distribution alimentaire, le logement, la santé publique, la scolarisation et le maintien de l’ordre dans les quartiers ouvriers. Les effectifs bolcheviques ayant été décimés par le recrutement dans l’Armée rouge et les détachements de ravitaillement, le pouvoir soviétique survécut, selon Rabinowitch, « en grande partie grâce à la collaboration mutuelle entre les bolcheviks de Petrograd et les SR de gauche ».
Qu’est-il advenu de cette alliance entre les bolcheviks et les SR de gauche ? Malheureusement, Rabinowitch cède beaucoup trop de terrain à ses collègues universitaires libéraux qui ont fait carrière en essayant d’inventer des alternatives au pouvoir soviétique. Cette approche tend à minimiser les activités violemment antisoviétiques des mencheviks et des SR, tout en passant sous silence les efforts occidentaux pour écraser la révolution.
Rabinowitch inclut toutefois une grande quantité d’informations sur les machinations antisoviétiques des SR et des mencheviks, et montre comment l’ambassade britannique servait de foyer d’intrigues contre-révolutionnaires visant à instaurer une « dictature militaire » — même s’il omet de mentionner les efforts similaires des États-Unis (décrits dans America’s Secret War Against Bolshevism, de David Fonglesong).
Une large part de Les bolcheviks au pouvoir est consacrée à analyser les raisons de l’échec d’une « vaste alliance socialiste », au regard du résultat final : l’instauration d’une « dictature bolchevique ». Alexander Rabinowitch est un historien trop rigoureux pour se livrer aux habituels découpages sélectifs des événements. Il fournit en effet amplement la démonstration que, malgré ses propres affirmations contraires, une telle alliance était vouée à l’échec pour une raison très simple : les mencheviks et les socialistes-révolutionnaires de droite n’avaient aucun intérêt pour le pouvoir des soviets, tandis que les socialistes-révolutionnaires de gauche n’y adhéraient que dans la mesure où leurs propres exigences étaient satisfaites.
Rabinowitch concède que les mencheviks et les SR de droite considéraient « l’idée même d’une dictature du prolétariat et de la paysannerie pauvre » comme une « abomination » et qu’en octobre 1917, ils avaient uni leurs forces à celles d’officiers, de chefs de guerre cosaques et de membres du parti cadet (parti des démocrates bourgeois) pour tenter de renverser le pouvoir soviétique.
Ce clivage social manifeste, au cœur des conceptions de Vladimir Lénine (1870–1924) et de Léon Trotsky (1879–1940), est souvent estompé dans l’analyse de Rabinowitch, qui met en avant les figures des bolcheviks « modérés » et des SR de gauche. Il en résulte que le mépris de classe persistant des SR et des mencheviks à l’égard du pouvoir populaire n’est pas suffisamment souligné, en particulier dans les passages consacrés à la dispersion de l’Assemblée constituante, aux manœuvres mencheviques dans l’Assemblée des délégués des usines de Petrograd, ou encore à la Terreur rouge.
Rabinowitch déplore à plusieurs reprises que les bolcheviks modérés, tels que Yuri Larin (1882–1932), David Riazanov (1870–1938) et Grégori Kamenev (1883–1936) qui prônaient le compromis avec d’autres socialistes modérés, aient été marginalisés au profit de la ligne léniniste.. À Moscou, des dirigeants bolcheviks modérés comme Viktor Nogine (1878–1924) tentèrent de négocier un tel compromis, avec des résultats catastrophiques. John Reed (1887–1920) rapporte les « huées et les cris » des ouvriers moscovites qui ont accueilli Nogine lors d’une assemblée générale du parti bolchevique à Moscou, après que sa stratégie d’apaisement eut conduit à la mort de quelque 500 travailleurs.
Les bolcheviks et les Socialistes Révolutionnaires de gauche s’allièrent pour remporter facilement les élections à l’Assemblée constituante en novembre 1917. Toutefois, comme les listes électorales du parti Socialiste-Révolutionnaire avaient été élaborées avant leur scission politique, elles favorisèrent indûment les SR de droite.
Ces derniers tentèrent alors d’utiliser la convocation de l’Assemblée, en janvier 1918, comme un événement de ralliement destiné à contester le pouvoir des soviets. Alexander Rabinowitch reconnaît que la stratégie de Lénine (1870–1924) consistait à fermer purement et simplement l’Assemblée si celle-ci refusait de reconnaître la légitimité du pouvoir soviétique — « Qu’ils rentrent chez eux », disait-il — et que sa dispersion ne suscita aucun tollé populaire.
Rabinowitch soutient néanmoins que la fermeture de l’Assemblée constituante « mit fin aux espoirs des libéraux russes et des socialistes modérés de voir la révolution de 1917 déboucher sur un système politique démocratique de type occidental ». Il reproche également aux bolcheviks de ne pas avoir levé leur interdiction de manifester autour du Palais de Tauride, afin de permettre un rassemblement en faveur de l’Assemblée.
Or, selon Rabinowitch lui-même, il s’agissait d’une manifestation majoritairement composée de membres des classes supérieures, tandis que les Gardes rouges se considéraient comme les garants de la « défense du pouvoir soviétique contre les ennemis regroupés autour de l’Assemblée constituante, déterminés à restaurer les injustices du passé ». Cette interprétation du caractère contre-révolutionnaire de la manifestation permet d’expliquer pourquoi, après de multiples avertissements de ne pas s’approcher du palais, quelques gardes ouvrirent le feu sans ordre préalable, faisant une vingtaine de morts — loin du massacre légendaire décrit dans les récits anticommunistes.
Mais c’est la description élogieuse que fait Alexander Rabinowitch des socialistes-révolutionnaires de gauche (SR de gauche) qui s’avère la plus discutable. Il va jusqu’à affirmer que « le cœur du credo des SR de gauche incluait l’hégémonie des soviets démocratiques et révolutionnaires ». L’alliance entre bolcheviks et SR de gauche se brisa néanmoins à propos du traité de paix de Brest-Litovsk.
Le quatrième Congrès panrusse des soviets, réuni à la mi-mars 1918, fut l’un des rares exemples historiques d’une assemblée populaire élue devant décider de l’entrée ou du maintien d’un pays dans une guerre. Dominé par les bolcheviks, qui y comptaient 814 délégués sur 1 172, ce congrès ratifia le traité. Comme le souligne Rabinowitch, seuls quatorze délégués bolcheviques virent leurs mandats contestés, et ni pendant ni après les débats, les SR de gauche ou les communistes de gauche ne remirent en question la légitimité de l’assemblée.
Quelle fut alors la réponse des SR de gauche ? Ils agirent avec un mépris manifeste envers le mandat populaire massif en faveur de la paix. Quelques semaines après le congrès, Rabinowitch rapporte que le deuxième congrès du Parti SR de gauche autorisa explicitement l’usage de la terreur contre les dirigeants « impérialistes » étrangers dans le but de torpiller l’accord de paix. En juillet, des militants SR, sur ordre de leur comité central, assassinèrent l’ambassadeur allemand Wilhelm von Mirbach-Harff (1871–1918) dans l’intention de relancer la guerre.
Victor Serge (1890-1947) pose alors la question évidente que Rabinowitch évite : qui les SR de gauche représentaient-ils par cet attentat contre Mirbach et leur propagande en faveur de la « guerre révolutionnaire » ? Certainement pas la paysannerie, qui fuyait le front en masse et qui, en pratique, avait imposé la paix. Après mars 1918, ni la classe ouvrière ni les soldats n’étaient enclins à soutenir une reprise des combats. Rabinowitch lui-même souligne un « changement majeur de la base en faveur de la ratification » du traité, et reconnaît que l’attentat fut un « acte impétueux » — sans toutefois admettre que la terreur, plus que le pouvoir ouvrier, constituait le véritable credo des SR de gauche.
Malgré cette tentative quelque peu maladroite d’Alexander Rabinowitch de reconstituer a posteriori une alliance de socialistes « modérés », Les bolcheviks au pouvoir s’imposera sans doute comme l’ouvrage académique de référence sur les débuts du pouvoir des soviets, supplantant les récits idéologisés hérités de l’historiographie de la guerre froide. Pour tous les socialistes et historiens soucieux de comprendre la dynamique concrète de la révolution russe, ce livre ne doit pas seulement être lu, mais étudié avec attention.
*
Kevin Murphy est historien, professeur à l’Université du Massachusetts–Boston. Spécialiste du mouvement ouvrier et de la révolution russe, il est notamment l’auteur de Revolution and Counterrevolution: Class Struggle in a Moscow Metal Factory, Chicago, Haymarket Books, 2005, ouvrage récompensé par le Deutscher Memorial Prize — prix académique distinguant chaque année une contribution marxiste majeure en langue anglaise. Il collabore régulièrement à des revues marxistes, notamment à International Socialist Review (1997-2019).
Alexander Rabinowitch (né en 1934) est professeur émérite d’histoire à l’Université de l’Indiana (Bloomington) et chercheur associé à l’Université européenne de Saint-Pétersbourg. Il est l’un des historiens occidentaux les plus reconnus de la révolution russe, en particulier pour son utilisation approfondie des archives soviétiques. Il est notamment l’auteur de The Bolsheviks Come to Power : The Revolution of 1917 in Petrograd (New York, W. W. Norton, 1976 ; rééd. Haymarket Books, 2017) et de The Bolsheviks in Power : The First Year of Soviet Rule in Petrograd (Bloomington, Indiana University Press, 2007).
Publié initialement dans International Socialist Review Traduit de l’anglais pour Contretemps par Christian Dubucq.
Note
[1] La Commune du Nord désigne l’organisation politico-administrative qui gouverna de fait Petrograd et ses environs durant une grande partie de l’année 1918. Elle regroupait les soviets de districts et le soviet de Petrograd, et joua un rôle central dans la gestion quotidienne — ravitaillement, logement, santé, éducation — à un moment où l’appareil bolchevique était affaibli par les mobilisations militaires. Elle fut marquée par une forte collaboration entre bolcheviks et socialistes-révolutionnaires de gauche.




