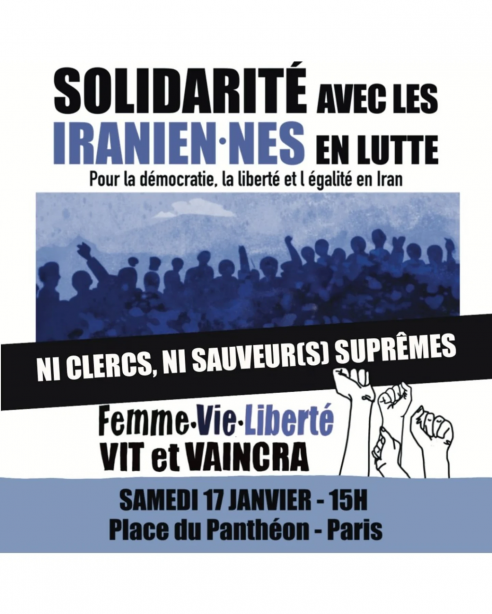Agenda militant
Ailleurs sur le Web
![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)
- La situation au Cameroun après les dernières élections (01/02)
- Municipales à Issoire : Enguerran Massis veut être "le poil à gratter de la campagne" (01/02)
- Agriculture française, Union européenne, Mercosur : la colère paysanne gronde (29/01)
- Quelques mots de Téhéran pour dépasser le manichéisme (28/01)
- Gaza a libéré la conscience mondiale. Entretien avec Marwan Abdel Aal (27/01)
- La défense du Rojava : les tâches révolutionnaires contre l’impérialisme, le djihadisme réactionnaire et la bourgeoisie locale (EKIB/Turquie) (27/01)
- Comprendre le mouvement agricole (27/01)
- Trois leçons politiques de Che Guevara (27/01)
- 50 ans après son assassinat, l’œuvre vivante de Pier Paolo Pasolini (27/01)
- Tondelier à un dîner lié à l’extrême droite catholique : la gêne persiste chez Les Écologistes (26/01)
- Municipales 2026 : à la social-écologie, préférons l’écologie de rupture (26/01)
- Désembourgeoiser l’école maternelle (26/01)
- Une vie de mathématicien itinérant (26/01)
- LA CROISSANCE VOUS REND MALHEUREUX...Mais comment s’en passer ? - Tim Jackson (26/01)
- Pétrole du Venezuela : quand la mainmise de Trump se heurte à la réalité (26/01)
- Élection présidentielle : "Pour le premier tour, Mélenchon a un boulevard" (24/01)
- L’opinion, ça se travaille… - S. Halimi, M. Reymond, D. Vidal, H. Maler (24/01)
- La destruction créancière du capital fictif. Bulle de l’intelligence artificielle et mystère de la rentabilité (24/01)
- Fascisation et stratégie. Entretien avec Ugo Palheta (24/01)
- Venezuela: l’heure de la perplexité (24/01)
- La question du pluralisme au regard du parti unique. Entretien avec Mohammed Harbi (24/01)
- D’un «enseignement citoyen» au «formatage» : au lycée, des profs dénoncent un programme de SES inadapté à l’urgence écologique (24/01)
- Le soleil se couche sur la rébellion kurde en Syrie (23/01)
- A propos d’un courrier de la direction de la CGT à Mélenchon (21/01)
- Les patrons piquent une crise (20/01)
Liens
Le tournant géostratégique de Trump au Moyen-Orient : une nouvelle doctrine du redéploiement de la puissance états-unienne

Lors de son discours du 13 mai 2025 au forum d’investissement américano-saoudien, Donald Trump a dressé les contours de sa politique au Moyen-Orient, appuyée en grande partie sur les partenariats économiques avec les pétromonarchies du Golfe : Arabie Saoudite, Qatar et Émirats Arabes Unis. En faisant de ces puissances régionales un modèle de développement, de prospérité et de stabilité, le président états-unien a ancré son intervention dans une rupture avec les modèles interventionnismes précédents. En effet, il ne s’agit plus de faire des guerres pour provoquer des changements de régime (comme en Irak ou en Afghanistan) afin de bâtir ensuite des démocraties libérales à l’aide de milliards de dollars et d’agences gouvernementales comme l’USAID. A l’inverse, il s’agit de s’appuyer sur les éléments les plus avancés économiquement en réalisant des partenariats stratégiques (matières premières – en premier lieu énergétiques –, militaires, technologiques – IA, data centers) dans l’objectif de structurer une prospérité qui faciliterait la mise en place d’une stabilité –, ce que Trump formule en disant qu’il veut la paix. Cette réorientation, qui bouleverse les alliances états-uniennes historiques (détournement de l’Europe, critique de Netanyahu et complaisance à l’égard de Poutine) occulte sciemment la nature autoritaire et réactionnaire des régimes du Golfe. Plus encore : cela les valorise, comme une sorte de modèle à suivre.
« Je suis venu cet après-midi pour parler de l’avenir radieux du Moyen-Orient »
Chez Trump, un avenir radieux repose d’abord sur l’accumulation des richesses. En ce sens, l’opération diplomatique dans le Golfe est un succès : plus de 3500 milliards de dollars d’investissements ont été conclus, en particulier dans les secteurs de pointe des nouvelles technologies, des cryptomonnaies, des énergies fossiles et du secteur militaire. Ces accords mettent à jour le partenariat stratégique entre la première puissance mondiale et les monarchies du Golfe, accentuant leur position de puissances régionales, aux dépens de l’Iran et, dans une moindre mesure, d’Israël. C’est une nouvelle doctrine, selon laquelle il ne s’agit plus d’exporter le « modèle américain » démocrate-libéral, mais bien de s’appuyer sur l’existant et, en particulier, sur les États les plus puissants. C’est en ce sens qu’il faut comprendre ses lourdes attaques contre les administrations Biden et Obama, qui ont, selon les mots de Trump, « détruit bien plus de nations qu’ils n’en ont construites ». Trump applique ici la logique « formaliste » de Yarvin Curtis, idéologue des Lumières Sombres, selon lesquelles il ne s’agit pas de se demander qui devrait posséder quoi, mais partir du fait établi : le royaume saoudien est prospère et stable, il a besoin de stabilité régionale pour investir et prospérer davantage, tout comme les États-Unis. Dès lors, il faut traiter avec le royaume saoudien, qui est du reste un allié historique. À l’inverse, l’Iran n’est pas stable, mais aussi Israël qui est en guerre. Ce ne sont donc pas des alliés de choix. Cette présentation, certes simplifiée, tend à montrer la dynamique globale de la doctrine Trump au Moyen-Orient : trouver des points d’appui pour garantir la suprématie états-unienne sur la planète par les accords commerciaux et le business. Cette nouvelle doctrine s’oppose à la doctrine historique des USA, dite « réaliste », qui visait à garantir la « sécurité » par la diffusion universelle du mode de gouvernement démocratique et libéral.
L’Arabie Saoudite en particulier, le Qatar et les Émirats Arabes Unis dans un second temps, offrent donc à Trump ce dont il a besoin : une garantie de stabilité et de sécurité, à l’inverse de l’État d’Israël et de l’Europe, le premier s’enfonçant dans un génocide, la seconde dans une guerre de position de haute intensité en Ukraine (bien qu’elle ne soit pas à l’initiative de celle-ci). Les cités-États comme Dubaï, Abu Dhabi, Doha deviennent le modèle à suivre, en opposition totale avec Bagdad ou Kaboul. Selon Trump, les premières dominées par des entrepreneurs audacieux, les secondes par des terroristes islamistes et des bureaucrates des agences fédérales états-uniennes.
« Je n’ai jamais cru qu’il fallait avoir des ennemis permanents. »
Les accords commerciaux sont un des aspects de la visite diplomatique de Trump. Le deuxième est largement politique – et par extension militaire. Dans cette logique, la stabilité régionale revêt au moins trois aspects.
D’abord, la question du nucléaire iranien. Le régime de Téhéran, en proie à une crise économique profonde et largement affaibli sur le terrain par l’effondrement de « l’Axe de la résistance », est au bord du gouffre, bien qu’il ait atteint un stade critique d’enrichissement d’uranium, lui laissant percevoir la possibilité d’obtenir l’arme atomique, ce qui représente une menace majeure pour les États-Unis et Israël en particulier. C’est à la lecture de cette situation que l’on peut comprendre le retournement de Trump autour de l’accord sur le nucléaire iranien qu’il avait rompu en 2017 : il s’agit pour lui de s’assurer que la République islamique n’enrichisse pas d’uranium à des fins militaires en utilisant pour cela la menace d’un embargo sur le pétrole iranien, pour l’asphyxier complètement. Téhéran s’est dit ouvert à ces négociations, qu’il n’a cessé d’espérer et qui expliquent en partie son refus d’entrer dans un conflit direct face à Israël. Trump opère donc un tournant « pragmatique », dans le sens où il laisse entrevoir la possibilité d’une gestion de la crise par l’intégration plutôt que par la confrontation.
Le deuxième élément est la levée totale des sanctions contre la Syrie. Le pays, exsangue après 14 années de guerre civile et 50 ans d’une des pires dictatures du monde, se trouvait, depuis le renversement de Bachard Al-Assad par la coalition HTS dirigée par l’ancien djihadiste Ahmed Al-Charaa, dans une situation critique. Si la population syrienne a accueilli favorablement, dans une large mesure, ce nouveau gouvernement, des germes de guerre civile sont réapparus, en plus des bombardements et accaparements de certaines parties du territoire par Israël. Dans cette situation, les sanctions états-uniennes contribuaient à fragiliser davantage le nouveau pouvoir, au risque de voir la Syrie se disloquer et Daesh se reconstituer. L’intégration des Kurdes du PYD (lié au PKK de Turquie) et de leurs forces armées (YPG) au sein des forces gouvernementales est un tournant : en renonçant à la lutte pour l’indépendance, le PYD s’engage à construire une Syrie plurielle et multiethnique. Cet événement peut cependant être le signe d’une faiblesse, voire d’une capitulation, dans la mesure où rien ne garantit, à terme, la pérennité de l’identité kurde en Syrie – tout comme le renoncement du PKK à la lutte armée en Turquie ne garantit nullement le respect de l’identité des Kurdes, ni leur droit de participer enfin à la vie politique sur une base d’égalité. Les deux principaux opposants à cette nouvelle configuration, Daesh et les restes des soutiens alaouites à Bachar, se trouvent progressivement isolés, en particulier du fait de l’écrasement du Hezbollah par Israël et de la déroute russe, bien que des canaux de discussion entre Damas et Moscou soient toujours ouverts. La levée des sanctions états-uniennes par Trump est donc un signal très fort : cela peut être le début d’une reconstruction de la Syrie en tant que pays souverain. Trump fait ici le pari (encouragé directement par Mohamed Ben Salmane, le prince héritier saoudien) que ses actions, ses « marques de confiances », vont permettre la fin de la guerre civile, contribuer à isoler davantage l’Iran, poursuivre la guerre contre Daesh et les restes d’Al-Qaïda et, à terme, peut-être faire de la Syrie un partenaire économique pour la région et, par extension, pour les USA.
Enfin, la question israélienne. Si au début de son mandat Trump s’est montré l’ami inconditionnel de Netanyahu, c’est d’abord parce que ce dernier avait accepté la condition d’un cessez-le-feu à Gaza, dans le but de libérer les otages tout en envisageant la possibilité d’une « Riviera » sur les bords de la Méditerranée, une fois l’enclave débarrassée du Hamas. Or la radicalisation coloniale et génocidaire de Netanyahu est venue percuter les illusions trumpiennes. La famine organisée à l’échelle du territoire de Gaza, la reprise de l’offensive dans Gaza et la poussée coloniale en Cisjordanie, au Sud du Liban et en Syrie viennent mettre un peu plus à mal le narratif israélien de la lutte contre le terrorisme en tant que moteur de son action. Netanyahu, reçu en grande pompe à Washington il y a deux mois, est aujourd’hui isolé sur la scène internationale, voyant même les pays européens se désengager de leur soutien. Rien n’indique que ces positions seront durables, mais cela signale néanmoins le déplacement du curseur dans le système d’alliances. Pour Trump, la stabilité du Moyen-Orient passe notamment par les accords d’Abraham et en particulier les liens entre l’Arabie Saoudite et Israël. Or le royaume saoudien a bloqué les échanges avec Israël depuis le 7 octobre 2023 et conditionne la reprise de ceux-ci, par opportunisme en grande partie, à la fin du génocide et à la reconnaissance de l’État palestinien. Si Trump ne formule que des vœux pieux en la matière pour l’instant, le fait qu’il ait négocié directement avec le Hamas via le Qatar pour obtenir la libération de l’otage israélo-états-unien Edan Alexander montre qu’il ne considère plus le Premier ministre israélien comme légitime, ou tout du moins essentiel, pour avancer son propre programme politique. Cette situation illustre par ailleurs le « numéro d’équilibriste saoudien entre son leadership du monde musulman et sa coopération sécuritaire avec ses partenaires occidentaux » : d’un côté, il s’agit d’éviter un conflit de grande ampleur avec l’Iran et, de l’autre, d’envisager la possibilité d’une relation étroite avec Israël, mais à la condition qu celle-ci aille d’abord dans le sens des intérêts saoudiens, c’est-à-dire que l’Arabie saoudite, en rivalité avec la Turquie, devienne la principale puissance régionale.
« Je n’aime pas la guerre »
Trump pacifiste ? Non. Il le rappelle dans son discours : les États-Unis ont voté un budget de 1000 milliards de dollars pour l’armée (le plus important budget militaire jamais voté – à titre de comparaison, la Chine à allouer 650 milliards de dollars à son propre budget militaire), cette armée recrute et se développe, en particulier pour faire face à la menace principale selon Trump : la Chine. De plus, pour obtenir la fin des attaques des Houtits contre les navires états-uniens circulant via le détroit d’Ortmuz, l’armée états-unienne a procédé à 52 bombardements, contraignant ces derniers à capituler en s’engageant à ne plus s’attaquer aux intérêts des États-Unis. Trump ne veut plus des guerres qui nuisent dans l’immédiat aux intérêts états-uniens. En revanche, il développe l’ensemble du secteur militaire (en particulier dans les domaines de pointe, comme la balistique, l’IA, la robotisation, le renseignement, l’espace…) dans le but de créer une force d’intervention dissuasive. C’est ce qu’il appelle « la paix par la force ».
Les accords militaires d’un montant de 142 milliards de dollars avec l’Arabie Saoudite montrent que Trump, plutôt qu’un simple désengagement états-unien de la région, cherche d’abord à déléguer les questions sécuritaires à ses alliés sur place. C’est en ce sens qu’on peut comprendre ses décisions de reprendre les discussions sur le nucléaire iranien (il s’agit d’intégrer l’Iran dans l’infrastructure de sécurité régionale) tout en se détachant de l’allié historique israélien. En un mot, Trump établit une nouvelle doctrine états-unienne au Moyen-Orient, rompant avec le « réalisme » antérieur pour lui substituer un « formalisme » contemporain. Cependant, la question militaire reste centrale dans cette nouvelle architecture : la Chine, en tant qu’adversaire stratégique des États-Unis, concentre une grande partie de l’attention états-unienne. Renforcer les partenariats stratégiques au Moyen-Orient permet à Trump de contrer l’influence chinoise, en particulier celle exercée via les Nouvelles Routes de la Soie. La présence d’Elon Musk durant le parcours diplomatique vient confirmer cette volonté : l’homme le plus riche du monde est venu évoquer le futur des relations commerciales avec les pétromonarchies, basées sur le développement de l’intelligence artificielle, notamment pour une utilisation sécuritaire, mais aussi pour le développement de la robotique et de la conquête spatiale. La guerre du futur entre les États-Unis et la Chine a pris une nouvelle dimension à Riyad.
Notes
[1] Les citations et une grande partie des informations présentées ici proviennent du discours prononcé par Trump à Riyad le 13 mai 2025, traduit en français ici : https://legrandcontinent.eu/fr/2025/05/15/trump-et-le-tournant-de-riyad-texte-integral-du-discours-en-arabie-saoudite/







.png)