Agenda militant
Ailleurs sur le Web
![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)
- Au cœur du capital (12/03)
- Le débat des représentants des partis, avec Paul Vannier (12/03)
- Meeting avec Bagayoko, Coquerel et Mélenchon à Saint-Denis ! (11/03)
- Ludivine Bantigny, "La Bourse ou la vie. Le Front populaire, histoire pour aujourd’hui" (11/03)
- C’est quoi le "marxisme classique" et le "marxisme occidental" ? (10/03)
- “Le socialisme est la maison commune de tous les combats justes.” – Entretien avec Joseph Andras (10/03)
- Sur Franceinfo : Brigitte Boucher et les irresponsables (10/03)
- Ce que révèle l’affaire Epstein (10/03)
- Au Liban, d’une guerre coloniale à l’autre et du droit de résister (10/03)
- POUR UN FRONT ANTIFASCISTE AU SECOND TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES (10/03)
- Meeting de la campagne municipale LFI à Lille (10/03)
- Meeting avec Jean-Luc Mélenchon et Sophia Chikirou à Paris ! (09/03)
- Colombie : la gauche de Gustavo Petro valide le dernier test des législatives avant la présidentielle (09/03)
- Penser l’émancipation autrement, discuter l’apport de marxistes hétérodoxes [Podcast] (09/03)
- Terrorisme d’Ultra-droite (08/03)
- "L’Iran est sur le point d’obtenir l’arme nucléaire" : trente ans de prophéties démenties (08/03)
- Hommage au chercheur marxiste Michael Parenti – Compilation d’entretiens (08/03)
- La guerre de trop : les Américains et les Israéliens n’ont rien compris à l’Iran ! (08/03)
- Poutou annonce un probable soutien du NPA-A à Mélenchon en 2027 (07/03)
- Attaques en série contre LFI (07/03)
- Des maires insoumis pour tout changer | Clip officiel - Municipales 2026 (07/03)
- Romaric Godin : "La force fondamentale du capitalisme le pousse vers le néofascisme" (07/03)
- Quentin Deranque était en première ligne dans la bagarre (06/03)
- Tirer une balle dans la tête sans intention de donner la mort (06/03)
- Les États-Unis et Israël nous entraînent dans une barbarie suicidaire (06/03)
Liens
Recension de livres
Ces articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » sont publiés à titre d'information et n'engagent pas la Tendance CLAIRE.
http://www.revue-ballast.fr/cartouches-14/
Pourquoi n’y a-t-il pas d’hommes de ménage ?, vivre sans argent à Belfast, une philosophie oubliée, des marins écrasés à Kronstadt, un poète et un récif de granit, un combi Volkswagen rouge, affecter pour mobiliser politiquement, le Paris de Zola, penser la ville sous l’ère capitaliste, Daech sur nos écrans, filer vers les îles du Pacifique : nos chroniques du mois d’octobre.
☰ Le Sexe des mots, de Marina Yaguello
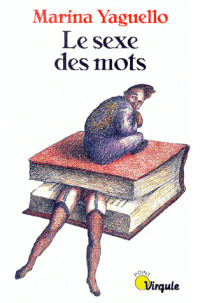 Pourquoi n’y a-t-il pas de neutre en français ? Le masculin l’emporte-t-il vraiment sur le féminin ? Avez-vous remarqué que les termes désignant les animaux femelles sont souvent métaphoriquement utilisés pour insulter les femmes (une dinde, une vache, une poule) alors que l’inverse n’est pas vrai ? Pourquoi garce ne désigne pas une jeune fille alors que gars désigne un jeune garçon ? Qu’est-ce qu’un mot épicène ? L’Académie française est-elle vraiment une institution de référence ? Est-ce un hasard si certains métiers déconsidérés socialement sont mis au féminin sans le moindre problème, voire uniquement au féminin (une femme de ménage), alors que les mots désignant de hautes fonctions représentatives résistent à la féminisation (doit-on dire le ou la juge,le ou la docteur-e ?). Quand Nicole Avril dit dans les années 1970 que son héroïne est « un chirurgien » car le mot « chirurgienne » n’existe pas, a-t-elle raison ? Qu’est-ce qui fait la validité d’un mot ? Le dictionnaire, mais quel dictionnaire ? Ainsi, le Robert reconnaît l’existence de chirurgienne mais pas le Dictionnaire de l’Académie française. Est-ce l’usage qui doit l’emporter ? Quel usage ? Si le mot paraît inusité dans la seconde moitié du XXe siècle, il apparaît pourtant sous la plume de Voltaire dans Candide… Autant de questions d’actualité : il suffit de se rappeler de la bronca à l’Assemblée nationale en 2014 lorsque le député Julien Aubert a obstinément refusé d’appeler Sandrine Mazetier « Madame la présidente »… s’attirant en retour un « Monsieur la députée » ! Autant de questions posées par Marina Yaguello, habituée à vulgariser les grandes questions de linguistique (Alice au pays du langage), et à discuter des enjeux de la féminisation (Les Mots et les femmes — sur ce point, on peut aussi lire Éliane Viennot et son Non, le masculin ne l’emporte pas sur le féminin !), dans un bref ouvrage plein d’humour, un contre-dictionnaire où chaque entrée s’accompagne moins d’une définition que d’une réflexion sur la définition. Au-delà de l’enjeu de la féminisation ou non des mots, ce petit livre pose la question de la langue même : qu’est-ce qu’une langue ? Comment fonctionne-t-elle ? Quelle est la limite entre évolution et déformation ? Quels sont les rapports entre langue et société ? Questions de linguistes, mais qui s’adressent à tout un-e chacun-e ! [L.V.]
Pourquoi n’y a-t-il pas de neutre en français ? Le masculin l’emporte-t-il vraiment sur le féminin ? Avez-vous remarqué que les termes désignant les animaux femelles sont souvent métaphoriquement utilisés pour insulter les femmes (une dinde, une vache, une poule) alors que l’inverse n’est pas vrai ? Pourquoi garce ne désigne pas une jeune fille alors que gars désigne un jeune garçon ? Qu’est-ce qu’un mot épicène ? L’Académie française est-elle vraiment une institution de référence ? Est-ce un hasard si certains métiers déconsidérés socialement sont mis au féminin sans le moindre problème, voire uniquement au féminin (une femme de ménage), alors que les mots désignant de hautes fonctions représentatives résistent à la féminisation (doit-on dire le ou la juge,le ou la docteur-e ?). Quand Nicole Avril dit dans les années 1970 que son héroïne est « un chirurgien » car le mot « chirurgienne » n’existe pas, a-t-elle raison ? Qu’est-ce qui fait la validité d’un mot ? Le dictionnaire, mais quel dictionnaire ? Ainsi, le Robert reconnaît l’existence de chirurgienne mais pas le Dictionnaire de l’Académie française. Est-ce l’usage qui doit l’emporter ? Quel usage ? Si le mot paraît inusité dans la seconde moitié du XXe siècle, il apparaît pourtant sous la plume de Voltaire dans Candide… Autant de questions d’actualité : il suffit de se rappeler de la bronca à l’Assemblée nationale en 2014 lorsque le député Julien Aubert a obstinément refusé d’appeler Sandrine Mazetier « Madame la présidente »… s’attirant en retour un « Monsieur la députée » ! Autant de questions posées par Marina Yaguello, habituée à vulgariser les grandes questions de linguistique (Alice au pays du langage), et à discuter des enjeux de la féminisation (Les Mots et les femmes — sur ce point, on peut aussi lire Éliane Viennot et son Non, le masculin ne l’emporte pas sur le féminin !), dans un bref ouvrage plein d’humour, un contre-dictionnaire où chaque entrée s’accompagne moins d’une définition que d’une réflexion sur la définition. Au-delà de l’enjeu de la féminisation ou non des mots, ce petit livre pose la question de la langue même : qu’est-ce qu’une langue ? Comment fonctionne-t-elle ? Quelle est la limite entre évolution et déformation ? Quels sont les rapports entre langue et société ? Questions de linguistes, mais qui s’adressent à tout un-e chacun-e ! [L.V.]
Éditions du Seuil, 1995
☰ Les Dépossédés, de Robert McLiam Wilson
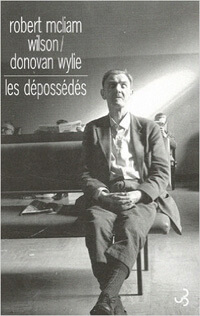 Voici un livre à placer dans le lignage de Dans la dèche de Paris à Londres de George Orwell. L’Irlandais Robert McLiam Wilson et le photographe Donovan Wylie y décrivent en observateurs actifs la misère à l’époque thatchérienne dans les villes de Londres, Glasgow et Belfast par l’intermédiaire de textes et de photos. D’emblée, McLiam Wilson prend le contre-pied de la normalisation de la misère par les bidouillages des statistiques qui invisibilisent ou minorent le phénomène, mais surtout justifient la fin des régimes d’aides et la diminution de la protection sociale. Il mène une observation subjective d’autant plus active qu’il a lui aussi connu des périodes de pauvreté. Que ce soit dans le centre d’accueil « Crypt Center » de Londres, les foyers, les squats ou au sein de la cellule familiale, McLiam Wilson montre de manière particulièrement réaliste la variété des profils — allant de celles-eux qui ont été déclassé.e.s par un événement non prévu, qu’ils veulent surmonter, à d’autres qui ont « accepté » cette condition. Pointent alors les récits de chacun, qui restent recroquevillés sur leur malheur individuel ou le politisent, qui voient cela comme un événement local ou plus national. On remarque que, comme toujours au sein de la catégorie « pauvre », les populations minorisées que sont les femmes de Belfast ou les Noirs de Londres doivent encore plus multiplier les stratégies pour s’en sortir au détriment de leur amour-propre. Face à ces vies dures comme la pierre, l’auteur ne triche pas, livrant ses impressions les plus intimes allant de la pure admiration aux doutes, en passant, même, par des moments de dépression. Les conventions littéraires ou sociologiques sont sans regret mises à la poubelle pour affirmer le respect que l’on doit à des gens pour qui vivre, manger, maintenir un endroit propre est un combat, mais aussi une exigence envers soi-même pour ne pas plus sombrer. C’est donc le récit de la dignité face à la violence normalisée, ordinaire de la pauvreté du coin de la rue ou dans l’ombre des appartements cache-misère. Bien sûr, la lecture de ce livre est difficile, elle est pour celleux qui ne ferment pas les yeux et qui savent que « la pauvreté est peut-être la seule expérience humaine, en dehors de la naissance et de la mort, que tout être humain est capable de partager ». [T.M.]
Voici un livre à placer dans le lignage de Dans la dèche de Paris à Londres de George Orwell. L’Irlandais Robert McLiam Wilson et le photographe Donovan Wylie y décrivent en observateurs actifs la misère à l’époque thatchérienne dans les villes de Londres, Glasgow et Belfast par l’intermédiaire de textes et de photos. D’emblée, McLiam Wilson prend le contre-pied de la normalisation de la misère par les bidouillages des statistiques qui invisibilisent ou minorent le phénomène, mais surtout justifient la fin des régimes d’aides et la diminution de la protection sociale. Il mène une observation subjective d’autant plus active qu’il a lui aussi connu des périodes de pauvreté. Que ce soit dans le centre d’accueil « Crypt Center » de Londres, les foyers, les squats ou au sein de la cellule familiale, McLiam Wilson montre de manière particulièrement réaliste la variété des profils — allant de celles-eux qui ont été déclassé.e.s par un événement non prévu, qu’ils veulent surmonter, à d’autres qui ont « accepté » cette condition. Pointent alors les récits de chacun, qui restent recroquevillés sur leur malheur individuel ou le politisent, qui voient cela comme un événement local ou plus national. On remarque que, comme toujours au sein de la catégorie « pauvre », les populations minorisées que sont les femmes de Belfast ou les Noirs de Londres doivent encore plus multiplier les stratégies pour s’en sortir au détriment de leur amour-propre. Face à ces vies dures comme la pierre, l’auteur ne triche pas, livrant ses impressions les plus intimes allant de la pure admiration aux doutes, en passant, même, par des moments de dépression. Les conventions littéraires ou sociologiques sont sans regret mises à la poubelle pour affirmer le respect que l’on doit à des gens pour qui vivre, manger, maintenir un endroit propre est un combat, mais aussi une exigence envers soi-même pour ne pas plus sombrer. C’est donc le récit de la dignité face à la violence normalisée, ordinaire de la pauvreté du coin de la rue ou dans l’ombre des appartements cache-misère. Bien sûr, la lecture de ce livre est difficile, elle est pour celleux qui ne ferment pas les yeux et qui savent que « la pauvreté est peut-être la seule expérience humaine, en dehors de la naissance et de la mort, que tout être humain est capable de partager ». [T.M.]
Christian Bourgois éditeur, 2005
☰ De l’Égalité des deux sexes, discours physique et moral où l’on voit l’importance de se défaire des préjugés, de François Poullain de La Barre
 Il est des ouvrages que crayons ou stabilos épuisent tellement que les pages surlignées en deviennent difficilement lisibles. Celui-ci est de cette trempe-là. Écrit en 1673 par un certain François Poullain de La Barre, il développe un propos archéo-féministe, sous perfusion de cartésianisme, qui détonne — et attriste — par sa modernité, et prend autant pour cible le conservatisme du peuple vulgaire que des savants. C’est « une philosophie oubliée du XVIIe siècle », nous dit la philosophe contemporaine Elsa Dorlin. À voir la qualité des débats actuels, et malgré des avancées incontestables — les 300 ans qui nous séparent de cet ouvrage n’ont pas été totalement vains —, on ne peut qu’y souscrire, tant la redondance des déconstructions des préjugés par Poullain avec celles faites aujourd’hui par les féministes est frappante, et indique une répétition jusqu’au grotesque. Tout, ou presque, y passe : tâches ménagères, faits systémiques d’infériorisation, d’invisibilisation, de rapports de force défavorables… L’auteur fait preuve d’une intuition sociologique très fine. Mais il contredit également, par l’outil de la Raison, la nature inconstante des femmes et autres essentialisations dégradantes. S’il cède quelques fois à des éloges peu subtils, prenant le contre-pied de leur dévalorisation, il assume ainsi, très cohérent avec son engagement : « Il est vrai que leur culte va quelques fois jusqu’à l’excès : mais je ne trouve pas que cet excès soit si blâmable. L’ignorance où on les élève en est la cause nécessaire. » Les passages sur l’analyse de la répartition inégale et injuste des emplois font particulièrement écho à notre actualité — expliquant que la seule surprise à voir des femmes avocates, professeures ou médecins ne saurait qu’être « par la raison de la nouveauté ». « Si en formant les états et en établissant les différents emplois qui les composent, on y avait aussi appelé les femmes, nous serions accoutumés à les y voir, comme elles le sont à notre égard. » Poullain formulait déjà en termes simples des propositions politiques égalitaires, faisant découler de son fameux « l’esprit n’a pas de sexe » des prémisses à une reconnaissance pleine et entière des droits des femmes : « Je ne soutiens pas qu’elles soient toutes capables des sciences et des emplois, ni que chacune le soit de tous : personne ne le prétend non plus des hommes ; mais je demande seulement qu’à prendre les deux Sexes en général, on reconnaisse dans l’un autant de disposition que dans l’autre. » [J.C.]
Il est des ouvrages que crayons ou stabilos épuisent tellement que les pages surlignées en deviennent difficilement lisibles. Celui-ci est de cette trempe-là. Écrit en 1673 par un certain François Poullain de La Barre, il développe un propos archéo-féministe, sous perfusion de cartésianisme, qui détonne — et attriste — par sa modernité, et prend autant pour cible le conservatisme du peuple vulgaire que des savants. C’est « une philosophie oubliée du XVIIe siècle », nous dit la philosophe contemporaine Elsa Dorlin. À voir la qualité des débats actuels, et malgré des avancées incontestables — les 300 ans qui nous séparent de cet ouvrage n’ont pas été totalement vains —, on ne peut qu’y souscrire, tant la redondance des déconstructions des préjugés par Poullain avec celles faites aujourd’hui par les féministes est frappante, et indique une répétition jusqu’au grotesque. Tout, ou presque, y passe : tâches ménagères, faits systémiques d’infériorisation, d’invisibilisation, de rapports de force défavorables… L’auteur fait preuve d’une intuition sociologique très fine. Mais il contredit également, par l’outil de la Raison, la nature inconstante des femmes et autres essentialisations dégradantes. S’il cède quelques fois à des éloges peu subtils, prenant le contre-pied de leur dévalorisation, il assume ainsi, très cohérent avec son engagement : « Il est vrai que leur culte va quelques fois jusqu’à l’excès : mais je ne trouve pas que cet excès soit si blâmable. L’ignorance où on les élève en est la cause nécessaire. » Les passages sur l’analyse de la répartition inégale et injuste des emplois font particulièrement écho à notre actualité — expliquant que la seule surprise à voir des femmes avocates, professeures ou médecins ne saurait qu’être « par la raison de la nouveauté ». « Si en formant les états et en établissant les différents emplois qui les composent, on y avait aussi appelé les femmes, nous serions accoutumés à les y voir, comme elles le sont à notre égard. » Poullain formulait déjà en termes simples des propositions politiques égalitaires, faisant découler de son fameux « l’esprit n’a pas de sexe » des prémisses à une reconnaissance pleine et entière des droits des femmes : « Je ne soutiens pas qu’elles soient toutes capables des sciences et des emplois, ni que chacune le soit de tous : personne ne le prétend non plus des hommes ; mais je demande seulement qu’à prendre les deux Sexes en général, on reconnaisse dans l’un autant de disposition que dans l’autre. » [J.C.]
Éditions Folio, 2015 (accessible librement)
☰ Kronstadt 1921, prolétariat contre bolchevisme, d’Alexandre Skirda
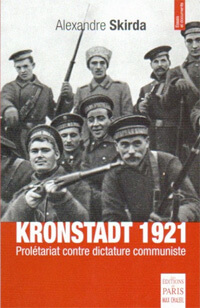 Éternel débat entre trotskystes et libertaires : le cas Kronstadt continue de faire couler beaucoup d’encre. Dans les rangs mêmes des marxistes, de plus en plus de voix semblent s’accorder pour dire que Trotsky et un certain nombre de bolcheviks eurent tort et que l’argument de la « tragique nécessité », usé jusqu’à la corde, ne suffit plus. Mais quel est l’objet du scandale, nous direz-vous ? En 1921, les marins de Kronstadt, qui s’étaient pour bon nombre illustrés lors de la révolution de 1917, se rebellent contre l’ordre bolchevik, perçu par eux comme un nouveau pouvoir oppressif : ils appellent à une troisième révolution afin de parvenir au socialisme intégral. La première, avancent-ils, a balayé le tsar, la seconde les Blancs (entendre : les nostalgiques de l’Ancien régime) : la troisième — et ultime — s’en ira balayer les « rouges ». L’idée était d’ailleurs déjà présente au sein de la Makhnovtchina, l’armée insurrectionnelle ukrainienne, d’inspiration libertaire, qui combattit armées bourgeoise et rouge de concert. L’auteur ne manque pas de tisser des parallèles entre ces deux mouvements. Le livre de Skirda permet, par la force démonstrative, une vision équilibrée des événements quand tant de mensonges, aujourd’hui évidents, firent autorité… Histoire écrite, comme à l’accoutumée, par les vainqueurs. Contrairement aux calomnies répétées des chefs bolcheviks, on constate que, non, ce ne sont pas des gardes blancs qui se trouvaient à la tête d’une contre-révolution à Kronstadt, mais bien des « sans-partis », pour certains d’entre eux d’inspiration anarchiste, et d’authentiques révolutionnaires qui ne faisaient que dénoncer les déraillements du régime. On relève, par le biais de nombreux témoignages, qu’aucun Kronstadtien n’a jamais voulu aller au conflit. Que bon nombre de soldats rouges ne savaient pas pourquoi ils avaient à tirer sur leurs camarades — et que certains refusèrent de le faire, voire tuèrent leurs commandants. Plus tard, on mettra un membre de la police politique derrière les soldats rouges réfractaires, pour mieux les obliger à avancer… Si le rôle des anarchistes Emma Goldman et Alexandre Berkman qui ont, en mars 1921, fait des tentatives de médiation entre les bolcheviks et les Kronstadtiens afin d’empêcher le massacre est relativement connu, d’autres, comme Kornatovsky, tentèrent de soulever les soldats rouges et les ouvriers de Petrograd en soutien à Kronstadt (et les Kronstadtiens, affamés et épuisés, n’ont certainement résisté que dans l’espoir qu’il y ait un soulèvement général du prolétariat russe). Le soulèvement n’a pas lieu. C’est peu dire que le tournant libéral que Lénine apportera peu de temps après ces événements, via la Nouvelle politique économique et sa défense du capitalisme d’État comme étape nécessaire, donnera raison aux insurgés. Concluons sur ces mots de Petritchenko : « Kronstadt a couté cher aux bolcheviks. La chute de Kronstadt est la chute des bolcheviks. » [W.]
Éternel débat entre trotskystes et libertaires : le cas Kronstadt continue de faire couler beaucoup d’encre. Dans les rangs mêmes des marxistes, de plus en plus de voix semblent s’accorder pour dire que Trotsky et un certain nombre de bolcheviks eurent tort et que l’argument de la « tragique nécessité », usé jusqu’à la corde, ne suffit plus. Mais quel est l’objet du scandale, nous direz-vous ? En 1921, les marins de Kronstadt, qui s’étaient pour bon nombre illustrés lors de la révolution de 1917, se rebellent contre l’ordre bolchevik, perçu par eux comme un nouveau pouvoir oppressif : ils appellent à une troisième révolution afin de parvenir au socialisme intégral. La première, avancent-ils, a balayé le tsar, la seconde les Blancs (entendre : les nostalgiques de l’Ancien régime) : la troisième — et ultime — s’en ira balayer les « rouges ». L’idée était d’ailleurs déjà présente au sein de la Makhnovtchina, l’armée insurrectionnelle ukrainienne, d’inspiration libertaire, qui combattit armées bourgeoise et rouge de concert. L’auteur ne manque pas de tisser des parallèles entre ces deux mouvements. Le livre de Skirda permet, par la force démonstrative, une vision équilibrée des événements quand tant de mensonges, aujourd’hui évidents, firent autorité… Histoire écrite, comme à l’accoutumée, par les vainqueurs. Contrairement aux calomnies répétées des chefs bolcheviks, on constate que, non, ce ne sont pas des gardes blancs qui se trouvaient à la tête d’une contre-révolution à Kronstadt, mais bien des « sans-partis », pour certains d’entre eux d’inspiration anarchiste, et d’authentiques révolutionnaires qui ne faisaient que dénoncer les déraillements du régime. On relève, par le biais de nombreux témoignages, qu’aucun Kronstadtien n’a jamais voulu aller au conflit. Que bon nombre de soldats rouges ne savaient pas pourquoi ils avaient à tirer sur leurs camarades — et que certains refusèrent de le faire, voire tuèrent leurs commandants. Plus tard, on mettra un membre de la police politique derrière les soldats rouges réfractaires, pour mieux les obliger à avancer… Si le rôle des anarchistes Emma Goldman et Alexandre Berkman qui ont, en mars 1921, fait des tentatives de médiation entre les bolcheviks et les Kronstadtiens afin d’empêcher le massacre est relativement connu, d’autres, comme Kornatovsky, tentèrent de soulever les soldats rouges et les ouvriers de Petrograd en soutien à Kronstadt (et les Kronstadtiens, affamés et épuisés, n’ont certainement résisté que dans l’espoir qu’il y ait un soulèvement général du prolétariat russe). Le soulèvement n’a pas lieu. C’est peu dire que le tournant libéral que Lénine apportera peu de temps après ces événements, via la Nouvelle politique économique et sa défense du capitalisme d’État comme étape nécessaire, donnera raison aux insurgés. Concluons sur ces mots de Petritchenko : « Kronstadt a couté cher aux bolcheviks. La chute de Kronstadt est la chute des bolcheviks. » [W.]
Éditions de la Tête de Feuilles, 1971
☰ Notre besoin de consolation est impossible à rassasier, de Stig Dagerman
 Lisons le poème en prose testamentaire de l’écrivain libertaire suédois Stig Dagerman. Lisons-le en sachant qu’il vaudrait mieux éviter de le lire pour les angoissés métaphysiques que nous sommes.« Qu’ai-je alors entre mes bras ? Puisque je suis solitaire : une femme aimée ou un compagnon de voyage malheureux. Puisque je suis poète : un arc de mots que je ressens de la joie et de l’effroi à bander. Puisque je suis prisonnier : un aperçu soudain de la liberté. Puisque je suis menacé par la mort : un animal vivant et bien chaud, un cœur qui bat de façon sarcastique. Puisque je suis menacé par la mer : un récif de granit bien dur. » Armé d’une sincérité absolue, l’auteur livre à son lecteur l’extrême diversité et complexité de son être, la bataille rangée et infinie qui s’est jouée en lui. Il met en scène l’alternance qui ponctue nos vies entre des phases de chaos intérieur, enchâssées dans des déterminismes rythmés par les fracas du monde, et des moments de paix et de communion avec son milieu de vie, ouvrant ainsi des perspectives de liberté en dehors du temps. Dagerman nous invite à trouver la seule consolation qui vaille, celle d’une raison de vivre. Ce chasseur de consolation en choisira une autre, celle du choix de sa mort appréhendé comme le dernier exercice possible de sa liberté face à un monde qui ne vit que pour compter et quantifier. « Si je veux vivre libre, il faut pour l’instant que je le fasse à l’intérieur de ces formes. Le monde est donc plus fort que moi. À son pouvoir je n’ai rien à opposer que moi-même — mais, d’un autre côté, c’est considérable. Car, tant que je ne me laisse pas écraser par le nombre, je suis moi aussi une puissance. Et mon pouvoir est redoutable tant que je puis opposer la force de mes mots à celle du monde, car celui qui construit des prisons s’exprime moins bien que celui qui bâtit la liberté. »Non, nous ne pouvons entendre son geste. Mais nous en prenons acte puisqu’il a livré le secret pour que nos vies soient un magnifique feu d’artifice, qui, lui, ne sera pas fugace. [T.M.]
Lisons le poème en prose testamentaire de l’écrivain libertaire suédois Stig Dagerman. Lisons-le en sachant qu’il vaudrait mieux éviter de le lire pour les angoissés métaphysiques que nous sommes.« Qu’ai-je alors entre mes bras ? Puisque je suis solitaire : une femme aimée ou un compagnon de voyage malheureux. Puisque je suis poète : un arc de mots que je ressens de la joie et de l’effroi à bander. Puisque je suis prisonnier : un aperçu soudain de la liberté. Puisque je suis menacé par la mort : un animal vivant et bien chaud, un cœur qui bat de façon sarcastique. Puisque je suis menacé par la mer : un récif de granit bien dur. » Armé d’une sincérité absolue, l’auteur livre à son lecteur l’extrême diversité et complexité de son être, la bataille rangée et infinie qui s’est jouée en lui. Il met en scène l’alternance qui ponctue nos vies entre des phases de chaos intérieur, enchâssées dans des déterminismes rythmés par les fracas du monde, et des moments de paix et de communion avec son milieu de vie, ouvrant ainsi des perspectives de liberté en dehors du temps. Dagerman nous invite à trouver la seule consolation qui vaille, celle d’une raison de vivre. Ce chasseur de consolation en choisira une autre, celle du choix de sa mort appréhendé comme le dernier exercice possible de sa liberté face à un monde qui ne vit que pour compter et quantifier. « Si je veux vivre libre, il faut pour l’instant que je le fasse à l’intérieur de ces formes. Le monde est donc plus fort que moi. À son pouvoir je n’ai rien à opposer que moi-même — mais, d’un autre côté, c’est considérable. Car, tant que je ne me laisse pas écraser par le nombre, je suis moi aussi une puissance. Et mon pouvoir est redoutable tant que je puis opposer la force de mes mots à celle du monde, car celui qui construit des prisons s’exprime moins bien que celui qui bâtit la liberté. »Non, nous ne pouvons entendre son geste. Mais nous en prenons acte puisqu’il a livré le secret pour que nos vies soient un magnifique feu d’artifice, qui, lui, ne sera pas fugace. [T.M.]
Éditions Actes Sud, 1993
☰ Les Autonautes de la cosmoroute, de Julio Cortazar et Carol Dunlop
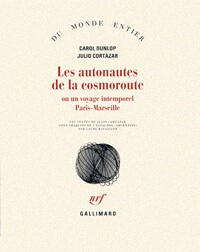 Qui sont ces autonautes de la cosmoroute ? C’est un couple en transition — entre deux reportages et une dictature. Sans que ce ne soit explicitement annoncé, on sent qu’ils oscillent entre passages à l’acte (ou à vide) et épisodes dépressifs. Comme toujours à ces moments, il s’agit de laisser pourrir la situation ou de la changer radicalement. En mai 1982, l’écrivain Julio Cortazar et l’écrivaine, traductrice et photographe Carol Dunlop optent pour le second choix en embarquant dans un combi Volkswagen rouge — surnommé Fafner, le dragon légendaire de Wagner — sur l’autoroute Paris-Marseille, durant trente-deux jours. Le défi est de nier la logique profonde de grande vitesse de l’autoroute pour pratiquer la lenteur, avec l’obligation de demeurer sur deux aires de repos par jour sur les soixante-quinze que compte le parcours. Sans jamais aller au-delà dans les terres. La gageure est importante car il est légalement interdit de stationner plus de deux jours sur une autoroute. Deux ravitaillements sont prévus, organisés par des amis qui, dans la confidence, accourront à bride abattue. Adoptant cette pratique du cabotage insulaire en tournant le dos au déchaînement de l’A6, nos deux protagonistes et auteurs nous montrent l’épaisseur que prennent le temps et l’espace lorsque l’on choisit de lui laisser une place dans nos vies. Le nomadisme n’est pas qu’une affaire de temps mais aussi de choix dans la manière de qualifier le temps vécu, en laissant une place particulière à l’imagination et à l’imprévu. Et pour les « démons » qui les étouffent depuis des mois : « No pasaran ! », comme disent nos autonautes ! Ce qu’il y a au bout du chemin de ce journal de bord ? Un amour perdu qui renaît dans la poésie, un couple qui se retrouve dans une intimité hors du temps, une communion charnelle et mentale que nos rythmes de vie ignorent à force de laisser le quotidien lui tordre le cou. Quelques mois plus tard, Carol Dunlop meurt, donnant à ce livre une tonalité différente : celle de la profondeur de moments en apparence futiles mais très significatifs, car arrachés à la dictature du réel et du matériel. Le souffle, en définitive. [T.M.]
Qui sont ces autonautes de la cosmoroute ? C’est un couple en transition — entre deux reportages et une dictature. Sans que ce ne soit explicitement annoncé, on sent qu’ils oscillent entre passages à l’acte (ou à vide) et épisodes dépressifs. Comme toujours à ces moments, il s’agit de laisser pourrir la situation ou de la changer radicalement. En mai 1982, l’écrivain Julio Cortazar et l’écrivaine, traductrice et photographe Carol Dunlop optent pour le second choix en embarquant dans un combi Volkswagen rouge — surnommé Fafner, le dragon légendaire de Wagner — sur l’autoroute Paris-Marseille, durant trente-deux jours. Le défi est de nier la logique profonde de grande vitesse de l’autoroute pour pratiquer la lenteur, avec l’obligation de demeurer sur deux aires de repos par jour sur les soixante-quinze que compte le parcours. Sans jamais aller au-delà dans les terres. La gageure est importante car il est légalement interdit de stationner plus de deux jours sur une autoroute. Deux ravitaillements sont prévus, organisés par des amis qui, dans la confidence, accourront à bride abattue. Adoptant cette pratique du cabotage insulaire en tournant le dos au déchaînement de l’A6, nos deux protagonistes et auteurs nous montrent l’épaisseur que prennent le temps et l’espace lorsque l’on choisit de lui laisser une place dans nos vies. Le nomadisme n’est pas qu’une affaire de temps mais aussi de choix dans la manière de qualifier le temps vécu, en laissant une place particulière à l’imagination et à l’imprévu. Et pour les « démons » qui les étouffent depuis des mois : « No pasaran ! », comme disent nos autonautes ! Ce qu’il y a au bout du chemin de ce journal de bord ? Un amour perdu qui renaît dans la poésie, un couple qui se retrouve dans une intimité hors du temps, une communion charnelle et mentale que nos rythmes de vie ignorent à force de laisser le quotidien lui tordre le cou. Quelques mois plus tard, Carol Dunlop meurt, donnant à ce livre une tonalité différente : celle de la profondeur de moments en apparence futiles mais très significatifs, car arrachés à la dictature du réel et du matériel. Le souffle, en définitive. [T.M.]
Éditions Gallimard, 1983
☰ Les Affects de la politique, de Frédéric Lordon
 Frédéric Lordon continue de déployer les concepts de Spinoza pour penser notre réalité. Après l’étude du rapport salarial (dans Capitalisme, Désir et servitude) et des formes institutionnelles des groupes humains (dans Imperium), le chercheur au CNRS s’attaque à l’intervention politique. Les affects, pour Spinoza, n’ont pas grand-chose à voir avec ce que nous nommons « les émotions » et que nous opposons à « la raison ». « Une chose exerce une puissance sur une autre, cette dernière s’en trouve modifiée : affect est le nom de cette modification », explique l’auteur dès l’introduction. Ainsi entendue, la politique peut être définie comme l’art d’affecter : intervenir en politique (par un discours, une œuvre artistique, une geste symbolique etc.), c’est chercher à produire un effet sur les autres, à les faire bouger, à les déplacer — dans « leur tête », certes, mais aussi dans leur corps (aller en manifestation, participer à une grève, aller au bureau de vote mettre le « bon » bulletin dans l’urne, etc.). Ce sont donc des « idées » qu’il faut réussir à faire partager. Mais ces dernières, en tant que pures abstractions, sont « sans force sur les corps » : il faut les « empuissanter » ou, dit autrement, leur adjoindre un support affectif. L’idée du « changement climatique » ne nous touche que lorsque nous pouvons nous le figurer par des images ; l’idée d’une « dette publique abyssale » nous terrorise une fois représentée par un compteur en temps réel qui file irrémédiablement. D’où la centralité que donne Frédéric Lordon à la « machine affectante » par excellence qui a le monopole de la production d’images : les médias de masse audiovisuels. La condition des minorités politiques (ici, la gauche radicale) revient à rendre visible ce que le système dominant tend à cacher (la violence du rapport salarial, l’imminence de la catastrophe climatique, la misère sociale, etc.). Pourquoi rendre visible « marche »-t-il ? Car, le social, nous dit l’auteur, est guidé par un puissant ressort passionnel : l’imitation des affects, la capacité à « se mettre à la place de ». Mais chacun n’est pas une coquille vide prête à recevoir les images et s’en trouver chamboulé. Notre biographie (socialisation, famille, rencontres, etc.) laisse en nous des plis durables qui, devant l’image de la chemise arrachée du DRH d’Air France, nous prédétermine à une sympathie pour l’homme bousculé ou pour les salariés licenciés. L’auteur pose ensuite le problème au niveau macroscopique : à quel moment le pouvoir d’affecter d’un régime politique s’effondre ? Les crises politiques surviennent au « point d’indignation ». Non pas des « traverses individuelles » mais « une bifurcation globale dans la dynamique des affects collectifs », moment inévitable pour tout pouvoir qui franchit la ligne rouge — tout ce qui était supportable hier ne l’est plus aujourd’hui. Un livre utile pour dégriser une énième fois les militants. Leur contestation n’est pas le résultat d’une analyse rationnelle du capitalisme mais répond à un régime affectif particulier : la révolte logique que l’auteur appelle à généraliser (la seule évocation du mot « flexibilité » ou « réformes nécessaires » suffit pour mettre en rogne car ces termes sont associés à un ensemble d’images mentales du néolibéralisme). [A.G.]
Frédéric Lordon continue de déployer les concepts de Spinoza pour penser notre réalité. Après l’étude du rapport salarial (dans Capitalisme, Désir et servitude) et des formes institutionnelles des groupes humains (dans Imperium), le chercheur au CNRS s’attaque à l’intervention politique. Les affects, pour Spinoza, n’ont pas grand-chose à voir avec ce que nous nommons « les émotions » et que nous opposons à « la raison ». « Une chose exerce une puissance sur une autre, cette dernière s’en trouve modifiée : affect est le nom de cette modification », explique l’auteur dès l’introduction. Ainsi entendue, la politique peut être définie comme l’art d’affecter : intervenir en politique (par un discours, une œuvre artistique, une geste symbolique etc.), c’est chercher à produire un effet sur les autres, à les faire bouger, à les déplacer — dans « leur tête », certes, mais aussi dans leur corps (aller en manifestation, participer à une grève, aller au bureau de vote mettre le « bon » bulletin dans l’urne, etc.). Ce sont donc des « idées » qu’il faut réussir à faire partager. Mais ces dernières, en tant que pures abstractions, sont « sans force sur les corps » : il faut les « empuissanter » ou, dit autrement, leur adjoindre un support affectif. L’idée du « changement climatique » ne nous touche que lorsque nous pouvons nous le figurer par des images ; l’idée d’une « dette publique abyssale » nous terrorise une fois représentée par un compteur en temps réel qui file irrémédiablement. D’où la centralité que donne Frédéric Lordon à la « machine affectante » par excellence qui a le monopole de la production d’images : les médias de masse audiovisuels. La condition des minorités politiques (ici, la gauche radicale) revient à rendre visible ce que le système dominant tend à cacher (la violence du rapport salarial, l’imminence de la catastrophe climatique, la misère sociale, etc.). Pourquoi rendre visible « marche »-t-il ? Car, le social, nous dit l’auteur, est guidé par un puissant ressort passionnel : l’imitation des affects, la capacité à « se mettre à la place de ». Mais chacun n’est pas une coquille vide prête à recevoir les images et s’en trouver chamboulé. Notre biographie (socialisation, famille, rencontres, etc.) laisse en nous des plis durables qui, devant l’image de la chemise arrachée du DRH d’Air France, nous prédétermine à une sympathie pour l’homme bousculé ou pour les salariés licenciés. L’auteur pose ensuite le problème au niveau macroscopique : à quel moment le pouvoir d’affecter d’un régime politique s’effondre ? Les crises politiques surviennent au « point d’indignation ». Non pas des « traverses individuelles » mais « une bifurcation globale dans la dynamique des affects collectifs », moment inévitable pour tout pouvoir qui franchit la ligne rouge — tout ce qui était supportable hier ne l’est plus aujourd’hui. Un livre utile pour dégriser une énième fois les militants. Leur contestation n’est pas le résultat d’une analyse rationnelle du capitalisme mais répond à un régime affectif particulier : la révolte logique que l’auteur appelle à généraliser (la seule évocation du mot « flexibilité » ou « réformes nécessaires » suffit pour mettre en rogne car ces termes sont associés à un ensemble d’images mentales du néolibéralisme). [A.G.]
Éditions du Seuil, 2016
☰ Paris, d’Émile Zola
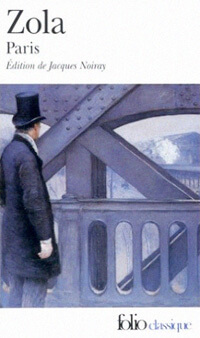 Troisième volet du cycle romanesque « Trois villes » d’Émile Zola, ce Paris suit le retour de l’abbé Pierre Froment à Paris — après une visite à Lourdes, où il n’est pas touché par la ferveur religieuse, et une autre à Rome, d’où il ressort dégouté par le luxe de l’institution catholique. La Ville Lumière a changé depuis sa reprise en main par Haussmann : la classe ouvrière — la classe dangereuse — est reléguée, surveillée, contrôlée. L’abbé est un ambassadeur. Son habit provoque de l’hostilité mais lui permet d’évoluer dans tous les milieux, dans toutes les classes, dans tous les espaces. Confronté à l’injustice, il perd sa foi déjà bien entamée par l’observation empirique des dérives de son institution religieuse et du renoncement qu’il crée chez ses adeptes. Les inégalités sociales renforcées par l’industrialisation forment ce fil rouge que Zola tire tout au long de ses chapitres. L’abbé les ressent dans sa chair avec d’autant plus d’amertume qu’il plaide dans les hautes sphères industrielles et politiques afin que celles-ci s’investissent dans des œuvres philanthropiques pour les plus nécessiteux. Il y observe amèrement la fatuité d’une classe engoncée dans ses privilèges, une classe qui s’amuse des nombreux scandales (Panama et autres) qui refaçonnent son terrain de jeu. Mais le « quatrième état » — le petit peuple — reprend la main en visant, par un attentat anarchiste, l’un des membres de cette haute bourgeoisie capitaliste. L’abbé y assiste et voit un membre de sa famille soutenir l’entreprise ; cela provoque chez lui une prise de conscience nouvelle et un retour à ses racines. Ce drame social interroge très tôt, en cette fin du XIXe siècle, les fondements de l’anarchie, des inégalités, du terrorisme, de la privation de l’espace politique et des décisions par une oligarchie. Le talent de Zola est d’y arriver avec un réalisme intransigeant tout en y instillant à chaque ligne une forte charge romantique. [T.M.]
Troisième volet du cycle romanesque « Trois villes » d’Émile Zola, ce Paris suit le retour de l’abbé Pierre Froment à Paris — après une visite à Lourdes, où il n’est pas touché par la ferveur religieuse, et une autre à Rome, d’où il ressort dégouté par le luxe de l’institution catholique. La Ville Lumière a changé depuis sa reprise en main par Haussmann : la classe ouvrière — la classe dangereuse — est reléguée, surveillée, contrôlée. L’abbé est un ambassadeur. Son habit provoque de l’hostilité mais lui permet d’évoluer dans tous les milieux, dans toutes les classes, dans tous les espaces. Confronté à l’injustice, il perd sa foi déjà bien entamée par l’observation empirique des dérives de son institution religieuse et du renoncement qu’il crée chez ses adeptes. Les inégalités sociales renforcées par l’industrialisation forment ce fil rouge que Zola tire tout au long de ses chapitres. L’abbé les ressent dans sa chair avec d’autant plus d’amertume qu’il plaide dans les hautes sphères industrielles et politiques afin que celles-ci s’investissent dans des œuvres philanthropiques pour les plus nécessiteux. Il y observe amèrement la fatuité d’une classe engoncée dans ses privilèges, une classe qui s’amuse des nombreux scandales (Panama et autres) qui refaçonnent son terrain de jeu. Mais le « quatrième état » — le petit peuple — reprend la main en visant, par un attentat anarchiste, l’un des membres de cette haute bourgeoisie capitaliste. L’abbé y assiste et voit un membre de sa famille soutenir l’entreprise ; cela provoque chez lui une prise de conscience nouvelle et un retour à ses racines. Ce drame social interroge très tôt, en cette fin du XIXe siècle, les fondements de l’anarchie, des inégalités, du terrorisme, de la privation de l’espace politique et des décisions par une oligarchie. Le talent de Zola est d’y arriver avec un réalisme intransigeant tout en y instillant à chaque ligne une forte charge romantique. [T.M.]
Œuvres complètes, volume 17, Nouveau Monde éditions, 2007
☰ Villes Rebelles, de David Harvey
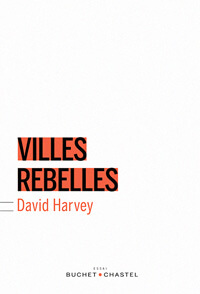 La question de l’organisation est aujourd’hui cruciale dans la production théorique de la gauche radicale. Et que cela soit par le biais de l’étude transhistorique des communs (Negri & Hardt, Dardot & Laval) ou du zonage (les « communisateurs », par exemple), l’organisation de l’espace adopte une place centrale dans les débats qui s’y déroulent. On voit ainsi la question du droit à la ville, que portait le sociologue Henri Lefebvre dans les années 1960 et 1970, s’inviter sur le devant de la scène. David Harvey donne avec cet ouvrage un éclairage particulier sur l’espace urbain dans un contexte où il n’est pas un trimestre sans que des affrontements opposent une population urbaine et les forces gouvernementales de maintien de l’ordre, d’Athènes à la place Tahrir en passant par Paris ou São Paulo. Harvey est un géographe et anthropologue marxiste ; il s’agit donc pour lui de penser la ville au sein du capitalisme, en gardant à l’esprit que « depuis qu’elles sont apparues, les villes ont surgi de la concentration géographique et sociale d’un excédent de production. L’urbanisation a toujours été, par conséquent, un certain type de phénomène de classe ». Les villes et les concentrations urbaines jouent dès lors un rôle absolument fondamental pour Harvey en ce qu’elles sont le cadre (et le reflet) non seulement d’une organisation sociale, mais aussi de la création de nouvelles institutions, et notamment d’institutions de crédit. Harvey passe en revue les réformes haussmanniennes de Paris, mais aussi celles de la métropole new yorkaise sous l’urbaniste Robert Moses ; il montre la collusion entre ces immenses ouvrages et de nouvelles formes de crédit, et donc d’absorption d’un excédent de production. Les crises du capitalisme ne sont pas toutes des crises de surproduction, et « un nombre raisonnable d’entre elles trouve son origine dans le développement immobilier ou urbain ». Passant en revue les différents éclairages théoriques qui entourent la question du droit à la ville, Harvey appuie sur la nécessité fondamentale pour les mouvements révolutionnaires de se réapproprier l’espace urbain en le proclamant espace commun, et non seulement espace public. Il s’agit de partir des luttes concrètes des habitants en ayant comme horizon une critique radicale de la toile de fond sur laquelle s’inscrivent toutes ces luttes : le mode de production capitaliste et la prédation organisée qu’est la ville néolibérale. [J.G.]
La question de l’organisation est aujourd’hui cruciale dans la production théorique de la gauche radicale. Et que cela soit par le biais de l’étude transhistorique des communs (Negri & Hardt, Dardot & Laval) ou du zonage (les « communisateurs », par exemple), l’organisation de l’espace adopte une place centrale dans les débats qui s’y déroulent. On voit ainsi la question du droit à la ville, que portait le sociologue Henri Lefebvre dans les années 1960 et 1970, s’inviter sur le devant de la scène. David Harvey donne avec cet ouvrage un éclairage particulier sur l’espace urbain dans un contexte où il n’est pas un trimestre sans que des affrontements opposent une population urbaine et les forces gouvernementales de maintien de l’ordre, d’Athènes à la place Tahrir en passant par Paris ou São Paulo. Harvey est un géographe et anthropologue marxiste ; il s’agit donc pour lui de penser la ville au sein du capitalisme, en gardant à l’esprit que « depuis qu’elles sont apparues, les villes ont surgi de la concentration géographique et sociale d’un excédent de production. L’urbanisation a toujours été, par conséquent, un certain type de phénomène de classe ». Les villes et les concentrations urbaines jouent dès lors un rôle absolument fondamental pour Harvey en ce qu’elles sont le cadre (et le reflet) non seulement d’une organisation sociale, mais aussi de la création de nouvelles institutions, et notamment d’institutions de crédit. Harvey passe en revue les réformes haussmanniennes de Paris, mais aussi celles de la métropole new yorkaise sous l’urbaniste Robert Moses ; il montre la collusion entre ces immenses ouvrages et de nouvelles formes de crédit, et donc d’absorption d’un excédent de production. Les crises du capitalisme ne sont pas toutes des crises de surproduction, et « un nombre raisonnable d’entre elles trouve son origine dans le développement immobilier ou urbain ». Passant en revue les différents éclairages théoriques qui entourent la question du droit à la ville, Harvey appuie sur la nécessité fondamentale pour les mouvements révolutionnaires de se réapproprier l’espace urbain en le proclamant espace commun, et non seulement espace public. Il s’agit de partir des luttes concrètes des habitants en ayant comme horizon une critique radicale de la toile de fond sur laquelle s’inscrivent toutes ces luttes : le mode de production capitaliste et la prédation organisée qu’est la ville néolibérale. [J.G.]
Éditions Buchet-Chastel, 2015
☰ Daech, le cinéma et la mort, de Jean-Louis Comolli
 Musiques entraînantes, rythmes échauffés, éclairs aveuglants… Tout un arsenal d’effets orne les films réalisés par Daech. Construites à partir des principaux codes des blockbusters occidentaux, ces vidéos font partie des méthodes de radicalisation employées par l’organisation terroriste. Dans cet ouvrage, Jean-Louis Comolli ne se contente pas d’analyser ces productions : il nous transmet son savoir de spécialiste et nous fait prendre du recul sur ce que peut être le cinéma (et ce qu’il ne doit pas être). Comprenons bien ce qu’est une vidéo réalisée par Daech : il ne s’agit ni du fruit de notre imagination ni d’un scénario improvisé ; nous sommes à cheval entre la réalité de la mort et l’art de feindre à travers un montage vidéo. Conditionnés par les fictions sanglantes, nous n’avons plus l’habitude, lorsque nous sommes devant un écran, de faire la part des choses entre ce qui est et ce qui n’est pas. Sur les images montées par Al-Hayat Media Center, studios de cinéma de Daech, tout est embelli mais la mort, elle, est bien réelle. Au-delà de cet enseignement, l’étude de Jean-Louis Comolli nous apprend — entre autres choses — que si Daech s’est emparé des codes occidentaux du cinéma, ce n’est pas une coïncidence : « ce passé est aussi le nôtre », écrit-il. Parce que Daech hérite d’un lourd passé de tortures et de mises à mort, les armes sont les mêmes, les financements sont voisins et les styles s’imitent ainsi les uns les autres. Si le sujet est délicat et laisse penser qu’il côtoie le terrain de la fascination morbide, il n’en est rien. Entre philosophie, histoire du cinéma et du terrorisme, techniques de cadrage, politique et sociologie, Comolli nous livre un réflexion intelligente sur les images et les sons façonnés par l’organisation terroriste. Une étude qui se démarque clairement de nombreux ouvrages et articles sur le sujet. [M.S.F.]
Musiques entraînantes, rythmes échauffés, éclairs aveuglants… Tout un arsenal d’effets orne les films réalisés par Daech. Construites à partir des principaux codes des blockbusters occidentaux, ces vidéos font partie des méthodes de radicalisation employées par l’organisation terroriste. Dans cet ouvrage, Jean-Louis Comolli ne se contente pas d’analyser ces productions : il nous transmet son savoir de spécialiste et nous fait prendre du recul sur ce que peut être le cinéma (et ce qu’il ne doit pas être). Comprenons bien ce qu’est une vidéo réalisée par Daech : il ne s’agit ni du fruit de notre imagination ni d’un scénario improvisé ; nous sommes à cheval entre la réalité de la mort et l’art de feindre à travers un montage vidéo. Conditionnés par les fictions sanglantes, nous n’avons plus l’habitude, lorsque nous sommes devant un écran, de faire la part des choses entre ce qui est et ce qui n’est pas. Sur les images montées par Al-Hayat Media Center, studios de cinéma de Daech, tout est embelli mais la mort, elle, est bien réelle. Au-delà de cet enseignement, l’étude de Jean-Louis Comolli nous apprend — entre autres choses — que si Daech s’est emparé des codes occidentaux du cinéma, ce n’est pas une coïncidence : « ce passé est aussi le nôtre », écrit-il. Parce que Daech hérite d’un lourd passé de tortures et de mises à mort, les armes sont les mêmes, les financements sont voisins et les styles s’imitent ainsi les uns les autres. Si le sujet est délicat et laisse penser qu’il côtoie le terrain de la fascination morbide, il n’en est rien. Entre philosophie, histoire du cinéma et du terrorisme, techniques de cadrage, politique et sociologie, Comolli nous livre un réflexion intelligente sur les images et les sons façonnés par l’organisation terroriste. Une étude qui se démarque clairement de nombreux ouvrages et articles sur le sujet. [M.S.F.]
Éditions Verdier, 2016
☰ La Longue route, de Bernard Moitessier
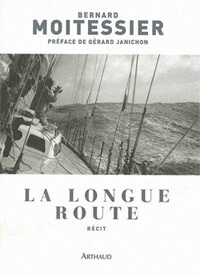 En 1968, le journal britannique The Sunday Times organise une course autour du monde en solitaire, le « Golden Globe Challenge ». Des neuf concurrents engagés, quatre abandonnèrent avant de quitter l’Atlantique, un autre après avoir franchi le cap de Bonne-Espérance, le bateau d’un Sud-Africain sombra, un Britannique communiqua par radio de fausses positions faisant croire à une progression réelle autour du monde et se suicida ; c’est finalement le Britannique Robin Knox-Johnston qui remporta la course. Mais intéressons-nous au neuvième participant, celui qui aurait pu finir premier et remporter la récompense promise. Son nom, Bernard Moitessier, résonne probablement dans le cœur de chaque navigateur. Alors qu’il était en bonne position pour gagner, ce dernier rejeta la compétition et envoya un message à l’aide d’un lance-pierres sur un grand pétrolier : « Cher Robert (du Sunday Times), le Horn a été arrondi le 5 février et nous sommes le 18 mars. Je continue sans escale vers les îles du Pacifique parce que je suis heureux en mer, et peut-être, aussi pour sauver mon âme. » Est-il besoin d’en dire plus ? L’homme goûtait peu les honneurs et préféra prendre la tangente, loin d’une « société où tous les coups sont permis pourvu qu’ils soient légaux ». Contre les destructions physiques et spirituelles de la course au progrès, et parce qu’il se sentait libre sur les océans, le navigateur poursuivit sa route jusqu’à Tahiti, accomplissant un tour du monde et demi. « Je n’en peux plus des faux dieux de l’Occident toujours à l’affût comme des araignées, qui nous mangent le foie, nous sucent la moelle. Et je porte plainte contre le Monde moderne, c’est lui, le Monstre. Il détruit notre terre, il piétine l’âme des hommes. » [M.E.]
En 1968, le journal britannique The Sunday Times organise une course autour du monde en solitaire, le « Golden Globe Challenge ». Des neuf concurrents engagés, quatre abandonnèrent avant de quitter l’Atlantique, un autre après avoir franchi le cap de Bonne-Espérance, le bateau d’un Sud-Africain sombra, un Britannique communiqua par radio de fausses positions faisant croire à une progression réelle autour du monde et se suicida ; c’est finalement le Britannique Robin Knox-Johnston qui remporta la course. Mais intéressons-nous au neuvième participant, celui qui aurait pu finir premier et remporter la récompense promise. Son nom, Bernard Moitessier, résonne probablement dans le cœur de chaque navigateur. Alors qu’il était en bonne position pour gagner, ce dernier rejeta la compétition et envoya un message à l’aide d’un lance-pierres sur un grand pétrolier : « Cher Robert (du Sunday Times), le Horn a été arrondi le 5 février et nous sommes le 18 mars. Je continue sans escale vers les îles du Pacifique parce que je suis heureux en mer, et peut-être, aussi pour sauver mon âme. » Est-il besoin d’en dire plus ? L’homme goûtait peu les honneurs et préféra prendre la tangente, loin d’une « société où tous les coups sont permis pourvu qu’ils soient légaux ». Contre les destructions physiques et spirituelles de la course au progrès, et parce qu’il se sentait libre sur les océans, le navigateur poursuivit sa route jusqu’à Tahiti, accomplissant un tour du monde et demi. « Je n’en peux plus des faux dieux de l’Occident toujours à l’affût comme des araignées, qui nous mangent le foie, nous sucent la moelle. Et je porte plainte contre le Monde moderne, c’est lui, le Monstre. Il détruit notre terre, il piétine l’âme des hommes. » [M.E.]
Éditions Arthaud, 2004
Bannière : photographie du groupe Roz Cron and the International Sweethearts of Rhythm (DR)
REBONDS
☰ Cartouches 13, septembre 2016
☰ Cartouches 12, juillet 2016
☰ Cartouches 11, juin 2016
☰ Cartouches 10, mai 2016
☰ Cartouches 9, avril 2016




