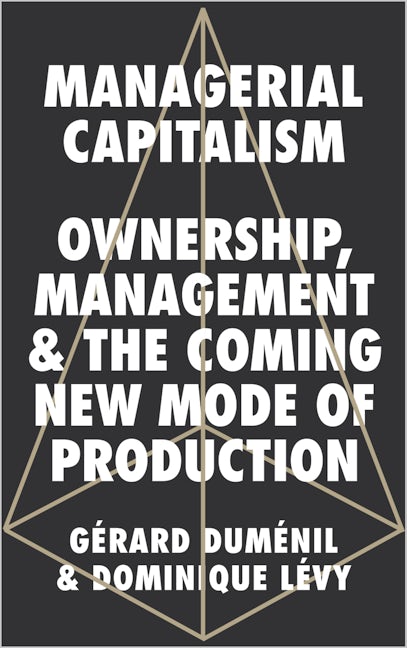Agenda militant
Ailleurs sur le Web
![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)
- Meeting avec Bagayoko, Coquerel et Mélenchon à Saint-Denis ! (11/03)
- Ludivine Bantigny, "La Bourse ou la vie. Le Front populaire, histoire pour aujourd’hui" (11/03)
- C’est quoi le "marxisme classique" et le "marxisme occidental" ? (10/03)
- “Le socialisme est la maison commune de tous les combats justes.” – Entretien avec Joseph Andras (10/03)
- Sur Franceinfo : Brigitte Boucher et les irresponsables (10/03)
- Ce que révèle l’affaire Epstein (10/03)
- Au Liban, d’une guerre coloniale à l’autre et du droit de résister (10/03)
- POUR UN FRONT ANTIFASCISTE AU SECOND TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES (10/03)
- Meeting de la campagne municipale LFI à Lille (10/03)
- Meeting avec Jean-Luc Mélenchon et Sophia Chikirou à Paris ! (09/03)
- Colombie : la gauche de Gustavo Petro valide le dernier test des législatives avant la présidentielle (09/03)
- Penser l’émancipation autrement, discuter l’apport de marxistes hétérodoxes [Podcast] (09/03)
- Terrorisme d’Ultra-droite (08/03)
- "L’Iran est sur le point d’obtenir l’arme nucléaire" : trente ans de prophéties démenties (08/03)
- Hommage au chercheur marxiste Michael Parenti – Compilation d’entretiens (08/03)
- La guerre de trop : les Américains et les Israéliens n’ont rien compris à l’Iran ! (08/03)
- Poutou annonce un probable soutien du NPA-A à Mélenchon en 2027 (07/03)
- Attaques en série contre LFI (07/03)
- Des maires insoumis pour tout changer | Clip officiel - Municipales 2026 (07/03)
- Romaric Godin : "La force fondamentale du capitalisme le pousse vers le néofascisme" (07/03)
- Quentin Deranque était en première ligne dans la bagarre (06/03)
- Tirer une balle dans la tête sans intention de donner la mort (06/03)
- Les États-Unis et Israël nous entraînent dans une barbarie suicidaire (06/03)
- Clémence Guetté sur RTL ce jeudi (06/03)
- Annuler LFI : le dangereux fantasme du PS (06/03)
Liens
Néolibéralisme et capitalisme managérial. Entretien avec Gérard Duménil
Ces articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » sont publiés à titre d'information et n'engagent pas la Tendance CLAIRE.
http://www.contretemps.eu/dumenil-capitalisme-managerial-neoliberalisme/
Dans cet entretien avec Guillaume Fondu, Gérard Duménil revient sur ses analyses du néolibéralisme, de la financiarisation de l’économie et sur les transformations du capitalisme liées au rôle toujours accru des cadres. Gérard Duménil est notamment l’auteur, avec Dominique Lévy, de La grande bifurcation. En finir avec le néolibéralisme (La Découverte, 2014, 160 p), à propos duquel on pourra relire cet entretien, et de Managerial Capitalism. Ownership, Management and the Coming of a New Mode of Production (Pluto Press, 2018, 272 p).
Contretemps : Vous êtes, avec Dominique Lévy, l’un des rares chercheurs en France à pratiquer encore la discipline économique en tant que marxiste. Pourriez-vous revenir sur votre parcours et nous expliquer les raisons de ce recul important ?
Dominique et moi étions étudiants dans les années 1960, dans un contexte où la référence à Marx était hautement valorisée à gauche. Et vous en connaissez un des débouchés, mai 1968. L’URSS était radicalement critiquée par les militants d’extrême-gauche, au nom du trotskisme ou du maoïsme, comme ayant trahi les idéaux socialistes-communistes.
C’était l’époque des « gauchistes », ainsi nommés parce que se situant à gauche du Parti communiste. Même si l’économie française était jugée prospère, malgré les conditions de travail et de vie de la classe ouvrière, nous étions très critiques de l’ordre établi, aux plans économique, politique et idéologique. Et nous nous trouvions, plus généralement, dans un contexte encore marqué par les guerres coloniales impérialistes françaises et l’impérialisme états-unien, notamment en Amérique latine mais surtout de guerre du Vietnam.
Les courants auxquels nous appartenions étaient sous l’influence du maoïsme ou directement maoïstes. Nous n’avions guère de doutes sur la justesse du jugement porté par Marx sur la dynamique historique du capitalisme quant à ses contradictions et son « historicité ». Personnellement, je ne m’attendais pas la révolution prolétarienne et les espoirs suscités par la Révolution culturelle chinoise furent brefs, mais j’avais la conviction de la justesse du diagnostic relatif à l’historicité du capitalisme sans imaginer les formes que pourrait revêtir un dépassement.
Tel fut le point de départ de la « grande étude » de l’économie, de la politique et de l’histoire qui nous anime encore aujourd’hui. Au plan plus strictement économique, il fallait s’enfoncer dans la forêt profonde du Capital sans s’y perdre, mais aussi tenter de maîtriser la critique de l’économie dominante (souvent appelée néoclassique) ainsi que l’économie keynésienne. Le chantier le plus vaste était celui de l’analyse factuelle : comprendre les événements contemporains et leur racines historiques. Il s’agissait d’un programme pour des décennies, une vie.
Le marxisme était encore enseigné à l’université, et il y avait des cours d’histoire dans les lycées susceptibles de soutenir un discours politique contestataire. La grande entreprise de déconstruction du marxisme, telle qu’elle se matérialisa en économie, en histoire et dans les sociologies bourdieusienne et foucaldienne en France, était encore en gestation. Elle allait prendre son essor dans les années 1970, en parallèle à l’accélération de la contre-offensive de la part des classes dominantes, qui allait aboutir au grand virage néolibéral. Le « vide », comme vous dites, fut le produit de ces circonstances : des luttes perdues à gauche, gagnées à droite.
Pourquoi maintenir la relation à Marx dans ce climat défavorable ? Il ne faut pas voir seulement en Marx le critique de l’économie dominante. Il construisit une économie politique alternative. La portée principale de son œuvre se situait, en fait, à l’articulation de l’économie et de la théorie de l’histoire. L’une et l’autre demeurent sans égales : d’une part, l’analyse de l’exploitation dans le capitalisme, les grandes tendances du mode de production, auxquelles il faut ajouter quantité d’analyses plus « techniques » comme celle de la concurrence, et d’autre part, les rapports de production, les structures et luttes de classe.
Mais il ne faut pas chercher dans l’œuvre de Marx des théories achevées des crises ou de ce qu’on appelle pudiquement en France le « cycle conjoncturel » : pour une raison simple, les données et informations nécessaires étaient indisponibles au XIXe siècle, ce qui n’empêchait pas Marx de penser mener à bien cette entreprise impossible. Surtout, concernant l’histoire, Marx perçut avec une grande acuité la montée des cadres, mais n’en accepta jamais les implications politiques, sauf à voir dans cette montée la préfiguration du socialisme.
Concernant la relation cruciale entre économie politique et théorie de l’histoire, j’invite les lecteurs de ces lignes à lire, à titre d’illustration, au chapitre 10 de Managerial Capitalism, notre analyse du néolibéralisme, dans lequel nous voyons l’aboutissement d’une lutte de classe victorieuse de la part des classes supérieures, étroitement intriquée aux tendances et contradictions du mode de production. Ce sont de telles convergences avec la problématique politico-économique de Marx, qui font que nous estimons encore travailler dans le sillage de Marx.
Contretemps: Pourriez-vous dire quelques mots de votre ouvrage Le concept de loi économique dans Le Capital, et de votre rapport avec Althusser à l’époque, qui l’avait préfacé ?
Ayant entrepris l’étude des œuvres de Marx, notamment du Capital, je n’ai pu maintenir la séparation entre l’économie politique, l’histoire et ce qu’on peut appeler la « méthode » de Marx ou, plus exactement, les principes théoriques de la connaissance qui structurent cette œuvre. Il y a peu de textes explicites de Marx lui-même, c’est donc dans la pratique de la connaissance de Marx qu’il fallait chercher.
Le Concept de loi économique fut d’abord une thèse sous la direction de Charles Bettelheim, qui y prêta peu d’intérêt. Mais la soutenance eut lieu en 1971. Ayant fait disparaître toute référence à ces circonstances universitaires, j’en envoyais un exemplaire à Louis Althusser, qui me demanda de passer le voir. Après quelques entretiens, qui allaient être suivis d’autres, il décida de le publier dans sa collection Théorie, malgré la vigoureuse opposition de François Maspero.
Cette introduction est le texte le plus important qu’Althusser ait publié sur la « méthode » de Marx, dont Althusser me prêta une interprétation originale : « Justement sur ce point, Duménil défend des thèses fortes. J’espère ne pas trahir sa pensée en disant que, loin de procéder par autoproduction de concepts, la pensée de Marx procéderait plutôt par position de concept, inaugurant l’exploration (analyse) de l’espace théorique ouvert et fermé par cette position… ».
Dans le texte d’Althusser, tout tourne autour de la relation entre les dialectiques de Marx et Hegel. C’était me faire beaucoup d’honneur, car, à l’époque, malgré mes efforts, je n’avais que la connaissance élémentaire et fausse de cette question que pouvait posséder un jeune marxiste. Il m’a fallu plusieurs décennies. C’est le sujet que j’aimerais maintenant traiter. Mais pour quels lectorats ? À quelles fins ?
Pour être honnête, je dois dire ici qu’Althusser avait lu mon petit livre La position de classe des cadres et employés, publié en 1975, peu avant Le concept de loi économique, le premier exposé des thèses de Managerial Capitalism. Son commentaire fut bref : « Intéressant, mais vous pêchez en eau trouble » !
Contretemps : Votre ouvrage, Managerial Capitalism, est volontairement provocant. Vous émettez l’idée, pour le dire grossièrement, que la classe dominante qui se profile n’est plus nécessairement celle qui détient le capital. C’est d’autant plus étrange pour le lecteur que vous êtes connu pour avoir pensé le néolibéralisme comme une reprise en main par la finance – c’est-à-dire les détenteurs du capital à l’état « pur » – des institutions de l’économie contemporaine. Pourriez-vous revenir sur cette thèse ?
Nous ne percevons pas Managerial Capitalism comme un ouvrage provoquant. À l’inverse, j’ai, personnellement, souhaité en faire une sorte de « testament » à l’intention des plus jeunes. Mais il est très difficile de briser les barrières, car il faudrait appartenir aux deux générations : avoir été pénétrés de la pensée de Marx comme nous l’avons été, et avoir l’avenir devant soi. Ce sont de tels liens que j’ai voulu établir, espérant surtout que la bouteille à la mer n’ira pas s’échouer sur les récifs du sectarisme dans lequel ce qui reste du marxisme s’est ossifié.
En effet, selon vos termes, « la classe dominante qui se profile n’est plus nécessairement celle qui détient le capital ». Ce que nous disons est, plus exactement, que deux classes dominent de nos jours, celle qui détient le capital et celle qui détient un pouvoir dérivé d’une compétence au sein des entreprises et des institutions étatiques, ce qu’on appelle en France des « cadres » (auxquels on peut adjoindre des membres de professions libérales). Le pouvoir des cadres va croissant. Ils ne forment plus une classe moyenne, mais une nouvelle classe supérieure ; le pouvoir des capitalistes va en diminuant, malgré la remontée qu’a provoquée le néolibéralisme.
Mais il faut immédiatement souligner que les États-Unis sont le pays le plus avancé dans cette transition vers un nouveau « mode de production », au sens très marxiste du terme, comme l’Angleterre fut la patrie de la révolution industrielle au gré de la formation des rapports de production capitalistes, un processus pluriséculaire. Nous sommes dans une société hybride, avec deux classes au sommet. Mais, surtout aux Etats-Unis, les fractions supérieures des cadres exercent le leadership aux plans économique, politique et culturel. Nous utilisons ici le terme « cadre » (ou « manager ») dans un sens plus restreint que l’usage statutaire beaucoup plus large qui en fait en France en référence, notamment, à des régimes de retraites.
Certaines études suggèrent d’en limiter le champ à quelques 3% des sommets de la hiérarchie salariale. Mais, du point de vue de ces nouveaux rapports de production comme des anciens, il faut distinguer des fractions supérieures des classes dominantes et des classes moyennes plus étendues, se situant au-dessous de ces quelques pourcents supérieurs. Plus intéressant que cette position « moyenne » — une notion empirique trop facile pour être honnête — il faudrait faire une « sociologie » de ces groupes, de ses composantes gestionnaires, administratives, et intellectuelles dans la perspective de la montée du nouveau mode de production.
Le processus historique d’affirmation des cadres est directement évident. Il fut noté, en particulier, par Bourdieu et Foucault en France, et, antérieurement, par quantité d’auteurs aux États-Unis, dont les plus connus sont Kenneth Galbraith et Alfred Chandler. On peut remarquer au passage que ces deux penseurs identifièrent en premier lieu la montée des cadres d’entreprise, contrairement aux français.
Il est curieux de constater que ces tendances furent beaucoup mieux analysées aux États-Unis bien que la société française des premières décennies de l’après-Seconde Guerre mondiale ait été très profondément managériale (il faudrait dire « cadriste »). Aux États-Unis, la notion de « capitalisme managérial » n’est nullement choquante, elle est à l’inverse banale, et la référence est courante à la révolution managériale à la transition des XIXe et XXe siècles.
Nous avons toujours considéré les cadres comme une classe, mais il nous a fallu du temps pour établir la relation que nous jugeons désormais correcte, entre le néolibéralisme en tant que nouvelle phase du capitalisme managérial, et les deux classes, capitalistes et cadres considérées conjointement. Notre vieux marxisme nous conduisit d’abord à placer l’initiative de cette transformation historique dans les mains des classes capitalistes tentant de reconquérir leur hégémonie et de rétablir leurs revenus après des décennies d’érosion. Nous analysions l’adhésion des cadres au nouvel ordre social néolibéral en termes de ralliement : les cadres rejoignant les capitalistes.
Au premier chapitre de notre livre Crise et sortie de crise, publié en 2000, nous situions encore l’origine du néolibéralisme dans une « Finance capitaliste », c’est-à-dire une classe capitaliste dont le pouvoir était investi dans les institutions financières. Mais nous avons ensuite progressé et compris que ce pouvoir et les revenus correspondants se trouvaient désormais dans les grandes institutions financières, gérées par les cadres financiers constituant le sommet d’une grande hiérarchie managériale.
Il faut lire, à ce propos, le chapitre 11 de Managerial Capitalism ou le chapitre 7 de La grande bifurcation. Le terme Finance ne nous sert plus à désigner « les détenteurs du capital à l’état « pur » » mais l’institution managériale-capitaliste centrale sous hégémonie des cadres financiers.
Contretemps: Vous produisez dans votre ouvrage un grand nombre de données pour étayer vos thèses, et notamment des indicateurs de l’évolution des inégalités. Pourriez-vous-rappeler ici les grandes tendances, quantitatives et qualitatives ? Pourriez-vous situer votre propos par rapport à l’ouvrage de Thomas Piketty ?
Les structures de classe se définissent par référence aux moyens de production dans les entreprises et à ce que nous appelons des institutions de « socialisation », comme les États, dans un sens très étendu incluant les institutions en charge des grandes fonctions administratives et sociales. Mais l’appartenance à des classes supérieures manifeste également la capacité à concentrer des revenus, ce que Marx appelait l’appropriation d’un « surtravail ».
Les statistiques d’inégalité des revenus et des richesses sont donc des « indicateurs » très importants des structures de classe (à défaut d’en être les « définisseurs »). Ces statistiques ont été mises en forme par Thomas Piketty et ses collaborateurs. Il s’agit des revenus des ménages tels que déclarés au fisc, donc avant impôts. La hausse des inégalités a été prodigieuse aux États-Unis et au Royaume-Uni. Il n’en va pas de même en France ou en Europe, où cette hausse accomplit ses premiers pas. L’étude des États-Unis est ainsi très importante car la société états-unienne préfigure notre avenir, à moins que ne soit réalisée la très nécessaire « bifurcation ».
Je vais insister sur deux aspects : 1) la composition des hauts revenus aux États-Unis, et 2) la variation des inégalités de revenus. Abstraction faite de revenus « mixtes », deux grandes catégories de revenus doivent être distinguées, les salaires et les « revenus du capital », ce par quoi il faut entendre les intérêts, les dividendes payés par les sociétés et les loyers. À cela, on peut ou non ajouter les plus-values réalisées à la bourse ou sur la propriété immobilière.
Considérant le 1% supérieur de la hiérarchie des revenus (une fraction du sommet des nouvelles classes supérieures hybrides), en 2017, le revenu des ménages appartenant à ce groupe se composaient à hauteur de 80% de salaires, donc 20% de revenu du capital (si l’on inclut dans ces revenus les plus-values, le pourcentage était de 70%). Il est donc impossible, aujourd’hui, de caractériser les membres de ce 1% supérieur comme constituant à titre principal et indiscutable une fraction des classes capitalistes : ils sont prioritairement des salariés.
Ces hauts revenus sont ceux des sommets de la hiérarchie salariale. Les individus concernés reçoivent des revenus du capital, mais minoritairement. Et il ne s’agit pas ici des seuls PDGs, mais d’une catégorie sociale regroupant environ 1.600.000 unités fiscales (1% des « familles »), soit des couples soit, des personnes seules. Il est, de plus, très frappant de constater que la croissance de ce pourcentage depuis la crise de 1929 et la Seconde Guerre mondiale, s’est faite de manière étonnamment régulière, traduisant une tendance profonde et sans ruptures depuis environ 80 ans, l’effet, selon nous, d’une mutation des rapports de production.
On peut appréhender ces mêmes tendances en termes d’inégalités, considérant, pour changer, les 5% supérieurs des revenus, soit 8 millions environ d’unités fiscales. La concentration des revenus en faveur de ce groupe s’est produite depuis le milieu ou la fin des années 1970. Au cours des années 1960, ce 5% recevait un peu plus de 20% des revenus de tous les ménages ; depuis 2010, il en reçoît 32%. C’est ce qui est décrit aujourd’hui comme la « hausse des inégalités ». Mais ce qui m’intéresse ici au premier chef est que cette concentration au sommet s’est faite par les salaires, et très peu par la hausse des revenus du capital, sauf au sommet du sommet.
J’aimerais savoir comment les marxistes « traditionnels » interpréteraient ces tendances s’ils les identifiaient clairement, ce dont je doute. J’entends souvent affirmer que ces « salaires » n’en sont pas, mais cachent des « profits ». Ce diagnostic révèle une confusion entre le surtravail et ses formes monétaires : ces salaires sont indépendants de la propriété du capital (qui peut être nulle) et rémunèrent une activité. On peut évidemment décider d’appeler « profit » toute rémunération élevée, bien à tort à notre avis, et de désigner tout rapport de classe moderne comme « capitaliste » indépendamment des relations sociales. Il faut être conséquent : reconnaître la mutation des rapports de production ou abandonner l’interprétation marxiste de l’histoire.
Concernant Thomas Piketty, le travail empirique qu’il a accompli a été d’une grande importance. Cela ne change pas le fait que nous jugeons erronée l’interprétation de la montée des inégalités qu’il a donnée dans son livre. Piketty identifia bien l’importance des cadres et « super-cadres », mais sa théorie de la montée des inégalités, reposant sur la constatation que les taux de rendements des placements sont supérieurs aux taux de croissance de la production, est inacceptable.
C’est là l’objection principale, mais il en existe au moins une autre dont l’exposé nécessiterait d’entrer la technique des modèles : Piketty pose des relations de causalité aux antipodes des problématiques classiques et marxistes, selon des modes de raisonnement que nous n’acceptons pas (nous avons placé une étude de ces modèles sur notre site internet Thomas Piketty’s Economics : Modeling Wealth and Wealth Inequality, 2014). Mais tout ça n’est pas très grave.
Contretemps: Votre thèse sur le « managérialisme » en gestation vous permet un regard rétrospectif renouvelé sur les expériences « socialistes » (l’URSS notamment) et sur les critiques qui en ont été faites. Je pense notamment aux thèses trotskistes. Pouvez-vous, en quelques mots, résumer votre analyse ?
Une fois abandonné le postulat « vieux-marxiste » d’une structure de classe homogène du salariat et reconnue l’emprise des fractions supérieures des salariés sur les économies et sociétés contemporaines du capitalisme managérial, l’analyse de classe de l’Union soviétique va d’elle-même. L’interprétation qui en fit un « capitalisme d’État » était inconciliable avec la théorie de l’histoire de Marx et, peut-on dire, le simple bon sens.
Dans un capitalisme, il y a nécessairement une classe supérieure de capitalistes. Nous désignons ces sociétés comme des « managérialismes bureaucratiques ». La notion d’État prolétarien dégénéré ne parvient pas à masquer la vigueur des forces sociales de réaffirmation des dominations de classe et la formation d’une nouvelle classe. L’existence d’une « nouvelle classe » selon la terminologie parfois employée était si évident, que de nombreux auteurs l’ont identifiée, déjà du vivant de Lénine et bien après, sans parler de ceux qui en avaient prévu l’affirmation. Le livre en nomme les plus connus et évoque leurs analyses.
Il faut comprendre, à ce propos, que le glissement progressif, après l’échec de la Commune de Paris – de Marx à Lénine, en passant par les mencheviks quelque peu réticents – faisant jouer un rôle croissant à l’intelligentsia, conduisit nombre de penseurs à mettre en doute la possibilité de construire un « socialisme » sur de telles bases sociales. Après la prise du pouvoir, Lénine et Trotski se firent les ardents avocats des modes d’organisation tayloriste et fordiste. La troisième partie du livre retrace ces débats.
Un ample usage est fait des analyses de Moshe Lewin, qui fut le meilleur spécialiste de l’Union Soviétique. Lewin dénombra les effectifs de la nouvelle classe. Au sommet des hiérarchies, on comptait selon Lewin une élite d’un millier de personnes, les hauts membres des ministères, les membres du Politburo, et les têtes de l’appareil du parti aux plans national et régional. Mais la vraie « classe » de dirigeants était évaluée à 2.500.000 personnes. Il est clair que dans son livre Le siècle soviétique, Lewin laissa échapper le terme « classe » presque malgré lui, mais le mot est partout dans le livre ultérieur, Le phénomène Gorbatchev.
Contretemps : Outre l’étude rétrospective du passé, votre livre entend être aussi une intervention, au moins indirectement, dans notre présent politique. Vous faites ainsi du « populisme » le signe indicateur d’un potentiel glissement politique vers un autoritarisme peu susceptible d’effrayer les classes dirigeantes et finalement assez cohérent avec le managérialisme que vous décrivez. Pouvez-vous revenir là-dessus ?
Le terme populisme a été et est utilisé dans des contextes très différents. Ces ambiguïtés ne changent rien à la tendance actuelle de montée des populismes de droite, en Europe, aux États-Unis et en Amérique latine. Et la France n’a de leçons à donner à personne. Le Brexit est l’expression d’un processus similaire à celui qui conduisit à l’arrivée au pouvoir de Donald Trump et Jair Bolsonaro.
Les causes en sont bien connues, à savoir l’impudence des classes supérieures dans le néolibéralisme et l’effondrement des gauches expression de l’adhésion des cadres, jusqu’à leurs couches moyennes et intellectuelles, au projet néolibéral. L’alliance sociale du compromis de l’après-Seconde Guerre mondiale entre les cadres et les classes populaires céda la place à la nouvelle alliance, à droite, entre cadres et capitalistes. Elle signifia : nouvelle gestion, nouvelle politique, nouvel enseignement, nouvelle idéologie.
Le Parti socialiste français, traditionnellement un parti de cadres de gauche, du moins quant à son leadership, fut, durant plusieurs décennies après la guerre, la principale composante de cette alliance entre cadres et classes populaires, trouvant une expression dans le Programme commun entre le Parti socialiste et le Parti communiste, un programme, par ailleurs, poussiéreux, encore enfermé dans les logiques de nationalisation de l’après-guerre et sans aucune analyse des nouvelles structures de classes.
Le grand virage « delorien » [impulsé par Jacques Delors, ministre de l’économie de 1981 à 1984 et président de la commission européenne de 1985 à 1995] et le traité de Maastricht consacrèrent la rupture de l’alliance à gauche en France ainsi que la dissolution de la construction européenne dans la grande mondialisation néolibérale. Face au déclin des forces de gauche, une partie significative des classes populaires s’en remet à des courants rétrogrades, compte tenu de l’offensive des droites.
On peut évoquer ici l’élection de Donald Trump. Dans le sillage de la crise de 2008, nous avions imaginé une stratégie des classes supérieures de cadres et capitalistes réunies dans l’alliance néolibérale, qui, sans en déstabiliser les bases de classe, aurait tendu à en rationaliser le cours. Hillary Clinton était la candidate idéale de ces classes. Les conséquences de la crise ont été tout autres. Ces développements illustrent parfaitement l’alternative à laquelle les classes populaires sont désormais confrontées, d’un écueil à l’autre, d’un côté comme de l’autre de l’Atlantique.
Contretemps : Que diriez-vous aux militants qui seront potentiellement déboussolés par vos thèses, dont on pourrait hâtivement conclure que le capital n’est plus l’ennemi principal ?
Qu’ils ne désespèrent pas : le « capital », en fait les classes capitalistes, sont encore un ennemi majeur. Mais qu’ils se demandent pourquoi l’URSS et la Chine ont échoué à construire le socialisme et pourquoi les « social-démocraties » de l’après-Seconde Guerre mondiale ont été broyées dans l’engrenage néolibéral. La réponse est la même : les cadres forment une classe et aspirent au pouvoir si la lutte des classes populaires ne prévient pas leur ascension.