Agenda militant
Ailleurs sur le Web
![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)
- Au cœur du capital (12/03)
- Le débat des représentants des partis, avec Paul Vannier (12/03)
- Meeting avec Bagayoko, Coquerel et Mélenchon à Saint-Denis ! (11/03)
- Ludivine Bantigny, "La Bourse ou la vie. Le Front populaire, histoire pour aujourd’hui" (11/03)
- C’est quoi le "marxisme classique" et le "marxisme occidental" ? (10/03)
- “Le socialisme est la maison commune de tous les combats justes.” – Entretien avec Joseph Andras (10/03)
- Sur Franceinfo : Brigitte Boucher et les irresponsables (10/03)
- Ce que révèle l’affaire Epstein (10/03)
- Au Liban, d’une guerre coloniale à l’autre et du droit de résister (10/03)
- POUR UN FRONT ANTIFASCISTE AU SECOND TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES (10/03)
- Meeting de la campagne municipale LFI à Lille (10/03)
- Meeting avec Jean-Luc Mélenchon et Sophia Chikirou à Paris ! (09/03)
- Colombie : la gauche de Gustavo Petro valide le dernier test des législatives avant la présidentielle (09/03)
- Penser l’émancipation autrement, discuter l’apport de marxistes hétérodoxes [Podcast] (09/03)
- Terrorisme d’Ultra-droite (08/03)
- "L’Iran est sur le point d’obtenir l’arme nucléaire" : trente ans de prophéties démenties (08/03)
- Hommage au chercheur marxiste Michael Parenti – Compilation d’entretiens (08/03)
- La guerre de trop : les Américains et les Israéliens n’ont rien compris à l’Iran ! (08/03)
- Poutou annonce un probable soutien du NPA-A à Mélenchon en 2027 (07/03)
- Attaques en série contre LFI (07/03)
- Des maires insoumis pour tout changer | Clip officiel - Municipales 2026 (07/03)
- Romaric Godin : "La force fondamentale du capitalisme le pousse vers le néofascisme" (07/03)
- Quentin Deranque était en première ligne dans la bagarre (06/03)
- Tirer une balle dans la tête sans intention de donner la mort (06/03)
- Les États-Unis et Israël nous entraînent dans une barbarie suicidaire (06/03)
Liens
Enquêter au cœur de la classe ouvrière. Entretien avec Michel Pialoux
Ces articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » sont publiés à titre d'information et n'engagent pas la Tendance CLAIRE.
http://www.contretemps.eu/enquete-classe-ouvriere-entretien-pialoux/
Les éditions Raisons d’Agir ont récemment publié un recueil de textes écrits entre 1970 et 2000 par Michel Pialoux : Le temps d’écouter. Enquête sur les métamorphoses de la classe ouvrière. À l’occasion de la sortie de cet ouvrage, Contretemps publie un extrait de l’entretien du sociologue avec Paul Pasquali publié en annexe du volume, et intitulé « Des cités de transit aux ouvriers de Peugeot: un parcours de recherche ».
Dans cet extrait, Michel Pialoux revient sur son parcours intellectuel, plus spécifiquement sur son rapport au marxisme, mais aussi sur les raisons qui l’ont poussé à enquêter sur les classes populaires et en particulier sur le travail ouvrier.
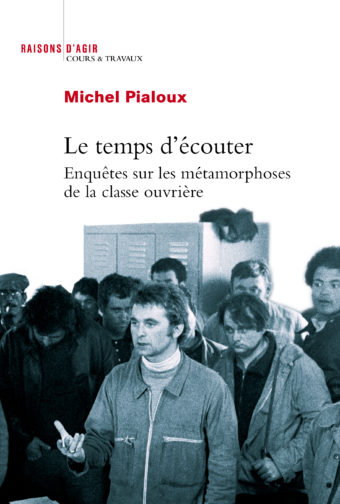
Un regard décalé sur le marxisme et les classes populaires
Une chose qu’on ne voit pas explicitement dans tes textes et qui peut être intéressante pour comprendre à la fois ton parcours et l’ambiance intellectuelle dans laquelle tu travaillais dans les années 1970, c’est justement tes lectures d’auteurs étrangers, que le public français ne connaissait alors quasiment pas : Raymond Williams, mais aussi et surtout Edward P. Thompson, qui semble avoir beaucoup compté dans ta façon de penser les recompositions des classes populaires
Oui, Thompson, j’avais lu la version originale de son livre sur la formation de la classe ouvrière anglaise[1], et je connaissais l’article de Castoriadis dans Socialisme et Barbarie[2], puisque c’est une revue que je lisais toujours de très près. […]
Quand on lit des passages de ta thèse d’État, tu parles de cette dynamique historique faite de constitutions et de reconstitutions du sous-prolétariat dans laquelle sont pris tous les ouvriers qui peuvent devenir sous-prolétaires, en tant que chômeurs ou que travailleurs pauvres…
Tout à fait mais, ça, c’était d’abord un acquis de ma présence sur le terrain. Parce que quand je voyais les familles à Noisy-le-Grand, les gens me racontaient qu’ils venaient du Nord, que leurs parents avaient été ouvriers, mais qu’ils avaient eu des malheurs. Et comme j’habitais à Aubervilliers à cette époque et que j’allais souvent au bistrot le soir, on discutait avec des gens et ils racontaient leurs histoires. Et j’avais l’impression que c’étaient les mêmes expériences, à peu de choses près, que vivaient les « vrais » ouvriers de l’époque et ceux qu’on appelait les sous-prolétaires.
Les enquêtes de Bourdieu sur les sous-prolétaires algériens[3] t’ont aussi aidé à construire tes réflexions ?
Oui mais, en Algérie, ces sous-prolétaires, en réalité, pour beaucoup, c’étaient des paysans, pas des prolétaires, ils venaient de la campagne, c’étaient des fellahs. Les camps dont parlait Bourdieu regroupaient souvent des petits agriculteurs qui vivaient dans des hameaux et des bourgs, ce n’étaient pas des salariés agricoles. Les salariés agricoles étaient plutôt dans la Mitidja, là où il y avait les grands domaines des colons, et ces gens-là n’avaient pas été déplacés. Ceux qui avaient été déplacés, c’étaient ceux de la montagne. Mais je pense que dans mon exposé au séminaire du Centre, j’ai quand même fait attention à ne pas trop mettre l’accent sur ces questions de mots, parce qu’au fond c’est une question de mots et Bourdieu aurait été sans doute d’accord pour dire que le mot « sous-prolétariat » recouvre des réalités complètement différentes.
Le « sous-prolétariat » dont tu parlais dans ta thèse d’État [consacrée au sous-prolétariat dans les cités de transit] correspond à ce qu’on a appelé ensuite les « exclus », vocabulaire que justement tu entreprends de déconstruire ?
Exactement, ça deviendra ensuite les « exclus » ! Tous ces discours revenaient à dire qu’il y avait un sous-groupe sur lequel il fallait concentrer les efforts. Et le thème de l’illettrisme, porté par Aide à toute détresse, systématisait l’idée que ces gens manquent de culture, qu’il faut donc mettre en place des pivots culturels, avec une attention particulière portée à l’alphabétisation et à la socialisation, ou plutôt à la « bonne » socialisation des enfants de deux ou trois ans. C’était au centre des discours en 1966, même si les mots « illettrisme » et « exclus » n’existaient quasiment pas à l’époque.
C’est principalement dans Critiques de l’économie politique que sont parus les textes où tu analyses les enjeux de ce nouveau vocabulaire, mais aussi où tu esquisses une reformulation de la théorie marxiste à l’aune de tes enquêtes et des réflexions de Bourdieu. Comment en es-tu venu à publier dans cette revue, puis à entrer dans son comité de rédaction ?
J’y suis entré en 1976, par l’entremise de Bruno Théret, que j’avais eu comme étudiant au départ. Nous nous sommes beaucoup fréquentés dans les années 1970, et nous sommes devenus amis. Cette revue s’ouvrait alors aux diverses tendances du marxisme hétérodoxe, j’ai donc tout de suite accepté sa proposition d’intégrer ce comité de rédaction. Et c’est comme ça qu’on en est venu à écrire ensemble l’article « État, classe ouvrière et logement social », qui est paru dans cette revue en deux parties, en 1979 et 1980[4].Théret travaillait à l’époque à la Direction de la prévision du ministère de l’Économie, on parlait souvent de ce qui s’y passait. J’avais également de bonnes relations avec un autre économiste, que j’avais aussi eu comme étudiant, Mario Dehove. Ils étaient tous les deux centraliens, mais ils suivaient des enseignements de sociologie à Paris-V. Et, par la suite, on y a fait quelques cours ensemble, vers 1974-1975, sur la sociologie du sous-développement. On parlait de figures telles que Samir Amin, André Gunder Frank, Claude Meillassoux, Pierre-Philippe Rey, en relation avec les enseignements de Jean Bazin et Louis-Vincent Thomas.
Dans cette revue tu as aussi publié, à la même époque, deux recensions critiques et particulièrement acerbes, l’une sur le livre de Jacques Donzelot, La Police des familles, l’autre sur un ouvrage dirigé par Jean-Paul de Gaudemar, sur l’avenir de la classe ouvrière et du travail en usine. Avec le recul, comment perçois-tu ces textes ?
J’ai un peu regretté de les avoir publiés, par la suite, parce qu’au fond je n’avais pas envie que ça m’engage dans de longues polémiques que je n’aurais pas aimé affronter, aussi bien avec Donzelot qu’avec de Gaudemar. Sur le moment, je me faisais plaisir, comme on dit, mais après coup je me suis demandé si j’avais été si honnête que ça, si je ne caricaturais pas trop leurs positions. Je crois qu’il vaut mieux avoir « son » terrain bien à soi si on veut critiquer, pour avancer des affirmations qu’on est capable de défendre preuves à l’appui. Ce genre de critique, c’est un exercice qu’il faut faire, mais sans forcément le publier. Si on m’avait fait des critiques sur ce ton, et il y aurait sans doute eu lieu d’en faire, ça m’aurait beaucoup mortifié. Mais, à l’époque, je prenais plus facilement des positions tranchées, en me disant : « Ça m’énerve de voir des gens qui se présentent comme sociologues et qui disent autant de choses simplistes, avec autant d’assurance ! »
En quête d’un « vrai terrain » : des ouvriers d’Amiens à ceux de Sochaux
Tout le monde a entendu parler des recherches que tu as menées sur les ouvriers de Peugeot-Sochaux, d’abord seul puis avec Stéphane Beaud. Mais on sait moins qu’avant ça, entre 1980 et 1983, tu as participé à une enquête collective sur les ouvriers de la région d’Amiens. Tu y as rencontré des OS ?
Des OS, j’en avais rencontré, en effet, avant d’aller enquêter à Sochaux, notamment à Amiens, où j’ai surtout découvert des OS de 40 ans travaillant dans le secteur du pneumatique, qui m’ont permis de « roder » quelques questions et hypothèses que j’ai pu discuter par la suite avec Corouge. Mais, en dehors de mon article avec Alain Desrosières[5] pour Critiques de l’économie politique, je n’ai jamais exploité les entretiens que j’ai réalisés à Amiens, beaucoup n’ont même jamais été transcrits. En revanche, ce que j’ai pu approfondir là-bas, c’est la question du travail ouvrier sous toutes ses formes et celle des hiérarchies entre ouvriers. Grâce à Amiens, en arrivant à Sochaux, je savais un peu mieux ce qu’est un atelier avec des OP et des OS, en quoi consiste le travail à la chaîne, etc. Si je n’avais pas eu ces expériences à Amiens, il est probable que j’aurais posé des questions naïves à Corouge et qu’il m’aurait envoyé paître ! Même si j’ai beaucoup plus appris de mes premières discussions avec lui, qui m’ont permis ensuite de pouvoir parler avec d’autres ouvriers de Peugeot. Mais il est vrai que les entretiens avec ces ouvriers picards m’ont permis d’avoir quelques idées en tête quand je suis allé à Sochaux. Parce qu’avant Amiens j’avais été davantage en rapport avec des ouvriers du BTP, intérimaires ou employés par des petites entreprises, et avec des éducateurs et des travailleurs sociaux. C’était loin des ouvriers d’usine et de la « grande usine »…
Ahmed K., l’ouvrier dont tu parles dans « Crise économique et honneur social »[6], tu l’as rencontré à Amiens ?
Non, je l’ai rencontré à Massy, où je vivais et où je vis toujours. Je l’ai rencontré dans une commission extra-municipale sur le logement où j’allais de temps en temps. J’avais été frappé par cet ouvrier qui avait pris la parole lors de la réunion, pour raconter toutes les difficultés que rencontraient ses enfants. C’était assez rare de voir un ouvrier s’exprimer aussi longuement, avec autant de conviction… et de colère. Son discours m’a interpellé, et je lui ai dit à la fin : « C’est intéressant tout ce que vous racontez, est-ce que vous accepteriez d’en reparler devant un magnétophone ? »
Et tu l’as revu, par la suite ?
Non, je l’ai vite perdu de vue après l’entretien. Je lui avais dit que j’en ferai quelque chose, donc je lui ai passé un exemplaire de l’article, mais ce n’est pas allé plus loin. Mon seul regret, c’est que j’avais écrit plusieurs pages sur ses enfants, leur éducation et leurs projets professionnels, qui ont sauté finalement dans la version publiée. C’était très proche de ce que j’ai fait plus tard avec Stéphane [Beaud] sur Sochaux, parce que s’y posait déjà la question des difficultés scolaires des enfants d’ouvriers et de leur lien avec leur entrée sur le marché du travail.
L’enquête collective à Amiens était dirigée par Alain Desrosières et Michel Gollac. Comment les as-tu rencontrés ?
Ma rencontre avec Desrosières a dû avoir lieu vers la fin des années 1970, juste après l’article que j’ai publié dans Critiques de l’économie politique sous le pseudonyme de Michel Mérignas, au sujet du livre de Donzelot[7]. Il m’en a fait un vif éloge, mais visiblement il ne se doutait pas que c’était moi qui l’avais écrit ! Donc je le lui ai dit, et nous avons plaisanté là-dessus. Par la suite, je le revoyais souvent quand il passait au CSE. On discutait beaucoup tous les deux des textes qui paraissaient dans Critiques de l’économie politique ou dans d’autres revues d’économie et de sociologie. Il y avait entre nous une forte sympathie qui passait par des petites discussions politiques. Et c’est comme ça qu’on en est venu à écrire en collaboration ce texte pour Critiques de l’économie politique, sur la base de l’enquête que nous avions effectuée à Amiens, avec une équipe composée de statisticiens et de sociologues. Mais on ne s’est plus beaucoup croisés par la suite, quand je me suis mis à enquêter à Sochaux et qu’on a tourné la page d’Amiens. Nous nous sommes quand même revus plusieurs fois, à l’INSEE, où j’allais de temps en temps puisque j’ai été pendant quelques années membre du comité de rédaction de Travail et Emploi, la revue du ministère du Travail. Quant à Gollac, je l’ai rencontré au CSE, quelques années avant Amiens. J’ai eu et j’ai toujours beaucoup de plaisir à le voir et à le lire.
J’ai trouvé dans les archives que tu m’as montrées un document rédigé par toi, datant de la fin des années 1970, où il est question d’une « réflexion engagée avec Desrosières et Gollac sur les statistiques et les classements sociaux », notamment dans le cadre d’un séminaire de Robert Linhart à l’ENS Ulm, en 1978-1979.Tu t’en souviens ?
Oui, je suis allé plusieurs fois à ce séminaire. Il devait y avoir Althusser d’ailleurs, qui assistait aux séances sans rien dire, en restant dans un coin. Je crois que j’ai dû intervenir en rapport avec mon premier article dans Actes. Et puis, comme j’étais au comité de rédaction de Critiques de l’économie politique, jusqu’en 1984, ça avait du sens pour moi d’aller à ce séminaire. Il y avait un tas de gens intéressants qui venaient y parler, par exemple Benjamin Coriat, Alain Lipietz et d’autres économistes.
En 1983, tu commences à enquêter à Sochaux. C’est un tournant dans ton parcours ?
Oui, parce qu’aller à Sochaux ça m’a permis d’avoir un « vrai » terrain. Quand j’y étais, je ne m’occupais que de mon travail. Là, c’était plus simple, je me disais sans arrêt : « Les ethnologues, quelle chance ils ont d’aller sur leur terrain plusieurs mois sans avoir rien d’autre à penser ! » Mais c’était sans doute une vue très idéalisée du travail de l’ethnologue…
À la même période, tu enseignes aussi, à côté de tes cours à Paris-V, au DEA de sciences sociales qui vient d’être créé en 1983 à l’ENS Ulm…
Oui, ça m’a beaucoup plu, ça ! Florence Weber, qui avait été mon étudiante à Paris-V, m’avait sollicité pour venir y enseigner. Mais je connaissais depuis longtemps Chamboredon, qui fut la principale cheville ouvrière de ce nouveau DEA. J’ai pris un grand plaisir à enseigner pendant plusieurs années dans ce cadre très informel, souple, où je n’avais qu’à parler librement des travaux des étudiants, réalisés dans le cadre d’un stage de terrain qui a eu lieu d’abord à Nemours, puis à Dreux, etc. Florence Weber avait fait appel à moi et à Bensa pour ce genre de choses. Moi, ça me changeait les idées et ça me confirmait dans mon envie de ne plus revenir sur ce que j’avais pu faire avant pour ma thèse ou sur Amiens. Je préférais aller à Sochaux et revenir chaque année à Nemours. Donc, entre ça, les deux années de détachement au CNRS que j’ai obtenues à la même période et mon travail avec Corouge à partir de 1983, j’ai pu rebondir et oublier ma thèse. Et surtout, c’est par ce biais que j’ai rencontré Stéphane [Beaud], en 1987. Il avait fait le stage de terrain à Nemours, son enquête portait sur les ouvriers d’une usine agroalimentaire des surgelés Picard. J’encadrais son mémoire de DEA, donc on avait travaillé ensemble sur ça. Puis, quelque temps après, il est venu me rejoindre à Sochaux. À partir de là, on n’a jamais cessé de travailler en étroite relation et, j’oserais dire, en très bonne harmonie. Chacun avait plus ou moins son domaine propre, qui recoupait souvent celui de l’autre (l’atelier/l’école, les vieux/les jeunes, les Français/les immigrés), et chacun avait sa manière de s’engager sur le terrain. Même si, bien sûr, nous avions une vision assez proche des transformations du monde ouvrier. Ces années passées à Sochaux avec Stéphane font partie des moments de bonheur dans ma carrière, ils ont beaucoup compté pour moi.
Dans ces années-là, il y a aussi des débats autour de Bourdieu, le plus connu étant celui que Grignon et Passeron ont initié au sujet de La Distinction[8]. Compte tenu de tes sujets de recherche, as-tu eu vent de ces critiques avant la parution de leur livre ?
Oui, bien sûr. Avant leur livre, j’avais lu une version ronéotée tirée de leur séminaire. Mais, pour ma part, je n’avais pas très envie d’entrer dans ces débats, j’en avais marre de tous ces débats ! C’est aussi peut-être parce que j’en avais assez que je suis passé à Corouge et à Sochaux. Moi, mon problème était de trouver un « vrai » terrain. Ce dont je souffrais, c’était de ne pas avoir un terrain à moi. Pour le reste, je ne me sentais pas la tête à « philosopher ». Je préférais me concentrer sur mon travail avec Corouge, parce que j’avais l’impression que travailler avec un gars comme ça, dont je savais un peu l’histoire, son expérience en tant qu’OS et en tant que syndicaliste qui se faisait matraquer, je sentais bien que ça avait un intérêt théorique. Quand, en 1983, j’ai commencé avec Corouge, j’ai été vraiment surpris par la violence de ce qu’il me racontait sur l’antisyndicalisme à Peugeot-Sochaux… et j’avais plus envie de parler d’analyses des économistes, sur la productivité ou sur le freinage ouvrier, que d’entrer dans d’autres débats. Je me suis mis à lire beaucoup de travaux sur le taylorisme, sur la robotique, sur l’informatisation de la production, sur les économistes de la régulation, etc. Toutes ces analyses-là m’intéressaient parce qu’elles étaient en relation avec ce dont les ouvriers de Peugeot me parlaient dans les entretiens. Et j’écoutais aussi Corouge me parler de ses rapports avec Pol Cèbe [le responsable culturel du comité d’entreprise de Peugeot-Sochaux] et avec les cinéastes [des groupes Medvedkine], de son rapport à la culture, de la fascination que ça représentait pour lui, puisque sa rencontre avec des intellectuels a été l’événement décisif de sa vie. Je l’enregistre et, même si à ce moment-là ce ne sont pas les choses qui m’intéressent le plus, je sais que de toute façon il faudra que je les évoque parce que ce serait inimaginable que je parle de lui sans parler de ça. Je comprends, à force de l’écouter, que la réflexion doit être menée simultanément sur la vie à l’intérieur de l’usine et sur ce qui se passe en dehors. À la fin des années 1990, nous avons repris en partie la même idée avec Armelle Gorgeu et René Mathieu, deux chercheurs qui m’ont beaucoup appris, lors d’une enquête comparative sur la filière automobile298 qui englobait un vaste ensemble de salariés employés par différentes entreprises et leurs sous-traitants.
Tu as donc été conduit, dans les années 1980, à te plonger dans la vaste littérature de la sociologie du travail ?
Oui, j’ai redécouvert tout cela pendant ma recherche sur Peugeot, parce que j’ai toujours été un peu décalé. Pendant les années 1970, je m’intéressais au logement, quand l’air du temps c’était de s’occuper du travail ouvrier et des usines. Et dans la décennie suivante, je me suis intéressé aux usines, au travail ouvrier, au freinage, alors que l’air du temps cela devenait plutôt le logement social, les « quartiers », la ségrégation urbaine, etc. J’ai toujours été un peu à contretemps, mais sans l’avoir voulu.
En même temps, on peut voir des continuités derrière ces changements de thèmes. Pas seulement sur la question de la domination, avec le cheminement qui te fait aller des cités de transit aux usines. Mais une autre continuité, autour de la question des positions sociales instables, brouillées, frontalières, comme c’est le cas de Corouge…
Oui, c’est très juste. Et cela renvoie sans doute à mon histoire personnelle…
Propos recueillis par Paul Pasquali.
Notes
[1] Edward P. Thompson, The Making of the English Working Class, Londres, Victor Gollancz Ltd, 1963.
[2] Cornelius Castoriadis, « La question de l’histoire du mouvement ouvrier », in L’Expérience du mouvement ouvrier, 1, Paris, UGE, 10-18, 1974, p. 21 et 84-89.
[3] Pierre Bourdieu, « Les sous-prolétaires algériens», Les Temps modernes, 12, 1962, repris dans P. Bourdieu, Esquisses algériennes, Paris, Seuil, 2008. Voir aussi P. Bourdieu, Algérie 60, Paris, Minuit, 1977.
[4] Voir le chapitre 2 du présent ouvrage, qui réunit ces deux textes en un seul (p. 43-109).
[5] Voir le chapitre 8 du présent ouvrage, p. 301-328.
[6] Voir le chapitre 7 du présent ouvrage, p. 271-300.
[7] Voir le chapitre 5 du présent ouvrage, p. 167-200.
[8] Voir Claude Grignon et Jean-Claude Passeron, Le Savant et le Populaire, Paris, EHESS- Seuil-Gallimard, 1989 et Pierre Bourdieu, La Distinction, Paris, Minuit, 1979.




