Agenda militant
Ailleurs sur le Web
![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)
- Au cœur du capital (12/03)
- Le débat des représentants des partis, avec Paul Vannier (12/03)
- Meeting avec Bagayoko, Coquerel et Mélenchon à Saint-Denis ! (11/03)
- Ludivine Bantigny, "La Bourse ou la vie. Le Front populaire, histoire pour aujourd’hui" (11/03)
- C’est quoi le "marxisme classique" et le "marxisme occidental" ? (10/03)
- “Le socialisme est la maison commune de tous les combats justes.” – Entretien avec Joseph Andras (10/03)
- Sur Franceinfo : Brigitte Boucher et les irresponsables (10/03)
- Ce que révèle l’affaire Epstein (10/03)
- Au Liban, d’une guerre coloniale à l’autre et du droit de résister (10/03)
- POUR UN FRONT ANTIFASCISTE AU SECOND TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES (10/03)
- Meeting de la campagne municipale LFI à Lille (10/03)
- Meeting avec Jean-Luc Mélenchon et Sophia Chikirou à Paris ! (09/03)
- Colombie : la gauche de Gustavo Petro valide le dernier test des législatives avant la présidentielle (09/03)
- Penser l’émancipation autrement, discuter l’apport de marxistes hétérodoxes [Podcast] (09/03)
- Terrorisme d’Ultra-droite (08/03)
- "L’Iran est sur le point d’obtenir l’arme nucléaire" : trente ans de prophéties démenties (08/03)
- Hommage au chercheur marxiste Michael Parenti – Compilation d’entretiens (08/03)
- La guerre de trop : les Américains et les Israéliens n’ont rien compris à l’Iran ! (08/03)
- Poutou annonce un probable soutien du NPA-A à Mélenchon en 2027 (07/03)
- Attaques en série contre LFI (07/03)
- Des maires insoumis pour tout changer | Clip officiel - Municipales 2026 (07/03)
- Romaric Godin : "La force fondamentale du capitalisme le pousse vers le néofascisme" (07/03)
- Quentin Deranque était en première ligne dans la bagarre (06/03)
- Tirer une balle dans la tête sans intention de donner la mort (06/03)
- Les États-Unis et Israël nous entraînent dans une barbarie suicidaire (06/03)
Liens
Livre-débat: «A la prochaine: De Mai 68 aux Gilets jaunes»
Ces articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » sont publiés à titre d'information et n'engagent pas la Tendance CLAIRE.
https://alencontre.org/debats/livre-debat-a-la-prochaine-de-mai-68-aux-gilets-jaunes.html
Par Alain Bihr
L’année 2018 allait s’achever sans que le cinquantenaire des événements de mai-juin 1968 n’ait particulièrement retenu l’attention, au-delà de quelques cercles limités d’historiens du temps présent et des rangs (déjà bien clairsemés) des désormais vieux soixante-huitards, sans surtout que son écho n’ait retenti dans l’actualité des luttes sociales. Et puis vinrent les «gilets jaunes» (GJ) qui allaient reposer à nouveaux frais quelques-unes des questions soulevées cinquante ans auparavant et restées pour certaines en suspens depuis, tout en en formulant quelques nouvelles. C’est de cet improbable télescopage dont traite le dernier ouvrage de Pierre Cours-Salies, dont il s’agit ici de discuter les thèses au fil des pages qui les exposent: A la prochaine… De Mai 68 aux Gilets jaunes (Ed. Syllepse, décembre 2019)
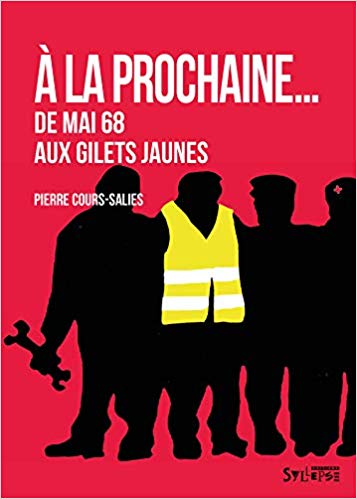
Un riche héritage
Dans son retour sur Mai 68, Pierre Cours-Salies prend bien soin de considérer que ce dernier ne se réduit ni aux événements parisiens ni à mai-juin 1968 stricto sensu [1]. Il rappelle la dimension véritablement mondiale des mobilisations étudiantes qui ont marqué (et souvent endeuillé) aussi bien Varsovie et Prague, Mexico, Cordoba, Dakar, Le Caire et Islamabad que Paris, Berlin, Amsterdam, Bruxelles, Rome, Madrid, New York et Berkely ou Tokyo. Il rappelle aussi l’onde de choc des grèves ouvrières (en France mais aussi en Italie, en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux États-Unis) qui, partie d’une révolte des OS contre la barbarie tayloriste, s’élèvera dans les années suivantes jusqu’à l’élaboration et la défense de contre-plans pour la reconversion de l’appareil militaro-industriel destinés à préserver les emplois (en Grande-Bretagne) ou se fourvoiera, pour une part, dans la lutte armée (en Italie et en Allemagne) ; tandis que, simultanément, en coulisses, des intellectuels organiques d’une bourgeoisie en voie de transnationalisation, réunis dans la Société du Mont-Pèlerin et la Commission trilatérale, prépareront la contre-révolution néolibérale à laquelle le Chili de Pinochet servira de banc d’essai (pages 110-114).
La première partie de l’ouvrage est ainsi consacrée à la revue d’un certain nombre de revendications, propositions, éléments programmatiques ou même projets politiques formulés, soutenus et défendus par le mouvement de Mai 68 pour en souligner mais aussi en discuter l’actualité au vu de ce que le capitalisme est devenu entre-temps. Sont ainsi successivement revisités la problématique écologique (Chapitre 1 et Chapitre 4) alors présente sous la forme de la critique du consumérisme, des atteintes de la santé au travail, de la destruction de l’agriculture paysanne, du nucléaire, du fétichisme de la technique, etc.; la revendication de « travailler moins pour travailler tous » (Chapitre 2): la nécessité et la possibilité de diminuer drastiquement le temps de travail (journalier, hebdomadaire, annuel, etc.) pour fournir un emploi à tous tout en modifiant le contenu du travail: donc se libérer du travail autant que se libérer dans le travail; ce qui mène logiquement à l’une des aspirations phares de Mai 68: l’autogestion (Chapitre 3), non seulement sur les lieux de travail et de production mais étendue à la société entière (l’autogestion généralisée), supposant la réappropriation de ses «communs» fondamentaux que sont les moyens sociaux de production et l’élaboration d’une planification démocratique de la production socialisée, du métabolisme entre société et nature ; la solidarité internationale et même internationaliste, les mobilisations contre la guerre, la lutte pour la paix et le désarmement, centrées à l’époque sur la guerre impérialiste états-unienne au Vietnam (Chapitre 4 et Chapitre 5) ; le contrôle des activités des entreprises multinationales, désormais transnationales même, qui constituent de véritables oligopoles mondiaux (Chapitre 4) ; le mouvement antiraciste, dont le fer de lance est alors constitué par les mobilisations antiségrégationnistes aux États-Unis (Chapitre 5).
Dans cette revue, il faut regretter toutefois un oubli de taille: la (ré)émergence dans le cours et le fil de Mai 68 d’un mouvement féministe avec la constitution du Mouvement de libération des femmes (MLF) en 1970 et celle Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception (MLAC) en 1973, qui va rapidement remporter une importante victoire avec la légalisation de l’avortement (1975); Pierre Cours-Salies en fera cependant état par la suite. Au titre de l’héritage de Mai 68, il ne signale pas non plus l’émergence des revendications de libre orientation sexuelle avec la formation du Front homosexuel d’action révolutionnaire (FHAR) fondé en 1971.
Derrière les « Trente Glorieuses », le fordisme
Dans les deuxième et troisième parties, Pierre Cours-Salies revient sur quelques questions pendantes à propos des événements de mai et juin 1968 eux-mêmes. Et, pour commencer, quelles ont été les origines immédiates du mouvement ou plutôt des deux mouvements qui se sont conjoints, pour partie seulement: la grève générale ouvrière et la contestation étudiante ? Pierre Cours-Salies en traite dans le Chapitre 7, en les inscrivant l’un et l’autre dans la dynamique dans laquelle le « néocapitalisme » (ainsi qu’on en parle à l’époque) est engagé depuis les lendemains de la Libération.
On peut cependant émettre quelques réserves quant à la manière dont il analyse cette dynamique. Il a certes raison de dénoncer la dénomination de «Trente Glorieuses» proposée par Jean Fourastié pour désigner l’époque et sa tonalité dominante. Les trente années séparant la fin de la guerre de l’ouverture d’une nouvelle crise structurelle au milieu des années 1970 n’ont guère été glorieuses que pour le capital, qui a semblé alors avoir trouvé une formule magique libérant son accumulation de ses contradictions et limites antérieures. Mais l’expression masque évidemment de quel coût ces trois décennies de «croissance» quasi continue ont été payées : coût social en termes d’intensification d’un travail parcellisé, condamnant celles et ceux qui l’ont subi à «perdre leur vie à la gagner», ainsi qu’en termes de plongée de la vie sociale et personnelle dans un consumérisme réduisant l’être (la qualité de la vie, la richesse des relations sociales) à l’avoir (l’accumulation de moyens de consommation, dont la futilité et la médiocrité étaient corrélées à leur multiplication); coût écologique, surtout, dont la conscience ne faisait qu’affleurer mais dont nous mesurons et payons aujourd’hui le prix amer.
Je serai plus réservé, par contre, dans la récusation par Pierre Cours-Salies, du concept de fordisme pour rendre compte de la dynamique génératrice des événements de mai-juin 1968. Les arguments dont il se sert à cette fin paraissent faibles. La persistance d’une intense exploitation? Cela fait précisément partie intégrante du fordisme côté usine, sous l’effet de la parcellisation et de la mécanisation du travail d’exécution, qu’il s’agisse de l’atelier ou du bureau. La persistance et même l’aggravation des inégalités de revenu? Sans doute, mais elles n’auront pas empêché l’augmentation absolue sinon relative des salaires réels des ouvriers et employés, synonyme de hausse de leur pouvoir d’achat et d’amélioration de leurs conditions d’existence. Surtout, ces arguments ne touchent pas au cœur du concept de fordisme, qu’il s’agisse de la corrélation de la hausse des salaires (réels, directs et indirects) avec les gains de productivité qui est au principe de la formule magique précédemment évoquée; qu’il s’agisse encore de la socialisation du salaire sous la forme de l’«État-providence» et, plus largement, d’un ensemble d’équipements collectifs et de services publics comme condition de la reproduction de la force de travail; qu’il s’agisse enfin de la tentative d’inscrire le rapport entre capital et travail dans une logique de compromis, que la poursuite inévitable de la lutte de classes compromet sans cesse.
La grève générale de mai-juin 1968 n’aurait pas pu avoir lieu sans toute cette dynamique fordiste antérieure. Pierre Cours-Salies rappelle à juste titre l’importance de l’accord d’unité d’action conclu entre la CGT et la jeune CFDT courant 1966 qui aura incontestablement renforce la confiance en soi du monde ouvrier et, par conséquent, son potentiel de conflictualité. Mais la forte progression des grèves dans les deux années qui ont précédé l’explosion de mai-juin 1968 (aux chantiers navals de Saint-Nazaire, à la Rhodiaceta à Besançon, chez Berliet et à la Saviem, dans la métallurgie mulhousienne, etc.) s’explique surtout par la constitution de véritables «forteresses ouvrières», procédant de la massification de la force de travail prolétaire, au double sens de sa concentration spatiale et de son uniformisation, autant de rançons de la taylorisation et de la mécanisation inhérente à la dynamique fordiste. Ce seront aussi ces mêmes forteresses qui seront le fer de lance des luttes en mai-juin 1968. Et le mouvement étudiant ne s’enracine pas moins dans la dynamique fordiste; car le même procès fordiste de production qui réduit le travail ouvrier et employé à des tâches parcellisées et mécanisées fait naître un travail d’encadrement, lui-même divisé et hiérarchisé, qui suppose la formation et qualification de cohortes de techniciens, ingénieurs, comptables, cadres commerciaux, publicitaires, etc., au sein de l’université, d’écoles d’ingénieurs et autres institutions d’enseignement supérieur, sans compter les lycées en amont. D’où une première vague de «démocratisation» mais aussi de «massification» (l’une et l’autre relatives à l’état antérieur) de l’enseignement secondaire et supérieur qui va permettre aux premières générations de fils et filles de paysans, d’ouvriers, d’employés d’accéder au lycée et à l’université.
Surtout, l’un et l’autre de ces mouvements s’expliquent par les contradictions spécifiques à cette dynamique fordiste. Comment par exemple reproduire le régime de caserne à l’usine, où l’ouvrier-masse est en proie au caporalisme des petits chefs (d’atelier, d’équipe) et des chronométreurs et autres «chiens de garde» des bureaux de méthodes, tandis que, côté supermarché et médias, le fordisme ne lui parle que de liberté de choix et d’exaltation de l’existence dans la fébrilité de la consommation marchande? La révolte des OS comme les aspirations au «contrôle ouvrier» sur les conditions de travail dans l’atelier, bientôt suivies des aspirations au «pouvoir ouvrier», y plongeront leurs racines. De même, l’inadaptation des contenus et des méthodes d’enseignement secondaire et supérieur relativement aux attentes et aspirations des jeunes issus des classes populaires n’est certainement pas étrangère à leur entrée en contestation de ces mêmes éléments et à l’adaptation enthousiaste par elles de courants idéologiques issus des œuvres de Marx et de Freud, qui donnera sa couleur si particulière à Mai 68.
«Une situation révolutionnaire sans révolution?»
Autre question d’importance: en mai-juin 1968, «le pouvoir était-il à prendre?» Question sur laquelle Pierre Cours-Salies ne revient pas moins de quatre fois, au fil des Chapitres 6, 8, 9 et 11. Indice de la difficulté qu’il éprouve à préciser sa pensée sur ce point, tout en fournissant pourtant des éléments propres à démêler une question complexe parce que multivoque. Car tout dépend de ce qu’on entend par pouvoir.
Si la question est de savoir s’il était possible en mai-juin 1968 pour la gauche gouvernementale de l’époque (le Parti communiste, la Fédération de la gauche démocrate et socialiste [2] (FGDS) et le Parti socialiste unifié [3]) de chasser de Gaulle du pouvoir, la réponse est oui pour Pierre Cours-Salies: sous la pression des grèves et des occupations d’usines et sous la poussée de la contestation étudiante, il aurait été possible d’imposer un gouvernement provisoire que seraient venues sanctionner ultérieurement des élections.
Mais, on le sait, la chose ne s’est pas faite. Pierre Cours-Salies l’explique de la manière suivante. Désemparé par une situation ne répondant absolument pas à ses attentes et à sa stratégie (il n’entendait accéder au pouvoir qu’à la suite d’une victoire électorale sur la base d’un programme commun de gouvernement dûment négocié au préalable), le PC n’en a pas voulu, par crainte de ne pas peser suffisamment dans la coalition et surtout par peur d’être débordé par des masses en lutte, de devoir gérer en somme une situation prérévolutionnaire, en agitant le spectre de la guerre civile pour se justifier. Et, de leur côté, la FGDS et consorts n’ont pas pu ou su passer outre, au-delà du meeting de Charléty du 27 mai qui en a exposé le projet et amorcé la réalisation, avant d’être mis au pied du mur par un de Gaulle revenant dans le jeu politique en dissolvant l’Assemblée nationale trois jours plus tard.
Ce faisant, le PC aura d’ailleurs placé la CGT dans une position très inconfortable, l’obligeant à la fois à suivre en partie une base très revendicative, convaincue qu’on pouvait faire tomber le gouvernement («Dix ans, ça suffit!») et contraindre le patronat à des concessions majeures, et inversement à freiner le mouvement et finalement l’arrêter pour ne pas placer le PC face à une situation sortant de ses schémas stratégiques; d’où le revirement de la CGT au cours des négociations poursuivies à Grenelle (la conduisant à abandonner plusieurs revendications d’importance, telles l’abrogation des ordonnances sur la Sécurité sociale adoptées l’année précédente et «l’échelle mobile des salaires», indexant ces derniers sur l’inflation) et l’épisode des sifflets de Billancourt (Renault), sur lequel Pierre Cours-Salies revient longuement (pages 183-187). Surtout, compromettant un crédit déjà largement entamé par son soutien quasi inconditionnel au «socialisme réellement existant», dont l’inexistence se révélait sans cesse davantage, le PCF s’est alors condamné à un lent déclin qui s’est précipité à partir de la seconde moitié de la décennie suivante [4].
Si mai-juin 68 a incontestablement constitué une grave crise de régime voire présenté des prémices de crise de l’État (avec des hauts fonctionnaires et des préfets n’obéissant plus aux gouvernants et faisant allégeance aux forces de gauche, cherchant pour certains à s’entendre avec les contestataires), a-t-il pour autant réuni les conditions d’une crise révolutionnaire? Comme certains des protagonistes des événements, Pierre Cours-Salies semble le penser: les potentialités révolutionnaires de ces événements auraient pu se développer précisément à la faveur de l’arrivée au pouvoir des forces de gauche; et c’est d’ailleurs cette perspective qui aurait effrayé le PC. « Il est alors possible de défendre une stratégie d’évolution révolutionnaire, avec des instances politiques, tel un gouvernement des travailleurs ou un gouvernement des organisations (politiques et syndicales, ouvrières et de jeunesse) placées sous le contrôle démocratique des comités de grève et de diverses assemblées locales » (page 264).
Et il en veut pour preuve la dynamique du mouvement au cours des années suivantes, qui va se traduire par une généralisation de la contestation à laquelle aucune des structures de pouvoir ne va échapper au sein de la société française, aboutissant souvent à faire naître des situations au moins temporaires de contre-pouvoir, dont il donne de nombreux exemples: les occupations d’usines (Lip – juin 1973 – ne sera que le point d’orgue d’un mouvement qui culminera alors avec l’occupation de quelque deux cents usines), les liens établis entre entreprises en lutte et les paysans travailleurs, la grève des loyers dans les foyers de travailleurs immigrés, l’occupation du Larzac, la constitution du MLAC et l’action en vue de la légalisation de l’avortement (déjà mentionnées), les Comités d’action lycéens et le mouvement des lycéens contre la loi Debré en 1973, la constitution des comités de soldats à partir de 1974, la formation du Syndicat de la magistrature (en juin 1968), les Comités d’action des prisonniers, le mouvement antinucléaire, etc. (pages 268-293).
Cette dynamique n’a cependant pas abouti à une rupture révolutionnaire, conduisant Pierre Cours-Salies à se rallier au diagnostic d’Henri Lefebvre à propos de Mai 68: «une situation révolutionnaire sans révolution» [5]. Pourquoi? Pour Pierre Cours-Salies, au fur et à mesure où les contestations à la base échouaient, les formations gauchistes se sont avérées incapables de coopérer entre elles, en restant prisonnières de leur concurrence avant-gardiste, tandis que les espoirs de transformation politique se sont reportés sur la gauche de gouvernement, d’abord unie par un Programme commun (conclu en 1972) puis désunie à partir de 1977, au sein de laquelle le PS, renforcé par une partie du PSU et appuyé par l’aile majoritaire au sein de la CFDT (qui allait imposer un sévère virage à droite à cette dernière à partir de 1978-1979), prenait l’ascendant sur le PC, le tout ouvrant la voie à la victoire électorale de mai-juin 1981, mais aussi au revirement néolibéral qui allait s’ensuivre dès 1983. (cf. pages 283-289).
Une interprétation différente, esquissant une autre réponse à cette seconde question, partira de la célèbre formule léniniste, qu’évoque d’ailleurs Pierre Cours-Salies: une situation révolutionnaire se produit quand ceux d’en bas ne veulent plus être dominés comme auparavant, tandis que ceux d’en haut ne peuvent plus dominer comme auparavant. Qu’en était-il en mai-juin 1968 et dans les années suivantes? Incontestablement, ceux d’en bas (le prolétariat ouvrier et employé, le mouvement étudiant en lien ou non avec le précédent) ne souffraient plus d’être dominés dans le cadre de rapports marqués au coin d’un paternalisme conjuguant patronat de droit divin refusant toute forme de contestation de son pouvoir, familialisme et ordre moral, sclérose d’institutions scolaires et universitaires datant d’une époque révolue où elles étaient dédiées aux seuls enfants des bonnes familles bourgeoises, le tout symbolisé par la figure tutélaire du général de Gaulle au verbe académique, alors que la dynamique fordiste ouvrait de nouvelles possibilités en termes d’émancipation individuelle, notamment du côté des femmes et des jeunes, et exigeait que soient instituées des structures de concertation entre capital et travail, tant au sein des entreprises qu’au niveau de l’État.
Jacques Chaban-Delmas et Jacques Delors
Mais qu’en étaient-ils pour ceux d’en haut (la bourgeoisie, de plus en plus composite, et ses représentants politiques, concentrés au sein de l’Union pour la défense de la République gaulliste et des Républicains indépendants giscardiens)? Si une partie n’envisageait pas d’abandonner les anciennes formes de son pouvoir, une autre avait parfaitement compris que celles-ci avaient fait leur temps et demandaient à être remplacées par d’autres, s’inscrivant dans la dynamique fordiste ou poussant même déjà au-delà de celle-ci. D’où, dans les années suivantes, les expériences d’«élargissement» et d’«enrichissement» des tâches le long des chaînes taylorisées et mécanisées, propres à récupérer en partie les aspirations ouvrières au contrôle de la production, tandis que, une fois de Gaulle renvoyé à Collombey-les-Deux Eglises (avril 1969), le tandem Chaban-Delors [6] développera entre 1969 et 1972 son projet de «Nouvelle société», impliquant la généralisation du «dialogue entre partenaires sociaux» et une modernisation de l’appareil d’État passant par la décentralisation et la déconcentration, impliquant davantage d’autonomie pour les services publics. Innovations dont la hardiesse se paiera du prix d’un retour en grâce des partisans de l’ordre ancien, sous la férule du trio Messmer [7]– Royer [8]–Marcellin [9].
Surtout, à partir du déclenchement de la crise structurelle du régime fordiste de reproduction du capital au milieu des années 1970, tant par ses innovations dans le mode d’exploitation et de domination directe du capital sur le travail au sein des entreprises donnant naissance à «l’usine fluide, flexible, diffuse et nomade» que par la mise en œuvre des politiques néolibérales de libéralisation et de déréglementation des marchés, la bourgeoisie (et notamment sa fraction en cours de transnationalisation) allait montrer qu’elle disposait de solutions de rechange parfaitement efficaces pour remplacer non seulement ses formes préfordistes de domination mais ses formes proprement fordistes [10]. En somme, si en mai-juin 1968 et dans les années suivantes, en France, la première des deux conditions d’une crise révolutionnaire a bien été remplie, au moins en partie, on ne peut pas en dire autant pour la seconde. Autrement dit, il ne s’est pas agi d’une crise révolutionnaire et cela explique, indépendamment du jeu des appareils politiques et syndicaux qui n’ont rien arrangé et de manière plus décisive que ces derniers, pourquoi la révolution n’y a finalement pas eu lieu.
Drapeaux rouges et gilets jaunes, même combat?
La dernière partie et la conclusion de l’ouvrage sont consacrées à une analyse du mouvement des GJ (Gilets jaunes), de ses ressemblances et différences, continuités et discontinuités avec Mai 68. Car le rapprochement entre les deux mouvements n’a rien d’évident a priori.
Certes quelques similitudes entre les deux sautent immédiatement aux yeux. Dans les deux cas, le mouvement a fait événement, au sens où il était parfaitement inattendu et a surpris à peu près tout le monde, comme il est d’usage pour les explosions sociales, résolutions brusques de tensions acculées au fil de décennies. Dans les deux cas aussi, partie de la base sociale, l’irruption a immédiatement visé le sommet de l’appareil d’État, le slogan «Macron démission!» renvoyant au «Au revoir, de Gaulle, au revoir!» et «Dix ans, ça suffit!» scandé en mai: dans le cas de Macron, dix-huit mois auront suffi… Enfin, bien évidemment, il s’est agi d’une révolte populaire, prenant par moments des allures d’émeute, agitant par conséquent le spectre de la révolution.
Mais, à partir de là, ce sont les écarts entre les deux mouvements qui s’imposent. Et d’abord, si le peuple est à la manœuvre dans les deux cas, il ne s’agit pas du même peuple. Ce qui, au demeurant, n’a rien d’étonnant: la France et le monde ont bien changé au cours du demi-siècle écoulé depuis 1968.
Différentes enquêtes sur le peuple des ronds points occupés par les GJ nous ont rapidement renseigné sur sa sociologie, dont Pierre Cours-Salies condense sommairement les résultats: sous-représentation des cadres et des professions intermédiaire, surreprésentation des ouvriers et employés mais aussi des retraités; sous-représentation des diplômés de l’enseignement supérieur et surreprésentation des titulaires d’un CAP ou d’un BEP mais aussi d’un baccalauréat; des niveaux de revenus faibles (10% disposent d’un revenu par ménage inférieur à 800 €, pour une moyenne qui s’établit à 1700 €); un peu plus d’hommes que de femmes (54 % contre 46 %), mais celles-ci souvent plus engagées que ceux-là; enfin, un peuple un peu plus âgé en moyenne que l’ensemble de la population française du fait d’une sous-représentation des jeunes. Bref, en majorité, des membres des couches inférieures du prolétariat, dont bon nombre en situation de précarité et de chômage, souvent en incapacité de mener une lutte sur leurs lieux de travail (par isolement, manque d’expérience ou d’encadrement syndical, ressources économiques insuffisantes), auxquels les mobilisations sur, autour et à partir des ronds-points servent de substitut (pages 307-308).
Pierre Cours-Salies y retrouve ce qu’il appelle le «bas de l’échelle», auquel il a consacré antérieurement une étude [11], regroupant chômeurs, salariés précaires (sur contrat à durée déterminé, intérimaires, personnes sur emplois aidés), titulaires de minima sociaux (revenu de solidarité active, allocation spéciale de solidarité, minimum vieillesse, etc.) qui représentent quelque dix millions de personnes en France sur un total de vingt-sept millions d’actifs, soit quelque 37 % de la population active actuelle. Auxquels il faut ajouter les salariés des petites et moyennes entreprises (PME), souvent en situation de sous-traitance de grandes entreprises, dont la situation économique est rien moins que garantie, par conséquent eux aussi victimes d’une insécurité sociale grandissante, pour compléter le tableau noir du salariat contemporain que Pierre Cours-Salies nous brosse (pages 309-312).
Mais, du même coup, la différence dans la composition sociale des deux mouvements qu’il rapproche l’un de l’autre saute aux yeux. En mai-juin 1968, le mouvement est porté par le noyau d’un prolétariat (plus largement d’un salariat), concentré dans les « forteresses ouvrières » qu’a fait naître le fordisme, qui n’est pas encore menacé par le chômage et la précarité: on compte alors à peine quelque 260’000 chômeurs, représentant tout juste 1,3% de la population active, bien que le chômage soit en hausse depuis le milieu de la décennie [12]; et le travail précaire reste marginal [13]. Et le monde étudiant, dont la mobilisation vient renforcer celle de ce noyau prolétariat, ne craint alors nullement le chômage et la précarité, assuré au contraire de pouvoir s’intégrer pour une bonne part dans les couches moyennes du salariat.
Le mouvement des GJ, au contraire, a résulté de la mobilisation des zones périphérisées voire marginalisées du prolétariat (pensons aux auto-entrepreneurs et autres ubérisés, victimes de formes de salariat déguisé en travail indépendant, cumulant les contraintes de l’un et de l’autre sans en retirer aucun des avantages), fruit amer d’un éclatement du prolétariat directement orchestré par la mise en œuvre, à partir des années 1970, du paradigme de «l’usine fluide, flexible, diffuse et nomade» et des politiques néolibérales de libéralisation et de déréglementation des marchés, précédemment évoqués: elle a conduit à multiplier, autour d’un noyau de salariat stable restreint, les multiples formes de travail précaire et de situations économiques génératrices d’insécurité, pour la partie du salariat chargé d’assurer la flexibilité du capital le long de «chaînes de valeur» désormais transnationalisées. Le tout sur fond d’un fort taux de chômage structurel, permettant à «l’armée industrielle de réserve» ainsi gonflée de remplir sa fonction disciplinaire à l’égard de «l’armée active» qu’elle menace en permanence de remplacer, selon un mécanisme déjà parfaitement analysé par Marx [14].
Du coup s’explique aussi deux autres différences importantes entre le mouvement de mai-juin 1968 et celui des GJ. D’une part, leurs modes de mobilisation: alors qu’il y a cinquante ans, le mouvement était fortement encadré par les organisations syndicales (qui, si elles ne l’ont pas lancé, ont été malgré tout en mesure de le canaliser et le faire cesser, non sans mal quelquefois cependant), les GJ se sont rassemblés et organisés par l’intermédiaire des soi-disant « réseaux sociaux » (Facebook en priorité) et n’ont pas trouvé, au moins immédiatement, des relais pas plus que des garde-fous dans les organisations syndicales. Tout simplement parce que celles-ci sont largement absentes des espaces de travail dans lesquels opèrent (quand ils opèrent…) les périphéries et marges actuelles du salariat. Mais aussi parce que les GJ ont, originellement au moins, manifesté une lourde défiance entre les organisations syndicales et plus encore politiques, par peur de la récupération mais aussi par souvenir sans doute des trahisons, impuissances, maladresses, atermoiements de la gauche gouvernementale, non seulement entre 1995 et 2017 comme le relève Pierre Cours-Salies (pages 313-317) mais plus largement depuis le début des années 1980. Défiance renforcée d’ailleurs par une défiance réciproque de la part des principales organisations syndicales de gauche (CGT, FSU, Solidaires).
S’expliquent aussi, d’autre part, les différences notables et souvent notées dans les revendications et les objectifs des deux mouvements. En mai-juin 1968, on se met en grève et on manifeste pour des augmentations de salaire (notamment celle du salaire minimum interprofessionnel garanti, le Smig), des conditions de travail (la réduction de la durée et de l’intensité du travail: pour la semaine de quarante heures payées quarante-six, contre «les cadences infernales») et la reconnaissance du fait syndical dans l’entreprise: les acquis du mouvement portent d’ailleurs sur ces trois points, autant de dimensions du rapport salarial direct. Parmi les GJ, au contraire, se sont fait entendre des revendications et des objectifs qui concernent surtout le salaire indirect [15]: il y a été question de revalorisation immédiate des bas salaires certes mais aussi et surtout des prestations sociales, notamment des minimas sociaux; de maintien et de renforcement des services publics et des équipements collectifs, notamment en matière de logement, de transport, de santé et d’éducation; enfin de justice fiscale («faire payer les riches») pour dégager les recettes permettant de financer les dépenses qu’impliquent les objectifs précédents.
Cela renvoie évidemment au fait que les périphéries et les marges du salariat sont particulièrement sensibles aux différents aspects du salaire indirect, dont leur précarité les rend précisément dépendants et d’autant plus dépendants qu’ils sont plus précaires. Mais cela s’explique aussi par le fait qu’après s’en être pris principalement au salaire direct par le biais de la mise en œuvre du paradigme de « l’usine fluide, flexible, diffuse et nomade » et des politiques de déréglementation et de libéralisation de la circulation du capital, les politiques néolibérales ont ciblé au cours de ces deux dernières décennies, et plus particulièrement depuis les lendemains de la crise financière de 2007-2008 (crise dite des subprime), les différents aspects du salaire indirect (ou socialisé), poursuivant ainsi l’œuvre de destruction systématique du rapport salarial fordiste entamé à la fin des années 1970 [16]. Et l’actuelle «réforme des régimes de retraite» n’en est que le dernier épisode en date. Dans cette mesure même, les GJ sont la rançon des politiques néolibérales non seulement par leur composition sociale mais encore par leur contenu revendicatif.
Vers un nouveau bloc historique?
Pourtant, en dépit de ces différences et divergences dont la gauche syndicale et politique hérite aujourd’hui, entre sa «vieille garde rouge» et sa «jeune garde jaune», rien ne condamne les deux a continué à se regarder en chiens de faïence. Pierre Cours-Salies a raison, au contraire, de souligner la possibilité, la nécessité et même l’urgence d’un rapprochement et même d’une fusion entre les deux, de manière à faire émerger un nouveau « bloc historique » (page 324) capable de renverser «l’hégémonie bourgeoise» aujourd’hui (page 322). De pareilles convergences se sont d’ailleurs dessinées au cours des derniers mois et se concrétisent aujourd’hui même dans les cortèges mobilisés contre le projet de «réforme des régimes de retraite». Dans la dernière partie et la conclusion, Pierre Cours-Salies s’attache donc également à définir, dans leurs grandes lignes, sur quelles bases un tel bloc pourrait se constituer.
Il le tente en partant des revendications cardinales formulées par les GJ auxquelles la gauche traditionnelle peut et doit répondre en les faisant siennes, tant elles poursuivent et actualisent une bonne partie de son propre héritage, dont celui de Mai 68. Car, passé le premier moment de ras-le-bol fiscal à la suite de l’instauration de la taxe sur les carburants qui a mis le feu au pouvoir (ce qui a fait parler de poujadisme ou de «populisme») et quelques échos de relents xénophobes ou racistes, les GJ ont fait entendre, selon Pierre Cours-Salies, des revendications fortes notamment dans les documents adoptés à la suite des Assemblées des assemblées (qui se sont tenues à Commercy les 26 et 27 janvier 2019, à Saint-Nazaire les 5 et 6 avril 2019 et à Montceau-les-Mines les 28-30 juin 2019) qui laissent apparaître deux axes susceptibles de rapprocher GJ et luttes syndicales et politiques traditionnelles et de jeter ainsi les bases de ce nouveau bloc historique qu’il appelle de ses vœux.
En premier lieu, la proclamation d’un ensemble des droits propres à redéfinir la condition salariale: «le droit au salaire à vie, le droit au travail et le droit à la formation» (page 321). Une revendication de grande portée, puisqu’elle implique notamment le droit à changer d’entreprise et d’occupation professionnelle, en se voyant garantir son reclassement par un fonds abondé par des cotisations sociales, mettant les entreprises à contribution en due proportion de la valeur ajoutée qu’elle génère (ibidem et page 323); mais aussi une réduction massive du temps de travail de manière à fournir un emploi à tout le monde (page 357, page 372) et à «libérer le plus possible le non-travail» (page 388); et un dépassement tendanciel de la division sociale du travail marchant de pair avec l’autogestion des unités de production (page 359), partant de nouvelles formes d’organisation du travail (page 368).
Revendication en fait proprement révolutionnaire, qui suppose de mettre fin à la transformation de la force de travail en marchandise et, partant, à l’expropriation des producteurs qui en est la condition: en somme, de mettre fin au capital comme rapport social de production, et du même coup non pas de redéfinir la condition salariale mais bien de l’abolir. Car exiger le droit au travail sous le régime du capital revient à exiger la liberté sous le régime de l’esclavage: une contradiction dans les termes. Un pareil droit est en effet incompatible avec ce rapport social de production dans lequel les moyens sociaux de production sont la propriété d’une classe sociale qui décide de leur usage ou non-usage en fonction des seules nécessités et possibilités de valoriser ainsi l’argent avancé dans l’acquisition de ces moyens et des forces de travail qui les mettront en œuvre. Ce que Pierre Cours-Salies ne souligne pas assez me semble-t-il, même s’il l’indique en passant (pages 393-394, page 410, page 415), sans préciser comment une telle réappropriation des moyens sociaux de production, qui équivaudrait à «une expropriation des expropriateurs», peut avoir lieu dans les conditions actuelles.
Le mouvement des GJ a été, en second lieu, porteur d’une exigence forte d’élargissement et d’approfondissement de la démocratie. Élargissement en ce qu’elle doit pouvoir s’étendre à tous les domaines de la vie collective: «que les questions majeures soient discutées devant toutes et tous, par toutes et tous » (page 396), en promouvant du coup toute une série de nouveaux droits: «droit à l’égalité entre les hommes et les femmes; droit politique pour tou-tes les résident·e·s; droit de contrôle et de décision des travailleur-euses sur l’organisation des tâches deproduction; droit au logement ; droit au contrôle sur les productions agricoles et développement des “circuits courts”… » (page 323).
 Et, simultanément, cet élargissement à des contenus nouveaux doit s’accompagner d’un approfondissement dans le sens d’une exigence de «radicalement démocratiser la démocratie» (page 392): de l’instauration de formes de démocratie directe et continue (démocratie d’assemblée), ou de démocratie participative, destinées à compléter, concurrencer, amender ou même remplacer la démocratie représentative (parlementaire). Cette exigence s’est notamment exprimée dans la proposition de l’institution d’un référendum d’initiative citoyenne (RIC), tout à la fois législatif (permettant l’adoption d’un projet de loi), abrogatif (permettant l’abrogation d’une loi existante), révocatoire (permettant la révocation d’un élu) et constitutionnel (permettant la modification d’une disposition de la constitution). Pierre Cours-Salies en détaille et discute longuement les modalités possibles et les vertus mais aussi les difficultés (pages 343-356), en plaidant en faveur d’une articulation étroite entre les procédures et structures de démocratie directe et celles de démocratie représentative, en s’inspirant d’une longue tradition remontant à la Révolution française avant son écrasement par la réaction thermidorienne (page 340) et courant tout au long de l’histoire du mouvement ouvrier.
Et, simultanément, cet élargissement à des contenus nouveaux doit s’accompagner d’un approfondissement dans le sens d’une exigence de «radicalement démocratiser la démocratie» (page 392): de l’instauration de formes de démocratie directe et continue (démocratie d’assemblée), ou de démocratie participative, destinées à compléter, concurrencer, amender ou même remplacer la démocratie représentative (parlementaire). Cette exigence s’est notamment exprimée dans la proposition de l’institution d’un référendum d’initiative citoyenne (RIC), tout à la fois législatif (permettant l’adoption d’un projet de loi), abrogatif (permettant l’abrogation d’une loi existante), révocatoire (permettant la révocation d’un élu) et constitutionnel (permettant la modification d’une disposition de la constitution). Pierre Cours-Salies en détaille et discute longuement les modalités possibles et les vertus mais aussi les difficultés (pages 343-356), en plaidant en faveur d’une articulation étroite entre les procédures et structures de démocratie directe et celles de démocratie représentative, en s’inspirant d’une longue tradition remontant à la Révolution française avant son écrasement par la réaction thermidorienne (page 340) et courant tout au long de l’histoire du mouvement ouvrier.
Cependant, Pierre Cours-Salies manque de souligner que cette seconde exigence, cardinale en effet, a pu quelquefois affaiblir le mouvement des GJ, en faisant obstacle ou, du moins, en freinant la nécessaire centralisation organisationnelle et programmatique du mouvement (telle qu’elle s’est produite sous la forme des Assemblées des assemblées), sous l’effet de la peur de son institutionnalisation et de sa récupération par le biais de représentants, désignés ou auto-désignés. De même omet-il de relever que, en transformant le RIC en une sorte de panacée censée remédier à tous les maux qui accablent le «bas de l’échelle», une partie du mouvement des GJ a produit une nouvelle version du fétichisme de l’État qui consiste à croire que l’on peut révolutionner ce dernier (en l’occurrence le démocratiser radicalement) sans révolutionner les rapports sociaux, et tout d’abord de production, dont il est l’institutionnalisation et qui constituent ses prémisses. Autrement dit, la seconde exigence portée par le mouvement des GJ ne peut ni ne doit se séparer de la première, à la condition de donner à celle-ci toute sa portée révolutionnaire.
De cette nécessaire solidarité entre les deux exigences portées par les GJ, Pierre Cours-Salies en rend néanmoins compte à sa façon, en soulignant que l’une et l’autre témoignent d’une même résistance à cette individualisation des rapports sociaux qui constitue le moyen et le but à la fois du néolibéralisme: transformer chacun-e en «entrepreneur-se de soi», chargé·e de valoriser sur le marché son «capital humain» en ne se rapportant aux autres que comme autant d’opportunités ou, au contraire, d’obstacles à cette valorisation. Ce que, pour sa part, Pierre Cours-Salies caractérise comme un «individualisme possessif» (page 408), qu’illustre par exemple «la remise en cause gouvernementale du système de retraite par répartition vis[ant] à “remarchandiser” le souci de la retraite pour chacun-e : contraindre les salarié-es à compter comment ils/elles constituent des droits individuels pour leurs vieux jours (page 393).
Contre cet «individualisme possessif», Pierre Cours-Salies en appelle à un «individualisme nouveau» (page 387), qu’il qualifie d’«individualisme coopératif et créatif» (page 410). Expressions surprenantes tant le concept d’individualisme connote ordinairement un repli et recentrage de l’individu sur lui-même dans une posture de séparation des autres et de mise en concurrence de tous-toutes avec tous-toutes, alors qu’il s’agit au contraire de désigner ici un type d’individualité façonnée par la propriété collective des moyens sociaux de production et la participation quotidienne aux structures de décision collective, libéré par conséquent de la tyrannie du marché et de l’étroitesse de la propriété privée. Et il n’est pas certain que la référence au concept d’égaliberté (pages 402-403), introduit par Etienne Balibar [17], suffise à préciser les contours et le contenu de ce nouveau type d’individualité, tant les concepts de liberté et d’égalité, même dialectisés, restent marqués au coin des rapports capitalistes de production et de propriété, comme Marx l’a souligné dans sa critique de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen développée au fil de La question juive [18].
Il restait à définir le cadre géopolitique dans lequel ces droits et exigences doivent être défendus. Dans le dernier chapitre de l’ouvrage, sans négliger pour autant les niveaux local et national, Pierre Cours-Salies plaide en faveur d’une action de caractère international et même mondial. Il part du constat que le mouvement des GJ a connu un écho bien au-delà des frontières françaises, en faisant des émules en Belgique, en Allemagne, en Bulgarie, au Monténégro, en Israël, au Liban, en Afrique du Sud, en Irak, en Russie, en Pologne, en Slovénie, au Portugal, en Irlande, en Grande-Bretagne, etc., sans que pour autant nulle part le mouvement n’ait connu l’ampleur et de la durée de son noyau français. Cette contagion n’a rien de fortuite: elle traduit tout simplement le fait que, les mêmes causes produisant les mêmes effets, les dégâts occasionnés par la mise en œuvre des politiques néolibérales, tant au niveau micro qu’au niveau macro, ailleurs à l’étranger y ont suscité les mêmes mécontentements et les mêmes révoltes, aux spécificités locales et nationales près. Dès lors, il est logique d’envisager d’étendre la lutte pour les droits et exigences précédents au niveau international (qui ne se réduit pas au seul cadre européen), ce qui lui permettra d’ailleurs de s’enrichir de nouvelles dimensions, notamment en intégrant toute la problématique écologique. Mais sur quels alliés, appuis et relais compter à ce niveau? Le propos de Pierre Cours-Salies se fait allusif plus qu’analytique et démonstratif à ce sujet: les Forums sociaux mondiaux sont évidemment évoqués (pages 367, 372, 374, 380), mais aussi la Confédération internationale des syndicats (page 372) et la Via Campesina (page 375), ainsi que l’OIT (pages 367-368), sans oublier finalement une ONU qu’il s’agirait pourtant de corriger de ses défauts congénitaux (pages 378-380). Sans que soit précisé comment (selon quelles modalités) ces différents acteurs sont censés collaborer à la réalisation du programme précédemment défini. Si bien que le lecteur sort de ce chapitre en restant en bonne partie sur sa faim, avec plus de questions que de réponses.
Au demeurant, personne n’est en mesure de répondre à lui seul à l’ensemble des questions soulevées par le projet de constitution d’un nouveau bloc historique, ou même seulement par l’évolution critique de ces deux moments forts de la lutte des classes en France qu’ont été mai-juin 1968 et le mouvement des GJ. Telle n’était pas non plus l’ambition de Pierre Cours-Salies, plus modeste: ouvrir une discussion à leur sujet. Sous ce rapport, il aura largement rempli son contrat.
__________
[1] Convenons de noter mai-juin 1968 les événements français de cette période, en réservant l’expression de Mai 68 à l’ensemble de ce moment de la lutte des classes qui aura pris une dimension mondiale, en trouvant souvent son origine bien avant mai-juin 1968 et en se poursuivant tout aussi bien de longues années après.
[2] Constituée à l’initiative de François Mitterrand dans le cours de sa candidature à l’élection présidentielle de décembre 1965, la FGDS regroupait alors l’essentiel de la gauche non communiste, en comprenant notamment la Section française de l’Internationale ouvrière (SFIO) dirigée par Guy Mollet, le Parti radical de René Billières et la Convention des institutions républicaines du même Mitterrand. Elle a précédé et préparé la refondation du Parti socialiste qui n’interviendra qu’au congrès d’Épinay en juin 1971.
[3] Le PSU se constitue en avril 1960 en réunissant notamment le Parti socialiste autonome (procédant d’une scission de la SFIO entraînant les opposants à la poursuite de la guerre d’Algérie par la SFIO arrivée au pouvoir en février 1956, il comprend dans ses rangs Pierre Mendès-France) et l’Union de la gauche socialiste regroupant d’autres dissidents de la SFIO, des chrétiens de gauche et des trotskistes. A partir de 1967, son secrétaire général sera Michel Rocard, jusqu’à son départ avec une minorité pour le Parti socialiste en octobre 1974.
[4] Curieusement, Pierre Cours-Salies n’envisage pas une autre hypothèse: le PCF aurait cédé aux pressions du «grand frère» soviétique, alors déjà aux prises avec la situation en Tchécoslovaquie (faisant éclore les prémices d’un «socialisme démocratique» au sein de son pré carré) et tenant rien moins qu’à gérer une seconde crise avec l’avènement d’une expérience socialiste en Europe occidentale, susceptible de renforcer le discrédit du «socialisme d’État» et de remettre en cause les accords de Yalta, en provoquant du coup un nouvel accès de tension avec les États-Unis. La violence avec laquelle il a fait intervenir les troupes du pacte de Varsovie dit pourtant combien l’affaire était d’importance pour Brejnev et consorts, de même que la faible « désapprobation » du PCF à ce sujet nous renseigne sur ce qu’était encore à l’époque son inféodation à Moscou. Pierre Cours-Salies n’en dit rien dans le Chapitre 10 dans lequel il traite de la lente descente aux enfers du soi-disant «bloc socialiste», depuis l’écrasement du printemps de Prague jusqu’à l’effondrement de l’URSS en passant par la répression des dissidents, la mise hors la loi de Solidarnosc, l’échec de la perestroïka et la chute du mur de Berlin. Un chapitre d’ailleurs en partie décalé par rapport à l’ensemble du propos de l’ouvrage.
[5] Henri Lefebvre, L’irruption de Nanterre au sommet, Paris, Anthropos, 1968 ; réédité sous le titre Mai 68… l’irruption, Paris, Syllepse, 1998, page 75.
[6] Jacques Chaban-Delmas est nommé Premier ministre par Georges Pompidou, prenant la succession de de Gaulle, poste qu’il occupera de juin 1969 à juillet 1972. Jacques Delors en sera le conseiller particulier, avant de rejoindre le Parti socialiste (1974), puis de devenir ministre de l’Économie et des Finances sous Mitterrand (mai 1981 à mai 1984) en présidant ainsi au tournant néolibéral du printemps 1983, enfin d’assurer la présidence de la Commission européenne (1985-1995).
[7] Premier ministre de trois gouvernements successifs entre juillet 1972 et mai 1974.
[8] Ministre du Commerce et de l’Artisanat, puis des Postes et Télécommunications sous le précédent, défenseur flamboyant de l’ordre moral.
[9] Inamovible ministre de l’Intérieur du 31 mai 1968 au 27 février 1974, surnommé Marcellin-la-Trique. Ennemi juré des «gauchistes», il fit interdire onze mouvements d’extrême gauche en juin 1968 et, à nouveau, la Ligue communiste en juin 1973.
[10] Pour un développement de ces deux derniers points, cf. les articles «Flexibilité & Précarité» et «Libéralisation » dans La novlangue néolibérale. La rhétorique du fétichisme capitaliste, 2e édition, Page 2 et Syllepse, Lausanne et Paris, 2017.
[11] Pierre Cours-Salies et Stéphane Le Lay (dir.), Le bas de l’échelle: la construction sociale des situations subalternes, Toulouse, Éres, 2006.
[12] Pierre Vila, « Chômage et salaires en France sur longue durée », Économie et statistique, n°282, Insee, 1995, page 54.
[13] Par exemple, «en 1956, il n’existe que 7 entreprises de travail temporaire dans toute la France. En 1962, elles sont 170 et font travailler 33 000 intérimaires.» Rachid Belkacem et Cathel Kornig, La construction sociale du travail intérimaire: de ses origines aux États-Unis à son institutionnalisation en France. Économies et sociétés, Développement, croissance et progrès, Presses de l’ISMEA, Paris, 2011, tome XLV/8 (Socio-Économie du Travail n° 33), page 10. Elles vont cependant connaître un développement important à partir de la première moitié des années 1960, en conduisant à la création de l’ANPE pour le contrer.
[14] Le Capital, Livre I, Chapitre XXV, section IV.
[15] J’entends ici cette expression dans un sens large qui inclut tous les éléments et procédures institutionnels par lesquels s’effectuent la socialisation de la reproduction de la force de travail: non seulement la protection sociale mais encore un ensemble d’équipements collectifs et de services publics (logement, école, santé, loisirs) dont le financement procédure de la redistribution des revenus opérés par les finances publiques.
[16] Cf. l’article «Crise» dans La novlangue néolibérale…, op. cit. Cf. aussi http://alencontre.org/europe/france/les-gilets-jaunes-un-soulevement-populaire-contre-lacte-ii-de-loffensive-neoliberale.html
[17] Etienne Balibar, La proposition de l’égaliberté, Presses Universitaires de France, 2010.
[18] Cf. aussi les articles «Liberté» et «Égalité» dans La novlangue néolibérale…, op. cit.





