Agenda militant
Ailleurs sur le Web
![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)
- L’économie américaine : la réalité derrière le récit trumpien (04/03)
- Le Gaze à l’état fumeux. Sur "Bourgeois Gaze" de Rob Grams (04/03)
- En solidarité avec LFI et l’antifascisme. Construire un front social antifasciste et antiraciste (04/03)
- Emmanuel Todd : "Le début d’une guerre mondiale" (04/03)
- Face à LFI : le règne des interrogatoires (04/03)
- LA PERM : POLÉMIQUE MELENCHON EPSTEIN ? LA GUERRE USA, ISRAEL et IRAN ! (03/03)
- White Power : au coeur de l’extrême droite (03/03)
- Iran : lobbying pro-chah dans les médias français (02/03)
- Lordon : Marx va avoir raison (IA et lutte des classes) (02/03)
- Plus de 5 200 nouveaux militants en une semaine – LFI agrège de plus en plus de nouveaux soutiens en vue des municipales (02/03)
- HOLLANDE vs MÉLENCHON au 2ÈME TOUR : la PROPHÉTIE INTERDITE !! (01/03)
- Le Figaro modifie ses articles de manière orwellienne et Médiapart s’en prend à Contre Attaque (01/03)
- Meeting avec Jean-Luc Mélenchon et Mickaël Idrac à Perpignan ! (01/03)
- Meeting de Mélenchon à Lyon : ce que les médias ne veulent pas que vous entendiez (28/02)
- ABATTRE MÉLENCHON ET LFI, PROMOUVOIR LE RN (27/02)
- Meeting avec Jean-Luc Mélenchon, Anaïs Belouassa-Cherifi et Florestan Groult à Lyon ! (26/02)
- Se souvenir du Black Panther Party (25/02)
- Le fascisme. Un texte d’Otto Bauer (25/02)
- JUAN BRANCO : UN ROUGE... TRÈS BRUN (25/02)
- Manu Bompard et Mathilde Panot dans les médias ce mercredi (25/02)
- Fascisme vs antifascisme : le renversement des valeurs - Avec Johann Chapoutot (25/02)
- Écrans: la guerre contre le scroll est déclarée (25/02)
- Antifascisme et LFI : les médias brutalisent le débat public (24/02)
- À Paris, la dynamique Chikirou (23/02)
- Meeting de la campagne municipale à Besançon (23/02)
Liens
Ballast: Cartouches
Ces articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » sont publiés à titre d'information et n'engagent pas la Tendance CLAIRE.
Les spartakistes dans l’Histoire, les Mémoires d’une libertaire, les steppes kazakh, l’ébauche d’une société communiste, la sinologie en débat, une alternative à la tyrannie marchande, une enfance au Rojava, les communards traqués, la liberté en question et l’arnaque de la résilience : nos chroniques du mois de mars.
☰ Le Spartakisme — Les dernières années de Rosa Luxemburg et de Karl Liebknecht, de Gilbert Badia
 Saluons l’initiative des éditions Otium : les écrits francophones ayant trait à la Ligue spartakiste font cruellement défaut et l’ouvrage de Gilbert Badia, paru en 1967, était de longue date épuisé. Historien, germaniste, résistant sous l’Occupation et militant communiste : voici pour l’auteur. En 1914, la guerre s’en va briser d’un coup d’un seul les rêveries progressistes : Diderot et Kant voient leurs nations s’entretuer pour la joie des marchands d’armes ; en 1919, les opposants révolutionnaires à la guerre sont broyés par ceux-là mêmes qui l’avaient votée, les sociaux-démocrates allemands. Cinq années de sang ; il n’en finira pas de couler — déjà, le fascisme attend son heure en Italie. Karl Liebknecht a crié « A bas la guerre ! » : ce fut la prison pour tous deux, puis, libérés, l’engagement ardent en faveur de la République des Conseils, autrement dit la Révolution. Celle qui s’avance « dans l’intérêt de la grande majorité et grâce à la grande majorité des travailleurs ». Avec un soin du détail qui jamais ne leste, Badia fait le récit de la Ligue au cœur du soulèvement populaire allemand de 1918 : l’écrasement du mois de janvier de l’année suivante est longuement mis en contexte, texturant, densifiant, charpentant dès lors ce qui, trop souvent, tient de l’image pieuse et de la martyrologie communiste. Luxemburg — « vieillie, malade » — y apparaît dans toute sa vérité : elle s’échine à convaincre ses camarades que l’heure n’est pas à la victoire ; qu’il importe de participer aux élections ; que le volontarisme spartakiste tient « d’un extrémisme un peu puéril, en pleine fermentation, sans nuances ». Si l’ouvrage est à raison partisan, il ne succombe pas à l’hagiographie : l’auteur affirme que l’influence des spartakistes sur les masses était « trop limitée » et indique que, « pris à leur propre lutte », ils n’ont peut-être pas « prêté une attention suffisante à la question de l’alliance […] de toutes les forces anti-majoritaires ». Pareille initiative éditoriale, on aurait tort de s’en priver. [E.B.]
Saluons l’initiative des éditions Otium : les écrits francophones ayant trait à la Ligue spartakiste font cruellement défaut et l’ouvrage de Gilbert Badia, paru en 1967, était de longue date épuisé. Historien, germaniste, résistant sous l’Occupation et militant communiste : voici pour l’auteur. En 1914, la guerre s’en va briser d’un coup d’un seul les rêveries progressistes : Diderot et Kant voient leurs nations s’entretuer pour la joie des marchands d’armes ; en 1919, les opposants révolutionnaires à la guerre sont broyés par ceux-là mêmes qui l’avaient votée, les sociaux-démocrates allemands. Cinq années de sang ; il n’en finira pas de couler — déjà, le fascisme attend son heure en Italie. Karl Liebknecht a crié « A bas la guerre ! » : ce fut la prison pour tous deux, puis, libérés, l’engagement ardent en faveur de la République des Conseils, autrement dit la Révolution. Celle qui s’avance « dans l’intérêt de la grande majorité et grâce à la grande majorité des travailleurs ». Avec un soin du détail qui jamais ne leste, Badia fait le récit de la Ligue au cœur du soulèvement populaire allemand de 1918 : l’écrasement du mois de janvier de l’année suivante est longuement mis en contexte, texturant, densifiant, charpentant dès lors ce qui, trop souvent, tient de l’image pieuse et de la martyrologie communiste. Luxemburg — « vieillie, malade » — y apparaît dans toute sa vérité : elle s’échine à convaincre ses camarades que l’heure n’est pas à la victoire ; qu’il importe de participer aux élections ; que le volontarisme spartakiste tient « d’un extrémisme un peu puéril, en pleine fermentation, sans nuances ». Si l’ouvrage est à raison partisan, il ne succombe pas à l’hagiographie : l’auteur affirme que l’influence des spartakistes sur les masses était « trop limitée » et indique que, « pris à leur propre lutte », ils n’ont peut-être pas « prêté une attention suffisante à la question de l’alliance […] de toutes les forces anti-majoritaires ». Pareille initiative éditoriale, on aurait tort de s’en priver. [E.B.]
Éditions Otium, 2021
☰ May Picqueray — La réfractaire
 Les Mémoires de militants et de militantes anarchistes, souvent palpitantes — pour ne pas dire romanesques —, constituent désormais un genre à part entière. L’on connaissait celles de Kropotkine, d’Emma Goldman, d’Alexander Berkman ou encore du bagnard Clément Duval (pour n’en citer que quelques-unes), l’on découvre désormais celles de May Picqueray, figure majeure et quelque peu oubliée de l’anarchisme français. Née en 1898 en Bretagne dans un milieu modeste, la trajectoire de Picqueray a embrassé tous les événements majeurs de son siècle. Contemporaine de la Première Guerre mondiale, elle survit à l’épidémie de grippe espagnole puis découvre l’URSS à la faveur d’un congrès de l’Internationale syndicale ; elle y rencontre notamment Trotsky, auquel elle refuse de serrer la main alors même qu’elle est venue lui demander de libérer deux camarades en déportation, Mollie Steimer et Sénia Flechine. Plusieurs fois emprisonnée en France en raison de ses positions antimilitaristes et de ses fréquentations, antibolchevik déclarée, elle accueillera par la suite à Paris Nestor Makhno en exil puis deviendra la secrétaire personnelle d’Emma Goldman et d’Alexander Berkman, à Saint-Tropez. Familière de toutes les grandes personnalités libertaires de son temps (Rudolf Rocker, Voline, Marius Jacob, Rirette Maîtrejean, Sébastien Faure, Camillo Berneri, Louis Lecoin et bien d’autres), elle fut une actrice à part entière des dernières décennies de « l’âge d’or » de l’anarchisme, dont on s’accorde généralement à dire qu’il prit fin avec la guerre d’Espagne. Résistante au cours de la Seconde Guerre mondiale, inlassable « réfractaire », on la retrouve encore dans les années 1970 dans les luttes antimilitaristes, notamment sur le Larzac, ou dans la lutte antinucléaire à Plogoff. Sobre et sensible, cette autobiographie vivifiante offre un beau témoignage de la continuité des luttes libertaires en France au cours du siècle dernier. [P.M.]
Les Mémoires de militants et de militantes anarchistes, souvent palpitantes — pour ne pas dire romanesques —, constituent désormais un genre à part entière. L’on connaissait celles de Kropotkine, d’Emma Goldman, d’Alexander Berkman ou encore du bagnard Clément Duval (pour n’en citer que quelques-unes), l’on découvre désormais celles de May Picqueray, figure majeure et quelque peu oubliée de l’anarchisme français. Née en 1898 en Bretagne dans un milieu modeste, la trajectoire de Picqueray a embrassé tous les événements majeurs de son siècle. Contemporaine de la Première Guerre mondiale, elle survit à l’épidémie de grippe espagnole puis découvre l’URSS à la faveur d’un congrès de l’Internationale syndicale ; elle y rencontre notamment Trotsky, auquel elle refuse de serrer la main alors même qu’elle est venue lui demander de libérer deux camarades en déportation, Mollie Steimer et Sénia Flechine. Plusieurs fois emprisonnée en France en raison de ses positions antimilitaristes et de ses fréquentations, antibolchevik déclarée, elle accueillera par la suite à Paris Nestor Makhno en exil puis deviendra la secrétaire personnelle d’Emma Goldman et d’Alexander Berkman, à Saint-Tropez. Familière de toutes les grandes personnalités libertaires de son temps (Rudolf Rocker, Voline, Marius Jacob, Rirette Maîtrejean, Sébastien Faure, Camillo Berneri, Louis Lecoin et bien d’autres), elle fut une actrice à part entière des dernières décennies de « l’âge d’or » de l’anarchisme, dont on s’accorde généralement à dire qu’il prit fin avec la guerre d’Espagne. Résistante au cours de la Seconde Guerre mondiale, inlassable « réfractaire », on la retrouve encore dans les années 1970 dans les luttes antimilitaristes, notamment sur le Larzac, ou dans la lutte antinucléaire à Plogoff. Sobre et sensible, cette autobiographie vivifiante offre un beau témoignage de la continuité des luttes libertaires en France au cours du siècle dernier. [P.M.]
Libertalia, 2021
☰ Djamilia, de Tchinguiz Aïtmatov
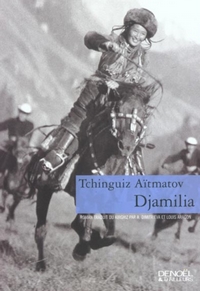 Entre les monts kirghiz et les steppes kazakh coule la rivière Kourkouréou. Dans la vallée, les échos d’une grande guerre qui court au loin parviennent jusqu’au village où vit le jeune Seït : nous sommes en 1943, Seït est encore un enfant. C’est par ses yeux que nous apparaissent, au fil des pages, les regards et sourires de Djamilia qu’il adore et admire, les couleurs de la steppe, mais aussi le pénible labeur des moissons — le travail au kolkhoze sert à envoyer du grain aux hommes partis s’évaporer au front. Du front revient un jour un homme, orphelin d’un village alentour, que tout le monde où presque avait oublié. C’est Danïiar, « un homme étrange qui n’[appartient] pas à ce monde-ci », mais bien plutôt au monde des sons et mélodies qui parcourent la steppe : celle de la rivière, du vent, des chevaux. Djamilia s’y connaît elle aussi en chevaux. Elle est capable de conduire des calèches où deux animaux sont attelés, s’adonne au travail avec peine et joie mêlées, affirme ses opinions, et rayonne bien au-delà des usages anciens qui perdurent à l’aïl — au village —, héritages d’un nomadisme révolu. C’est bien simple, pour Seït, « dans tout l’univers, il n’y [a] rien de mieux que Djamilia », qui a le respect des aînés malgré sa force de caractère et sa jovialité peu conventionnelles. La beauté, la force et l’énergie de Djamilia captivent Seït et font naître chez lui une fierté et une jalousie d’enfant. Il découvre ses propres émotions en même temps qu’il est attentif au monde qui l’environne. Il note les odeurs de la nuit, des absinthes en fleur et de l’orge mûre, les couleurs du soleil vespéral. Il tend l’oreille aux discussions entre les membres du villages, aux propos du brigadier Orozmat, aux échanges des jeunes gens qui la plupart du temps travaillent, mais parfois aussi batifolent… Louis Aragon, qui signe la préface et la traduction de ce roman kirghiz paru en 1957, y voit « la plus belle histoire d’amour du monde ». Il a peut-être raison. [L.M.]
Entre les monts kirghiz et les steppes kazakh coule la rivière Kourkouréou. Dans la vallée, les échos d’une grande guerre qui court au loin parviennent jusqu’au village où vit le jeune Seït : nous sommes en 1943, Seït est encore un enfant. C’est par ses yeux que nous apparaissent, au fil des pages, les regards et sourires de Djamilia qu’il adore et admire, les couleurs de la steppe, mais aussi le pénible labeur des moissons — le travail au kolkhoze sert à envoyer du grain aux hommes partis s’évaporer au front. Du front revient un jour un homme, orphelin d’un village alentour, que tout le monde où presque avait oublié. C’est Danïiar, « un homme étrange qui n’[appartient] pas à ce monde-ci », mais bien plutôt au monde des sons et mélodies qui parcourent la steppe : celle de la rivière, du vent, des chevaux. Djamilia s’y connaît elle aussi en chevaux. Elle est capable de conduire des calèches où deux animaux sont attelés, s’adonne au travail avec peine et joie mêlées, affirme ses opinions, et rayonne bien au-delà des usages anciens qui perdurent à l’aïl — au village —, héritages d’un nomadisme révolu. C’est bien simple, pour Seït, « dans tout l’univers, il n’y [a] rien de mieux que Djamilia », qui a le respect des aînés malgré sa force de caractère et sa jovialité peu conventionnelles. La beauté, la force et l’énergie de Djamilia captivent Seït et font naître chez lui une fierté et une jalousie d’enfant. Il découvre ses propres émotions en même temps qu’il est attentif au monde qui l’environne. Il note les odeurs de la nuit, des absinthes en fleur et de l’orge mûre, les couleurs du soleil vespéral. Il tend l’oreille aux discussions entre les membres du villages, aux propos du brigadier Orozmat, aux échanges des jeunes gens qui la plupart du temps travaillent, mais parfois aussi batifolent… Louis Aragon, qui signe la préface et la traduction de ce roman kirghiz paru en 1957, y voit « la plus belle histoire d’amour du monde ». Il a peut-être raison. [L.M.]
Denoël, 2001
☰ Figures du communisme, de Frédéric Lordon
 Si Imperium et Vivre sans ?, les précédents ouvrages de Frédéric Lordon, proposaient une approche théorique des problèmes que tout partisan de l’émancipation se doit d’affronter (État, horizontalité, travail, argent, institutions ou police), ce nouvel opus se veut plus concret : c’est qu’il est question de donner à voir à quoi pourrait ressembler un autre monde. Entendre un monde moins dégueulasse (dérèglement climatique, ploutocratie, citoyens éborgnés ou étranglés dans la rue). En 2007, Daniel Bensaïd déplorait « une crise de la raison stratégique » ; voici que la stratégie est de retour — que les propositions de Lordon, Baschet et Olin Wright se chevauchent à l’heure qu’il est en librairie ne doit rien au hasard. « En réalité, c’est simple », avance le premier. Chacun sait désormais que le capitalisme saccage la vie sur Terre. S’ensuit : il faut détruire le capitalisme. S’ensuit : comment procéder ? Les sociaux-démocrates ont tenté : ils déjeunent aujourd’hui avec Hidalgo. Les libertaires ont tenté : ils ont pris l’exil ou du plomb dans la peau. Les léninistes ont tenté : les plus fidèles compagnons de la Révolution victorieuse ont été déportés dans l’Oural. Les zapatistes tentent : ils n’investissent qu’une humble portion du Mexique. Les zadistes tentent : ils mordent la poussière dès l’instant où l’État lève le petit doigt. Il faut donc tout reprendre, et dans l’urgence avec ça : chaque jour vécu sous occupation capitaliste est un jour de trop. La reprise passe, chez l’auteur, par la résurrection d’un mot qu’on croyait mort : « communisme ». Non pas celui qui fut son « contraire même » (URSS, Angkar, famines) mais sa « vérité » : la vie bonne pour le grand nombre. Contre « le grand parti des propos sans suite » (écologistes libéraux, révolutionnaires « ontologiques », groupies de Taubira et citoyens du monde), Lordon enjoint à la conséquence. Résumons ce qui n’entend pas être un « plan tout armé » : on gagnerait à passer outre le régime parlementaire ; attraper l’État ; abolir la propriété privée des moyens de production, le marché de l’emploi et la finance ; instaurer le salaire à vie (renommé). Avant, il conviendra de rendre désirable la révolution, autrement dit de refaire « la scène imaginaire ». Le livre s’achève sur une invitation au débat : il sera nécessaire. Autant que l’est ce livre. [E.C.]
Si Imperium et Vivre sans ?, les précédents ouvrages de Frédéric Lordon, proposaient une approche théorique des problèmes que tout partisan de l’émancipation se doit d’affronter (État, horizontalité, travail, argent, institutions ou police), ce nouvel opus se veut plus concret : c’est qu’il est question de donner à voir à quoi pourrait ressembler un autre monde. Entendre un monde moins dégueulasse (dérèglement climatique, ploutocratie, citoyens éborgnés ou étranglés dans la rue). En 2007, Daniel Bensaïd déplorait « une crise de la raison stratégique » ; voici que la stratégie est de retour — que les propositions de Lordon, Baschet et Olin Wright se chevauchent à l’heure qu’il est en librairie ne doit rien au hasard. « En réalité, c’est simple », avance le premier. Chacun sait désormais que le capitalisme saccage la vie sur Terre. S’ensuit : il faut détruire le capitalisme. S’ensuit : comment procéder ? Les sociaux-démocrates ont tenté : ils déjeunent aujourd’hui avec Hidalgo. Les libertaires ont tenté : ils ont pris l’exil ou du plomb dans la peau. Les léninistes ont tenté : les plus fidèles compagnons de la Révolution victorieuse ont été déportés dans l’Oural. Les zapatistes tentent : ils n’investissent qu’une humble portion du Mexique. Les zadistes tentent : ils mordent la poussière dès l’instant où l’État lève le petit doigt. Il faut donc tout reprendre, et dans l’urgence avec ça : chaque jour vécu sous occupation capitaliste est un jour de trop. La reprise passe, chez l’auteur, par la résurrection d’un mot qu’on croyait mort : « communisme ». Non pas celui qui fut son « contraire même » (URSS, Angkar, famines) mais sa « vérité » : la vie bonne pour le grand nombre. Contre « le grand parti des propos sans suite » (écologistes libéraux, révolutionnaires « ontologiques », groupies de Taubira et citoyens du monde), Lordon enjoint à la conséquence. Résumons ce qui n’entend pas être un « plan tout armé » : on gagnerait à passer outre le régime parlementaire ; attraper l’État ; abolir la propriété privée des moyens de production, le marché de l’emploi et la finance ; instaurer le salaire à vie (renommé). Avant, il conviendra de rendre désirable la révolution, autrement dit de refaire « la scène imaginaire ». Le livre s’achève sur une invitation au débat : il sera nécessaire. Autant que l’est ce livre. [E.C.]
La Fabrique, 2021
☰ Contre François Jullien, de Jean François Billeter

Dès les années 1980, le philosophe François Jullien formulait un projet sinologique aux antipodes des méthodes léguées par la vénérable tradition érudite. Il ne s’agissait pas tant pour lui de présenter des œuvres et des auteurs chinois que d’opérer un « détour » stratégique par la Chine, en vue de réinterroger les impensés de la philosophie occidentale. Mais, dès cette époque, certains de ses collègues, parmi lesquels figurait ou création, transcendance ou immanence, etc. Comme cette tendance venait à tourner à la caricature, au fil des années, et que Jullien trouvait un public de plus en plus large — c’est l’un des philosophes français les plus traduits dans le monde —, Billeter a choisi d’intervenir, avec ce « titre accrocheur », pour tenter de lancer un débat. Ou, à tout le moins, de mettre en garde le public. Mais, au-delà des questions de méthode proprement sinologiques, l’enjeu est aussi politique : si Billeter reconnaît la justesse et la profondeur de certaines analyses de Jullien, notamment dans ses premiers livres, il lui reproche surtout de ne pas faire la critique de certaines notions qu’il étudie. Il en va ainsi de la « pensée de l’immanence » que Jullien décèle chez maints auteurs chinois, comme s’il s’agissait d’une pure option de la pensée, alors qu’elle est selon Billeter indissociable de ce qu’il nomme « l’idéologie impériale ». En érigeant des blocs de pensée antithétiques, Jullien omet toute la dimension social-historique à l’œuvre dans la genèse des idées ; or, il y va presque, dans la tradition politique chinoise, de ce que Castoriadis appelait autrefois la « pensée héritée ». Si nous ne sommes pas tenus de suivre Billeter jusqu’au bout de ses analyses, notamment dans le lien consubstantiel qu’il établit entre la civilisation chinoise et le « despotisme impérial », son livre a le grand mérite de poser des questions essentielles quant au sens de l’aventure sinologique. [A.C.]
Allia, 2006
☰ Basculements — Mondes émergents, possibles désirables, de Jérôme Baschet
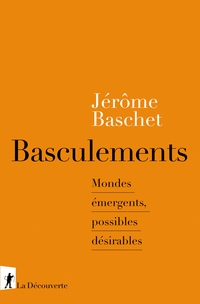 Changer le monde était un impératif ; la pandémie mondiale confirme seulement que ne pas en changer est criminel. Le virus est, avance l’auteur, « une maladie du Capitalocène » : d’autres suivront, plus redoutables encore. Historien et spécialiste de l’expérience zapatiste, Baschet propose dans cet ouvrage de faire disparaître « la tyrannie marchande ». On connaît la chanson, nous direz-vous. Certes. À la différence que l’air prend cette fois de l’épaisseur : une feuille de route stratégique est ébauchée — et l’horizon a pour nom « autogouvernement des communes ». Un fédéralisme bien connu de la tradition libertaire, éclairé pour l’occasion par la pratique zapatiste et le corpus écologiste. La révolution politique que Jérôme Baschet convie de ses vœux se double ainsi d’une révolution anthropologique : tourner la page de l’individu humaniste moderne, progressiste et cartésien en vue de retrouver le sens de la communauté et des limites. Singularité du propos global : l’auteur déboute trois ou quatre fétiches chers aux espaces alternatifs : l’horizontalité intégrale, le localisme, le culte indifférencié du « vivant » et la recherche de pureté. Discutant son époque, c’est en toute logique qu’un chapitre se voit consacré à Frédéric Lordon en tant qu’il incarne l’une des trop rares modalités concrètes de l’émancipation anticapitaliste : Basculements se porte en faux contre la proposition politique formulée par le philosophe et économiste communiste. Non, rien ne sert de s’emparer de l’appareil d’État ; non, il ne faut pas imaginer une autre économie mais l’abolir tout entière ; non, il ne faut pas concevoir des alternatives émancipatrices au travail mais en finir avec « la notion même de travail ». Si, le livre achevé, il n’est pas certain que l’on sache précisément comment appréhender pareils chantiers, une chose est sûre : avec sa perspective des « espaces libérés » allant croissant et de « l’autonomie » combattive, Basculements apparaît comme le frère-ennemi de Figures du communisme. Souhaitons qu’un média aura l’heureuse idée de faire se rencontrer leurs auteurs. [L.T.]
Changer le monde était un impératif ; la pandémie mondiale confirme seulement que ne pas en changer est criminel. Le virus est, avance l’auteur, « une maladie du Capitalocène » : d’autres suivront, plus redoutables encore. Historien et spécialiste de l’expérience zapatiste, Baschet propose dans cet ouvrage de faire disparaître « la tyrannie marchande ». On connaît la chanson, nous direz-vous. Certes. À la différence que l’air prend cette fois de l’épaisseur : une feuille de route stratégique est ébauchée — et l’horizon a pour nom « autogouvernement des communes ». Un fédéralisme bien connu de la tradition libertaire, éclairé pour l’occasion par la pratique zapatiste et le corpus écologiste. La révolution politique que Jérôme Baschet convie de ses vœux se double ainsi d’une révolution anthropologique : tourner la page de l’individu humaniste moderne, progressiste et cartésien en vue de retrouver le sens de la communauté et des limites. Singularité du propos global : l’auteur déboute trois ou quatre fétiches chers aux espaces alternatifs : l’horizontalité intégrale, le localisme, le culte indifférencié du « vivant » et la recherche de pureté. Discutant son époque, c’est en toute logique qu’un chapitre se voit consacré à Frédéric Lordon en tant qu’il incarne l’une des trop rares modalités concrètes de l’émancipation anticapitaliste : Basculements se porte en faux contre la proposition politique formulée par le philosophe et économiste communiste. Non, rien ne sert de s’emparer de l’appareil d’État ; non, il ne faut pas imaginer une autre économie mais l’abolir tout entière ; non, il ne faut pas concevoir des alternatives émancipatrices au travail mais en finir avec « la notion même de travail ». Si, le livre achevé, il n’est pas certain que l’on sache précisément comment appréhender pareils chantiers, une chose est sûre : avec sa perspective des « espaces libérés » allant croissant et de « l’autonomie » combattive, Basculements apparaît comme le frère-ennemi de Figures du communisme. Souhaitons qu’un média aura l’heureuse idée de faire se rencontrer leurs auteurs. [L.T.]
La Découverte, 2021
☰ Le Criquet de fer, de Salim Barakat
 Pour qui s’intéresse au Rojava, la lecture du Criquet de Fer de Salim Barakat apporte un éclairage intime, émotionnel, différent des documentaires ou des écrits historiques. C’est celui d’un enfant kurde qui y grandit dans les années 1950–1960, et subit de plein fouet la violence de la jeune République arabe syrienne — soucieuse d’unifier dans un même moule arabe et sunnite un territoire multiethnique. « Je commençais alors à prendre conscience de quelque chose de nouveau et d’imprévu, quelque chose de violent et d’évident : tu es Kurde ; les Kurdes sont dangereux ; il est interdit de parler kurde à l’école. Voilà qui est nouveau parce que tu sais que les trois quarts des habitants de cette ville proche des monts Taurus sont kurdes. Tu prends alors conscience d’un fait : c’est à qui des instituteurs humiliera les élèves et les frappera. » L’enfant retourne sa colère et sa rage contre celles et ceux qui l’entourent, adultes, enfants et surtout animaux. « Tu es un enfant mais tu as des yeux pour voir. Ils te détestent d’avance et tu ne sais pas pourquoi. Le maître te déteste, le fonctionnaire du gouvernement et le policier te détestent. Voilà qui change les choses. Je serai donc violent, plus violent que nécessaire contre cette intrusion démoniaque. » Les cinq histoires qui composent l’ouvrage permettent d’aborder différentes thématiques de la société kurde : le poids du patriarcat, la féodalité de la société traditionnelle, la religion yézidie… Un recueil plus proche du conte que du roman. Le fantastique y apparaît par instants. Auteur kurde écrivant en arabe, compagnon de route de Mahwoud Darwich, Salim Barakat est un auteur méconnu en France, bien que traduit partiellement par Actes Sud. Le style très oral de ses romans surprend ; il rappelle les chants des dengbêj, bardes kurdes qui ont conservé dans leurs épopées la mémoire historique et sociale du Kurdistan. « Et tu nous as réveillés pour conter cette farce ! », lance le narrateur en forme de conclusion. [L.]
Pour qui s’intéresse au Rojava, la lecture du Criquet de Fer de Salim Barakat apporte un éclairage intime, émotionnel, différent des documentaires ou des écrits historiques. C’est celui d’un enfant kurde qui y grandit dans les années 1950–1960, et subit de plein fouet la violence de la jeune République arabe syrienne — soucieuse d’unifier dans un même moule arabe et sunnite un territoire multiethnique. « Je commençais alors à prendre conscience de quelque chose de nouveau et d’imprévu, quelque chose de violent et d’évident : tu es Kurde ; les Kurdes sont dangereux ; il est interdit de parler kurde à l’école. Voilà qui est nouveau parce que tu sais que les trois quarts des habitants de cette ville proche des monts Taurus sont kurdes. Tu prends alors conscience d’un fait : c’est à qui des instituteurs humiliera les élèves et les frappera. » L’enfant retourne sa colère et sa rage contre celles et ceux qui l’entourent, adultes, enfants et surtout animaux. « Tu es un enfant mais tu as des yeux pour voir. Ils te détestent d’avance et tu ne sais pas pourquoi. Le maître te déteste, le fonctionnaire du gouvernement et le policier te détestent. Voilà qui change les choses. Je serai donc violent, plus violent que nécessaire contre cette intrusion démoniaque. » Les cinq histoires qui composent l’ouvrage permettent d’aborder différentes thématiques de la société kurde : le poids du patriarcat, la féodalité de la société traditionnelle, la religion yézidie… Un recueil plus proche du conte que du roman. Le fantastique y apparaît par instants. Auteur kurde écrivant en arabe, compagnon de route de Mahwoud Darwich, Salim Barakat est un auteur méconnu en France, bien que traduit partiellement par Actes Sud. Le style très oral de ses romans surprend ; il rappelle les chants des dengbêj, bardes kurdes qui ont conservé dans leurs épopées la mémoire historique et sociale du Kurdistan. « Et tu nous as réveillés pour conter cette farce ! », lance le narrateur en forme de conclusion. [L.]
Actes Sud, 2012
☰ Josée Meunier. 19, rue des juifs, de Michèle Audin
 Cela commence par une perquisition et se termine dans la tombe. Entretemps, dix années. La perquisition se déroule au 19, rue des Juifs, dans le quatrième arrondissement de Paris, un jour de juillet 1871. Habitent là, entre autres personnes, « dame Le Tellier, ouvrière » et « Mlle Georgette, raccommodeuse de dentelles », « Godelet Jacques, fort aux Halles » et « Oblet Charles, imprimeur ». Un commissaire prend soigneusement en note l’identité de toutes et tous, ainsi que les détails de la décoration — comme ces intrigants « bijoux de pacotilles dans une boîte à biscuits ». L’affaire est importante ; l’écrin des bijoux compte : il s’agit de débusquer les communards ou communardes qui se terrent dans Paris depuis deux mois. Mais le commissaire ne voit pas, ou si peu : « seuls les policiers ne comprennent rien au monde qui nous entoure ». Des hommes pourtant sont cachés dans les placards. Parmi eux, « l’ouvrier ciseleur Albert Theisz », qui sera le « premier membre de la Commune à mourir à Paris après l’amnistie de juillet 1880 ». Il réside chez les Meunier. Josée, la femme, « tout à la fois douce, triste, souriante, secrète », prend grand soin de son invité. Entre Albert et celle qui l’accueille, amitié et amour peu à peu s’entremêlent. Le premier part pour Londres ; la seconde ne tarde pas à l’y rejoindre. Alors on découvre les lettres qu’ils échangent avec la familles ou les ami·es resté·es en France, le quotidien des exilé·es, les sociabilités ouvrières et militantes de ces combattant·es de l’Internationale. Après avoir fait des 72 jours de la Commune la trame de son roman précédent, Comme une rivière bleue, la mathématicienne et autrice Michèle Audin s’attache ici à retracer les trajectoires des proscrits et proscrites, celles et ceux qui s’exilèrent dix années durant à Londres, Genève ou Bruxelles pour éviter la répression. Si les archives compulsées par Audin forment le fond de ce récit, il s’agit bien d’un roman : c’est en tout cas ce que rappelle l’autrice. Et d’ajouter que, lorsque les sources sont restées incomplètes, « la nécessité d’en savoir plus m’a poussée à inventer le reste ». [E.M.]
Cela commence par une perquisition et se termine dans la tombe. Entretemps, dix années. La perquisition se déroule au 19, rue des Juifs, dans le quatrième arrondissement de Paris, un jour de juillet 1871. Habitent là, entre autres personnes, « dame Le Tellier, ouvrière » et « Mlle Georgette, raccommodeuse de dentelles », « Godelet Jacques, fort aux Halles » et « Oblet Charles, imprimeur ». Un commissaire prend soigneusement en note l’identité de toutes et tous, ainsi que les détails de la décoration — comme ces intrigants « bijoux de pacotilles dans une boîte à biscuits ». L’affaire est importante ; l’écrin des bijoux compte : il s’agit de débusquer les communards ou communardes qui se terrent dans Paris depuis deux mois. Mais le commissaire ne voit pas, ou si peu : « seuls les policiers ne comprennent rien au monde qui nous entoure ». Des hommes pourtant sont cachés dans les placards. Parmi eux, « l’ouvrier ciseleur Albert Theisz », qui sera le « premier membre de la Commune à mourir à Paris après l’amnistie de juillet 1880 ». Il réside chez les Meunier. Josée, la femme, « tout à la fois douce, triste, souriante, secrète », prend grand soin de son invité. Entre Albert et celle qui l’accueille, amitié et amour peu à peu s’entremêlent. Le premier part pour Londres ; la seconde ne tarde pas à l’y rejoindre. Alors on découvre les lettres qu’ils échangent avec la familles ou les ami·es resté·es en France, le quotidien des exilé·es, les sociabilités ouvrières et militantes de ces combattant·es de l’Internationale. Après avoir fait des 72 jours de la Commune la trame de son roman précédent, Comme une rivière bleue, la mathématicienne et autrice Michèle Audin s’attache ici à retracer les trajectoires des proscrits et proscrites, celles et ceux qui s’exilèrent dix années durant à Londres, Genève ou Bruxelles pour éviter la répression. Si les archives compulsées par Audin forment le fond de ce récit, il s’agit bien d’un roman : c’est en tout cas ce que rappelle l’autrice. Et d’ajouter que, lorsque les sources sont restées incomplètes, « la nécessité d’en savoir plus m’a poussée à inventer le reste ». [E.M.]
Gallimard, 2021
☰ L’Expérience de la liberté, de Robert Legros
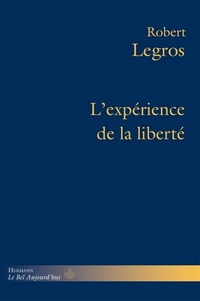 Toute société humaine, dès lors qu’elle se trouve livrée à l’évidence instituée par ce que la phénoménologie nomme « l’attitude naturelle », est menacée de faire l’expérience d’une clôture du sens (Castoriadis) ou de la tautologie symbolique (Richir) : ce que je dis et pense ne renvoie à rien d’autre que ce qui est pour moi, a priori. D’où vient donc notre capacité à briser cette clôture ou à penser en amont de la tautologie ? Y a‑t-il quelque chose comme une expérience phénoménologique — soit en-deçà de toute institution symbolique — de la liberté ? Telles sont les énigmes affrontées par Robert Legros dans cet ouvrage où l’on rencontre, chemin faisant, nombre de penseurs qui ont compté dans son itinéraire philosophique : Platon, Kant, Heidegger, Arendt, Castoriadis, Lefort, Levinas, Richir, mais aussi, de façon quelque peu inattendue, Dominique Janicaud. Autant d’intellectuels qu’il fait travailler, ensemble, entre métaphysique et philosophie politique — deux axes d’étude dont l’articulation se fait précisément grâce à la phénoménologie. En effet, selon Legros, la phénoménologie « peut être au fondement d’une philosophie politique » en ce qu’elle admet à la fois l’ancrage humain dans un monde déterminé, avec son institution symbolique et imaginaire propre, et la possibilité de l’expérience d’un monde indéterminé — expérience toujours en excès par rapport à ce qui nous est donné et paraît aller de soi. Ainsi la phénoménologie permet-elle de conjurer deux mauvais sorts : l’un consistant à se croire maître et souverain du sens, l’autre consistant à se laisser enfermer dans les évidences instituées. L’énigme étant que l’humain est le seul être qui n’adhère pas complètement à son expérience, et pour qui demeure un irréductible écart de soi à soi ; et c’est précisément cet écart qui fait toute notre liberté originaire. Cette question d’une profondeur abyssale, que Legros n’a cessé de méditer au fil des décennies, trouve ici un heureux approfondissement, quoique non définitif. [A.C.]
Toute société humaine, dès lors qu’elle se trouve livrée à l’évidence instituée par ce que la phénoménologie nomme « l’attitude naturelle », est menacée de faire l’expérience d’une clôture du sens (Castoriadis) ou de la tautologie symbolique (Richir) : ce que je dis et pense ne renvoie à rien d’autre que ce qui est pour moi, a priori. D’où vient donc notre capacité à briser cette clôture ou à penser en amont de la tautologie ? Y a‑t-il quelque chose comme une expérience phénoménologique — soit en-deçà de toute institution symbolique — de la liberté ? Telles sont les énigmes affrontées par Robert Legros dans cet ouvrage où l’on rencontre, chemin faisant, nombre de penseurs qui ont compté dans son itinéraire philosophique : Platon, Kant, Heidegger, Arendt, Castoriadis, Lefort, Levinas, Richir, mais aussi, de façon quelque peu inattendue, Dominique Janicaud. Autant d’intellectuels qu’il fait travailler, ensemble, entre métaphysique et philosophie politique — deux axes d’étude dont l’articulation se fait précisément grâce à la phénoménologie. En effet, selon Legros, la phénoménologie « peut être au fondement d’une philosophie politique » en ce qu’elle admet à la fois l’ancrage humain dans un monde déterminé, avec son institution symbolique et imaginaire propre, et la possibilité de l’expérience d’un monde indéterminé — expérience toujours en excès par rapport à ce qui nous est donné et paraît aller de soi. Ainsi la phénoménologie permet-elle de conjurer deux mauvais sorts : l’un consistant à se croire maître et souverain du sens, l’autre consistant à se laisser enfermer dans les évidences instituées. L’énigme étant que l’humain est le seul être qui n’adhère pas complètement à son expérience, et pour qui demeure un irréductible écart de soi à soi ; et c’est précisément cet écart qui fait toute notre liberté originaire. Cette question d’une profondeur abyssale, que Legros n’a cessé de méditer au fil des décennies, trouve ici un heureux approfondissement, quoique non définitif. [A.C.]
Hermann, 2018
☰ Contre la résilience — À Fukushima et ailleurs, de Thierry Ribault
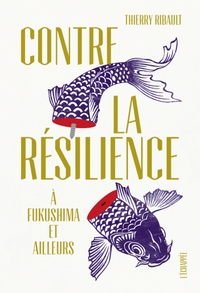 Qui n’a jamais rencontré de près ou de loin un discours vantant la résilience face à un mal, individuel ou collectif ? Le concept est omniprésent, mobilisé à tout-va, et s’engouffre dans le sillage des drames écologiques, sanitaires et politiques qui surviennent à la chaîne dans les sociétés industrielles. L’accident nucléaire de Fukushima en est un macabre exemple : il affecte les structures du vivant autant que les structures sociales, mais l’on entend claironner en fanfare qu’il s’agit avant tout d’être « résilient », de continuer à vivre, à travailler, à consommer dans un monde dévasté. Thierry Ribault livre dans cet essai une analyse critique extrêmement documentée des mécanismes insidieux du discours de la résilience, qui s’apparente à une véritable technologie placée au service de la fabrique du consentement des populations. Ici, nous parlons de populations irradiées, éclatées spatialement et psychiquement, affectées par des cancers, à qui l’on fait entonner le refrain du « retour au pays », de l’autogestion responsable de la vie en milieu radio-contaminé, du dépassement du mal par l’effort et l’adaptation… Car c’est là le sinistre danger du concept de résilience : il pousse à agir sur les actions post-catastrophe (madame, veillez à mesurer chaque jour les niveaux de radioactivité dans votre potager et vous vous sentirez en sécurité) plutôt que sur les causes qui y conduisent. Précise, féroce, l’analyse n’a rien à envier aux écrits qu’Adorno ou Anders ont produits en leur temps. Ces penseurs, d’ailleurs, nous sont utiles pour identifier les tenants de l’idéologie de la résilience : une négation de la négativité qui oppose à la finitude humaine un impudent solutionnisme technique, ou encore une production organisée d’ignorance qui conduit les populations à vivre dans un monde irrationnel — un monde faux. La résilience prétend prôner la vie qui vainc, quand elle cache en réalité une vie mutilée. Or à Fukushima comme ailleurs, « le malheur n’est pas un mérite ». [L.M.]
Qui n’a jamais rencontré de près ou de loin un discours vantant la résilience face à un mal, individuel ou collectif ? Le concept est omniprésent, mobilisé à tout-va, et s’engouffre dans le sillage des drames écologiques, sanitaires et politiques qui surviennent à la chaîne dans les sociétés industrielles. L’accident nucléaire de Fukushima en est un macabre exemple : il affecte les structures du vivant autant que les structures sociales, mais l’on entend claironner en fanfare qu’il s’agit avant tout d’être « résilient », de continuer à vivre, à travailler, à consommer dans un monde dévasté. Thierry Ribault livre dans cet essai une analyse critique extrêmement documentée des mécanismes insidieux du discours de la résilience, qui s’apparente à une véritable technologie placée au service de la fabrique du consentement des populations. Ici, nous parlons de populations irradiées, éclatées spatialement et psychiquement, affectées par des cancers, à qui l’on fait entonner le refrain du « retour au pays », de l’autogestion responsable de la vie en milieu radio-contaminé, du dépassement du mal par l’effort et l’adaptation… Car c’est là le sinistre danger du concept de résilience : il pousse à agir sur les actions post-catastrophe (madame, veillez à mesurer chaque jour les niveaux de radioactivité dans votre potager et vous vous sentirez en sécurité) plutôt que sur les causes qui y conduisent. Précise, féroce, l’analyse n’a rien à envier aux écrits qu’Adorno ou Anders ont produits en leur temps. Ces penseurs, d’ailleurs, nous sont utiles pour identifier les tenants de l’idéologie de la résilience : une négation de la négativité qui oppose à la finitude humaine un impudent solutionnisme technique, ou encore une production organisée d’ignorance qui conduit les populations à vivre dans un monde irrationnel — un monde faux. La résilience prétend prôner la vie qui vainc, quand elle cache en réalité une vie mutilée. Or à Fukushima comme ailleurs, « le malheur n’est pas un mérite ». [L.M.]
L’échappée, 2021




