Agenda militant
Ailleurs sur le Web
![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)
- Au cœur du capital (12/03)
- Le débat des représentants des partis, avec Paul Vannier (12/03)
- Meeting avec Bagayoko, Coquerel et Mélenchon à Saint-Denis ! (11/03)
- Ludivine Bantigny, "La Bourse ou la vie. Le Front populaire, histoire pour aujourd’hui" (11/03)
- C’est quoi le "marxisme classique" et le "marxisme occidental" ? (10/03)
- “Le socialisme est la maison commune de tous les combats justes.” – Entretien avec Joseph Andras (10/03)
- Sur Franceinfo : Brigitte Boucher et les irresponsables (10/03)
- Ce que révèle l’affaire Epstein (10/03)
- Au Liban, d’une guerre coloniale à l’autre et du droit de résister (10/03)
- POUR UN FRONT ANTIFASCISTE AU SECOND TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES (10/03)
- Meeting de la campagne municipale LFI à Lille (10/03)
- Meeting avec Jean-Luc Mélenchon et Sophia Chikirou à Paris ! (09/03)
- Colombie : la gauche de Gustavo Petro valide le dernier test des législatives avant la présidentielle (09/03)
- Penser l’émancipation autrement, discuter l’apport de marxistes hétérodoxes [Podcast] (09/03)
- Terrorisme d’Ultra-droite (08/03)
- "L’Iran est sur le point d’obtenir l’arme nucléaire" : trente ans de prophéties démenties (08/03)
- Hommage au chercheur marxiste Michael Parenti – Compilation d’entretiens (08/03)
- La guerre de trop : les Américains et les Israéliens n’ont rien compris à l’Iran ! (08/03)
- Poutou annonce un probable soutien du NPA-A à Mélenchon en 2027 (07/03)
- Attaques en série contre LFI (07/03)
- Des maires insoumis pour tout changer | Clip officiel - Municipales 2026 (07/03)
- Romaric Godin : "La force fondamentale du capitalisme le pousse vers le néofascisme" (07/03)
- Quentin Deranque était en première ligne dans la bagarre (06/03)
- Tirer une balle dans la tête sans intention de donner la mort (06/03)
- Les États-Unis et Israël nous entraînent dans une barbarie suicidaire (06/03)
Liens
Marcuse et Mattick, les limites de l’intégration, hier et aujourd’hui
Ces articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » sont publiés à titre d'information et n'engagent pas la Tendance CLAIRE.
Marcuse et Mattick, les limites de l’intégration, hier et aujourd’hui (lundi.am)
Le texte de Paul Mattick, Les limites de l’intégration, l’homme unidimensionnel dans la société de classe, récemment republié aux éditions Grevis, est une critique de l’ouvrage de Herbert Marcuse, L’Homme unidimensionnel — essai sur l’idéologie de la société industrielle avancée (trad. Monique Wittig, Paris, 1975). Les questions fondamentales discutées dans ces ouvrages, marquées par les circonstances d’une époque, les années 1960, sont toujours les nôtres et méritent qu’on s’y attarde.
A l’origine du débat, on trouve un petit cercle informel de théoriciens radicaux qui, au milieu des années 1960, bataille contre la pensée sclérosée de la vieille gauche nord américaine, prisonnière de l’orthodoxie marxiste-léniniste staliniste, dont la « guerre froide » et la répression maccartiste avaient rigidifié les limites et renforcé le sectarisme. Parmi eux, Herbert Marcuse, Howard Zinn, Noam Chomsky, Joyce et Gabriel Kolko, Zellig Harris et Paul Mattick, qui avaient pourtant des parcours de vie et des expériences différentes. A priori, l’écart était grand entre Herbert Marcuse, intellectuel renommé de l’Institut de l’École de Francfort, universitaire brillant et auteur d’une vaste œuvre critique, et Paul Mattick, ancien jeune spartakiste, ouvrier révolutionnaire dans l’Allemagne des années 1920, puis militant dans les conseils de chômeurs de Chicago des années 1930, profond connaisseur autodidacte de l’œuvre de Marx, théoricien du mouvement communiste anti-léniniste ainsi que des théories des crises. Les deux émigrés avaient été marqués par l’un des puissants bouleversements révolutionnaires du début du XXe siècle, en Europe, la révolution allemande des conseils de 1918-20, à laquelle ils avaient participé. Mais c’est finalement sur le sol nord-américain qu’ils s’étaient connus et qu’ils vont confronter leurs analyses du capitalisme moderne et des possibilités de sa subversion.
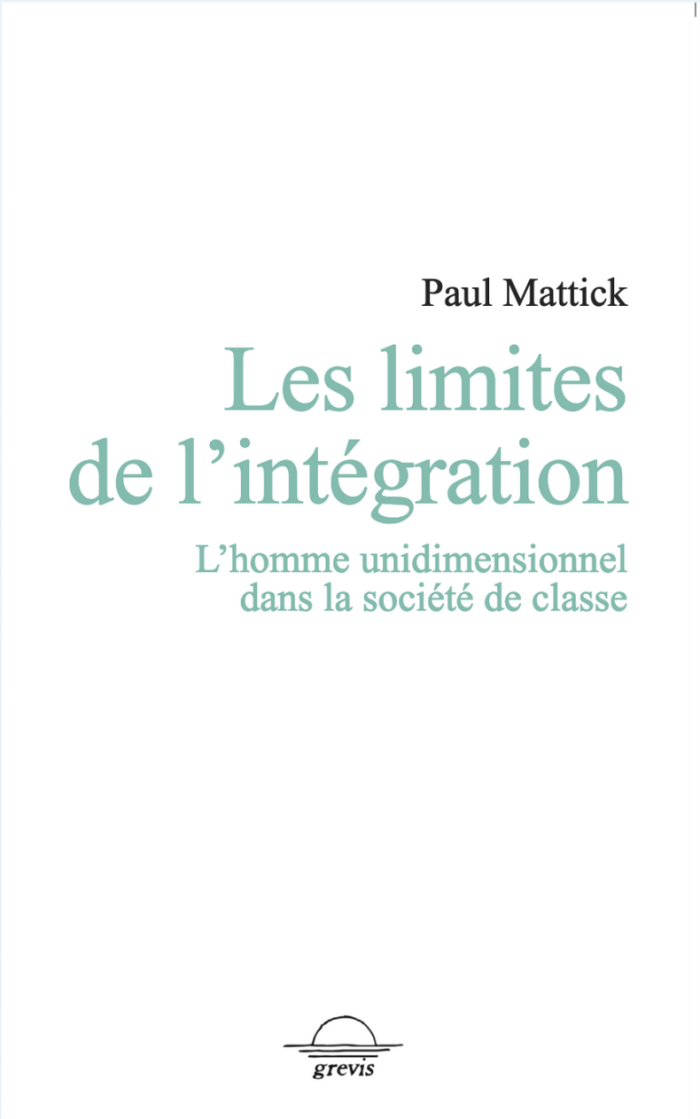
L’Homme unidimensionnel — essai sur l’idéologie de la société industrielle avancée de Marcuse, paru aux États-Unis en 1954, eut un fort impact sur les courants de « la nouvelle gauche » américaine qui se développa, pendant environ deux décennies, à la faveur d’une forte contestation sociale et de l’opposition à la guerre du Vietnam. Sur bien des points, Marcuse et Mattick avaient des conceptions divergentes. Toutefois, ils partageaient la même idée, selon laquelle la pensée et l’action radicale ne peuvent s’enraciner et se développer que dans un mouvement autonome et indépendant, capable de rompre avec l’aliénation bureaucratique et paralysante des vieilles institutions du monde ouvrier, partis et syndicats. Dans la préface qu’il signe à Les limites de l’intégration, l’Homme unidimensionnel dans la société de classe de Mattick, Gary Roth livre une éclairante mise en contexte des parcours des deux auteurs ainsi que de leurs désaccords politiques [1]. Roth souligne aussi le respect mutuel qui liait les deux auteurs, au delà de leurs divergences. Si Paul Mattick se trouvait en accord avec l’analyse critique que faisait Herbert Marcuse de l’idéologie dominante de la société « industrielle avancée », celui-ci, de son côté, reconnaissait que la critique de Paul Mattick sur son livre L’Homme unidimensionnel, touchait « le fond de la question » qu’il traitait. Paul Mattick mentionnait souvent un épisode illustrant la considération qu’il avait pour Herbert Marcuse, pour son intégrité politique. Professeur à la fameuse université Brandeis, celui-ci avait été rappelé à l’ordre par l’administration après avoir pris la parole lors d’un meeting contre la guerre du Vietnam. Alors que l’université travaillait ouvertement avec l’armée américaine à la mise au point de programmes de contrôle des populations, l’administration avait fait remarquer à Marcuse que la prise en compte des deux aspects d’un conflit devait toujours constituer un devoir académique. Autrement dit, et au nom de la fameuse objectivité des savants, il n’était pas censé prendre position contre la guerre. La réponse de Marcuse avait vite mis fin à la polémique : « Et quel est donc l’autre aspect d’Auschwitz ? ».
Chez Marcuse, la signification de l’idée de l’intégration capitaliste et de l’avènement de l’ « homme unidimensionnel », est liée à l’idée d’un capitalisme dynamique, en croissance et expansion continue. La « métamorphose du capitalisme » qu’il observait dans les États-Unis de l’après-guerre, il l’expliquait comme une réaction aux conditions de l’affrontement entre les deux blocs capitalistes et à la guerre froide. Se produisait alors un « changement quantitatif », caractérisé par « une marée sans cesse montante de marchandises, un niveau de vie toujours plus élevé » [2]. L’essor d’une société de consommation et d’abondance débouche sur un « capitalisme organisé », en mesure de se perpétuer sans rencontrer l’ancienne opposition de classe. En effet, l’amélioration constante des conditions de vie des travailleurs, neutralise la lutte contre l’exploitation, réduit les potentialités de contestation, de révolte et de subversion, créé les raisons pour que les opprimés s’intègrent au système. « Les classes mêmes qui incarnèrent jadis la négation du capitalisme y sont de plus en plus intégrées. » [3]. Plus précisément, selon Marcuse, on observe le déplacement de l’antagonisme au capitalisme vers la sphère de la consommation et vers les luttes menées par de nouveaux acteurs marginalisés par le système. Les nouvelles forces de contestation, d’opposition, émergent en dehors de l’ancien champ de la lutte de la classe ouvrière des pays industriels. C’est cette thèse qui est au centre de l’argumentation de Marcuse, de sa conception de l’avènement d’une société totalitaire intégrée, de l’homme unidimensionnel, que Mattick soumet à la critique.
Après avoir insisté sur le fait que tout état du capitalisme est transitoire, « un système social à la fois productif et destructeur » [4], Mattick s’attaque aux fondements de la thèse de Marcuse, l’idée d’un capitalisme en croissance continue avec des gains de productivité et une reproduction élargie permettant l’amélioration soutenue des conditions de vie. Nous étions, il faut le rappeler, dans les années de la reprise de l’après-guerre. Mattick construit sa critique en partant de la théorie des crises du capitalisme, mettant au centre la baisse tendancielle du taux de profit — théorie qu’il avait reprise et développée à partir des travaux du théoricien marxiste Henryk Grossmann et qui lui avait permis d’élaborer une critique marxiste du keynésianisme et de ses politiques interventionnistes [5]. En 1969, Mattick écrivait : « Rien ne permet de caractériser la situation actuelle, tant à l’échelle du monde entier, qu’à celle des diverses nations prises séparément —, par la stabilisation, l’organisation et l’intégration, comme le fait Marcuse. Au contraire, le monde capitaliste est infiniment plus instable, désorganisé et désintégré qu’il ne l’était, par exemple, il y a un demi-siècle. » [6]
Se projetant à long terme, Mattick défend que seul un raisonnement « à un niveau d’abstraction élevé (…) permet de porter au grand jour les rapports sociaux fondamentaux, dissimulés par les catégories économiques capitalistes. » [7]. C’est sans doute cette démarche qui explique l’intérêt que Marcuse portait à la critique de Mattick, lui reconnaissant la capacité à questionner et à discuter les fondements de l’avènement de la société de l’homme unidimensionnel. Mattick revient ainsi sur divers thèmes inhérents au mode de production capitaliste d’hier comme d’aujourd’hui, l’idée d’un capitalisme organisé, le rapport entre progrès technologique et abondance, l’opposition entre secteur privé et public dans la production de profit, la question du « loisir » et de l’abolition du travail, entre autres. Il aborde aussi les rapports entre capitalisme d’Etat (ou socialisme d’Etat) et les systèmes où domine le capitalisme privé et l’ « unification économique et politique » du monde capitaliste telle que le prédisait Marcuse. Mais surtout, Mattick questionne longuement la possibilité de la poursuite du développement du capitalisme dans les années de l’après-guerre, mouvement qui constitue le fondement des idées de Marcuse sur l’avènement d’une société d’abondance et l’évolution du capitalisme. Qu’il le fasse dès les années de l’après-guerre donne à son texte une valeur toute particulière.
Ramenée au présent, si le discours de Marcuse sur l’intégration semble difficilement recevable, la question de la soumission des classes opprimées au système se pose toujours et avec de plus en plus d’acuité. Plus qu’une intégration enracinée dans l’essor d’une société d’abondance et de consommation de biens, une amélioration des niveaux de vie, on assiste à une acceptation-soumission nourrie par la crainte de l’effondrement des conditions de travail, de salaire et de vie. A la frayeur de la disparition des sécurités qui soudaient l’« intérêt général » interclassiste d’hier, s’ajoute désormais la terreur de la catastrophe climatique vécue en direct et rappelée constamment par ceux qui en sont responsables. La peur et la paralysie forgent la passivité et, à terme, une forme de soumission. Plus qu’une intégration, c’est la désintégration du tissu social qui s’étend.
Seules, des luttes capables de récréer du collectif antagonique aux logiques de production de profit et contestant les rapports sociaux capitalistes sont en mesure d’inverser la tendance, percer le mur de l’impasse qui se profile devant nous. Il ne peut y avoir du commun, on ne produit pas de nouvelle société, tant que l’égalité politique formelle couvre l’inégalité sociale. Face à la dynamique capitaliste qui produit sans cesse de la précarité, de l’appauvrissement et de l’isolement, bref, de la séparation, toute lutte sectorielle, marginale, ne peut survivre que dans la contestation globale du système. Le refus de l’organisation existante de la société est la seule perspective mobilisatrice qui peut élargir et non enfermer. Aujourd’hui plus que jamais, le capitalisme ne peut se transformer, de par son propre mouvement, en un système différent. Il montre, par contre, sa capacité de détruire ses propres conditions de reproduction, avec le désastre social qu’une telle route implique. Tout se passe comme si on assistait au mouvement d’un capitalisme dont les possibilités de rebond se font chaque jour plus rares, surtout plus destructrices. Une époque où, et pour reprendre la formule de Marx, sous le capitalisme toute solution apparaît comme un nouveau problème.
La société totalitaire intégrée qu’envisageait avec crainte Marcuse ne s’est pas vérifiée, on tendrait plutôt vers une société « instable, désorganisée et désintégrée », pour reprendre les mots de Mattick, où des traits totalitaires remplacent progressivement les principes de l’idéologie démocratique de l’intérêt général.
Pour Mattick, ce sont les difficultés dans la production de profit, la rentabilité du capital et non l’évolution de la société de consommation, qui posent les limites de l’intégration. Ce sont les limites des politiques keynésiennes et leurs effets contradictoires qui vont à l’encontre d’une évolution vers un capitalisme organisé. Où le progrès technologique engendrerait l’abondance et annoncerait l’abolition du travail, l’intégration et l’avènement de l’homme unidimensionnel. À l’encontre de l’analyse de Herbert Marcuse, Paul Mattick ramène constamment son analyse critique aux facteurs destructifs du capitalisme, à ses déséquilibres. S’il considère qu’une société d’exploitation rend impossible le passage à une société unidimensionnelle, il questionne aussi l’existence possible d’une société capitaliste qui aurait la capacité d’effacer toute opposition de classe.
En cinquante ans, la position respective des deux auteurs par rapport à la situation réelle s’est bien évidemment modifiée. Dans les années 1960, l’analyse de Marcuse trouvait une large acceptation, paraissait correspondre à l’évolution de la situation alors que la critique de Mattick, son intention de porter au grand jour les rapports sociaux fondamentaux, se perdait dans les méandres d’un récit théorique qui semblait sans lien avec la situation réelle. L’idée d’une société d’abondance et d’une amélioration générale des conditions de vie des travailleurs dont parlait Marcuse a mal résisté à l’évolution du capitalisme. Elle s’est vue niée par la tendance à un appauvrissement général, par l’accroissement des inégalités sociales, par la concentration de la richesse, par la prolétarisation de couches salariées auparavant appelées « classes moyennes ». De même, et au contraire de ce que suggère Marcuse dans son livre, le développement des nouvelles technologies, loin d’ouvrir sur une société de loisir, a fait apparaître une masse croissante de travailleurs déqualifiés, précaires et mal payés. En revanche, le déclin des formes traditionnelles de lutte traduit indiscutablement l’effondrement du vieux mouvement ouvrier, incapable de survivre au rétrécissement de l’ancien champ de négociation que le capitalisme lui avait concédé. Cela étant, compte tenu du développement massif d’un travail salarié précaire et fragilisé, le combat contre l’appauvrissement général tend à se déplacer à nouveau du champ de la consommation et de la distribution vers celui de l’exploitation. De récentes luttes, nées hors de la production, ont recherché dans la question sociale les repères pour garder leur dynamique. Ce fut le cas en France avec la mobilisation des Gilets Jaunes. C’est ainsi que, aujourd’hui, on peut prétendre que les positions se sont inversées. L’idée du développement d’un capitalisme organisé et capable de générer une continuelle amélioration de la condition de vie des exploités, telle que Marcuse la défendait, est en décalage avec la route actuelle du capitalisme et avec ses conséquences sociales, alors que la critique de Mattick se trouve plus en prise avec les questions économiques et sociales de la période. Les arguments critiques de Mattick, qu’il a organisé par ailleurs dans une critique du keynésianisme, se trouvent aujourd’hui confirmés par la marche du capitalisme. Plus encore, ils permettent d’interpréter la réaction néolibérale du capitalisme privé à l’interventionnisme d’Etat.
Entre-temps, il est vrai, nous somme passés d’une période de croissance soutenue par l’État à celle d’une stagnation où l’interventionnisme, toujours présent, ne joue plus le rôle dynamiseur du capitalisme qui lui était naguère attribué.
Aujourd’hui comme hier, ces questions sont les nôtres et le débat ne peut que stimuler la pensée critique et la recherche de voies nouvelles nécessaires d’opposition au monde tel qu’il est. Pour autant que cette possibilité puisse émerger du désastre en cours et prendre forme dans des luttes collectives revendiquant leur autonomie et un projet émancipateur.
Charles Reeve
BONNES FEUILLES
Les niveaux de vie élevés, dont jouissent les pays industriels avancés, sont eux-mêmes appelés à entraver l’expansion capitaliste. Pour qu’ils demeurent intacts, alors que la rentabilité du capital privé diminue, il faudrait que la sphère de production non rentable s’élargisse en permanence, ce qui suppose à son tour des gains de productivité constants. Or voilà qui signifie, dans les conditions actuelles, une augmentation régulière de la masse des chômeurs dont l’entretien coûte d’autant plus cher ; ces dépenses, ajoutées à tous les autres « faux-frais de l’abondance » vont tôt ou tard grever au suprême degré les « ressources économiques et techniques », quelques grandes qu’elles puissent être. Il sera impossible, dès lors, de maintenir l’« abondance », à moins que la nature même de la société soit changée – à moins que le principe de la rentabilité soit éliminé. Étant donné les difficultés sociales que son dépérissement ne peut manquer d’engendrer, cette « abondance » elle-même se transformera en un facteur révolutionnaire.
On ne veut nullement dire par là que l’« abondance » provoque automatiquement la révolution, mais, tout simplement, que la naissance de sentiments d’opposition n’est pas liée à une paupérisation absolue. Les hommes n’ont pas besoin d’être réduits à la famine pour entrer en révolte ; celle-ci peut avoir lieu dès que leur niveau de vie habituel se trouve gravement atteint, ou qu’ils se voient interdit d’accéder au niveau de vie qu’ils jugent naturel. Mieux les hommes vivent, moins ils sont disposés à subir des privations, plus aussi ils tiennent à leur mode de vie. C’est en ce sens qu’une diminution de l’« abondance » régnante est susceptible de réduire à néant le consensus actuel.
Marx dit quelque part que « le prolétariat est révolutionnaire, ou il n’est rien ». En ce moment, il n’est rien et il a de fortes chances de continuer à ne rien être. Mais ce n’est pas une certitude absolue. Marx a dit aussi que « les idées dominantes sont celles des classes dominantes », ce qui n’empêche pas l’essor d’idées subversives. On ne saurait douter cependant que ces idées-là ne se propagent que dans un climat de mécontentement et que la prospérité présente – si factice qu’elle soit – n’est pas de nature à l’engendrer, du moins avec l’ampleur nécessaire. D’où la « pensée unidimensionnelle », l’absence d’opposition au sein de la société industrielle avancée. Comme c’est là chose qui va de soi dans pareilles conditions, nous ne discuterons pas l’analyse pénétrante que Marcuse donne de l’idéologie dominante. Nous ne pouvons qu’approuver ses critiques et lui en savoir gré. Depuis Marx, elle n’a rien pour surprendre au demeurant cette constatation que fait notre auteur : « La société unidimensionnelle a modifié le rapport du rationnel à l’irrationnel. En opposition avec les aspects fantastiques et démentiels de sa rationalité, le domaine de l’irrationnel devient le domaine du véritable irrationnel. » [8] Telle est en effet la conséquence dernière du fétichisme de la marchandise et du capital.
Une certaine rationalité non fétichiste subsiste sans doute – Marcuse lui-même en est une preuve –, mais elle n’a pas la moindre importance pratique. L’opposition actuelle reste un facteur négligeable. Faute de représenter des intérêts matériels d’un poids assez considérable pour faire front à ces intérêts matériels dont l’idéologie dominante – ou plus exactement : le délire dominant – est l’expression, elle n’a pu jusqu’à présent de- venir une force sociale. Une opposition qui a perdu toute force matérielle cesse d’être effective. Elle devient un luxe, le regard perspicace et froid que des hommes intelligents promènent sur la société et ses victimes, qu’ils pourraient bien mépriser, quant à eux, en raison de l’acharnement que ces mêmes victimes mettent à défendre l’irrationalité triomphante. Pourtant, la minorité abandonnée à elle-même doit vivre au sein de cette irrationalité et y consentir bon gré mal gré, nécessité dont on fait vertu pour la rendre moins amère. Lors même que l’opposition revêt une forme politique, elle ne parvient pas à trouver une voie idoine, ainsi de la lutte des Noirs américains pour les droits civiques, cet objectif absurde et qui, tout absurde qu’il soit, demeure irréalisable. L’« outsider » ne peut s’évader des conditions existantes – à moins de jouer son va-tout dans l’incendie et le pillage. Mais en ce cas il se trouve déjà sur la voie ramenant à une réalité qui, elle, est rationnelle.
Les autorités, qui représentent la grande majorité, les gens comme-il-faut, y compris la plupart des ouvriers, viennent aisément à bout des révoltes sporadiques où le désespoir jette de faibles minorités. Noir ou blanc, « le substrat des parias et des outsiders » peut être anéanti petit à petit, en raison des conditions de vie mêmes qu’on lui réserve. Mais à mesure qu’il croît en nombre – et il est en train de croître –, la fréquence de ses actes de révolte augmente elle aussi, en même temps que bien des gens comme- il-faut s’aperçoivent qu’ils risquent fort de figurer un jour, à leur tour, parmi les rebuts humains du capitalisme. À s’en rapporter au passé, la montée de la misère fait de cette misère une force sociale, et la force conduit à l’action consciente en vue d’éliminer la misère. Quand Marcuse dit à propos des chômeurs que « les sociétés établies ont des ressources économiques et techniques telles qu’elles peuvent se permettre des conciliations et faire des concessions aux misérables ; elles ont des forces armées pour faire face aux situations d’urgence » [9], il décrit correctement la situation actuelle au sein des pays industriels avancés. Mais la vérité d’aujourd’hui n’est pas forcément la vérité de demain, et le sera en tout cas d’autant moins si le développement du capitalisme tend à prendre le même chemin que par le passé.
Nous ne saurions, il va de soi, nous régler sur le passé. Il peut ne pas se répéter ; l’ère des révolutions est peut-être définitivement close et la société unidimensionnelle, immobiliste et totalitaire, peut-être inévitable. Mais si nous ne pouvons juger d’après le passé, nous ne pouvons pas juger du tout. Dès lors, tout est possible – même une révolution prolétarienne. Voilà sans doute qui présuppose que le prolétariat continue d’exister, lui qu’on prétend si souvent en état de dissolution déjà avancée, parce qu’il a perdu non seulement sa conscience de classe, mais aussi ses fonctions sociales. Il n’est pas rare de voir faire la différence entre la « classe ouvrière classique », c’est-à-dire celle des ouvriers d’industrie au sens de Marx, et la population active moderne, dont seule une petite partie exerce une activité productive. Distinction bien artificielle : car ce n’est pas la situation professionnelle du prolétariat qui le différencie de la bourgeoisie, c’est le fait qu’il n’est pas maître de son existence parce qu’il n’est pas maître des moyens de production. Quel que soit leur métier, les travailleurs salariés restent des prolétaires. Le nombre des travailleurs employés dans les industries non productives (ce qu’on appelle le secteur des services) s’est incontestablement accru, mais cela ne change rien à leur position sociale vis-à-vis des capitalistes. Par suite de la concentration du capital et de l’élimi- nation de la petite bourgeoisie propriétaire, il y a aujourd’hui beaucoup plus de prolétaires que ja- mais. Certes, une fraction non négligeable de ces employés jouit, grâce à ses revenus, de niveaux de vie bourgeois ou petits-bourgeois. Mais, en matière de niveaux de vie précisément, la grande majorité d’entre eux tombe dans la catégorie des travailleurs salariés, quelque improductif que puisse être leur travail.
Il se peut que les travailleurs actifs ne s’estiment pas des prolétaires, ou répugnent à se considérer comme tels, et que ce peu d’empressement à reconnaître la réalité pour ce qu’elle est contribue à renforcer le caractère unidimensionnel de l’idéologie dominante. Mais, pour conserver sa fonction sociale, une idéologie, quelle qu’elle soit, doit être capable peu ou prou de rendre compte du réel, faute de quoi elle perdrait toute efficacité. Si le travailleur bien payé a des raisons de se figurer qu’il échappe à la condition prolétarienne, le chômeur en a beaucoup moins ; quant au miséreux, traité en paria, il ne peut pas nourrir pareille illusion. Mais admettre sa condition propre, ne signifie nullement acquérir du même coup une conscience de classe, au sens révolutionnaire du terme. C’est là seulement une condition préalable au développement d’une idéologie et d’un mouvement anticapitalistes.
Quand Marx parlait de la « mission historique » de la classe ouvrière – mettre fin au système capitaliste –, il désignait ainsi, comme sa théorie de l’accumulation permet de l’inférer, l’expropriation du plus petit nombre par le plus grand. Il était convaincu, à juste titre, que l’expansion du capital a pour effet de polariser la société en une petite minorité de capitalistes et une immense majorité de non-propriétaires, contraints pour subsister de vendre leur force de travail, et voués aux pires calamités s’ils n’y arrivent pas. Le prolétariat d’industrie du siècle dernier a fini par prendre les dimensions d’une masse amorphe de salariés, employés dans une foule de branches professionnelles, toutes soumises aux fluctuations du marché et aux aléas, heureux ou non, du processus d’accumulation. Quelle que soit l’idée qu’ils se font d’eux-mêmes et de leur condition, il n’empêche qu’ils appartiennent non à la classe des dirigeants, mais à celle des dirigés.
Fondamentalement, la société capitaliste est divisée en deux classes, nonobstant l’existence au sein de chacune de ces classes d’une différenciation sociale très poussée. La classe dirigeante est celle qui décide ; l’autre, malgré sa différenciation interne, se trouve à la merci de ces décisions qui déterminent la condition générale de la société, quand bien même elles sont prises en fonction des seuls besoins particuliers du capital. Lucides ou stupides, ces décisions ne peuvent avoir qu’une fin : perpétuer par tous les moyens l’ordre établi. Il arrive sans doute que les couches de la population, qui n’ont aucun pouvoir de décision, soient en désaccord avec les grandes options de la classe dirigeante, parce que celles-ci ne leur paraissent pas conformes à leurs intérêts ou adaptées à la situation. Mais pour influer sur la décision ou la modifier après coup, il faut exercer un pouvoir propre.
Tout ce que les dirigeants décident doit être exécuté dans la sphère de production, celle-ci commandant le mode de répartition des produits et le style de consommation. Une classe, qui ne dis- pose pas des moyens de production, n’a pas la moindre parcelle d’un pouvoir qui s’exerce tant par des moyens idéologiques que par la force. Mais ni le droit de propriété, ni l’idéologie, ni la force ne produisent quoi que ce soit. C’est sur le travail du producteur que repose tout l’édifice social. Les travailleurs productifs ont un pouvoir latent beaucoup plus grand que celui de tout autre groupe social ou que celui de tous les autres groupes sociaux réunis. Transformer ce pouvoir latent en pouvoir effectif n’exige ni plus ni moins que la perception claire des réalités sociales, et la traduction de cette connaissance en actes permettant aux producteurs de réaliser leurs buts spécifiques.
La grande affaire de l’idéologie bourgeoise, c’est de contester cette vérité première, comme le révèlent plus particulièrement des théories économiques qui déprécient systématiquement les résultats tangibles du travail productif. Mais on a beau soutenir que l’importance du prolétariat d’industrie ne cesse de s’amenuiser, on lui accorde plus d’attention que jamais ; non sans d’excellentes raisons d’ailleurs : n’est-il pas vrai que sa capacité – toute virtuelle, assurément – de diriger la société ne fut jamais aussi grande ? La « socialisation » de la production, au niveau de la technique autant qu’à celui de l’organisation, c’est-à-dire le fait que les divers aspects du processus de la production nationale sont étroitement solidaires et que le sort de la population entière dépend directement de la bonne marche de la production, voilà ce qui donne à la classe ouvrière un pouvoir quasi absolu sur le cours suivi par la société. Elle peut y mettre un terme le plus simplement du monde : en se croisant les bras. Qu’en leur qualité de membres de cette société, les ouvriers hésitent à recourir à une solution aussi extrême et qui ne tarderait pas à les frapper eux- mêmes, cela se conçoit aisément ; il n’en demeure pas moins que s’ils décidaient de transformer la société, ils seraient en mesure de l’ébranler jusque dans ses fondements. C’est pour cette raison que les syndicats ouvriers ont été adaptés aux structures capitalistes et chargés de maintenir les conflits du travail dans des limites « acceptables », et pour cette raison aussi que les gouvernements – y compris les gouvernements socialistes – réglementent la grève, tandis que les gouvernements totalitaires, qui ont le plus conscience du pouvoir latent de l’action ouvrière, mettent carrément la grève hors la loi.
Du fait de ce pouvoir latent, le prolétariat d’industrie reste aujourd’hui, comme il l’était hier, la seule classe capable – à condition de le vouloir – de transformer réellement la société. Ce qui importe ici, c’est de dégager l’existence virtuelle de ce pouvoir, indépendamment de la question de sa- voir si les ouvriers pourront et voudront s’en servir un jour. Car si cette virtualité n’avait pas le moindre fondement social, si sa traduction en actes n’apparaissait pas comme une possibilité réelle, il n’existerait plus aucun espoir de voir des forces nouvelles l’emporter sur les forces matérielles de la coercition. Dès lors, le seul espoir, qui demeurerait permis, serait de croire que les idées à elles seules sont en mesure de transformer à la fois l’idéologie dominante et les intérêts matériels qui lui servent de base.
Toute lutte sociale est sans doute, simultanément, un combat idéologique ; mais elle ne peut être couronnée de succès si elle ne dispose pas d’une force matérielle qui lui permette d’enfoncer les défenses de l’ennemi. Il n’est pas absolument inconcevable que l’irrationalité croissante de la société entraîne un revirement de la population dans sa grande masse, indépendamment de son appartenance de classe, et la conviction toujours plus affirmée que les rapports d’exploitation ayant perdu toute espèce de nécessité et toute espèce de sens, il faut par conséquent réorganiser la société au profit de tous et offrir ainsi à tous la possibilité d’une existence enfin digne d’être vécue. Voilà qui équivaudrait à un triomphe de la raison sur les irrationnels intérêts de classe et à l’autodécomposition de la classe dominante. Faute de pareil miracle, la société nouvelle n’émergera qu’à l’issue d’un gigantesque combat poursuivi par tous les moyens possibles à la fois dans le champ idéologique et dans la sphère des rapports de force réels.
En cas de crise sociale, il est avéré que des couches étendues de la population, habituellement regardées comme étrangères à la classe ouvrière, prennent néanmoins son parti contre la classe dominante. Même aujourd’hui, alors que les travailleurs ne sont pas encore sortis de leur apathie, les étudiants, les intellectuels et autres membres de la nouvelle classe moyenne non propriétaire portent un intérêt passionné à des questions politiques apparemment isolées, telles que la guerre, le désarmement, les droits civiques, etc. Mais ce mouvement de contestation restera privé d’efficacité tant qu’il ne disposera pas d’un pou- voir politique réel, lequel ne peut tirer son origine que de la population laborieuse. Sans révolution prolétarienne, pas de révolution désormais.
Si l’on suit Marcuse, une révolution ouvrière est parfaitement exclue dans les pays industriels avancés. Et même si, par impossible, elle avait lieu, la gestion des pouvoirs productifs par « en bas » ne provoquerait à son avis aucun change- ment social qualitatif. L’idée d’un changement pareil était, dit-il, « légitime du temps que les ouvriers étaient la négation vivante et la condamnation de l’ordre établi ; elle continue de l’être partout où ils le sont encore. Cependant partout ou la classe ouvrière est devenue un pilier du mode de vie prépondérant, son accession au pouvoir ne ferait que prolonger ce mode de vie dans un cadre différent. » [10] En d’autres termes, la bourgeoisie et le prolétariat sont dorénavant interchangeables ; quelle que soit la classe au pouvoir, le mode de vie ne subirait aucun changement fondamental.
Si la classe ouvrière est devenue le « pilier » en question, toutes les autres classes se trouvent à coup sûr dans le même cas ; la différence, c’est que l’« abondance », qui a fait de la première un « pilier » du système, reste négligeable – quelque notable qu’elle puisse être – comparée à celle dont jouissent les autres classes. L’« abondance » demeure très inégalement répartie ; d’où une lutte permanente en vue de s’approprier une part plus grande du gâteau. Mais, du fait même de cette rivalité, personne ne s’estime rassasié et n’a vrai- ment le sentiment de vivre dans l’opulence. En vérité, l’« abondance » que connaît la classe ouvrière est plutôt miteuse ; aussi bien n’est-elle acquise qu’au prix d’efforts inouïs. Quoi qu’il en soit, elle suffit à combler les vœux des travailleurs, en ce sens tout du moins qu’ils ne s’interrogent pas sur l’opportunité d’une transformation sociale. L’hypothèse d’une « gestion par en bas », qui laisserait les choses en l’état, ne semble donc pas près d’être soumise à l’épreuve des faits.
Toute cette conception suppose que le capitalisme soit capable de maintenir à sa hauteur actuelle le niveau de vie des masses laborieuses ; que ce postulat se trouve infirmé en pratique, et la théorie s’effondre. Pour notre part, nous avons cherché à montrer que le capitalisme en est incapable. Certes, la situation actuelle prouve le contraire, mais cela ne prouve rien quant à l’avenir. Le problème, c’est de déterminer le sens de l’évolution dans son ensemble, car seule une petite partie du monde jouit de l’« abondance », ce- pendant que la condition humaine en général devient de plus en plus intolérable. Semblable état de choses ne saurait changer dans le cadre du capitalisme, dont la fin ne peut pas être conçue autrement que comme l’abolition des rapports de classes et de la condition prolétarienne. Unidimensionnelle, la société ne l’est que sur le plan idéologique ; à tous autres égards, elle demeure capitaliste comme devant. Né de la prospérité, le conformisme idéologique disparaîtra avec elle, car il n’est pas doué d’une existence autonome. Dans la mesure où le raisonnement théorique a une validité et permet des prévisions, tout indique qu’on s’achemine non seulement vers une détérioration de la prospérité, mais encore vers la fin du système capitaliste lui-même.
(p.129-144)
(…)
Revenons maintenant à des perspectives plus immédiates. En effet, vu le comportement actuel de la classe ouvrière, et puisque le socialisme ne pourra se faire sans elle, tout semble indiquer que l’avènement de celui-ci est renvoyé aux calendes grecques et, en attendant, a toutes les apparences d’un « rêve marxien ». Il suffit cependant de penser à ce qui a toutes chances d’arriver en l’absence de révolution pour voir se dessiner la possibilité d’un changement d’attitude pratique. À cet égard, l’avenir transparaît déjà dans le présent, et une projection quantitative du second sur le premier, à elle seule, montre que l’idée selon laquelle il est possible de résoudre les problèmes sociaux par des méthodes capitalistes n’est qu’une utopie absolue. « Socialisme ou barbarie », telle est la seule alternative concevable, encore qu’un état de barbarie puisse engendrer des contre-forces susceptibles de le transformer.
La conscience de classe, a-t-on dit souvent, est liée à la misère. Or, une chose est certaine : la population mondiale est appelée à sombrer dans une misère qui dépassera de loin tout ce qu’on a connu à ce jour : cette misère frappera mêmes les minorités privilégiées des pays industriels qui, jusqu’à présent, se croyaient à l’abri des conséquences de leurs propres agissements. Parce qu’il n’existe pas de « solutions économiques » aux contradictions du capitalisme, on cherche à imposer des « solutions économiques » par des moyens politiques – moyens adaptés, cela va de soi, à la structure socio-économique du capitalisme. En d’autres termes, les effets destructeurs de la production de capital vont s’exacerber encore : à l’intérieur, la production pour le gaspillage ne cessera de s’élargir, tandis qu’à l’extérieur, de vastes territoires, dont la population, peu désireuse de faire son propre malheur, aura refusé de se plier aux exigences de profit des puissances étrangères, seront en proie à la dévastation. Et, à mesure que les fruits de la productivité accrue seront dissipés, dans le cadre d’une concurrence meurtrière en vue de pallier les effets de la baisse des profits que provoque la généralisation de la misère, les îlots bénis de l’« abondance » seront submergés à leur tour.
Sans doute les raisons ne manquent pas de penser que rien n’ébranlera les masses laborieuses, qu’elles préféreront la misère à la lutte contre le système qui en est la cause. Mais l’absence de conscience révolutionnaire ne signifie pas l’absence de lucidité. Il est par conséquent beaucoup plus vraisemblable que la classe ouvrière n’acceptera pas à l’infini le destin que le système capitaliste lui réserve ; un point de rupture peut être atteint, à partir duquel la conscience de classe viendra s’unir à la lucidité. L’apparition d’une volonté révolutionnaire, le passage à l’action autonome, ne seront pas forcément précédés d’une longue période d’opposition résolue, de tous les instants. Apathique dans certaines conditions, la classe ouvrière peut se révolter dans d’autres. Et parce qu’elle est vouée à souffrir plus que les autres classes sociales des graves à-coups de la production de capital et des entreprise guerrières de la classe dirigeante, elle sera selon toute probabilité la première à briser avec l’idéologie unidimensionnelle inhérente au règne du capital.
Soit dit une fois de plus, il ne s’agit nullement d’une certitude. Une chance existe, c’est tout – comme Marcuse le note dans un contexte quelque peu différent. Et si cette chance existe, elle existe non parce qu’une partie du prolétariat se trouve exclue du processus d’intégration capitaliste, mais parce que le système dominant risque fort d’anéantir le monde avant qu’une possibilité de l’arrêter se présente. L’intégration dans la mort, telle est la seule voie réellement laissée au capitalisme. De toute façon, l’homme unidimensionnel n’en a plus pour longtemps. Il disparaîtra au premier effondrement de l’économie capitaliste – dans les bains de sang que l’ordre établi est en train de lui préparer. Arrivé à l’apogée de sa puissance, le capitalisme est aussi arrivé au plus haut point de vulnérabilité ; il ne débouche nulle part ailleurs que sur la mort. Si faibles que soient les chances de révolte, c’est moins que jamais le moment de renoncer au combat !
(p.148-151)
[1] Gary Roth est l’auteur d’une riche biographie de Paul Mattick, Marxism in a Lost Century : a Biography of Paul Mattick (Brill/ Haymarket Books, 2015). Il existe en français un court texte autobiographique de Paul Mattick, La révolution fut une belle aventure, des rues de Berlin en révolte aux mouvements radicaux américains, 1918-1934 (L’Echappée, 2013).
[2] Le socialisme dans la société industrielle, p. 149.
[3] Le socialisme dans la société industrielle, p. 148.
[4] Les limites de l’intégration : l’homme unidimensionnel dans la société de classe, p. 62.
[5] Marx et Keynes, Les limites de l’économie mixte, Gallimard, 1972, réédition : Collection Tel/Gallimard, 2010.
[6] Les limites de l’intégration : l’homme unidimensionnel dans la société de classe, p. 121.
[7] Les limites de l’intégration : l’homme unidimensionnel dans la société de classe, p. 52.
[8] L’homme unidimensionnel, op.cit., p.301.
[9] Ibid., p. 311
[10] Ibid., pp.306-307




