Agenda militant
Ailleurs sur le Web
![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)
- Au cœur du capital (12/03)
- Le débat des représentants des partis, avec Paul Vannier (12/03)
- Meeting avec Bagayoko, Coquerel et Mélenchon à Saint-Denis ! (11/03)
- Ludivine Bantigny, "La Bourse ou la vie. Le Front populaire, histoire pour aujourd’hui" (11/03)
- C’est quoi le "marxisme classique" et le "marxisme occidental" ? (10/03)
- “Le socialisme est la maison commune de tous les combats justes.” – Entretien avec Joseph Andras (10/03)
- Sur Franceinfo : Brigitte Boucher et les irresponsables (10/03)
- Ce que révèle l’affaire Epstein (10/03)
- Au Liban, d’une guerre coloniale à l’autre et du droit de résister (10/03)
- POUR UN FRONT ANTIFASCISTE AU SECOND TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES (10/03)
- Meeting de la campagne municipale LFI à Lille (10/03)
- Meeting avec Jean-Luc Mélenchon et Sophia Chikirou à Paris ! (09/03)
- Colombie : la gauche de Gustavo Petro valide le dernier test des législatives avant la présidentielle (09/03)
- Penser l’émancipation autrement, discuter l’apport de marxistes hétérodoxes [Podcast] (09/03)
- Terrorisme d’Ultra-droite (08/03)
- "L’Iran est sur le point d’obtenir l’arme nucléaire" : trente ans de prophéties démenties (08/03)
- Hommage au chercheur marxiste Michael Parenti – Compilation d’entretiens (08/03)
- La guerre de trop : les Américains et les Israéliens n’ont rien compris à l’Iran ! (08/03)
- Poutou annonce un probable soutien du NPA-A à Mélenchon en 2027 (07/03)
- Attaques en série contre LFI (07/03)
- Des maires insoumis pour tout changer | Clip officiel - Municipales 2026 (07/03)
- Romaric Godin : "La force fondamentale du capitalisme le pousse vers le néofascisme" (07/03)
- Quentin Deranque était en première ligne dans la bagarre (06/03)
- Tirer une balle dans la tête sans intention de donner la mort (06/03)
- Les États-Unis et Israël nous entraînent dans une barbarie suicidaire (06/03)
Liens
Violences fascistes et riposte antifasciste dans la France des années 1930
Ces articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » sont publiés à titre d'information et n'engagent pas la Tendance CLAIRE.
Violences fascistes et riposte antifasciste dans la France des années 1930 – CONTRETEMPS
Extrait de : Chris Millington, Le massacre de Clichy. Violences politiques et policières au temps du Front populaire, Paris, Éditions Critiques, 2021, p. 142-150. Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Vivien Guarino et Fabien Trémeau.
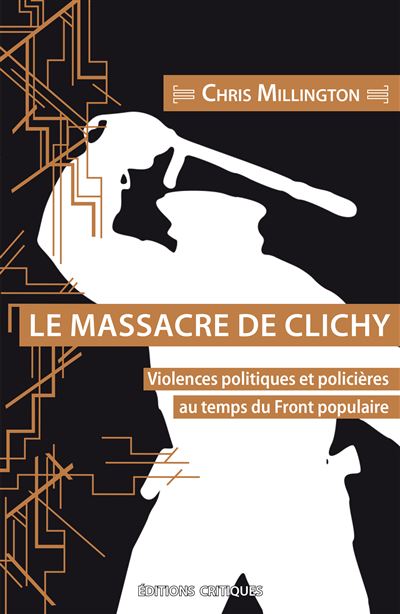
Présentation du livre
Le soir du 16 mars 1937, Clichy fut le théâtre d’une manifestation de masse organisée par le Front populaire local contre un rassemblement du Parti social français (ex Croix-de-Feu), le parti fasciste dirigé par le lieutenant-colonel de La Rocque. Face aux provocations de l’extrême droite et à une gestion policière calamiteuse, la manifestation se transforma en émeute. Six militants antifascistes et un gendarme trouvèrent la mort au cours des événements ou des suites de leurs blessures. Le lendemain, la “Red Riot” fit la une du New York Times et du Washington Post.
Tout en retraçant avec précision et de façon vivante cet événement majeur de l’entre-deux-guerres, l’auteur nous plonge dans ce contexte historique particulier où la rue était un lieu primordial de l’affrontement politique. Les stratégies des partis de masse, l’organisation et la doctrine de la police, ainsi que le rôle et le niveau de violence dans la vie politique sont autant de thèmes abordés qui nous restituent la culture politique et militante d’une époque aux tensions idéologiques extrêmes.
Tout lecteur qui se questionne sur la place de la violence en politique aujourd’hui et sur l’emploi de la police face aux mobilisations sociales et politiques, trouvera dans ce livre un précieux outil de réflexion.
***
Extrait
Lorsque la dépression économique mondiale commença à frapper la France après 1931, plusieurs nouvelles ligues furent fondées. En juin 1933, le magnat antisémite du parfum François Coty fondait la Solidarité française et nommait Jean Renaud à sa tête. Avec pas moins de 180 000 membres, la Solidarité française était la plus importante ligue fasciste au début des années 1930[1]. Les chemises bleues et les bérets assortis de ses ligueurs étaient une déclaration consciente de l’identité française, mais la politique violente de la Solidarité française égalait celle des fascistes à l’étranger, de ses attaques contre les Juifs dans les arrondissements du centre de Paris à sa menace de purger les ennemis avec de l’huile de ricin[2]. La ligue était présente lors de l’émeute de février 1934, et l’un de ses membres fut tué au cours des violences. Renaud imitait fièrement les pratiques fascistes étrangères. Le 14 avril 1934, la Solidarité française organisa une véritable expédition punitive à Morsang-sur-Org, à vingt kilomètres au sud de Paris. Leur cible était un instituteur aux tendances prétendument pacifistes. Une violente bagarre éclata à leur arrivée avant que les agents des gardes mobiles ne renvoient les ligueurs à Paris[3]. La ligue lança également des attaques contre la communauté juive de Paris. Le 25 septembre 1935, par exemple, des dizaines de ligues attaquèrent des cafés juifs dans le IIIe arrondissement[4]. L’apogée de la Solidarité française fut court : fin 1934, la ligue de Renaud était en déclin à cause des luttes intestines entre factions, de la détérioration des finances et de la mort de Coty en juillet.
Le Francisme de Marcel Bucard, un mouvement fasciste des années 1930 beaucoup plus petit, fut fondé en septembre 1933. Bucard revendiqua ouvertement le caractère fasciste de son mouvement, contrairement aux dirigeants des autres ligues qui tenaient à éviter l’accusation d’être sous l’emprise de l’Italie et de l’Allemagne. Bucard se plaisait à narguer la gauche : en septembre 1934, les Francistes publièrent une photographie d’un escadron de choc en uniforme qui semblait participer à un exercice de tir réel. La photo avait été prise dans un camp de jeunes francistes à Breuil-Bois-Robert (Seine-et-Oise) et était destinée à servir de support de propagande pour intimider la gauche locale[5]. Elle eut l’effet souhaité et fut reproduite plusieurs fois dans L’Humanité[6]. Vraisemblablement, la gauche voyait dans les francistes une menace supérieure à celle que constituait réellement ses 1 500 membres[7]. Néanmoins, la ligue était impliquée dans des violences très médiatisées avec ses opposants antifascistes, notamment à Basse-Yutz en juillet 1934, lorsqu’une foule antifasciste saccagea un café fréquenté par les francistes[8].
Dans la nuit du 6 février 1934, le rideau se leva sur une période de violence sans précédent dans la vie politique française de l’entre-deux-guerres, lorsque des milliers de ligueurs et de vétérans de guerre se déchaînèrent sur la place de la Concorde à la suite d’un scandale de corruption impliquant plusieurs membres du gouvernement du Cartel des gauches (élu en 1932). Des membres de l’Action française, de la Solidarité française et de l’Union Nationale des Combattants, association d’anciens combattants de droite, tentèrent de prendre d’assaut la Chambre des députés. Les Jeunesses patriotes s’approchèrent de la Chambre des députés par l’est, tandis qu’une autre ligue, les Croix-de-Feu, se dirigeait vers l’arrière du bâtiment. La police repoussa la foule et ouvrit le feu à deux reprises, tuant trois personnes et blessant des centaines d’autres. Seize personnes au total moururent des suites de blessures subies dans la nuit, tandis que douze autres personnes furent tuées lors des troubles survenus à Paris et dans ses environs entre le 7 et le 12 février[9].
La gauche réagit à l’émeute du 6 février avec inquiétude. Les partis communiste et socialiste dénoncèrent tous deux la nuit d’émeute comme une tentative de coup d’État fasciste, mais le conflit persistant au sein de la gauche vit chaque parti accuser l’autre de complicité avec l’extrême droite. Les dirigeants de gauche furent ainsi pris au dépourvu lorsque, le 12 février, des manifestations antifascistes d’ouvriers socialistes et communistes se mêlèrent dans les rues de Paris. Bien que les partis ne fussent pas unis immédiatement, la base était prête pour la création d’une alliance antifasciste. Chaque parti avait des idées différentes sur la meilleure façon de répondre à la menace fasciste. Le Parti communiste envisagea brièvement de relancer sa stratégie paramilitaire des années 1920. En fait, il avait sérieusement envisagé de relancer ses groupes paramilitaires d’autodéfense tout au long de l’année 1933, face à la menace « fasciste » grandissante et à la raclée que les communistes avaient reçue des Jeunesses patriotes lors d’une réunion politique à Paris. Cependant, les tentatives de la direction centrale pour stimuler les groupes provinciaux se heurtèrent à une léthargie apparente, à la désorganisation et au rejet de l’utilisation d’un groupe en uniforme. Cependant, si certains refusaient la présence d’uniformes, d’autres rejetaient ce style vestimentaire car il exposait les camarades à l’arrestation, la police pouvant facilement repérer les membres dans la rue et lors des réunions[10]. Fin 1934, le parti s’inquiéta des actions de certains de ces groupes, qu’il avait du mal à contrôler. Il ordonna que les camarades ne soient pas armés dans la rue ou lors des meetings, de peur que le parti ne soit accusé d’actes de provocation[11].
Le parti socialiste — qui n’avait pas adopté de stratégie paramilitaire quand apparurent les premières ligues au cours de la décennie précédente — donna le feu vert aux escouades antifascistes Toujours Prêt Pour Servir (TPPS) de Marceau Pivert, basées dans le département de la Seine[12]. Les escouades de Pivert portaient des matraques et des anneaux de caoutchouc sous leur béret pour protéger leur tête. Ils ne portaient pas d’uniforme mais étaient organisés comme d’autres groupes paramilitaires en « dizaines » et « centaines ». Lorsque les chefs de section criaient « Toujours prêt ! », leurs troupes répondaient « Pour servir ! ». Ces atours paramilitaires et le caractère semi-secret du groupe donnaient aux TPPS un air de mystère qui attirait les jeunes hommes des quartiers de Paris. Le groupe connut quelques succès notables tels que l’annulation d’une réunion des Croix-de-Feu à Conflans-Sainte-Honorine (Seine-et-Oise), et une attaque contre l’immeuble de l’Action française rue Asseline[13]. La création des TPPS marqua un changement important dans la politique du parti socialiste. Par le passé, les socialistes avaient utilisé le concept de « légitime défense » comme un euphémisme pour désigner l’action directe contre le régime, plutôt que contre leurs opposants politiques. Cependant, dans le contexte du milieu des années 1930, la cible de cette action passa de la République aux ligues. Finalement, les deux partis de gauche approuvèrent la stratégie d’auto-défense de masse*, qui impliquait l’organisation de grandes contre-manifestations pacifiques à proximité des meetings des ligues. Néanmoins, le Parti communiste assura à ses camarades que ses opposants continueraient à sentir la force de ses militants et les contre-manifestations conduisirent souvent à des violences avec les ligues et la police[14].
Le groupe d’extrême droite le plus important des années 1930 était sans aucun doute les Croix-de-Feu du lieutenant-colonel François de La Rocque. Fondées en 1927 comme association de vétérans décorés au front, sous la direction de La Rocque après 1931, les Croix-de-Feu s’orientèrent vers une politique paramilitaire d’extrême droite[15]. Ses escouades paramilitaires, appelées les disponibles ou Dispos, assuraient la sécurité des meetings et des manifestations ainsi que la protection des propagandistes de la ligue. Ces fonctions les mettaient en contact avec leurs ennemis politiques et des bagarres pouvaient s’ensuivre. Les Croix-de-Feu se distinguaient également par la mobilisation massive et périodique de ses membres. Au cours de ces rassemblements minutieusement organisés et orchestrés, des milliers de membres se rendaient en voiture à un endroit donné pour assister à un meeting de masse. Pour La Rocque et ses sympathisants de droite, les mobilisations des Croix-de-Feu démontraient le potentiel de la ligue à écraser la gauche si nécessaire ; pour la gauche, les mobilisations annonçaient une guerre civile à venir. Cependant, La Rocque rejeta toujours publiquement la violence, blâmant plutôt les tactiques agressives de ses ennemis de gauche. En 1935, les meetings des Croix-de-Feu dans les quartiers populaires furent la cible de contre-manifestations de gauche. Un affrontement entre des militants des Croix-de-Feu, des antifascistes et la police à l’extérieur d’un meeting à Villepinte en octobre 1935 fit sept blessés[16]. Le mois suivant, lors d’un meeting des Croix-de-Feu à Limoges, les ligueurs tirèrent sur des manifestants antifascistes. Les ligueurs des Croix-de-Feu n’enfreignaient aucune loi en organisant de tels rassemblements. Au contraire, les partisans de La Rocque suivaient scrupuleusement les obligations légales pour l’organisation d’un tel événement. Cependant, les meetings organisés dans les quartiers populaires étaient délibérément provocateurs, rendant la violence hautement probable[17]. Les ligueurs eux-mêmes se préparaient à profiter de l’occasion pour affronter leurs adversaires : après l’incident de Limoges, en novembre 1935, le procureur de la République estima que les ligueurs avaient été « fiers jusqu’à un certain point du péril qu’ils croyaient braver, puisque certains d’entre eux étaient armés […] fiers encore de résister à l’ordre d’évacuation, donné par Monsieur le préfet, qui garantissait leur sortie »[18].
La race pouvait être un ingrédient supplémentaire dans les affrontements violents. Cela n’était nulle part plus vrai qu’en Algérie où la présence d’une communauté de colons en grande partie de droite, d’une importante population juive qui jouissait de la pleine citoyenneté française et d’une majorité arabe assujettie créaient un climat de forte tension raciale. Les ligues d’extrême droite établirent chacune des sections sur le territoire, mais les Croix-de-Feu étaient de loin les plus efficaces, allant jusqu’à 30 000 membres à la mi-1936[19]. La démagogie antisémite des orateurs et de la presse de la ligue ne manqua pas d’attirer l’attention, malgré la ligne officielle selon laquelle les Croix-de-Feu acceptaient tous les « bons » français, quelle que soit leur race ou leur religion[20]. La ligue prenait en fait soin d’adapter sa rhétorique aux conditions spécifiques de chaque département. Elle minimisait ainsi son antisémitisme dans l’Alger plus modéré, tandis qu’à Oran, les membres se livraient à un antisémitisme violent contre l’importante communauté juive[21]. En août 1934, les ligueurs des Croix-de-Feu dans le département auraient incité les musulmans à un pogrom qui vit vingt-huit personnes tuées et 200 magasins saccagés[22]. En France métropolitaine, les groupes politiques recrutaient des Nord-Africains dans leurs unités paramilitaires, probablement en raison des préjugés racistes contemporains sur les caractéristiques inhérentes de ces hommes. Considéré comme un mercenaire agressif et belliqueux, qui de mieux pour s’engager en échange d’une maigre somme dans une unité de combat de rue ? Ces opinions étaient apparemment partagées par la police[23]. Les motivations de ces hommes pour rejoindre des groupes politiques sont introuvables dans la presse et les archives, pourtant, certains groupes pensaient manifestement que les Nord-Africains partageaient leurs propres opinions racistes. Ce n’est probablement pas une simple coïncidence si l’antisémite Solidarité française semblait plus proactive dans le recrutement de membres musulmans[24].
En juin 1936, la coalition du Front populaire nouvellement élue interdit les ligues. L’Action française avait déjà été dissoute en février à la suite d’une grave agression contre le dirigeant socialiste Blum. La dissolution des ligues se déroula avec peu de violence, à l’exception d’un affrontement entre la police et les militants sur la place de l’Étoile le 5 juillet 1936 au cours duquel 100 policiers furent blessés[25]. Certains récalcitrants continuèrent à porter leur insigne en public — un acte qui pouvait conduire à se battre avec des militants de gauche — mais l’extrême droite y consentit largement. La Rocque transforma les Croix-de-Feu en un parti politique, le Parti social français (PSF). Les « Équipes volantes de propagande » du parti, habillées de cuir, reprirent les fonctions des défunts Dispos. Mais le caractère paramilitaire du PSF était atténué comparé à celui de son prédécesseur. La Rocque avait réorienté le mouvement en s’éloignant de l’aspect paramilitaire masculin pour se tourner vers le travail social, une stratégie destinée à construire une contre-société pour défier la République. Néanmoins, les militants du parti étaient toujours prêts à commettre des violences si nécessaire : en octobre 1936, La Rocque organisa une violente contre-manifestation lors d’un meeting de la gauche au Parc des Princes à Paris qui vit des membres du PSF se battre avec la police et attaquer des antifascistes sur le chemin du rassemblement[26]. Un nouveau groupe politique se fit également connaître après 1936 : le Parti Populaire Français (PPF) de Jacques Doriot. Basé à Saint-Denis, où Doriot, ancien membre du Parti communiste, était maire, le PPF s’engagea volontiers dans des violences avec les antifascistes, comme à Lunel en octobre 1936, lorsque ses militants tirèrent avec leurs revolvers sur une foule de contre-manifestants de gauche[27].
Le milieu fertile de l’extrême droite des années 1930 donna naissance à une société secrète violente : l’Organisation Secrète d’Action Révolutionnaire Nationale (OSARN), plus connue sous le nom de la « Cagoule ». Fondée durant l’été 1936 par d’anciens membres de l’Action française (notamment Eugène Deloncle, Jean Filliol et Gabriel Jeantet), la Cagoule se répandit dans toute la France grâce à la fois aux affiliés provinciaux d’extrême droite comme les Chevaliers du Glaive à Nice et les Enfants de l’Auvergne à Clermont-Ferrand et aux réseaux d’extrême droite établis de longue date. L’argent et les armes affluaient vers le groupe en provenance de régimes fascistes étrangers. Deloncle mit au point un plan machiavélique pour renverser la République et installer un régime de type fasciste. Les agents Cagoulards commirent un certain nombre de meurtres et d’attentats terroristes destinés à alimenter les craintes de désintégration nationale et de révolution communiste : Le banquier russe Dimitri Navachine, tué en plein jour au Bois de Boulogne à Paris le 25 janvier ; Laetitia Toureaux, employée de bar et détective privée, assassinée dans un wagon du métro parisien le 16 mai ; et les frères antifascistes italiens Carlo et Nello Roselli, poignardés à mort à Bagnoles-de-l’Orne (Orne) le 9 juin ; les attentats à la bombe du siège parisien du Groupe des Industries métallurgiques de la région parisienne et du siège de la Confédération générale du patronat français le 11 septembre. Deloncle espérait qu’il pourrait pousser les hauts gradés des forces armées françaises à abattre le Parti communiste par une frappe préventive, avant de renverser le régime démocratique. La direction de la Cagoule décida d’agir en novembre 1937. Les enquêteurs de la police s’étant rapproché du groupe, avaient découvert plusieurs dépôts d’armes à Paris et arrêté plusieurs membres. Le coup d’État de Deloncle finit en pétard mouillé quand les alliés dans l’armée ne mordirent pas à l’hameçon. La direction de l’OSARN fut rapidement mise en détention[28].
À gauche, la vague de grève qui suivit l’élection du Front populaire est généralement considérée comme n’ayant pas donné lieu à de graves violences. Néanmoins, les échauffourées furent fréquentes et impliquèrent des grévistes, des briseurs de grève et la police. Si certains historiens en vinrent à considérer la violence lors des conflits du travail comme une violence « sociale » plutôt que politique, les contemporains ne faisaient pas cette distinction, interprétant souvent l’intention politique de la confrontation[29]. Le Parti communiste cherchait à donner un sens politique aux grèves en transformant les arrêts de travail dans les usines en grandes manifestations de rue. En retour, il interprétait l’intervention de la police pendant les grèves comme l’exercice d’une justice bourgeoise répressive contre une classe ouvrière victime. L’extrême droite estimait que les grèves étaient fomentées par des gréviculteurs* communistes dans l’espoir de provoquer une grève générale révolutionnaire. Ce soupçon trouva une confirmation apparente dans les fréquentes intimidations et agressions à l’encontre de travailleurs sympathisants de la politique conservatrice et nationaliste. Pendant ce temps, les groupes de gauche continuaient à affronter leurs ennemis de droite dans la rue. Les contre-manifestations aux meetings de droite entraînèrent de graves violences et des morts. Le 27 février 1937, Jean Créton, membre du PSF, mourut devant un meeting, abattu par un agresseur inconnu caché dans une foule de manifestants antifascistes[30]. L’incident le plus sanglant de 1937 impliquant des manifestants de gauche se produisit à Clichy en mars. L’émeute était visiblement un dernier spasme d’extrême violence dans la vie politique de la France de l’entre-deux-guerres. Cependant, entre le massacre et le début de la Seconde Guerre mondiale, au moins dix autres hommes furent tués lors d’affrontements impliquant des ennemis politiques et la police.
*
Chris Millington est historien, spécialiste de l’histoire contemporaine de la France. Il est Senior Lecturer in Modern European History à la Manchester Metropolitan University. Ses sujets d’études portent sur les mouvements des anciens combattants après la Première Guerre mondiale, l’extrême droite en France et plus généralement l’histoire politique de la France au XXe siècle. Il étudie également le rôle et les modalités de la violence en politique.
Parmi ses nombreuses publications on peut citer quatre ouvrages : From Victory to Vichy : Veterans in Interwar France (2012) ; Fighting for France : Violence in Interwar French Politics (2018) ; A History of Fascism in France: From the First World War to the National Front (2019) ; Le Fascisme français. Le 6 février 1934 et le déclin de la république (éd. originale 2017, traduction française : Éditions Critiques 2020).
*
Illustration : obsèques des militants antifascistes lors du massacre de Clichy / Gallica.
Notes
[1] R. Soucy, Fascisme français ?, op. cit., p. 105.
[2] R. Soucy, Fascisme français ?, op. cit., p. 131 et 156.
[3] AN BB18 2960, « Le procureur de la République à Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Paris », 15 avril 1935 ; « Une expédition punitive », L’Œuvre, 18 avril 1935, p. 2.
[4] APP BA 1960, « Le commissaire d’arrondissement à Monsieur le Directeur Général de la Police Municipale », 25 septembre 1935 ; rapport sans titre, 26 septembre 1935 ; « Le Commissaire de Police Henri Bourde du quartier de l’Arsenal à Monsieur le Directeur de Police ».
[5] APP BA 1907, rapport sans titre, 19 septembre 1934.
[6] Voir par exemple : « À Issy, la foule ouvrière désarme et chasse les camelots du roi », L’Humanité, 17 juin 1935, p. 1.
[7] R. Soucy, French Fascism : The Second Wave, p. 40.
[8] Voir BB18 2918, « Le procureur général près la cour d’appel de Colmar à Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice », 23 juillet 1934.
[9] Jenkins & Millington, Le Fascisme français, op. cit.
[10] Voir par exemple: AN 2W54, rapport sans titre, 14 juin 1933 ; rapport sans titre, 1er juillet 1933 ; rapport sans titre, 29 janvier 1934.
[11] AN 2W54, rapport sans titre, 17 octobre 1934.
[12] « Le 31e Congrès National du Parti a terminé ses travaux », Le Populaire, 24 mai 1934, p. 1 ; Voir aussi Bouchenot, Tenir la rue, op. cit.
[13] Jean Rabaut, Tout est possible ! Les « Gauchistes » francais 1929-1944, Paris, Denoël/Gonthier, 1974, p. 142-143.
[14] « Les ouvriers de Saint-Germain-en-Laye ripostent aux camelots du roi », L’Humanité, 25 juin 1934, p. 2 ; Nadaud, « Le renouvellement des pratiques militantes », p. 15, p. 22-25 ; Jacques Kergoat, Marceau Pivert : socialiste de gauche, Paris, Éditions de l’Atelier, 1994, p. 79-81.
[15] Sur les Croix-de-Feu et leur successeur le Parti social français voir Gareth Adrian Howlett, « The Croix de Feu, Parti Social Français and Colonel de La Rocque », Oxford University D.Phil. thesis, 1986 ; William D. Irvine, « Fascism in France : The Strange Case of the Croix de Feu », Journal of Modern History, 63, 1991, p. 271-295 ; Kalman, The Extreme Right in Interwar France ; Kéchichian, Les Croix-de-Feu, op. cit. ; Kennedy, Reconciling France Against Democracy, op. cit. ; Didier Leschi, « L’étrange cas La Rocque », in Le Mythe de l’allergie française au fascisme, op. cit., p. 155-194 ; Passmore, « Boy-scouting for grownups », art. cit. ; « The Croix de Feu : Bonapartism, National-populism or Fascism ? », French History, 9, 1995, p. 93-123 ; R. Soucy, Fascisme français ?, op. cit.
[16] AN F7 2960, « Le procureur de la République à Versailles à Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Paris », 12 octobre 1937 ; « Le procureur de la République à Pontoise à Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Paris », 8 octobre 1935.
[17] Kennedy, Reconciling France against Democracy, op. cit., p. 68 et 71.
[18] AN BB18 2959, « Le procureur de la République à Limoges à Monsieur le procureur général, Limoges », 22 mars 1936.
[19] Kennedy, Reconciling France against Democracy, op. cit., p. 88 ; Kalman, French Colonial Fascism, op. cit., établit le nombre de 15 000 en 1936 (56).
[20] Kalman, The Extreme Right in Interwar France, op. cit.,p. 212.
[21] Kalman, French Colonial Fascism, op. cit.,p. 64-65.
[22] Kalman, The Extreme Right in Interwar France, op. cit.,p. 216. Kéchichain conteste l’implication des Croix-de-Feu dans cette affaire, affirmant que les relations entre les Croix-de-Feu et les musulmans après l’émeute conduisirent la gauche à lire les événements à l’envers ; voir Les Croix-de-Feu, p. 234. Le chapitre de Joshua Cole sur la violence, bien qu’excellent, ne résout pas la question de l’implication des Croix-de-Feu : « Anti-Semitism and the colonial situation in interwar Algeria », The French Colonial Mind : Violence, Military Encounters, and Colonialism, Martin Thomas (dir.), Lincoln, NE, University of Nebraska Press, 2011, p. 77-112.
[23] Chérasse, La Hurle, op. cit., p. 59.
[24] APP BA 1960, « Le Commissaire d’Arrondissement à Monsieur le Directeur Général de la Police Municipale », 25 septembre 1935 ; rapport sans titre, 26 septembre 1935 ; « Le Commissaire de Police Henri Bourde du quartier de l’Arsenal à Monsieur le Directeur de Police ».
[25] Kennedy, Reconciling France against Democracy, op. cit., p. 124.
[26] Sur les violences au Parc des Princes en octobre 1936, voir les rapports de police contenus dans l’APP BA 1863. Pour l’explication de La Rocque sur les violences, voir AN 451 AP 102, « Tribunal de 1ère instance de la Seine. Police correctionnelle. 14éme Chambre. Audience du 13 décembre 1937.
[27] Le travail le plus récent sur le PPF est celui de Laurent Kestel, La Conversion politique: Doriot, le PPF, et la question du fascisme français, Paris, Raisons d’Agir, 2012. Sur l’incident de Lunel voir : AN BB18 3018-9, « Le procureur de la République à Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Montpellier », 26 octobre 1936.
[28] À propos de la Cagoule voir : Gayle K. Brunelle & Annette Finley-Croswhite, Murder in the Metro : Laetitia Toureaux and the Cagoule in 1930s France, Baton Rouge, LA: Louisiana State University Press, 2010.
[29] Par exemple, dans son étude de l’aspect paramilitaire du côté communiste, Georges Vidal établit une distinction entre la violence des « conflits sociaux » et celle des « affrontements aux motifs strictement politiques » : Vidal, « Violence et politique dans la France des années 1930 », art. cit., p. 901.
[30] AN BB18 3072, « Le procureur de la République à Monsieur le procureur général près la cour d’appel à Nancy », 28 février 1937 ; AN BB1 /3072, « Le procureur général près la cour d’appel de Nancy à Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice », 15 mars 1937.




