Agenda militant
Ailleurs sur le Web
![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)
- Au cœur du capital (12/03)
- Le débat des représentants des partis, avec Paul Vannier (12/03)
- Meeting avec Bagayoko, Coquerel et Mélenchon à Saint-Denis ! (11/03)
- Ludivine Bantigny, "La Bourse ou la vie. Le Front populaire, histoire pour aujourd’hui" (11/03)
- C’est quoi le "marxisme classique" et le "marxisme occidental" ? (10/03)
- “Le socialisme est la maison commune de tous les combats justes.” – Entretien avec Joseph Andras (10/03)
- Sur Franceinfo : Brigitte Boucher et les irresponsables (10/03)
- Ce que révèle l’affaire Epstein (10/03)
- Au Liban, d’une guerre coloniale à l’autre et du droit de résister (10/03)
- POUR UN FRONT ANTIFASCISTE AU SECOND TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES (10/03)
- Meeting de la campagne municipale LFI à Lille (10/03)
- Meeting avec Jean-Luc Mélenchon et Sophia Chikirou à Paris ! (09/03)
- Colombie : la gauche de Gustavo Petro valide le dernier test des législatives avant la présidentielle (09/03)
- Penser l’émancipation autrement, discuter l’apport de marxistes hétérodoxes [Podcast] (09/03)
- Terrorisme d’Ultra-droite (08/03)
- "L’Iran est sur le point d’obtenir l’arme nucléaire" : trente ans de prophéties démenties (08/03)
- Hommage au chercheur marxiste Michael Parenti – Compilation d’entretiens (08/03)
- La guerre de trop : les Américains et les Israéliens n’ont rien compris à l’Iran ! (08/03)
- Poutou annonce un probable soutien du NPA-A à Mélenchon en 2027 (07/03)
- Attaques en série contre LFI (07/03)
- Des maires insoumis pour tout changer | Clip officiel - Municipales 2026 (07/03)
- Romaric Godin : "La force fondamentale du capitalisme le pousse vers le néofascisme" (07/03)
- Quentin Deranque était en première ligne dans la bagarre (06/03)
- Tirer une balle dans la tête sans intention de donner la mort (06/03)
- Les États-Unis et Israël nous entraînent dans une barbarie suicidaire (06/03)
Liens
Les shots du Comptoir – Novembre 2022
Ces articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » sont publiés à titre d'information et n'engagent pas la Tendance CLAIRE.
Les shots du Comptoir – Novembre 2022 – Le Comptoir
Au Comptoir, nous lisons. Un peu, beaucoup, passionnément. Contre la dictature de l’instant, contre l’agitation de l’Internet et des écrans, contre la péremption annoncée et la critique avortée. Sans limite de genre ni de style, de l’essai au théâtre en passant par l’autobiographie ou le roman et la bande-dessinée, nous faisons le pari du temps long, de l’éternelle monotonie des pages, des jouissances de l’histoire qu’on ne peut lâcher. Parce que « Le savoir est une arme », nous mettons ici, à votre disposition, les recensions des livres qui nous ont marqués ces derniers temps. Pour vous donner, à tout le moins, l’envie d’aller feuilleter dans ces univers qui nous ont séparés du commun des mortels le temps de quelques chapitres.
- L’Atomisation de l’homme par la terreur, Leo Löwenthal, éditions Allia, 2022 (1ère ed : 1946) [1]
- Allons-nous continuer la recherche scientifique ?, Alexandre Grothendieck, éditions du Sandre, 2022 [2]
- Prendre la route, Alexandre Schiratti, éditions Arkhê, 2022 [3]
- Le Désinformateur. Sur les traces de Messaoud Djebari, Algérien dans le monde colonial, Arthur Asseraf, Fayard, 2022 [4]
- Les extraterrestres, Renan Larue et Estiva Reus, Presses Universitaires de France, 2022 [5]
- Ordre de survivre, Julian Semenov, éditions du Canoë, 2022 [6]
Les prospérités de la pensée fasciste [1]
 Universitaire allemand spécialiste de la critique sociologique littéraire, Leo Löwenthal (1900-1993) a fui l’Allemagne lors de l’accession au pouvoir des nazis. Trouvant refuge aux États-Unis à l’instar de ses compatriotes de l’École de Francfort, il enseigne un temps à l’université Colombia de New-York avant de rejoindre le département de sociologie de l’université de Berkeley en 1956. Il est notamment l’auteur de Literatur und Massenkultur (Littérature et Culture de masse) et Das bürgerliche Bewußtsein in der Literatur (La Conscience bourgeoise dans la littérature).
Universitaire allemand spécialiste de la critique sociologique littéraire, Leo Löwenthal (1900-1993) a fui l’Allemagne lors de l’accession au pouvoir des nazis. Trouvant refuge aux États-Unis à l’instar de ses compatriotes de l’École de Francfort, il enseigne un temps à l’université Colombia de New-York avant de rejoindre le département de sociologie de l’université de Berkeley en 1956. Il est notamment l’auteur de Literatur und Massenkultur (Littérature et Culture de masse) et Das bürgerliche Bewußtsein in der Literatur (La Conscience bourgeoise dans la littérature).
L’Atomisation de l’homme par la terreur est, quant à lui, paru pour la première fois dans la revue américaine Commentary en janvier 1946. Löwenthal y développe la thèse selon laquelle loin d’être un phénomène révolu, la terreur fasciste demeure « profondément ancrée dans les tendances de la civilisation moderne, et en particulier dans la structure de notre économie ». Il pointe ainsi un paradoxe : l’individu est exposé à un énorme dispositif de communication sans pouvoir communiquer avec son prochain. Il vit en collectivité mais demeure esseulé, paralysé par la peur de développer une pensée originale ou des émotions spontanées. Cet « état de coma moral » qui semble infuser tous les pans de la société, le sociologue le définit comme le processus d’atomisation de l’individu.
Ce processus terroriste agit par le biais de six leviers d’action : 1) L’irrationalité des actions d’un gouvernement envers sa population, notamment à travers les arrestations arbitraires qui a pour conséquence « l’élimination des différences et des droits individuels face à l’appareil du pouvoir ». 2) Le bouleversement du rythme normal de l’existence qui rompt « la continuité de l’expérience et de la mémoire » à l’œuvre dans les camps de concentration mais aussi, malgré un degré inférieur, au sein de la société terroriste dans laquelle « le projet pour l’individu est… de n’avoir aucun projet ». 3) La dissolution de la personnalité et du sens moral autant chez les victimes que chez les bourreaux. Ces derniers n’éprouvant plus une once de culpabilité ou de remords après avoir exécutés des actes barbares de manière automatique. Löwenthal cite un prisonnier évadé du camp polonais d’Oświęcim qui témoigne de la destruction de « tout lien social chez la victime [en réduisant] sa vie spirituelle au seul désir craintif de prolonger son existence ne serait-ce que d’un jour ou d’une heure. » 4) La lutte perpétuelle pour la survie imposée par un système répressif qui réduit les individus à une somme d’instincts primaires. 5) La sortie de l’humanité de l’Histoire universelle, redevenant selon les mots d’Hitler un « pur et noble matériau naturel », exploitable et jetable par une « jeunesse violente, autoritaire, intrépide, cruelle » ne connaissant « ni faiblesse, ni tendresse ». Jankiel Wiernik, charpentier dans le centre d’extermination de Treblinka, témoigne de cette manutention macabre des prisonniers en considérant « chaque personne vivante comme un futur cadavre, à très bref délai. » 6) L’identification aux bourreaux, décrite par Bruno Bettelheim en ces termes : « Un prisonnier avait atteint le stade final de l’adaptation au camp lorsqu’il avait modifié sa personnalité de manière à accepter siennes les valeurs de la Gestapo ».
Or, de nombreuses causes à l’œuvre dans les sociétés démocratiques peuvent favoriser l’émergence d’un nouveau système de terreur, à savoir : le vide social et économique qui tiraille des masses de travailleurs ne trouvant plus aucun sens dans le processus de création et de production standardisé ; la croyance aveugle en des idéologies politiques proposant une vision du monde binaire et intellectuellement confortable ; l’effondrement des principes moraux et individualistes hérités de la société libéral face aux crimes de masse, provoquant un lourd sentiment d’impuissance et de frustration chez des citoyens démunis. Lors d’une conversation avec le président du sénat de la Ville libre de Dantzig, Hermann Rauschning, Hitler avouera : « Ce qui est plus important encore que la terreur, c’est la transformation systématique des idées et des représentations sensorielles des populations. Nous devons parvenir à assujettir les pensées et les sentiments des hommes. »
En 1949, Leo Löwenthal, en collaboration avec le philosophe Norbert Guterman, prolongera son analyse de la pensée terroriste avec une étude sur « l’agitation fasciste aux États-Unis » dans les années 1940 : Les prophètes du mensonge.
Contre la technoscience [2]
 « Allons-nous continuer la rechercher scientifique ? » La question peut sembler curieuse, surtout aujourd’hui. D’autant plus lorsqu’elle est posée par le plus grand mathématicien du XXe siècle. Lauréat de la médaille Fields 1966 (qu’il refuse néanmoins de récupérer en URSS) grâce à ses travaux en géométrie algébrique, le Franco-allemand a eu « un impact incroyable sur les mathématiques », comme le rappelle Cédric Villani, qui ne manque jamais une occasion pour lui rendre hommage. Mais proche du mouvement libertaire il se consacre, à partir de 1971, exclusivement à l’écologie radicale et fonde le groupe Survivre et vivre, avant de se retirer dans l’Ariège vingt ans plus tard.
« Allons-nous continuer la rechercher scientifique ? » La question peut sembler curieuse, surtout aujourd’hui. D’autant plus lorsqu’elle est posée par le plus grand mathématicien du XXe siècle. Lauréat de la médaille Fields 1966 (qu’il refuse néanmoins de récupérer en URSS) grâce à ses travaux en géométrie algébrique, le Franco-allemand a eu « un impact incroyable sur les mathématiques », comme le rappelle Cédric Villani, qui ne manque jamais une occasion pour lui rendre hommage. Mais proche du mouvement libertaire il se consacre, à partir de 1971, exclusivement à l’écologie radicale et fonde le groupe Survivre et vivre, avant de se retirer dans l’Ariège vingt ans plus tard.
Allons-nous continuer la recherche scientifique ? est une conférence prononcée en 1972 au Conseil européen pour la recherche nucléaire, qui contient une passionnante séance de questions-réponses, retranscrite en deuxième partie d’ouvrage. Les éditions du Sandre ont également ajouté le texte « Comment je suis devenu militant », publié dans Survivre… et Vivre, en 1971. Comme nombre d’écologistes de sa génération, Grothendieck part d’un constat : la technoscience, en particulier le nucléaire, est dorénavant « associée à une véritable menace à la survie de l’humanité, une menace même à la vie tout court sur la planète ». Évidemment, le mathématicien ne refuse pas la science, sa rigueur et ses résultats. Mais pour lui, il faut changer de méthode et surtout introduire réflexion éthique dans la recherche scientifique. Car, selon lui cette dernière souffre de nombreux défauts : « la séparation stricte de nos facultés rationnelles et des autres modes de connaissances » ; « l’attitude analytique », à savoir « le fait de diviser chaque parcelle de la réalité, chaque problème en des composantes simples pour mieux les résoudre » ; « la science, dans sa pratique actuelle […] semble être le principal support idéologique de la stratification de la société avec toutes les aliénations que cela implique » ; « la séparation dans la science entre connaissances d’une part et désirs et besoin d’autre part ». Ce sont pour ces raisons que Grothendieck pense que « la solution ne proviendra pas d’un supplément de connaissances scientifiques, d’un supplément de techniques, mais [elle] proviendra d’un changement de civilisation. »
Est-ce dire qu’il faut bannir la science ? Le mathématicien pense que « la crise écologique […] va nous forcer […] à modifier notre cours et à développer des modes de vie et des modes de production qui soient radicalement différents de ceux en cours dans la civilisation industrielle. » Il estime cependant que « l’agriculture, l’élevage, la production d’énergie décentralisée, une certaine espèce de médecine très différente qui prévaut actuellement vont être à l’avant-plan. »
Bientôt les pleins pouvoirs à la petite reine [3]
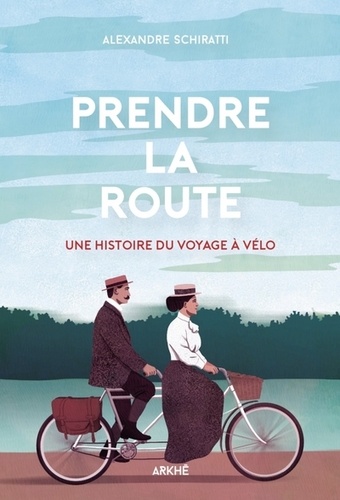 « Un jour viendra, le lendemain du Grand Soir, où la propriété de chacun sera réduite à l’unique bicyclette, source de toute joie, de toute santé, de toute ardeur, de toute jeunesse », déclamait Maurice Leblanc dans le journal Gil Blas, en juin 1894. Si la Révolution n’en finit pas d’être renvoyée aux calendes grecques, le vélo, lui, a su conquérir les cœurs. Depuis 1817 et l’invention de la draisienne, le biclou, à force d’innovations techniques, s’est imposé, tant dans le quotidien des urbains (gloire au « vélotaf » !) que durant les vacances, jusqu’à séduire aujourd’hui un million de cyclotouristes. C’est cette histoire du voyage à vélo qu’Alexandre Schiratti, géographe spécialiste des mobilités, cycliste lui-même, relate dans Prendre la route (éd. Arkhê, 2022).
« Un jour viendra, le lendemain du Grand Soir, où la propriété de chacun sera réduite à l’unique bicyclette, source de toute joie, de toute santé, de toute ardeur, de toute jeunesse », déclamait Maurice Leblanc dans le journal Gil Blas, en juin 1894. Si la Révolution n’en finit pas d’être renvoyée aux calendes grecques, le vélo, lui, a su conquérir les cœurs. Depuis 1817 et l’invention de la draisienne, le biclou, à force d’innovations techniques, s’est imposé, tant dans le quotidien des urbains (gloire au « vélotaf » !) que durant les vacances, jusqu’à séduire aujourd’hui un million de cyclotouristes. C’est cette histoire du voyage à vélo qu’Alexandre Schiratti, géographe spécialiste des mobilités, cycliste lui-même, relate dans Prendre la route (éd. Arkhê, 2022).
L’évolution du vélocipède, devenu véloce puis vélo par apocopes successives, guide naturellement le récit, qui retrace en parallèle les débuts du tourisme pendant la Révolution industrielle et le développement du train puis de la voiture. Au gré de la balade historique, on croise les pionniers du genre, dont les exploits semblent incroyables : dans les années 1880, Thomas Stevens fit, par exemple, près de 22 000 km à travers le monde au guidon de son grand-bi. D’abord l’apanage des bourgeois, la petite reine séduit peu à peu les classes populaires. Le vélo se révèle alors tant un mode de déplacement qu’un outil d’émancipation, en particulier des femmes – en 1894, Annie Londonderry s’élance dans un tour du monde à bicyclette avec chemisier corseté et jupe longue victorienne. Les filles sages vont au paradis, les autres où elles veulent à vélo, voilà qui a de quoi inquiéter certains hommes… qui ont tôt fait de dénoncer la « cyclomanie » – comprendre la surexcitation, par le vélo, des organes reproducteurs féminins. Faut-il n’avoir jamais parcouru 50 km à vélo sans cuissard pour oser affirmer telle bêtise !
Découverte, contemplation, authenticité… Alexandre Schiratti rappelle que les valeurs du vélo en font un véritable art de vivre. Maurice Leblanc, Georges Clemenceau, Émile Zola, Alfred Jarry, Mark Twain, Jules Renard ou Léon Tolstoï ne s’y étaient pas trompés : le vélo, par sa lenteur et l’effort solitaire qu’il requiert, leur semblait la voie royale pour atteindre l’état méditatif. L’anecdote raconte que Cioran lui-même aurait soigné sa dépression à grands coups de pédales ! Certes, les routes n’étaient alors pas entièrement dominées par les motorisés, et le danger était bien moins grand qu’aujourd’hui (plus de 200 cyclistes tués sur les routes en 2021). Certes, « trop souvent les cyclistes restent peu respectés, klaxonnés, doublés dangereusement, vus comme des parasites, des âmes sensibles, des chevaliers de l’inutile », déplore l’auteur. Mais le message final est celui de l’espoir : plus nombreux nous serons à vélo, plus grande sera notre force. Il est l’heure de reprendre la route.
Enquête sur un Algérien au service du colonialisme français [4]
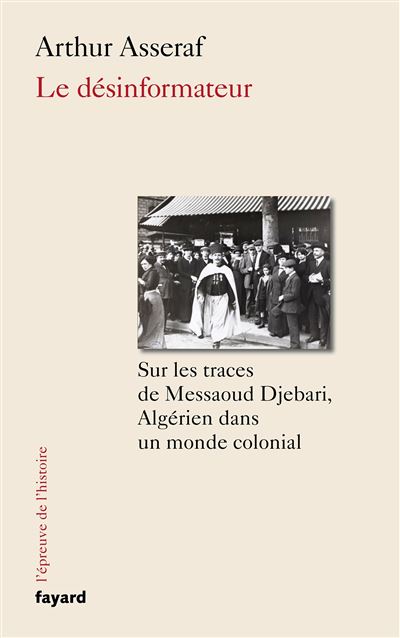 L’ouvrage Le Désinformateur, paru en septembre 2022, est autant une enquête sur un personnage de la colonisation, qu’une immersion dans l’espace colonial français de la « Belle Epoque » – expression évidemment profondément exagérée quand il est question, comme ici, des rapports de domination en Afrique du nord.
L’ouvrage Le Désinformateur, paru en septembre 2022, est autant une enquête sur un personnage de la colonisation, qu’une immersion dans l’espace colonial français de la « Belle Epoque » – expression évidemment profondément exagérée quand il est question, comme ici, des rapports de domination en Afrique du nord.
Arthur Asseraf, maître de conférences en histoire du monde francophone à Cambridge, retrace l’itinéraire de Messaoud Djebari, un indigène algérien de la seconde moitié du XIXe siècle, issu d’un milieu social pauvre, devenu informateur au service de l’empire colonial. Tel un caméléon, Messaoud Djebari est une personnalité polymorphe, à l’aise dans différents costumes : tour à tour explorateur, écrivain à succès, émissaire et journaliste. Ce sont en particulier les raisons du service dans l’empire colonial de cet Algérien, que rien n’aurait prédestiné à une telle carrière, que souhaite analyser Arthur Asseraf : de quelle manière et pourquoi cet homme algérien pauvre, musulman, intériorise-t-il le discours colonialiste et participe-t-il à divers projets colonialistes ? Messaoud Djebari est par exemple rémunéré par la société de Géographie pour évaluer la possibilité d’une ligne de train transsaharienne ; surtout, Djebari est recruté par le ministère de l’intérieur pour informer les gouvernants de possibles troubles dans les différentes régions de l’empire colonial français.
À la lecture de cet ouvrage, une personnalité énigmatique tend à se dévoiler ; Messaoud Djebari détonne notamment par ses réflexes antisémites et racistes anti-noirs, ce qui nous amène à questionner les ressorts de ce racisme, renforcé dans le cadre colonial de cette fin du XIXe siècle. Contre toute attente, nous apprenons ainsi que Messaoud Djebari est un homme parfaitement inséré dans la société mondaine parisienne, notamment dans les cercles d’extrême droite, en témoigne sa collaboration au journal antisémite d’Edouard Drumont, La Libre parole. L’auteur nous invite dès lors à sortir du cadre régional et à s’intéresser aux mobilités géographiques et sociales d’un colonisé dans l’empire, à souligner les interconnexions entre l’espace africain et la métropole et, en définitive, à complexifier notre regard sur les rapports sociaux et politiques dans l’espace colonial français.
Difficile néanmoins de cerner parfaitement la personnalité de ce Messaoud Djebari, faute de sources existantes pour chaque étape de sa vie. Mais l’un des tours de force d’Arthur Asseraf est justement de mener une enquête d’une grande rigueur méthodologique et stimulante, malgré un matériau fragile et piégeux. Se pose en effet la question, à plusieurs reprises, de la confiance attribuée à certaines sources émanant directement de Messaoud Djebari qui, en raison de ses missions d’espion, a tout intérêt à brouiller les pistes sur son identité et ses trajectoires.
Enfin, l’une des belles surprises de cet ouvrage porte sur le style employé par l’historien qui emprunte à l’ego-histoire, c’est-à-dire à cette écriture réflexive, où l’auteur n’hésite pas à utiliser le « Je ». À de multiples reprises nous pouvons ainsi lire de nombreuses incises de l’auteur, lors desquelles il croise son expérience d’enquête et son objet d’étude ; il s’agit de comprendre les ressorts de l’auteur, les contraintes, notamment éthiques, à travailler sur un personnage problématique à plusieurs points de vue.
Nous avons donc ici affaire à un ouvrage extrêmement original, à lire pour mieux comprendre la complexité des mécanismes sociaux et institutionnels de l’histoire coloniale française, au prisme de l’un de ses serviteurs les plus zélés.
Des extraterrestres trop humains [5]
 Renan Larue et Estiva Reus, deux intellectuels connus notamment pour leurs écrits sur l’animalisme et le véganisme, s’aventurent cette fois sur un tout autre terrain, en nous livrant un court et passionnant exposé à propos des extraterrestres. Au fond, peut-être ce nouveau sujet n’est-il pas si différent de leur thème de prédilection, puisqu’il s’agit là encore d’écrire sur la coexistence des êtres humains et non-humains, simplement considérée à une plus large échelle.
Renan Larue et Estiva Reus, deux intellectuels connus notamment pour leurs écrits sur l’animalisme et le véganisme, s’aventurent cette fois sur un tout autre terrain, en nous livrant un court et passionnant exposé à propos des extraterrestres. Au fond, peut-être ce nouveau sujet n’est-il pas si différent de leur thème de prédilection, puisqu’il s’agit là encore d’écrire sur la coexistence des êtres humains et non-humains, simplement considérée à une plus large échelle.
Comme le laisse supposer le pedigree des auteurs ainsi que la maison d’édition publiant cet opuscule, il ne s’agit pas ici d’un ouvrage farfelu sur « les excités des petits hommes verts », mais d’un point de vue académique sur l’histoire et l’évolution de l’hypothèse d’une vie extraterrestre au cours des siècles. Platon et Aristote croyaient-ils aux extraterrestres ? Comment la théologie chrétienne a-t-elle fluctué à propos de l’hypothèse du pluralisme (i.e., d’une Terre qui ne serait pas l’unique dépositaire de la vie dans l’Univers) ? Comment le point de vue des scientifiques a-t-il lui-même évolué sur la question, jusqu’à aboutir au couronnement de l’astrobiologie comme discipline scientifique à part entière ? La vie est-elle possible sans eau sur les exoplanètes ? Existe-t-il aujourd’hui, dans les instances gouvernementales de différents pays, une prospective stratégique et militaire afin de se préparer en cas de visite extraterrestre ? Le livre de Larue et Reus répondra à ces questions (et à beaucoup d’autres !) avec une concision et une pédagogie remarquables.
La force de cet ouvrage est d’être presque en trompe l’œil : en prétendant parler des extraterrestres, Larue et Reus parlent en réalité surtout des Humains. De leurs angoisses existentielles, de leur peur de l’infini et de l’étrange(r), de leur imagination débridée, et, sans doute, de leur rapport souvent difficile à l’altérité. C’est précisément pour cela qu’il mérite grandement d’être lu.
Le polar russe de la guerre froide [6]
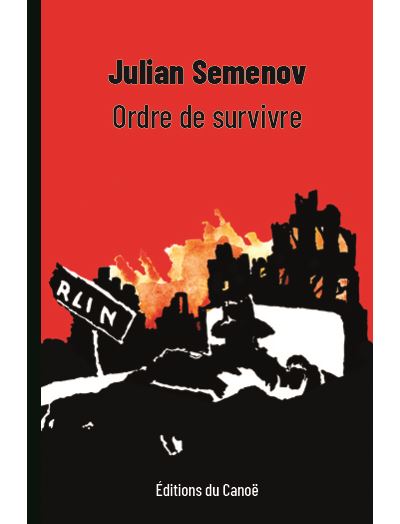 Stierlitz est un espion au service de l’URSS dont la mission est de faire échouer l’accord de paix entre des chefs nazis, qui tentent de sauver leu peau, et les États-Unis, ce qui exclurait l’Union Soviétique des traités de paix. Cette mission qu’entreprend l’espion russe à Berlin, au printemps 1945, n’est pas sans risques car le chef de la Gestapo, Müller, a la preuve que le premier est un espion soviétique. Démasqué, Stierlitz est en danger constant. Il a mis sa tête sur le billot. Le mot d’ordre non écrit du règlement militaire est « Ordre de survivre ».
Stierlitz est un espion au service de l’URSS dont la mission est de faire échouer l’accord de paix entre des chefs nazis, qui tentent de sauver leu peau, et les États-Unis, ce qui exclurait l’Union Soviétique des traités de paix. Cette mission qu’entreprend l’espion russe à Berlin, au printemps 1945, n’est pas sans risques car le chef de la Gestapo, Müller, a la preuve que le premier est un espion soviétique. Démasqué, Stierlitz est en danger constant. Il a mis sa tête sur le billot. Le mot d’ordre non écrit du règlement militaire est « Ordre de survivre ».
Né en 1931, Julian Semenov est un auteur éminemment populaire en Russie bien que son œuvre soit passée sous silence en raison de la chute de l’Union soviétique en 1991. L’œuvre romanesque de Semenov met en scène les différents terrains de la guerre froide où les agents soviétiques déjouent les complots fomentés contre leur pays et ses intérêts. Alter ego de Graham Greene, Georges Simenon, et John Le Carré, l’écrivain russe fait évoluer son héros, Maxime Issaïev, alias Max Von Stierlitz, sur les théâtre d’opérations des conflits qui succèdent à la seconde guerre guerre mondiale. Un certain nombre de ses romans ont été adaptés à l’écran et un musée lui est consacré près de Yalta.
Nos Desserts :
- Si vous avez encore soif, retrouvez toute la carte des shots du Comptoir
- Notre sélection littéraire des années 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 et 2014
- Et notre revue papier (trois numéros parus) à commander en ligne




