Agenda militant
Ailleurs sur le Web
![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)
- Lordon : Boulevard de la souveraineté (15/01)
- L’affaire d’État Alstom : l’étau se resserre autour de la responsabilité de Macron (15/01)
- Coquerel sur France 2 mercredi 14 janvier (14/01)
- Le "moment eurocommuniste" ou la déstalinisation ratée du PCF (14/01)
- Etats-Unis : comprendre la « nouvelle doctrine de sécurité nationale » et ses implications (14/01)
- La loi du plus fort - La chronique de Pierre-Emmanuel Barré (12/01)
- Retour sur le blocage du périph’ - A propos de la résistance à l’accord UE-Mercosur et à la politique d’abattage total. (12/01)
- Venezuela : des médias intoxiqués par la propagande de guerre (12/01)
- Où vivent les plus riches ? Ce que la géographie des hauts revenus dit des fractures françaises (11/01)
- Une récompense pour les criminels ! Le prix Nobel de la « paix » (11/01)
- La crise de la gauche portugaise. Entretien avec Catarina Príncipe (11/01)
- Victor Klemperer, critique impitoyable du sionisme (11/01)
- USA - VENEZUELA : UNE OPÉRATION MAFIEUSE SALUÉE PAR LES "COLLABOS" - Maurice Lemoine (11/01)
- Le paradoxe de la Sécurité sociale : et si, pour faire des économies, il fallait l’étendre ? (11/01)
- LFI : Soutien au peuple venézuélien contre l’agression de Trump ! (10/01)
- Du militarisme à gauche. Réponse à Usul et à Romain Huët (09/01)
- Face à l’impérialisme trumpiste : ne rien céder (08/01)
- Attaque américaine au Venezuela : ce que révèle le "zéro mort" de franceinfo (08/01)
- Que signifie "abolir la monnaie" ? (08/01)
- Abject dessin antisémite dans Marianne contre le député LFI Rodriguo Arenas (08/01)
- "ILS FONT LE SAV DE TRUMP !" CE QUE DISENT LES MÉDIAS FRANÇAIS SUR LE VENEZUELA (08/01)
- VENEZUELA : CE QUE NE DIT PAS LA PROPAGANDE DE TRUMP (08/01)
- Les États-Unis prennent d’assaut le territoire et le gouvernement du Venezuela (08/01)
- Les systèmes militaro-industriels, noyau totalitaire du capitalisme contemporain (08/01)
- LE KIDNAPPING DE MADURO - LE BANDITISME D’ÉTAT AMÉRICAIN (08/01)
Liens
Histoire. «Mer versus terre»: de la fonctionnalité de la guerre relativement à l’accumulation du capital
Ces articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » sont publiés à titre d'information et n'engagent pas la Tendance CLAIRE.
Par Alain Bihr
Partie 1
Dans le tome 3 du Premier âge du capitalisme [1], j’ai été amené à accorder une grande importance à la guerre. Celle-ci est en effet omniprésente dans l’Europe protocapitaliste et, plus largement, dans le premier monde capitaliste qui s’édifie à partir et autour de cette dernière. Sur les 348 années que couvre la période protocapitaliste telle que je l’ai définie (1415-1763), en me limitant aux seuls conflits majeurs qui s’y sont déroulés, j’ai pu compter 267 années de guerre pour seulement 81 années de paix en Europe, soit en gros plus de trois années de guerre pour une année de paix [2].

Guerre de Succession d’Espagne: la bataille de Malaga (1704)
Cela suggère évidemment une fonctionnalité profonde de la guerre relativement aux deux processus majeurs qui animent ce premier âge capitaliste et structure ce premier monde capitaliste: l’expansion européenne, coloniale et commerciale, hors d’Europe et la dynamique protocapitaliste en Europe même, qui parachève sa transition du féodalisme au capitalisme. Et on peut immédiatement concevoir que le premier processus a été rien moins que pacifique: visant à dominer et exploiter des territoires et des populations pour les instrumentaliser au service de l’accumulation du capital en Europe, il n’a pu que générer des conflits entre ces derniers et les colons et marchands européens. Mais il a tout aussi bien généré des conflits entre ces derniers, se disputant l’accès à ces territoires et populations.
Quant à la fonctionnalité de la guerre relativement à l’accumulation du capital, elle n’est que trop évidente, s’agissant du capital industriel (la guerre a été un puissant aiguillon de la formation et du développement de différentes industries fournissant du matériel de guerre: métallurgie, partant sidérurgie et mines, mais aussi industrie textile); du capital commercial (celui des fournisseurs aux armées); du capital financier (celui des créanciers de l’Etat, pourvoyeur de l’indispensable «nerf de la guerre» – j’y reviendrai). Tout cela a déjà été largement analysé et documenté par Werner Sombart [3].
Mais on pourra m’objecter immédiatement, et à juste titre, que la guerre est un phénomène universel au sein de l’histoire humaine et que, sous ce rapport, le monde protocapitaliste n’est pas particulièrement original. Il se distinguerait tout juste par une fréquence plus grande des guerres. En somme, une différence de degré non de nature.
Répondre à cette objection va me conduire, dans un premier temps, à souligner les profondes originalités, constituant quelquefois des nouveautés radicales, des guerres modernes. Cela me permettra, dans un deuxième temps, d’en déduire les conditions d’une stratégie gagnante. Avant d’illustrer cela sur l’exemple de deux conflits majeurs durant l’époque protocapitaliste.
Les originalités des guerres modernes
J’en distinguerai essentiellement quatre: quant aux enjeux, aux terrains, aux moyens et au mode de financement.
1. Jusque tard durant la période protocapitaliste, on continue à faire la guerre en Europe pour des raisons d’ordre dynastique et donc de souveraineté et de possession territoriale. L’Europe connaîtra ainsi trois guerres majeures de succession pendant la première moitié du XVIIIesiècle: la guerre de Succession d’Espagne (1701-1714), la guerre de Succession de Pologne (1733-1738), la guerre de Succession d’Autriche (1740-1748). On peut évidemment y voir un héritage et un prolongement du Moyen Age féodal.
Et pourtant, très tôt au cours de cette période, les guerres européennes mêlent à ces enjeux territoriaux des enjeux d’une tout autre nature, que j’appellerai mercantiles. Il s’agit de s’assurer le contrôle non plus de territoires mais de marchés: des sources d’approvisionnement, des points d’appui commerciaux (des ports, des villes, de foires, etc.), des circuits commerciaux, terrestres ou maritimes, des débouchés, des droits de douane, des réglementations commerciales, etc. Est ici tout particulièrement en jeu l’accès aux positions commerciales et coloniales outre-mer, dont on connaît le caractère stratégique au regard des opportunités et impératifs de la dynamique protocapitaliste.
Et ces enjeux mercantiles ne cesseront de gagner en importance au fur et à mesure où l’on avance dans la période protocapitaliste, en reléguant les enjeux territoriaux au second plan. Ainsi, la guerre de Succession d’Espagne n’a-t-elle pas pour enjeu tant l’accession au trône à Madrid que l’ouverture au commerce étranger de l’immense empire espagnol. Et les Britanniques, largement vainqueurs au terme de cette guerre, concéderont volontiers l’occupation de ce trône par un Bourbon, petit-fils de Louis XIV, contre l’accès à ce marché en obtenant pour la South Sea Company, constituée à cet effet, l’asiento de negros et le navÍo de permisio [4]. Leur seul gain territorial sera le cap de Gibraltar, position stratégique pour le contrôle de toute la circulation maritime entre la Méditerranée et l’Atlantique et, par conséquent, du commerce afférent.
Cette inhérence de la guerre au protocapitalisme a été parfaitement théorisée, comprise et légitimée, par les auteurs mercantilistes. Car, selon eux, le développement protocapitaliste ne peut être qu’un jeu à somme nulle, dans lequel les gains des uns se paient du prix des pertes des autres, le développement de chacun ayant pour condition la régression, la stagnation ou du moins le moindre développement de tous ses voisins et concurrents. En conséquence, les rapports économiques entre les Etats ne peuvent être que des rapports de force. Dès lors, la guerre et ce qu’elle permet – le pillage, la piraterie, la conquête de possessions coloniales ou de points d’appui commerciaux, l’imposition de contrats commerciaux léonins etc., – sont des moyens tout aussi normaux et légitimes de s’enrichir que le commerce régulier. Dans le monde protocapitaliste, pour paraphraser et détourner Clausewitz, la première n’est jamais que la poursuite du dernier par d’autres moyens.
2. De l’originalité des enjeux des guerres modernes découle immédiatement l’originalité de leurs terrains. Tout d’abord, quant à leur dimension spatiale. Ces conflits ont d’abord eu pour théâtre d’opérations le continent européen lui-même. Mais, pour toutes les raisons précédemment énoncées, ils ont, inévitablement, débordé sur les circuits commerciaux, ceux du commerce intereuropéen et plus encore ceux du commerce entre l’Europe et les colonies et comptoirs européens outre-mer, aux Amériques, en Afrique et en Asie, qui en constituent l’enjeu, de manière de plus en plus éminente au fur et à mesure qu’on avance dans l’époque protocapitaliste.
De ce fait, dès le XVIIe siècle et plus nettement encore au XVIIIe siècle, ces conflits prennent l’allure de guerres mondiales – bien avant le XXe siècle. Ainsi, pendant la guerre de Sept Ans (1756-1763), on ne se bat pas seulement en Europe centrale et dans les eaux européennes mais en Amérique du Nord, aux Antilles, le long des côtes africaines, sur le pourtour des Indes et aux Indes mêmes (au Bengale et dans le Carnatic) et jusqu’aux Philippines, partant dans l’océan Indien autant qu’en Méditerranée ou dans l’Atlantique.
Du coup, on comprend immédiatement aussi pourquoi le théâtre essentiel de ces affrontements n’a pas été la terre, ni en Europe ni dans les colonies européennes, mais bien la mer. Le double enjeu commercial et colonial de ces guerres explique qu’elles aient été avant tout et de plus en plus des guerres navales, et ce en un double sens. D’une part, à partir du XVIIe siècle, c’est sur mer que les affrontements décisifs vont avoir lieu, même si la plus grande part des opérations militaires et les plus spectaculaires d’entre elles vont se déployer sur terre; tout simplement parce que c’est sur mer que va se jouer le contrôle des circuits du commerce mondial et de leurs points d’appui coloniaux mais aussi la possibilité de mener des opérations sur terre (débarquer des troupes, les ravitailler, les appuyer par l’artillerie embarquée, etc.) D’autre part, et de ce fait, pour la première fois dans l’histoire, la marine va devenir durant cette période l’arme décisive. Elle le restera en gros jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, à partir de laquelle elle sera supplantée par l’aviation, le contrôle des airs devenant alors plus important encore que celui des mers et déterminant ce dernier.
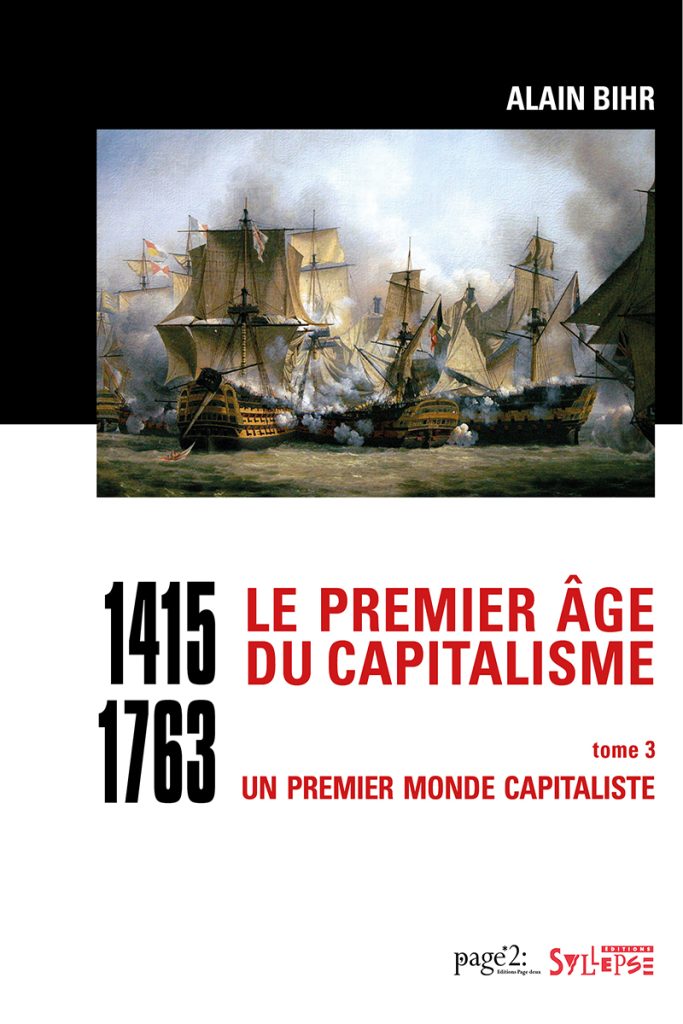 3. C’est sur le plan des moyens militaires que les évolutions les plus spectaculaires vont avoir lieu, à tel point que nombre d’historiens vont parler à leur sujet d’une véritable «révolution militaire» [5]. Cette révolution tient à l’introduction, la diffusion et le perfectionnement des armes à feu qui vont en effet bouleverser les conditions du combat, tant sur mer que sur terre.
3. C’est sur le plan des moyens militaires que les évolutions les plus spectaculaires vont avoir lieu, à tel point que nombre d’historiens vont parler à leur sujet d’une véritable «révolution militaire» [5]. Cette révolution tient à l’introduction, la diffusion et le perfectionnement des armes à feu qui vont en effet bouleverser les conditions du combat, tant sur mer que sur terre.
Sur terre, on assiste au développement simultané des armes à feu collectives (les canons) et des armes à feu individuelles (l’arquebuse, puis le mousquet, enfin le fusil rapidement muni d’une baïonnette), dont la précision (relative) et surtout la cadence de tir s’accroissent. Avec pour conséquence immédiate une augmentation des effectifs combattants: la mortalité sur le champ de bataille s’accroissant, il faut y engager des effectifs plus importants pour la pallier. Plus largement, ce sont tous les services auxiliaires qui voient leur importance s’accroître, en augmentant d’autant les effectifs d’ensemble: services d’intendance veillant à l’entretien des troupes (nourriture, habillement, logement, fourniture des armes et munitions, etc.); unités du train (comprenant véhicules, bêtes de trait, conducteurs, charrons et forgerons, etc.) pour transporter tout ce ravitaillement; unités du génie, indispensables pour faire franchir des obstacles naturels (cours d’eau, régions marécageuses, montagnes, etc.) à l’artillerie ou tout simplement pour ouvrir des routes capables de permettre aux troupes d’avancer ou d’être ravitaillées. En gros, d’un bout à l’autre de la période protocapitaliste, les effectifs militaires engagés sur terre vont décupler.
La guerre navale va se trouver révolutionnée par les progrès de l’artillerie bien plus radicalement encore que la guerre terrestre. La principale conséquence en sera la nécessité de constituer des marines spécifiquement militaires.
A la fin du Moyen Âge et à l’aube des temps modernes, hormis les galères, les marines de guerre permanentes sont encore réduites à quelques navires, plus prestigieux que réellement efficaces. A chaque ouverture des hostilités, l’usage est de convertir une partie de la marine commerciale en force navale. Le gouvernement s’adresse alors aux armateurs privés en leur demandant de lui louer leurs navires pour la durée du conflit, tout comme il vend éventuellement des lettres de marque à des capitaines qui les autorisent à se livrer à la course (à se faire corsaires). Cette pratique va progressivement faire sentir ses limites. D’une part, à l’ouverture des hostilités, les gouvernements peinent souvent à obtenir des armateurs qu’ils leur louent leurs navires parce qu’ils sont déjà engagés dans des opérations commerciales. D’autre part, les amiraux se plaignent de ce que les navires marchands manquent de qualité et d’homogénéité, en les contraignant à faire la guerre avec un matériel médiocre et hétéroclite, alors que l’adoption de la tactique de la bataille en ligne va rendre au contraire nécessaire la standardisation des navires; sans compter que les équipages sont forcément peu habitués à la manœuvre et nullement aguerris. Enfin et surtout, les progrès de l’artillerie embarquée, l’augmentation du nombre et du calibre des canons, leur installation dans les ponts inférieurs vont faire sentir la nécessité de disposer de navires spécialement et exclusivement armés pour la bataille et capables de résister à une puissance de feu grandissante.
Pour ces différentes raisons, la nécessité se fait sentir d’une marine de guerre permanente, composée de vaisseaux dédiés spécialement au combat, impliquant une infrastructure spécifique de chantiers navals pour leur construction et leur entretien ainsi qu’un commandement et des équipages formés et entraînés à cette fin.
4. Si la guerre moderne suppose et mobilise d’abord des moyens militaires, des hommes enrôlés et leurs équipements, ces moyens ont eux-mêmes un coût. Un coût qui va aller croissant au fil des décennies et qui va soumettre les finances publiques à rude épreuve. Voyons tout cela de plus près.
La nécessité du recours à l’emprunt. Depuis les Romains, on sait que l’argent est «le nerf de la guerre». Et cela restera vrai durant toute l’époque moderne. Ce qui explique la justesse de la réponse faite par le condottiere Trivulce à Louis XII qui, s’apprêtant à envahir le Milanais en 1498, s’enquerrait des moyens nécessaires pour assurer le succès de son entreprise: «Très gracieux Roi, trois choses sont nécessaires: de l’argent, encore de l’argent et encore de l’argent.» [6]
Bien plus, la maxime romaine sera de plus en plus vraie, dans la mesure où le coût des guerres modernes ne cessera de croître. C’est la rançon inévitable de l’alourdissement qu’a alors connu l’appareil militaire, du fait du gonflement des troupes, de leur équipement en armes à feu, du perfectionnement constant de ces dernières, de la construction des citadelles, du développement surtout des flottes de guerre, de l’étendue grandissante des champs d’opérations militaires, du développement de l’administration militaire, etc. Autant de dimensions différentes de la «révolution militaire», précédemment mentionnées, qui se renforcent mutuellement.
Extraordinaires (au sens propre du terme: sortant de l’ordinaire) par leur montant, les dépenses occasionnées par les guerres le sont encore davantage par leur soudaineté et leur urgence. Lorsque la guerre éclate, c’est immédiatement qu’il faut disposer des moyens nécessaires pour lever, enrôler et équiper de nouvelles troupes (régulières ou mercenaires), les doter des moyens logistiques permettant leur entrée en campagne, garnir les citadelles de réserves en aliments et armements, lancer des programmes de construction de nouveaux navires destinés à remplacer ceux qui vont être perdus, etc. Et ce besoin pressant d’argent perdure tout au long de la guerre.
Or les recettes ordinaires des Etats modernes ne sont pas en mesure de répondre à ces deux exigences conjuguées: une brusque et brutale augmentation des dépenses publiques. Ces recettes ordinaires sont celles tirées du domaine public (du sol ou du sous-sol que possède le monarque ou l’Etat); des monopoles publics (monopoles régaliens: battre monnaie, rendre justice, ou monopoles d’Etat, commerciaux ou industriels); de la vente des offices (missions ou services publics cédés à un particulier contre espèces sonnantes et trébuchantes); des impôts (directs ou indirects: droits de douane, accises sur la consommation de produits ordinaires ou de produits de luxe).
Lorsque la guerre éclate, les Etats modernes font ordinairement flèche de tout bois. Ils cherchent autant que possible à augmenter leurs recettes ordinaires. Ils aliènent des parties de leur domaine public. Ils aliènent de même des monopoles publics. Ils multiplient les ventes d’office. Ils augmentent les impôts, directs et indirects, jusqu’à la limite du supportable (tracée par le déclenchement d’émeutes antifiscales). Mais, en définitive, c’est toujours essentiellement par le recours au crédit, donc à l’endettement, que la guerre va se financer. Les guerres modernes présenteront aussi cette originalité de se financer essentiellement à crédit.
Les conditions du recours à l’emprunt. Mais le recours à l’emprunt par ces Etats est lui-même tributaire de plusieurs conditions de possibilité.
En premier lieu, l’existence dans les bourses et les coffres de certains de leurs sujets d’amples réserves monétaires, qui trouvent ainsi à se transformer en capital de prêt porteur d’intérêt. Ces sujets se recrutent évidemment dans les couches supérieures des deux ordres privilégiés (le clergé et la noblesse, dont la fortune et les revenus sont essentiellement fonciers), mais aussi de la bourgeoisie (principalement marchande), les deux pouvant évidemment se recouper (c’est le cas avec l’aristocratie nobiliaire qui diversifie ses actifs et ses revenus en investissant, au-delà de la terre, dans les mines, les industries métallurgique et textile, les compagnies commerciales… et la dette d’Etat). Partout, ce seront les principaux créanciers des Etats modernes. Et évidemment, leurs bourses et leurs coffres seront d’autant plus garnis que l’économie (l’agriculture, l’industrie, le commerce) qu’ils dominent sera plus prospère.
En deuxième lieu, le recours à l’emprunt n’est possible que pour autant que les Etats soient en mesure de fournir quelques garanties sérieuses en tant que débiteurs. A commencer par la garantie de verser les intérêts des emprunts pendant la durée de leur encours et de rembourser le principal à terme. Cette première garantie repose essentiellement sur les recettes ordinaires des Etats, les recettes fiscales au premier chef. De solides recettes fiscales sont donc une condition nécessaire pour pouvoir recourir à l’emprunt, si elles ne peuvent suffire à financer par elles-mêmes l’effort de guerre. Mais de pareilles recettes fiscales dépendantes à leur tour d’un certain nombre de conditions:
- L’aisance (toute relative) des couches populaires, sur lesquelles repose en particulier l’imposition indirecte. On rencontre ici une nouvelle fois ce facteur déterminant qu’est le dynamisme économique général de la formation sociale qui sert de base fiscale à l’Etat.
- Leur consentement à l’impôt, moyennant un «dialogue» entre le souverain et ses sujets, généralement par la médiation d’assemblées représentatives, instituées à cette occasion ou non.
- Enfin, toutes choses égales par ailleurs, le rendement de l’impôt sera d’autant plus élevé que son recouvrement se fera en régie directe, par l’intermédiaire d’un appareil d’Etat, en évitant les pertes sensibles de recettes que lui vaut l’affermage fiscal: ce dernier engloutit couramment au moins le tiers de l’impôt mais la proportion peut être quelquefois sensiblement supérieure.
Deuxième garantie que doit offrir l’Etat débiteur: celui de la stabilité monétaire. N’oublions pas que, durant toute la période protocapitaliste, le régime monétaire reste pour l’essentiel celui de la monnaie métallique, sonnante et trébuchante. Or il ne sert à rien de garantir que l’on sera en mesure de verser les intérêts et de rembourser le principal si cela doit se faire en «monnaie de singe», entendons en monnaie adultérée (dont le poids ou le titrage en métal précieux aura été réduit). Il faut donc que le souverain prenne l’engagement de ne pas céder aux facilités des manipulations monétaires, encore très courantes au début des temps modernes, surtout en période de guerre. Et, là encore, il y sera d’autant plus enclin ou contraint qu’il sera placé sous la surveillance et la pression d’assemblées représentatives.
Troisième condition favorisant le recours à l’emprunt: la transformation de la dette flottante en dette consolidée et perpétuelle. L’endettement public commence généralement sous forme de dettes flottantes (à échéances courtes et diverses et à taux variables). Mais leur multiplication, leur reconduction périodique, leur entrecroisement, l’accumulation de leurs intérêts et la difficulté de les rembourser aux échéances convenues vont inciter certains Etats à des opérations de consolidation et de rééchelonnement. Cela va se produire sous deux formes.
- D’une part, les transformations des dettes anciennes ou la constitution de nouvelles dettes sous forme de rentes constituées. Une rente constituée désigne à l’époque moderne l’intérêt résultant d’un prêt monétaire à très long terme (viager voire perpétuel), dont la garantie s’appuie généralement sur un bien foncier ou immobilier. Le crédirentier ne peut exiger le remboursement de son emprunt à son débirentier tant que celui-ci lui verse l’intérêt prévu, en n’ayant le cas échéant d’autre moyen de recouvrer son prêt que de vendre sa rente à un tiers.
- D’autre part, la titrisation de la dette publique. L’emprunt prend alors la forme d’émissions d’obligations (de bons du Trésor), remboursables à terme et portant intérêt en attendant, et parfaitement négociables. Ce qui suppose la constitution d’une banque d’Etat (généralement composée au départ des principaux créanciers antérieurs de l’État), disposant du privilège de l’émission, du placement et de l’escompte de ces titres.
C’est cette seconde formule qui va finir par s’imposer parce qu’elle présente de multiples avantages. Du côté des créanciers, les titres d’Etat étant négociables, ils leur permettent de recouvrer leur mise avant le terme prévu, moyennant l’apparition et le développement d’un marché financier, sur lesquels peuvent de surcroît se réaliser éventuellement des profits spéculatifs. Et du côté de l’Etat, elle permet de:
- Elargir le cercle des créanciers. D’une part, en mobilisant l’épargne populaire (celle de la petite-bourgeoisie, de la paysannerie enrichie) qui peut se placer dans des titres d’Etat alors qu’elle n’a aucune chance de participer au montage financier des « partis » (des consortiums de gros créanciers) qui monopolisent les dettes flottantes. D’autre part, en pouvant attirer aussi l’épargne étrangère par le biais du marché financier.
- Transformer sa dette en une dette perpétuelle. Les obligations anciennes pouvant se rembourser par l’émission d’obligations nouvelles, la dette publique est ainsi destinée à ne jamais s’éteindre. Cela dispense en quelque sorte l’Etat de rembourser le principal, à la condition d’être toujours en mesure de verser dûment les intérêts promis et d’en convaincre les créanciers potentiels.
La stratégie gagnante
Dans leurs affrontements militaires réguliers, les Etats européens les plus importants, ceux qui se disputent la prééminence en Europe et dans l’expansion commerciale et coloniale hors d’Europe, subissent donc des contraintes structurelles fortes. Sur la base des éléments précédents, il m’a été possible de définir ce que j’ai appelé la stratégie gagnante, apte à maximiser les chances de succès de ceux qui l’adopteront en renversant ces contraintes en leur faveur.
La première de ces contraintes structurelles résulte de la contradiction entre, d’une part, la nécessité pour ces Etats de se battre à la fois sur terre et sur mer (du moins s’ils veulent rester dans le peloton de tête: parmi les puissances centrales qui se disputent les bénéfices de l’expansion commerciale et coloniale outre-mer) et, d’autre part, le coût sans cesse croissant des armées et des marines. Dans ces conditions, s’il est nécessaire pour un Etat européen (du moins un Etat central) de mener la guerre sur les deux éléments, il lui est par contre impossible d’être le plus fort sur les deux à la fois. C’est tout simplement hors de ses moyens financiers.
Les Etats centraux, principaux protagonistes des guerres modernes, auront donc à choisir entre faire porter leurs efforts principalement sur l’arme terrestre ou privilégier au contraire l’arme navale. Mais, quel que soit leur choix, cela ne les dispense pas d’être présents sur l’autre terrain; simplement, ils ne pourront pas y jouer le premier rôle. Ils devront abandonner ce rôle à d’autres, à charge pour eux de s’en faire des alliés. Quant aux Etats semi-périphériques, protagonistes éventuels dans ces guerres, ils n’y participeront généralement que sur l’un ou l’autre de ces éléments, en y jouant un rôle secondaire comme alliés des Etats centraux.
La seconde contrainte structurelle pèse précisément sur les conditions dans lesquelles de telles alliances peuvent être conclues. Elle relève des principes qui régissent le système d’Etats européens en cours de constitution [7]:
- Le principe d’équilibre des puissances. Il doit être impossible à l’un quelconque des Etats européens d’atteindre une puissance telle qu’il puisse imposer sa volonté impériale à l’ensemble des autres Etats. Il faut veiller à la pondération réciproque des puissances du continent, de sorte que la coalition des plus faibles soit toujours plus forte que le plus fort, ou du moins capable de le tenir en échec.
- Le principe de prédominance hégémonique. L’Etat européen le plus fort doit dès lors se contenter de diriger une coalition ou une alliance regroupant un nombre variable d’autres Etats mais non pas tenter de les subordonner à lui dans une formule impériale. Cette alliance est clairement ordonnée en fonction de ses intérêts propres. Mais elle doit simultanément ménager ceux de ses alliés et, surtout, veiller à l’équilibre des puissances à l’intérieur du système.
Sur la base de l’ensemble des éléments précédents, on peut définir les conditions d’une stratégie optimale. Ce sont les suivantes :
Première condition: régner sur la mer plutôt que sur la terre. D’une part, c’est la stratégie appropriée à la finalité générale de la guerre pendant toute l’époque protocapitaliste: s’assurer une position prépondérante dans l’expansion commerciale et coloniale hors d’Europe, puisqu’elle est le principal moteur de la dynamique protocapitaliste. Ce qui suppose de:
- Pendant la guerre, être en mesure de défendre au mieux ses propres possessions et points d’appui outre-mer ainsi que les circuits commerciaux maritimes entre la métropole et l’outre-mer, tout en nuisant au maximum aux possessions, points d’appui et circuits de l’ennemi, en ruinant par exemple son commerce maritime par la course et par le blocus de ses ports.
- A la fin de la guerre, pour autant que l’on soit victorieux, veiller à ce que les clauses du traité de paix soient conformes à ces mêmes objectifs.
D’autre part, en contribuant ainsi à asseoir une position prédominante dans l’expansion commerciale et coloniale, la prédominance sur mer participe à la dynamisation économique de la métropole, gage de recettes fiscales abondantes et des possibilités d’emprunt élargies.
Enfin, sur un plan strictement militaire, la prédominance dans la guerre maritime peut peser lourd y compris sur la guerre terrestre. Régner sur la mer, c’est se donner les moyens de harasser et de menacer les ports et les côtes de l’ennemi, en l’obligeant à distraire une partie de ses forces terrestres pour les défendre, faute que ses forces navales y suffisent. C’est se donner les moyens de ravitailler et de soutenir ses propres troupes à terre, du moins pour toutes les opérations terrestres se déroulant à proximité des côtes, tout en empêchant l’ennemi d’en faire autant.
Deuxième condition: être capable de constituer et de diriger une coalition ou alliance qui reporte sur d’autres le poids principal de la guerre terrestre. Cela règle le problème qui résulte de l’impossibilité de régner simultanément sur la terre et la mer, en instituant une sorte de division du travail entre la puissance hégémonique et ses alliés, la première régnant sur la mer tandis que les seconds parviennent au minimum à tenir tête à l’ennemi sur terre. Ce qui suppose d’être malgré tout présent au sein de cette coalition (d’engager un minimum de forces terrestres) et de soutenir ses alliés par des subsides ou des prêts.
Troisième condition: s’assurer un bon crédit (dans tous les sens du terme), à l’intérieur (chez soi) comme à l’extérieur (dans les autres Etats), gage de rapides, larges et constantes possibilités d’emprunt. Mais on sait que cette condition en suppose elle-même plusieurs autres: un dynamisme économique général; une fiscalité solide; une monnaie stable; l’institution d’une dette publique consolidée, adossée à une banque d’Etat; une saine gestion des finances publiques grâce au contrôle qu’exercent sur elles des assemblées représentatives.
C’est pareille stratégie qui a rendu possible, par exemple, la victoire des Provinces-Unies sur l’Espagne (la Castille) pendant la guerre de Quatre Vingts Ans (1566-1648), au terme de laquelle elles auront conquis leur indépendance [8]; et celle de l’Angleterre (devenue entre-temps Grande-Bretagne et même Royaume-Uni) sur la France pendant la seconde Guerre de Cent Ans (1888-1815), dont je n’ai analysé dans mon ouvrage que les deux premiers rounds, celui correspondant à la guerre de la Ligue d’Augsbourg (1688-1697) et à la guerre de Succession d’Espagne (1701-1714) et celui correspondant à la guerre de Succession d’Autriche (1740-1748) et à la guerre de Sept Ans (1756-1763) [9]. (La seconde partie sera mise en ligne le 22 avril 2023)
__________
[1] Le premier âge du capitalisme, Tome 3 : Un premier monde capitaliste, Lausanne/Paris, Page 2/ Syllepse, 2019.
[2] Le premier âge du capitalisme, Tome 2 : La marche de l’Europe occidentale vers le capitalisme, Lausanne/Paris, Page 2/Syllepse, 2019, pages 348-356.
[3] Krieg und Kapitalismus (Le capitalisme et la guerre), Munich/Leipzig, Dunker&Humblot, 1913.
[4] L’asiento de negros était le contrat qui permettait à une compagnie commerciale d’approvisionner les colonies hispano-américaines en esclaves africains. Le navÍo de permisio autorisait deux navires marchands de cinq cent tonneaux à aborder les ports de Carthagène et de Veracruz pour y participer à leurs foires. L’un et l’autre fournissaient surtout des voies d’entrer au commerce de contrebande mené à partir des Antilles, des colonies nord-américaines ou directement des îles Britanniques.
[5] Cf. Geoffrey Parker, La révolution militaire. La guerre et l’essor de l’Occident 1500-1800, Paris, Gallimard, 1993 ; Jean Bérenger (dir.), La révolution militaire en Europe (XVe-XVIIIe siècles), Paris, Economica, 1998.
[6] Gabriel Ardant, Histoire de l’impôt. De l’Antiquité au XVIIe siècle, Paris, Fayard, 1971, page 242.
[7] Cf. La marche de l’Europe vers le capitalisme, op. cit., pages 521-528.
[8] Cf. Un premier monde capitaliste, op. cit., pages 183-196, 202-210 et 283-287.
[9] Cf. Un premier monde capitaliste, op. cit., Chapitre X.6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Partie 2
Au printemps 1566 éclatent dans l’ensemble des Anciens Pays-Bas, alors possession espagnole (castillane), des troubles dont personne ne peut alors imaginer qu’ils se solderont quelque quatre-vingts ans plus tard par la victoire des insurgés, certes repliés sur sept seulement des dix-sept provinces dont se composaient ces Pays-Bas, tant la disproportion du rapport de force est énorme.
La guerre de Quatre-vingts Ans
C’est que les geuzen révoltés [10] se trouvent face au plus puissant Etat européen de l’époque, l’Espagne habsbourgeoise, qui vient à peine dix ans auparavant de faire céder la France au terme du cycle des guerres dites d’Italie (1494-1557). Leur victoire s’explique précisément par le fait qu’eux ont su réunir la plupart des conditions de cette stratégie optimale que je viens de définir [voir la première partie de l’article publié le 21 avril 2023]; ce dont l’Espagne (la Castille) va s’avérer incapable.
1. En premier lieu, la suprématie maritime. Au cours des deux siècles précédents, les provinces septentrionales des Anciens Pays-Bas (Hollande et Zélande en tête) étaient devenues une puissance maritime de tout premier ordre, tant dans le domaine de la pêche (notamment aux harengs) que dans celui du commerce et du fret maritimes (en direction tant de la Méditerranée que des îles Britanniques et de la Baltique). Elles avaient accumulé ainsi moyens matériels (navires de tous types, chantiers navals, accès aux fournitures navales) et savoir-faire (matelots et capitaines expérimentés, traditions maritimes).
De ce fait, sur ce terrain, le rapport de force sera d’emblée favorable aux insurgés, comme le montreront les succès des zeegeuzen (les gueux de la mer) dès le début des années 1570. C’est ce qui leur vaudra de contrôler rapidement les côtes frisonnes, hollandaises et zélandaises, en élargissant leur tête de pont. Et ce rapport de force ne cessera de se déséquilibrer en leur faveur par la suite: en témoigneront les défaites cuisantes des Espagnols à Gibraltar (25 avril 1607) et aux Downs (21 octobre 1639) ainsi que les pertes infligées plus généralement à la marine espagnole tout le long du conflit. De ce fait, cette supériorité maritime soumettra à une menace constante les côtes des possessions espagnoles, tant aux Amériques qu’en Europe, ainsi que les voies maritimes les reliant entre elles.
La suprématie maritime néerlandaise va ainsi contraindre les Espagnols à chercher à vaincre les insurgés par voie de terre, en tentant de jouer de leur supériorité écrasante sur ce terrain. Mais cette même suprématie maritime va aussi les entraver sur ce terrain même. Elle va les contraindre à acheminer troupes et ravitaillement par voie de terre, depuis l’Italie (Gênes) jusqu’aux provinces méridionales des Anciens Pays-Bas via le Milanais, la Valteline, l’Allemagne méridionale et la vallée rhénane. Voie longue et pénible, rendue plus difficile encore par l’hostilité des populations de certaines régions traversées ou des puissances voisines, puis par la belligérance durant la guerre de Trente Ans tout le long de la vallée du Rhin.
2. La capacité hégémonique néerlandaise. Le deuxième atout des Provinces-Unies aura bien été leur capacité à constituer, consolider et conduire un système d’alliances tourné contre leur ennemi. Il réunira tous les Etats qui auront à redouter le tropisme impérial espagnol et qui, à un titre ou un autre, auront un intérêt direct à la tenir en échec.
Dans un premier temps, en gros jusqu’à la trêve signée en 1609, cette capacité hégémonique est le fruit de la résistance opiniâtre et victorieuse que les Provinces-Unies opposent à l’Espagne. Elle se limite à attirer à elles l’Angleterre d’Élisabeth Ière (c’est avec elle que les Néerlandais déferont en 1588 la si mal surnommée Invincible Armada) et, dans une moindre mesure, la France de Henri IV.
Mais, lorsque les hostilités reprendront en 1621, les Provinces-Unies parviendront à constituer une alliance bien plus large et plus puissante, réunissant outre les princes allemands protestants révoltés contre l’empereur, successivement le Danemark, la Suède et surtout la France, singulièrement renforcée entre-temps. Ce qui leur permettra d’ailleurs de minimiser le coût de la poursuite de la guerre contre l’Espagne et ses alliés impériaux sur terre, en le reportant pour l’essentiel sur ses principaux alliés, la Suède puis la France, tout en les soutenant financièrement.
3. La puissance financière néerlandaise versus la gabegie financière castillane. La victoire néerlandaise a tenu, en troisième et dernier lieu, à la facilité dont disposaient les autorités néerlandaises (la Généralité, les amirautés, les différentes provinces et les principales villes, Amsterdam en tête) d’emprunter auprès de leurs propres sujets ou auprès d’étrangers, pour se procurer rapidement les ressources monétaires nécessaires à la poursuite de la guerre, en dépit de la dramatique augmentation de son coût après la reprise des hostilités en 1621. C’est qu’elles pouvaient gager le remboursement de leurs emprunts :
- sur une fiscalité dont les impôts indirects constituaient la part majeure, leur rentrée étant assurée par la large monétarisation de l’économie, adossée à la prospérité continue du commerce intérieur et extérieur néerlandais en dépit des hostilités, du fait qu’il était essentiellement un commerce maritime;
- sur le fait que les finances publiques néerlandaises, aux différents échelons du pouvoir, sont sous la surveillance ou même la direction d’assemblées représentatives (les Etats généraux, les Etats provinciaux, les municipalités), au sein desquels l’élément bourgeois est le plus souvent prépondérant; ce qui en garantit la saine gestion et la bonne tenue.
Inversement, faute d’un appareil fiscal aussi efficace, faute surtout d’une saine gestion de ses finances publiques, l’Etat espagnol (en fait castillan) va rapidement devoir compter exclusivement sur l’arrivée des métaux précieux américains et les disponibilités du crédit «international» (par l’intermédiaire des banquiers génois) pour faire face au coût grandissant de la guerre. Avec pour conséquences de se retrouver dans une situation de détresse financière à chaque fois que l’or et l’argent américains n’arriveront pas (notamment du fait de l’action des pirates et corsaires néerlandais et de leurs alliés), arriveront en retard ou arriveront en trop faible quantité, en devant prononcer une banqueroute au lendemain de laquelle le recours au crédit sera encore plus difficile… et plus onéreux.
Le tout ne pouvant que perturber la poursuite des opérations militaires, voire la rendre tout simplement impossible. C’est la banqueroute de 1575 qui provoque, neuf mois plus tard, la mutinerie générale des troupes mercenaires engagées contre les insurgés néerlandais n’ayant plus touché de soldes, conduisant à l’effondrement du pouvoir habsbourgeois à Bruxelles. Celle de 1607 contraint Philippe III à concéder une trêve aux insurgés début 1609. Celle de 1627 permet aux Néerlandais de s’emparer de Bois-le-Duc, de Wesel et d’autres localités, les troupes mercenaires espagnoles ayant cessé de combattre. Celle de 1647 précipite la signature de la paix.
Entre-temps, la tentative menée par le comte-duc d’Olivares, «Premier ministre» de Philippe IV, de soulager la Castille du fardeau fiscal de la guerre, en en reportant en partie la charge sur les autres composantes européennes de l’Empire des Habsbourg d’Espagne aura abouti à la révolte de la Catalogne et à la sécession du Portugal en 1640, en engageant les forces castillanes sur deux fronts supplémentaires. Les fiers souverains espagnols éprouveront ainsi à leurs dépens que, dans le monde protocapitaliste, la puissance militaire est devenue essentiellement une affaire de richesse marchande, commerciale et financière.
Résumons. Suprématie maritime, d’où prospérité marchande, d’où rendement assuré de la fiscalité indirecte, d’où larges possibilités d’emprunts, qui permettent de financer sans problème majeur l’effort de guerre sur mer ainsi que des coalitions garantes de l’établissement et du maintien d’alliances à direction hégémonique capables de contenir et même de vaincre l’ennemi sur terre, en permettant en retour de conserver et même de renforcer la suprématie maritime: voilà une base solide pour gagner une guerre prolongée dans les conditions de l’époque protocapitaliste.
La seconde guerre de Cent Ans
Ce sont en gros les mêmes facteurs qui vont assurer la victoire de la Grande-Bretagne sur la France durant cette seconde guerre de Cent Ans qui débute par la guerre de la Ligue d’Augsbourg et s’achèvera dans la «morne plaine» de Waterloo.
1. En premier lieu donc, la suprématie maritime. Paradoxalement, la recherche de cette suprématie est la conséquence directe de la lourde défaite que la France inflige à l’Angleterre à la fin de la première guerre de Cent Ans (1453). Car cette défaite prive la monarchie anglaise et l’élite de sa noblesse de leurs riches possessions sur le sol français et les confine dans les îles Britanniques. Encore affaiblies par la guerre des Deux Roses entre 1455 et 1485, elles n’auront plus d’autre choix que de se lancer, d’une part, dans une meilleure mise en valeur de leurs terres en Angleterre même (ce qui vaudra à cette dernière de s’engager tôt dans une «révolution agraire» protocapitaliste), d’autre part, dans la recherche de toutes les ressources que l’on peut tirer de la mer: la pêche, la piraterie et l’expansion commerciale et coloniale.
- La piraterie va ainsi devenir, au cours du XVIe siècle, la grande cause nationale anglaise, en s’exerçant non seulement dans la Manche et la mer du Nord au détriment du commerce français et néerlandais mais encore dans l’Atlantique, au détriment des flotas espagnoles rapportant l’or et l’argent extrait des mines de Zacatecas et de Potosi.
- L’expansion commerciale se fera tout d’abord sous la forme d’un intense cabotage au sein des îles Britanniques elles-mêmes, avant de se déployer dans la mer du Nord et la Baltique où elle viendra concurrencer le commerce néerlandais mais aussi en Méditerranée où elle se déploiera au détriment du commerce français. Et avec la constitution le 31 décembre 1600 de l’East India Company (la Compagnie anglaise des Indes orientales), les Anglais afficheront clairement leur ambition de venir contester les positions portugaises dans le commerce asiatique, même s’ils seront moins heureux que leurs rivaux néerlandais de la Vereenigde Oost-Indische Compagnie (la Compagnie néerlandaise des Indes orientales).
- Quant à l’expansion coloniale, elle se fera d’abord au détriment de l’Irlande au cours du XVIe siècle avant, dans la première moitié du siècle suivant, de s’emparer de positions espagnoles dans les Antilles (en y acquérant du même coup des points d’appui pour leur piraterie et leur contrebande) et d’occuper progressivement toute la façade atlantique de l’Amérique du Nord, entre le Saint-Laurent et la Floride.
Cette intense activité maritime, rien moins que pacifique par bon nombre de ses aspects, va tôt s’accompagner, dès Henri VII (1485-1509) et Henri VIII (1509-1547) de la formation d’une marine de guerre au sens propre, la première en Europe, la Navy, composée de navires hauturiers et non pas seulement de galères, produits par des arsenaux royaux. Cette marine va croître en puissance tout au long du XVIe siècle; ce sont par exemple les Anglais qui vont les premiers placer leur artillerie embarquée sur les ponts inférieurs, en faisant tirer les canons par des sabords, et qui vont mettre au point la tactique de la bataille en ligne.
La montée en puissance mais aussi les ambitions grandissantes de l’Angleterre sur mer se manifesteront clairement à partir du milieu du XVIIe siècle, lorsque le Parlement anglais adoptera les deux Navigation Acts (1652 et 1660), destinés à contester le quasi-monopole néerlandais dans le commerce et le fret maritimes dans la Baltique, en mer du Nord et même dans les Antilles. En effet, ils réservent aux seuls navires anglais la possibilité d’introduire en Angleterre et dans ses colonies des marchandises en provenance d’Asie, d’Afrique ou des Amériques; tandis que les marchandises en provenance d’Europe ne pourront y être introduites qu’en étant transportées par des navires anglais ou des navires des pays à partir desquels elles ont été exportées. Il va en résulter trois guerres anglo-néerlandaises (1652-1654, 1664-1667 et 1672-1674) au cours desquelles la Navy sera en mesure de faire mieux que bonne figure face aux redoutables marins néerlandais.
Et, dès lors que s’amorcera la seconde Guerre de Cent Ans, la suprématie de la Navy ne fera que se confirmer et se renforcer. L’Amirauté britannique, parfaitement soutenue par le Parlement, veillera tout au long du XVIIIe siècle à ce que son effectif soit en gros le double de celui de la Royale (la marine de guerre française) et dépasse même celui des deux marines française et espagnole réunies (alliées), en y consacrant l’essentiel du budget militaire. Et elle y parviendra d’autant mieux que, face à elle, la France aura tôt fait le choix inverse, celui de privilégier la guerre terrestre.
Inverse de celui des Anglais, le choix français est d’abord un choix contraint. Si l’Angleterre peut et même doit d’abord compter sur sa marine pour se défendre face à tout risque d’invasion, il ne peut en aller de même pour la France. Car, si la France possède une des plus longues façades maritimes en Europe, elle possède presque autant de frontières terrestres, dont certaines ne sont entravées par aucun obstacle naturel. Ainsi en va-t-il notamment de ses frontières du Nord-est, s’étendant du nord de l’Alsace à la Manche, une trouée par laquelle s’engouffreront toutes les invasions que le territoire français subira au cours des siècles. Il lui faut donc défendre ses frontières, notamment cette section particulièrement vulnérable, par des lignes de fortifications (Vauban s’y emploiera en particulier) et en entretenant de puissantes forces armées terrestres. Or on sait qu’aucun Etat européen n’a à l’époque les moyens d’être le plus puissant à la fois sur terre et sur mer.
Mais ce choix de la lutte sur terre répond aussi, dans le cas de la France, à d’autres facteurs, moins directement contraignants. Durant toute l’époque protocapitaliste, la Russie mise à part, la France est la formation sociale européenne la plus peuplée: elle comptera en moyenne sur la période une petite vingtaine de millions d’habitants, soit plus que deux fois la population de l’Espagne, plus que trois fois celle de l’Angleterre, entre huit et dix fois celle des Provinces-Unies, pour s’en tenir à ses voisines et rivales immédiates. Elle le doit essentiellement à sa richesse agricole, héritage du Moyen Age et même de l’Antiquité, qui en fait aussi un pays essentiellement rural, où les intérêts fonciers sont prédominants, en assurant une solide assise à la noblesse et au clergé. Ce qui ne peut que conforter l’idée qu’il n’est de richesse et de puissance que celles qui procèdent de la terre (les physiocrates ne diront pas autre chose jusque tard dans le XVIIIe siècle) et que le meilleur moyen de les accroître est d’étendre la surface des terres que l’on possède. D’où la tendance naturelle à préférer la guerre sur terre que celle sur mer.
D’autant plus que ces mêmes facteurs démographique et économique auront longtemps incité les marchands et manufacturiers français à se tourner d’abord vers le marché intérieur plutôt que vers les marchés extérieurs. Ce qui explique le retard avec lequel la France se lancera dans l’expansion commerciale et coloniale outre-mer (elle sera la dernière des grandes puissances d’Europe occidentale à entrer dans cette voie) et la longue médiocrité des résultats qu’elle y enregistrera, en dépit des efforts déployés sous les ministères de Richelieu (1624-1642) et de Colbert (1661-1683) dans une perspective toute mercantiliste. A la notable exception des armateurs et marchands des villes de la façade atlantique (de Bayonne à Saint-Malo) et des manufacturiers de leurs arrière-pays immédiats. Ce qui ne pouvait que redoubler le peu d’intérêt qu’il y avait à développer l’arme navale.
Les mêmes Richelieu et Colbert seront du coup les seuls ministres à prendre au sérieux la nécessité d’un tel développement. C’est sous les ministères de Colbert et de son fils et successeur Seignelay (1683-1690) que la France se hissera au premier rang de la puissance navale, juste avant que les déboires des débuts de la guerre de la Ligue d’Augsbourg ne décident Louis XIV et ses principaux ministres de renoncer à la guerre d’escadre pour se contenter de cette guérilla navale qu’est la guerre de course. La puissance navale française déclinera alors rapidement. En dépit des efforts de réarmement entrepris dans les années 1740 et surtout, sous l’impulsion de Choiseul et de Sartine, dans les années 1760 et 1770, jamais plus la Royale ne sera en mesure de faire jeu égal avec la Navy. Cela vaudra à la France de perdre la quasi-totalité de ses possessions coloniales et de ses comptoirs commerciaux au Québec et surtout aux Indes (dans le Carnatic et au Bengale), pourtant très prometteurs s’agissant des seconds.
2. Deuxième atout britannique: la capacité hégémonique. Le choix britannique de privilégier la guerre maritime impliquait que la Grande-Bretagne soit en mesure d’édifier et de conduire une alliance avec d’autres Etats sur le continent, capable de tenir tête aux armées françaises. C’est ce que je nomme sa capacité hégémonique.
Dans un premier temps, elle va l’acquérir de manière inattendue et, là encore, proprement paradoxale. En fait, elle va littéralement hériter de la capacité hégémonique néerlandaise. En effet, au printemps 1672, lorsque les Provinces-Unies se trouvent brutalement agressées et en partie envahies par la France, alliée pour la circonstance à l’Angleterre, elles ne devront leur salut, outre l’inondation artificielle d’une grande partie de la Zélande et de la Hollande, à la constitution autour d’elles d’une vaste alliance. Celle-ci réunira, en à peine plus d’un an, le Saint Empire, le Grand Electorat de Brandebourg (la future Prusse), le Danemark, le duché de Lorraine et même l’Espagne, pourtant ancien ennemi héréditaire. Elle devra tout aux talents diplomatiques du stadhouder Guillaume III d’Orange; mais aussi aux subsides que les Etats généraux des Provinces-Unies alloueront à leurs alliés; enfin à la crainte que l’appétit territorial de l’ogre français inspire à toutes les Cours d’Europe. C’est notamment cette crainte qui conduira l’Angleterre à sortir de l’alliance française en février 1674; puis, après l’opportun mariage en novembre 1677 de Guillaume III avec sa cousine Marie Stuart, fille aînée du frère cadet du roi Charles II, le futur Jacques II, l’Angleterre elle-même rejoindra l’alliance anti-française en janvier 1678, précipitant la fin de la guerre.
C’est cette même alliance, encore étendue et renforcée (par la Saxe, la Bavière et la Savoie), que le même Guillaume III d’Orange remet sur les pieds à partir du milieu de la décennie suivante, face à un Louis XIV toujours aussi menaçant du fait de sa politique de «réunions» (des annexions ou des prétentions territoriales tout le long de la frontière nord-est, jouant des ambiguïtés des clauses des traités de Westphalie et de Nimègue) et dont l’impopularité dans les Etats protestants est à son comble à la suite de la révocation de l’édit de Nantes qui va chasser quelque deux cent mille huguenots. Ce sera la Ligue d’Augsbourg. Et, quand la guerre éclate, Guillaume III exécute un audacieux coup de force: pour prévenir toute reconstitution de l’alliance franco-anglaise, il débarque en Angleterre à la tête de vingt mille mercenaires, marche sur Londres, en chasse Jacques II (son propre beau-père) et se fait élire, lui et son épouse, roi et reine d’Angleterre et d’Ecosse par les Parlements de Londres et d’Edimbourg, en enrôlant du coup ces deux royaumes dans l’alliance anti-française. Celle-ci va dès lors être dirigée par un condominium anglo-néerlandais.
Dans ce condominium, l’élément britannique semble a priori subordonné à l’élément néerlandais: somme toute, ce sont les Provinces-Unies qui ont envahi l’Angleterre, en y imposant un changement de régime; et c’est un Orange qui est monté sur les deux trônes anglais et écossais. En fait, le premier élément va rapidement devenir prépondérant. Si le rapport entre les deux est encore globalement équilibré pendant la guerre de la Ligue d’Augsbourg, le déséquilibre devient manifeste à la faveur du conflit suivant, la guerre de Succession d’Espagne. C’est que, en ce début de XVIIIe siècle, la puissance économique et financière néerlandaise commence à décliner (pour la première fois, les Provinces-Unies auront du mal à financer la guerre) tandis que celle de la Grande-Bretagne est en pleine ascension. Le passage de l’hégémonie des Provinces-Unies à la Grande-Bretagne tient aussi à la division du travail qui s’est imposée dans leur coopération militaire: aux Britanniques, le soin de régner sur les mers, aux Néerlandais le soin de fournir l’essentiel de l’effort conjoint sur la terre, en liaison avec le restant des alliés. C’est que, contrairement aux premiers, les seconds seront constamment sous la menace des forces terrestres françaises, capables d’envahir les Pays-Bas espagnols pendant la guerre de la Ligue d’Augsbourg et installées à demeure dès lors que ces derniers seront devenus possessions des Bourbon d’Espagne. Or, pas plus qu’aucune autre puissance européenne de l’époque protocapitaliste, fût-elle aussi riche qu’elles le sont alors, les Provinces-Unies n’ont les moyens d’entretenir de larges forces militaires à la fois sur terre et sur mer.
Et, par la suite, lors du second round de cette seconde Guerre de Cent Ans, soit pendant la guerre de Succession d’Autriche puis pendant la guerre de Sept Ans, la capacité hégémonique britannique n’a pas failli, selon une formule désormais rodée: garantir à leurs alliés une suprématie incontestée sur mer; les soutenir militairement et surtout financièrement sur terre, en les chargeant d’y fournir l’effort principal. A deux différences près cependant. Sur mer, ils pourront de moins en moins compter sur l’appui des Néerlandais, qui leur fera même totalement défaut pendant la guerre de Sept Ans; ce qui prouvera qu’ils pouvaient désormais s’en passer. Sur terre, d’une guerre à l’autre, il leur faudra changer d’allié principal, en passant de l’Autriche à la Prusse.
3. Troisième atout britannique: la puissance financière. Entendons une capacité à s’endetter régulièrement, massivement et à bon compte; en tout cas, à de meilleures conditions que son ennemi. C’est que la Grande-Bretagne aura su s’assurer au cours des XVIIe et XVIIIesiècles quelques-unes des conditions que l’on sait essentielles à l’établissement et au maintien d’un crédit solide. Ce dont la France va s’avérer incapable. A savoir:
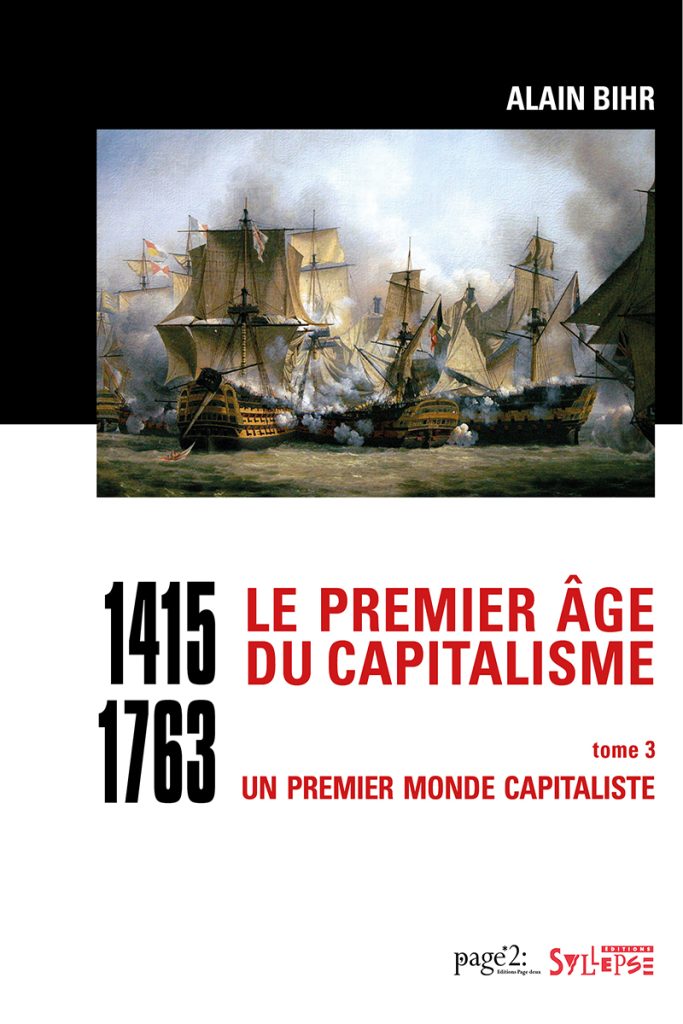 Une fiscalité solide. Il y a trois différences notables entre la fiscalité britannique et son homologue française. D’une part, la part (majoritaire dans les deux cas) des impôts indirects (droits de douane et accises) est plus importante en Grande-Bretagne qu’en France; ce qui permet à la fiscalité britannique de bénéficier pleinement de la croissance économique et démographique. D’autre part, contrairement à ce qu’on a longtemps dit et cru, la fiscalité britannique est globalement plus lourde que la fiscalité française: la taxe foncière frappe toutes les propriétés, y compris nobles; les accises sont plus nombreuses et leur taux plus élevé. Enfin, contrairement à la France, les impôts ne sont pas affermés en Grande-Bretagne: les impôts directs sont de longue date prélevés par des fonctionnaires locaux, généralement des membres de la gentry; tandis que les douanes ont cessé d’être affermées en 1672 et les accises en 1683.
Une fiscalité solide. Il y a trois différences notables entre la fiscalité britannique et son homologue française. D’une part, la part (majoritaire dans les deux cas) des impôts indirects (droits de douane et accises) est plus importante en Grande-Bretagne qu’en France; ce qui permet à la fiscalité britannique de bénéficier pleinement de la croissance économique et démographique. D’autre part, contrairement à ce qu’on a longtemps dit et cru, la fiscalité britannique est globalement plus lourde que la fiscalité française: la taxe foncière frappe toutes les propriétés, y compris nobles; les accises sont plus nombreuses et leur taux plus élevé. Enfin, contrairement à la France, les impôts ne sont pas affermés en Grande-Bretagne: les impôts directs sont de longue date prélevés par des fonctionnaires locaux, généralement des membres de la gentry; tandis que les douanes ont cessé d’être affermées en 1672 et les accises en 1683.
Une monnaie stable. Il faut relever la remarquable stabilité de la livre sterling, étonnante dans un régime monétaire métallique structurellement instable. Sa valeur est fixée sous Elisabeth Ire en 1560-1561 à l’équivalent de quatre onces d’argent fin, une valeur qu’elle conservera par la suite jusqu’en… 1931, en n’enregistrant qu’une faible dévaluation de 3,2% en 1601. Alors qu’il faudra attendre 1726 pour que la livre tournois soit de même stabilisée. Cela s’explique par plusieurs raisons.
- Le solde positif constant de son commerce extérieur a valu à l’Angleterre de bénéficier d’un afflux régulier de métaux précieux, condition indispensable à la qualité de l’émission monétaire en régime de monnaie métallique.
- Contrairement à la France, l’Angleterre n’a été engagée dans aucune guerre d’importance entre 1485 et 1652, soit pendant plus d’un siècle et demi, évitant ainsi aux finances publiques anglaises de connaître ces situations de stress qui incitent ordinairement les gouvernements à des manipulations monétaires pour gonfler artificiellement leurs moyens de paiement et dévaluer leurs dettes, comme ce sera le cas en France.
- Enfin, auraient-ils été tentés de recourir à de tels moyens que les souverains anglais en auraient été empêchés par le contrôle constant exercé sur les finances publiques par le Parlement.
Une gestion des finances publiques saine. Ce contrôle parlementaire assure plus largement une saine gestion de ces finances, alors qu’il est quasi inexistant en France. Dès sa création en 1215 par la Magna Carta (la Grande Charte), c’est le Parlement anglais qui seul autorise (ou non) le roi (ou la reine) à lever des impôts et à entrer en guerre. Par la suite, alors que sa composition s’élargit aux représentants des communes (villes et gros bourgs), son pouvoir ne cessera de se renforcer. Sous les Tudor, il obtient que le remboursement de tout emprunt soit gagé sur une recette fiscale spécialement affectée à cette fin. Pour avoir défié ses prérogatives, Charles Ier Stuart (1625-1649) y perdra sa couronne et finalement sa tête. Et, à la faveur de la Glorious Revolution orangiste (1688-1689), est institué un régime de monarchie constitutionnelle dans lequel, selon la formule consacrée, le roi ou la reine continue certes de régner mais ne gouverne plus: le budget de l’Etat est décidé par le Parlement et son exécution est contrôlée par lui, les ministres devenant responsables devant lui, tandis que le souverain doit se contenter du montant de la liste civile qui lui est attribuée, en plus des revenus qu’il peut tirer de ses domaines propres.
En France, rien de tel. Les Etats généraux, avec lesquels le roi doit en principe négocier le principe et le montant des impôts, ne seront plus convoqués entre 1614 et… 1789. Dans ces conditions, la monarchie absolue française a pu s’abandonner à son insouciance quant aux dépenses de l’Etat, y compris celles de la Maison royale et de la Cour et celles des guerres à répétition, jusqu’à se trouver finalement complètement ruinée. Lorsque Louis XVI se décide à rappeler Jacques Necker fin août 1788, le service de la dette absorbe les deux tiers du budget de l’État et il manque 300 millions de livres pour assurer l’équilibre de ce dernier [11]. On ne peut alors différer la convocation des Etats généraux. La suite est connue…
L’institution d’une dette publique consolidée. Enfin, dernière condition favorable à l’instauration et au maintien d’un crédit solide en Grande-Bretagne, qui aura fait défaut en France: la transformation de la dette flottante en une dette consolidée adossée à une Banque d’Etat. Je ne peux pas reprendre ici l’analyse de ce processus qui aura couvert toute la première moitié du XVIIIe siècle et aura vu la Banque d’Angleterre, créée en 1694, devenir progressivement le pivot de la gestion d’une dette publique contractée sous forme de l’émission de titres négociables [12].
Là encore, rien de tel en France où le crédit public continuera à reposer sur la formation de rentes constituées et des emprunts contractés auprès de consortiums de «financiers», regroupant receveurs des impôts directs, fermiers des impôts indirects (notamment ceux de la Ferme générale) ainsi que banquiers (lyonnais, génois et genevois), opérant pour le compte de membres des couches supérieures des deux premiers ordres, clergé et noblesse. Différents projets de constitution d’une banque d’Etat analogue à la banque d’Angleterre verront cependant le jour dans les années 1700 et 1710. La tentative la plus sérieuse en ce sens a été menée par John Law (1671-1729). En décembre 1718, il parvient à convaincre le régent Philippe d’Orléans de transformer sa banque privée en Banque royale, disposant du monopole de l’émission de monnaie fiduciaire. L’année suivante, il propose de racheter l’ensemble des rentes constituées, des titres de la dette flottante, bon nombre d’offices et les fermes fiscales, en les échangeant contre des titres de sa Compagnie des Indes, réunion de la Compagnie d’Occident exploitant la Louisiane, de la Compagnie du Sénégal maîtresse de la traite négrière vers les Antilles françaises, de la Compagnie des Indes orientales et de la Compagnie de Chine que Law avait réalisée parallèlement, avec laquelle sa Banque fusionnera en définitive en février 1720. De la sorte, Law espère réaliser d’une pierre trois coups: consolider définitivement la dette publique française, préalable à son amortissement éventuel; mobiliser les capitaux ainsi libérés pour les mettre au service de l’expansion commerciale et coloniale de la France; permettre à la circulation marchande de se libérer des contraintes de la monnaie métallique en lui substituant une monnaie fiduciaire, gagée en définitive sur le crédit de l’Etat et, à travers lui, sur la dynamique économique générale. Mais ce montage monétaro-financier ne résistera pas à la spéculation sur les titres qu’il a lui-même lancée par la témérité de ses entreprises et que ses différents adversaires, ministres, fermiers fiscaux et banquiers privés, dont il menaçait directement les intérêts, se sont ingéniés à déchaîner contre lui.
4. Résumé. En somme, dans leur affrontement contre les Français, les Britanniques auront su bénéficier des mêmes atouts que ceux qui avaient permis aux Néerlandais de vaincre les Espagnols un siècle auparavant: la suprématie maritime, la prospérité marchande, le rendement assuré d’une fiscalité indirecte dont les échanges intérieurs et extérieurs constituent l’assiette, de larges possibilités d’emprunts, la capacité de financer leur propre effort de guerre (menée principalement sur mer) ainsi que l’établissement et le maintien de larges coalitions sur le continent dont ils s’assuraient la direction par le biais de leurs subsides. Dans les deux cas, un petit Etat dont la prospérité est fondée essentiellement sur le commerce maritime et une fiscalité indirecte, dont l’usage des recettes fait l’objet d’un contrôle par les classes dominantes via des assemblées représentatives, est venu à bout d’un grand Etat territorial, dont la fiscalité foncière est grevée d’exemptions d’ordre et d’un pillage par les intermédiaires financiers, en dehors de tout contrôle y compris par un pouvoir qui se voulait pourtant absolu.
Je pense qu’il est désormais inutile de revenir sur le titre de cet article, d’apparence énigmatique à première vue, mais qui a trouvé à s’expliciter dans le fil des développements précédents. Retenons que, tout au long de la période protocapitaliste, par-delà des Etats qui en sont les protagonistes immédiats, les guerres confrontent en fait des formations sociales, prises dans toutes leurs dimensions, démographiques, économiques, sociales, institutionnelles, notamment les rapports de force entre ordres et classes sociales qui les constituent, sans omettre la profondeur de leur héritage historique. Elles opèrent en fait comme de véritables radiographies de ces sociétés en mettant en jeu et en donnant du coup à voir l’ensemble de leurs éléments constitutifs. (Voir la première partie de cet article publiée sur ce site le 21 avril 2023)
___________
[10] Geuzen est l’autodénomination ironique des sujets révoltés contre la Couronne castillane. Elle procède du détournement de ce terme, employé à titre d’injure et de stigmate, par un conseiller de la gouvernante Marguerite de Parme à la vue de la troupe de nobles venus présenter à cette dernière un ensemble de remontrances en son palais de Bruxelles le 5 avril 1566. Le mauvais accueil fait à cette troupe par la gouvernante marque le début des troubles.
[11] Michel Morineau, « Budgets de l’État et gestion des finances royales en France au XVIIIe siècle », Revue historique, tome DXXXVI, 1980, pages 301-316.
[12] Cf. à ce sujet Peter George Dickson, The Financial Revolution in England. A Study in the Development of Public Credit, 1688-1756, Londres, Macmillan, 1967 Je l’ai largement utilisé dans le tome 3 de mon ouvrage, pages 755-767.




