Agenda militant
Ailleurs sur le Web
![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)
- Xavier Niel roule pour le PS (13/03)
- Au cœur du capital (12/03)
- Le débat des représentants des partis, avec Paul Vannier (12/03)
- Meeting avec Bagayoko, Coquerel et Mélenchon à Saint-Denis ! (11/03)
- Ludivine Bantigny, "La Bourse ou la vie. Le Front populaire, histoire pour aujourd’hui" (11/03)
- C’est quoi le "marxisme classique" et le "marxisme occidental" ? (10/03)
- “Le socialisme est la maison commune de tous les combats justes.” – Entretien avec Joseph Andras (10/03)
- Sur Franceinfo : Brigitte Boucher et les irresponsables (10/03)
- Ce que révèle l’affaire Epstein (10/03)
- Au Liban, d’une guerre coloniale à l’autre et du droit de résister (10/03)
- POUR UN FRONT ANTIFASCISTE AU SECOND TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES (10/03)
- Meeting de la campagne municipale LFI à Lille (10/03)
- Meeting avec Jean-Luc Mélenchon et Sophia Chikirou à Paris ! (09/03)
- Colombie : la gauche de Gustavo Petro valide le dernier test des législatives avant la présidentielle (09/03)
- Penser l’émancipation autrement, discuter l’apport de marxistes hétérodoxes [Podcast] (09/03)
- Terrorisme d’Ultra-droite (08/03)
- "L’Iran est sur le point d’obtenir l’arme nucléaire" : trente ans de prophéties démenties (08/03)
- Hommage au chercheur marxiste Michael Parenti – Compilation d’entretiens (08/03)
- La guerre de trop : les Américains et les Israéliens n’ont rien compris à l’Iran ! (08/03)
- Poutou annonce un probable soutien du NPA-A à Mélenchon en 2027 (07/03)
- Attaques en série contre LFI (07/03)
- Des maires insoumis pour tout changer | Clip officiel - Municipales 2026 (07/03)
- Romaric Godin : "La force fondamentale du capitalisme le pousse vers le néofascisme" (07/03)
- Quentin Deranque était en première ligne dans la bagarre (06/03)
- Tirer une balle dans la tête sans intention de donner la mort (06/03)
Liens
La «transition écologique», imposture et nouvelle frontière du capital
Ces articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » sont publiés à titre d'information et n'engagent pas la Tendance CLAIRE.
Partie 1
Par Alain Bihr
Parmi les différents arguments mobilisés pour démontrer l’impossibilité d’un « capitalisme vert » (Tanuro, 2012) figure la démonstration, qui peut largement s’appuyer sur Marx, de l’absolue nécessité pour le capital de se reproduire à une échelle sans cesse élargie. Le capital se condamne de la sorte à traiter la nature à la fois comme un réservoir inépuisable de matières premières et de sources d’énergie et comme un dépotoir insondable dans lequel déverser les multiples déchets et rejets du procès social de production dans son ensemble, qui comprend évidemment aussi le procès de consommation.
Contre ces arguments, il a été avancé, de divers bords, les objections suivantes. D’une part, il serait possible de concevoir et de mettre en œuvre des procès de production plus sobres en matières premières tout comme plus efficaces en énergie : la consommation productive de ces derniers dans et par le procès de travail ne serait pas nécessairement proportionnelle à la formation de la valeur dans et par le procès de valorisation. D’autre part, dans le cadre d’une « l’économie circulaire », il serait possible de transformer les déchets en de nouvelles ressources, en économisant ainsi autant de ressources naturelles, si bien que la consommation productive de ces dernières ne serait pas nécessairement proportionnelle au renouvellement du procès de production. Enfin, il serait possible de former de la valeur (donc de la plus-value) à travers des procès de production purement immatériels. Et d’ailleurs, le procès de reproduction du capital a évolué ces dernières décennies vers le développement de pareils procès de production immatériels, notamment à la faveur du développement des services, de la numérisation (développement des NTIC-nouvelles technologies de l’information et de la communication, de « l’économie de la connaissance », etc.) et de l’importance croissante du « capital humain » dans le processus d’innovation.
L’ensemble de ces trois objections constitue le fonds auquel s’alimente la promesse d’une « transition écologique » d’un « Green Deal » capable de réduire l’empreinte écologique de la reproduction élargie du capital. Transition dans laquelle serait d’ores et déjà engagé le capitalisme contemporain et que ses thuriféraires s’engagent à réaliser au plus vite. Examinons de près ces trois objections, tant dans leurs fondements théoriques que dans les développements pratiques auxquels elles se réfèrent.
Sur « l’économie immatérielle »
Commençons par envisager ce qu’il en est de la soi-disant « économie immatérielle » : « une économie qui n’a pas de fondement physique mais qui place les capacités intellectuelles au cœur de la création de valeur » (Lévy et Jouyet, 2006 : 7). On conviendra aisément que, quoi qu’il en soit de cette dernière, elle ne peut guère connaître qu’une extension limitée. La plupart des travaux matériels (des travaux qui supposent une transformation de la matière, sous quelque forme que ce soit) ne peuvent pas se transformer en travaux « immatériels » : difficile de dématérialiser l’extraction d’une tonne de minerai ou d’un baril de pétrole pas plus qu’une intervention chirurgicale. On peut tout au plus envisager de substituer les uns aux autres, comme on le fait par exemple lorsqu’on communique électroniquement (par messagerie électronique, par vidéoconférence, etc.) au lieu de recourir au courrier postal ou de se déplacer et de se rencontrer physiquement. Et la réduction continue de la part de l’industrie au profit de celle du tertiaire (« les services ») dans la production du PIB n’est sûrement pas une objection valable, dès lors que l’on sait que des travaux aussi matériels que le transport (routier, fluvial, maritime ou aérien), la distribution d’eau, de gaz et d’électricité ou encore les activités de nettoyage des bâtiments sont classés dans le tertiaire ; tout comme l’est le commerce de détail, dont le développement sous forme de supermarchés et d’hypermarchés en périphérie des centres urbains est générateur de cette activité très matérielle qu’est le trajet hebdomadaire que leurs clients effectuent en automobile pour les rejoindre depuis leur domicile.
En fait, il y a quelque chose de trompeur dans l’expression même d’« économie immatérielle », en tant qu’elle suggère fallacieusement l’idée d’une dématérialisation de la production sociale ; raison pour laquelle j’assortis l’expression de travail « immatériel » de guillemets. Car tous les travaux soi-disant « immatériels » supposent en fait la mise en œuvre de moyens matériels considérables, dont l’empreinte écologique est rien moins que négligeable. Cela est vrai déjà des travaux « immatériels » les plus traditionnels : enseigner suppose des établissements d’enseignement et de recherche, des manuels, des bibliothèques, sans compter les enseignants eux-mêmes et leurs élèves ou étudiants ; soigner des personnes suppose une infrastructure de cabinets de ville, d’hôpitaux et de cliniques qu’il faut éclairer et chauffer, de transports en ambulance, sans compter toute l’industrie pharmaceutique en amont ; une pièce de théâtre ou un opéra se monte généralement à l’intérieur de bâtiments, équipés à cette fin, avec des troupes conséquentes, etc.
Mais cela est tout aussi vrai s’agissant des travaux « immatériels » qui recourent aux fameuses NTIC dont les impacts écologiques désastreux sont précisément masqués par la douteuse notion de « dématérialisation » qui leur est attachée, les dotant d’une fallacieuse réputation de technologies « propres ». Ces impacts sont pourtant d’ores et déjà repérables et commencent à être bien documentés aux différentes étapes du cycle de vie de leur appareillage. Et ils risquent fort de s’aggraver au vu du développement exponentiel que connaissent ces technologies, qui annule et au-delà les efforts consentis pour en réduire l’empreinte écologique par unité produite.
Au niveau de leur production tout d’abord. La production des appareils numériques (serveurs, routeurs, commutateurs, ordinateurs, tablettes, smartphones, etc.) consomme en premier lieu de nombreuses matières premières, pour certaines fort précieuses parce que disponibles en faibles quantités ou déjà raréfiées, principalement des métaux : aluminium, argent, cadmium, cobalt, cuivre, étain, fer, gallium, indium, lithium, manganèse, nickel, niobium, or, palladium, platine, plomb, ruthenium, tantale, zinc, sans compter les lanthanides (terres rares) dont 95 % sont localisés en Chine, mais aussi des métalloïdes semi-conducteurs naturels (silicium, germanium, sélénium, tellure). Un simple téléphone portable contient ainsi plus de soixante métaux différents ; et les cristaux liquides des écrans LCD quelque deux cent cinquante substances différentes (EcoInfo, 2012 : 27, 173).
Or l’extraction minière de ces matières premières est source de pollutions importantes des sols et des eaux environnantes ; d’autant plus qu’elle se concentre dans des formations semi-périphériques et périphériques à la législation environnementale peu contraignante et souvent encore moins respectée, dont les compagnies minières indigènes ou étrangères (notamment celles ayant leur siège social dans des formations centrales) s’affranchissent de surcroît facilement. Rappelons par ailleurs que l’industrie extractive est parmi les plus énergétivores, en contribuant ainsi à l’émission de gaz à effet de serre (GES).
Outre ces matières premières, la fabrication des appareils électroniques auxquels font appel les NTIC est également fort gourmande en énergie, en eau (déionisée) ainsi qu’en de multiples intrants chimiques:
« La production d’une simple puce électronique pour une barrette mémoire de 32 bits pesant 2 g nécessite 1600 g d’énergies fossiles secondaires, 72 g de produits chimiques, 32 000 g d’eau, 700 g de gaz élémentaires (principalement N2) ; par ailleurs, il faut 160 fois plus d’énergie pour produire du silicium de qualité électronique que dans sa forme basique » (EcoInfo, 2012 : 21).
Ces intrants sont souvent des polluants toxiques (c’est notamment le cas des solvants et des composants chimiques fluorés) qui contaminent sols, eau et atmosphère. Mais la fabrication de ces appareils génère aussi des poussières et scories de métaux lourds (cuivre, nickel, zinc, étain, plomb) et de soudures, tout comme des déversements plus ou moins accidentels de polluants organiques persistants (notamment ceux entrant dans la composition des produits ignifugeants présents dans les appareils électroniques), là encore sources de contamination du milieu.
Par ailleurs, étant donné que la production des principaux composants des appareils informatiques de consommation courante est très concentrée géographiquement (États-Unis, Japon, Taïwan, Corée du Sud, Chine), leur commercialisation au niveau mondial génère une quantité importante supplémentaire de GES du fait de leurs transports sur longue distance.
L’utilisation de ces appareils consomme de même de grandes quantités d’électricité qui ne cessent d’augmenter, dont la production participe de l’émission de GES, pour autant qu’elle recoure à des combustibles fossiles : en 2015-2016, en France, la consommation d’électricité de l’ensemble des appareils numériques s’est élevée à 56,5 TWh (sur une consommation totale de 476 TWh, soit 11,9 %), dont 22 TWh pour les seuls appareils domestiques ; leurs achats et leurs usages ont émis en moyenne 1180 kg d’équivalent CO2 par habitant, soit près du dixième des 12 092 kg de l’empreinte carbone totale de ce dernier et plus que celle générée par sa consommation de viande et de poisson (1144 kg) ; et, au niveau mondial, la part des émissions de GES dues au numérique a crû de 50 % entre 2013 et 2018 (Frenoux, 2019 : 30, 27, 31). Sont ici en cause la rapide diffusion de la microinformatique (les ordinateurs personnels, puis les tablettes) et, plus encore, celle du smartphone (en Europe, l’énergie consommée par les réseaux de téléphonie mobile s’élève à la moitié de celle des chemins de fer (EcoInfo, 2012 : 149)) ; la forte obsolescence de ces appareils, obsolescence physique (alimentée notamment par la course infernale entre logiciels de plus en plus gourmands en capacité de stockage et de traitement et matériels de plus en plus performants en volume et puissance de calcul) et plus encore obsolescence morale (quelle honte de ne pas être doté de la dernière version d’un logiciel ou du dernier modèle d’un appareil, ce qui conduit à en changer bien avant qu’ils soient matériellement hors service !) ; tout comme le développement de nouveaux usages, tels le commerce en ligne, le streaming (dès 2015, le streaming vidéo a représenté 63 % du trafic web mondial) ou le cloud (stockage de données sécurisées à distance) : dès 2012, si le cloud avait été un État, il se serait classé au cinquième rang mondial en termes de consommation d’électricité (notamment pour « rafraîchir » les data centers, opération qui engendre en aval la pollution thermique des cours d’eau, perturbatrice des écosystèmes aquatiques), et ses besoins devaient être multipliés par trois d’ici à 2020 (Frenoux, 2019 : 50, 35). Et, outre qu’elle est là encore nécessairement émettrice de GES (dans des proportions cependant variables selon le mix énergétique de chaque formation sociale), cette production d’électricité (sous forme thermoélectrique ou hydroélectrique) est elle-même fortement consommatrice d’eau :
« Un centre de données d’un peu plus de 450 m2 d’une puissance de 1000 kW pourrait être responsable de la consommation de plus de 64 millions de litres d’eau par an rien que pour sa consommation électrique (…) Le refroidissement de cet ensemble ajoutant encore 34 millions de litres d’eau, ce sont au total plus de 98 millions de litres d’eau par an qui sont consommés » (EcoInfo, 2012 : 43-44).
Voilà qui donne une idée du degré de « dématérialisation » des NTIC ! Dans le même ordre d’idées, on peut enfin ajouter que, alors qu’elles nous avaient promis un univers sans papier, ces technologies ont au contraire contribué à accroître la production et la consommation de papier d’imprimerie. Alors que la production mondiale de papier s’est élevée à 100 millions de tonnes en 1965 et 170 millions au début des années 1980, elle a atteint 375 millions de tonnes en 2009, le papier d’impression et d’écriture en constituant 28 % (deuxième poste après l’emballage) ; et difficile d’exonérer le développement des NTIC de toute responsabilité en la matière. Or la fabrication de papier est une industrie fortement consommatrice, outre de bois (elle contribue ainsi à l’artificialisation des surfaces boisées), d’eau, de ce fait aussi fortement polluante (en dépit de procédés alternatifs à l’usage du chlore pour blanchir le papier) ; quant aux papiers bureautiques usagés, leur pollution par l’encre d’impression les rend difficilement recyclables sans recourir, là encore, à des produits polluants.
En fin de vie, les appareils numériques sont d’autant plus difficiles à recycler qu’ils sont complexes (composés de matériaux différents : des céramiques, de multiples métaux différents, souvent sous forme d’alliage, des matières plastiques, etc.), qu’ils sont de plus en plus miniaturisés et qu’ils n’ont pas été conçus à cette fin. Résultat : seuls 10 % à 40 % des déchets électroniques sont correctement traités (le taux de recyclage des lanthanides mais aussi celui de l’indium, du gallium, du germanium, du lithium, du silicium, du tantale est par exemple inférieur à 1 %) (EcoInfo, 2012 : 30 ; Frenoux, 2019 : 21, 24). Les autres aboutissent souvent dans des décharges informelles à ciel ouvert (généralement dans des formations périphériques, notamment en Afrique et en Asie du Sud) où ils contaminent leur environnement (sol et eau) ; et c’est encore pire dans le cas où ils finissent dans des incinérateurs, qui dégagent toutes sortes d’émanations toxiques (monoxyde de carbone, oxyde de soufre, particules de brome, de plomb, de cadmium, d’antimoine, d’arsenic, de nickel et de zinc, composés chlorés ou brominés, dioxines et furanes, etc.), autant de polluants auxquels sont exposés les opérateurs et les populations environnantes mais qui sont autant de menaces pour la biodiversité plus généralement.
Au vu de ce qui précède, on ne s’étonnera pas des risques sanitaires tout le long du cycle de vie des appareils électroniques. Y sont ainsi successivement exposés : les mineurs qui extraient les différents matériaux (notamment les métaux lourds) entrant dans la composition des circuits électroniques ; les salarié-e-s des industries fabriquant ces derniers (exposés outre aux mêmes métaux lourds à différents composants organiques : solvants, phtalates, retardateurs de flammes bromés, produits perfluorés) ; mais aussi les riverains des sites d’extraction et de production ; enfin, les personnes travaillent au démantèlement des appareils électroniques mis au rebut, soumises à l’ensemble des agents pathogènes précédents, surtout lorsque cette opération s’effectue de manière plus ou moins sauvage, dans des décharges ou des ateliers ne leur assurant aucune protection, comme c’est encore souvent le cas dans les formations périphériques où s’accumulent 50 à 80 % des déchets électroniques. Et il ne faudrait pas oublier que, entre-temps, les usagers de ces appareils n’échappent pas non plus complètement à l’action nocive de ces substances, sous forme d’émanations diverses ; sans compter le surcroît d’ondes électromagnétiques auquel ces appareils les soumettent, dont les effets sanitaires sont encore imparfaitement connus ; et la contribution des NTIC au stress, au travail comme hors du travail, par l’amplification et l’accélération constantes des sollicitations de communication qu’elles génèrent, engendrant une véritable « infobésité » (EcoInfo, 2012 : 76-80). Pour s’en convaincre, il suffit d’observer le spectacle des usagers pendus à l’écran de leur smartphone à l’occasion du moindre « temps mort », dans la rue, en vélo comme au volant, dans les files d’attente, dans les transports en commun, quand ce n’est pas pendant des discussions à table entre convives.
Notons pour conclure cette section que l’engouement pour « l’économie immatérielle » sous nos latitudes correspond tout simplement à la fonction que se sont réservée les formations centrales dans la nouvelle division internationale du travail née de la transnationalisation du capital : celle des activités de direction, de conception, d’organisation et de contrôle d’un procès de production dont les activités productives matérielles ont été pour une bonne part délocalisées dans les formations périphériques ou semi-périphériques. Bref, « l’immatériel » est le paravent derrière lequel se cache le matériel, sans faire en rien disparaître ce dernier pour autant. (Article reçu le 15 mai 2023, la deuxième et la troisième partie seront publiées les 17 et 18 mai)
Bibliographie
Écoinfo (2012), Impacts écologiques des TIC. Les faces cachées de l’immatérialité, Les Ulis, EDP Sciences.
Frenoux Emmanuelle (2019), « Quel impact environnemental pour l’informatique ? », EcoInfo, Paris, CNRS, Limsi, Polytech Paris-Sud.
Lévy Maurice et Jouyet Jean-Pierre (2006), L’économie de l’immatériel : la croissance de demain. Rapport de la commission sur l’économie de l’immatériel au Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, Paris, La Documentation française.
Tanuro Daniel (2012), L’impossible capitalisme vert, Paris, La Découverte.
---------------------------------------
Partie 2
Par Alain Bihr
Qu’en est-il des perspectives qu’ouvre « l’économie circulaire » ? Selon le Dictionnaire de l’environnement, celle-ci se laisse définir par l’« organisation d’activités économiques et sociales recourant à des modes de production, de consommation et d’échange fondées sur l’éco-conception, la réparation, le réemploi et le recyclage, et visant à diminuer les ressources utilisées ainsi que les dommages causés à l’environnement » (cité par Benady et Ross-Carré, 2021 : 3).
Sur « l’économie circulaire »
« L’économie circulaire » s’oppose en ce sens à « l’économie linéaire » qui enchaîne l’extraction des ressources naturelles, leur transformation industrielle et l’élimination des produits en fin de vie sous forme de déchets, sans se soucier ni du caractère éventuellement non renouvelable des premières ni du caractère le plus souvent non assimilable et recyclable par les écosystèmes des derniers.
En fait, cette définition de « l’économie circulaire » s’inspire d’un schéma élaboré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe, devenue Agence de la transition écologique), repris par un grand nombre de ses partisans, selon lequel la dynamique de cette dernière est censée parcourir une boucle dont les trois phases successivement répétées, correspondant en gros aux différentes phases du cycle de vie d’un produit et constituant autant de « domaines d’action », sont « l’offre des acteurs économiques », « la demande et le comportement des consommateurs » et « la gestion des déchets ». Ce qui conduit l’agence à attribuer sept « piliers » à « l’économie circulaire »: « l’approvisionnement durable », « l’éco-conception », « l’économie industrielle et territoriale » et « l’économie de la fonctionnalité » pour le premier ; « la consommation responsable » et « l’allongement de la durée d’usage » par la réparation, le réemploi ou réutilisation et le reconditionnement pour le second ; enfin « le recyclage » pour le dernier (Benady et Ross-Carré, 2021 : 9). Passons par conséquent en revue ces différents « piliers » pour en évaluer la solidité et juger dans quelle mesure ils sont compatibles avec les nécessités de la reproduction du capital.
De « l’approvisionnement durable », l’Ademe propose la définition suivante : « L’approvisionnement durable concerne le mode d’exploitation/extraction des ressources visant leur exploitation efficace en limitant les rebuts d’exploitation et l’impact sur l’environnement pour les ressources renouvelables et non renouvelables » (cité dans Benady et Ross-Carré, 2021 : 50). Soit rien de plus que ce que font d’ores et déjà et depuis longtemps toutes les entreprises capitalistes prises une à une, soucieuses de réduire leur coût de production pour améliorer leur compétitivité, sans que diminue pour autant leur consommation (productive) globale de ressources naturelles, conformément à l’impératif de reproduction élargie du capital. Et on peut d’autant plus douter qu’il en aille différemment à l’avenir que cet objectif d’approvisionnement durable est censé être atteint par des moyens aussi « contraignants » que l’engagement de ces entreprises « dans un code de conduite vis-à-vis des fournisseurs », « l’intégration des critères de développement durable aux appels d’offres et autres étapes du processus d’approvisionnement », le recours aux certifications, la formation des fournisseurs, etc. (Benady et Ross-Carré, 2021 : 51). Car on sait d’expérience ce qu’il en est de l’autodiscipline et des autorégulations laissées au bon soin des industriels capitalistes, de leurs fédérations professionnelles et de leurs organisations syndicales.
« L’éco-conception », pour sa part, se définit par « l’intégration des critères environnementaux dès la phase de conception d’un produit ou d’un service afin d’en réduire les impacts environnementaux tout au long du cycle de vie (de l’extraction des matières premières jusqu’à sa fin de vie) » (Benady et Ross-Carré, 2021 : 15). Elle implique pour le fabriquant de minimiser autant que possible l’empreinte écologique (en termes de prélèvement de matières premières, de consommation d’énergie, de rejets et de déchets) de ses procédés de production, de s’abstenir de recourir à des produits toxiques, de concevoir ses produits de manière à ce qu’ils soient le plus durables possible, d’en faciliter la réparation, le reconditionnement ou le recyclage, etc.
A priori, cela devrait aller à l’encontre des intérêts du capital industriel, en renchérissant les coûts de production (quoique les économies de matières premières et d’énergie puissent exercer des effets adverses) et en allongeant la durée d’usage des produits, donc en limitant le renouvellement des achats. Or, selon une enquête de l’Ademe, « la marge bénéficiaire des produits éco-conçus est supérieur de 12 % en moyenne, comparativement à celle des produits conventionnels ; pour 96 % des répondants, l’éco-conception a un effet positif ou neutre sur les profits de l’entreprise » (Benady et Ross-Carré, 2021 : 65). C’est que les entreprises qui font le choix de se soumettre aux exigences d’auto-conception acquièrent ce faisant un avantage compétitif (du fait d’un meilleur rapport qualité/prix de leurs produits) qui leur permet de gagner des parts de marché et d’accroître leur marge bénéficiaire tout en vendant pourtant leurs produits plus cher. Le temps du moins que leurs concurrents en fassent autant, ce qui relance la course à l’innovation… et stimule globalement l’accumulation du capital ! Car il n’y a finalement, là encore, rien de neuf au regard des mécanismes habituels à la fois suscités et mis en œuvre par la concurrence intercapitaliste, dont nous savons qu’elle est le biais par lequel s’exerce sur les capitalistes la nécessité de la reproduction élargie du capital social dans son ensemble.
Egalement dénommée « symbiose industrielle », « l’économie industrielle et territoriale » fait appel à des pratiques collaboratives (coopératives, mutualistes) entre entreprises proches, sises sur un même territoire (un site, une localité, une région, etc.), de manière à réduire leur empreinte écologique globale. Mais cela peut aussi valoir pour des équipements collectifs ou des services publics inclus dans une aire déterminée.
« La symbiose industrielle repose sur une approche pragmatique, qui considère qu’à une échelle géographique donnée (zone industrielle, agglomération, département…), et quel que soit son secteur d’activité, chacun peut réduire son impact environnemental en essayant d’optimiser et/ou de valoriser et/ou de mutualiser les flux (matières, énergies, personnes…) qu’il emploie et qu’il génère » (Benady et Ross-Carré, 2021 : 78)
Une fois encore, il n’y a là rien d’inouï, puisqu’on se propose tout simplement de formaliser et de systématiser les phénomènes de synergie entre activités productives qui se produisent, plus ou moins spontanément, au sein des clusters(districts industriels) qu’avait déjà relevés Alfred Marshall à la fin du XIXe siècle, tout en les soumettant à un impératif de réduction de l’empreinte écologique. Dans cette perspective, de pareilles synergies peuvent prendre une double forme :
- la mutualisation de moyens, s’agissant des flux entrants (par exemple le développement d’un réseau commun de chaleur ou d’électricité photovoltaïque, le groupement des commandes), des flux sortants (par exemple la collecte des déchets) ou des deux (par exemple la mise en commun de la logistique amont et aval) ;
- la mise en réseau des entreprises, les flux sortant de l’une constituant des flux entrant dans une autre. C’est le cas par exemple quand les déchets de l’une peuvent constituer la matière première de l’autre ou quand la vapeur générée par l’une peut permettre d’actionner les turbines génératrices d’électricité de l’autre. Et tous les partisans de « l’économie circulaire» de citer le cas du site danois de Kalundborg.
Ce sont sans doute là des pratiques capables de réduire l’empreinte écologique de la reproduction du capital en termes relatifs (relativement au capital employé) mais non pas en termes absolus, puisqu’elles n’abolissent pas (ne peuvent ni d’ailleurs ne veulent abolir) l’impératif de reproduction élargie. D’autant plus que, là encore, on compte essentiellement sur le bon vouloir et l’intérêt bien compris des capitalistes individuels pour qu’ils s’y engagent, sans tenir compte des penchants contraires que développe nécessairement la propriété privée des moyens de production (questions relatives au droit de propriété, rivalité concurrentielle, horizon borné des intérêts particuliers, etc.), qui freinent inévitablement le développement de ce type de pratiques.
Quant à « l’économie de la fonctionnalité », elle consiste à privilégier « l’usage à la possession et tend à vendre des services liés aux produits plutôt que les produits eux-mêmes » (Benady et Ross-Carré, 2021: 90). L’entreprise reste propriétaire des biens dont elle ne commercialise que l’usage. Exemples : la location par Xerox de ses photocopieurs et son offre de service de reproduction de documents à la copie ; les constructeurs d’automobiles qui louent leurs véhicules au lieu de les vendre (le client paie l’usage d’une automobile qu’il ne possède pas et n’est pas destiné à acquérir) ; de même, Michelin propose de « louer » ses pneus aux entreprises de transport qui paient en proportion des kilomètres parcourus : en somme, Michelin vend non plus des pneus mais des kilomètres d’usage (et d’usure) des pneus ! Tandis que Autolib et consorts mettent des véhicules à la disposition des automobilistes qui ont souscrit un abonnement et en paient l’usage au kilomètre et à la durée. Dès lors, loin de soumettre leurs produits à une logique d’obsolescence programmée, les industriels ont au contraire tout intérêt à produire des biens les plus solides et les plus durables possible et à réduire leur usure (par leur maintenance, leur réparation, les conseils aux clients, etc.)
Font cependant obstacle à la généralisation de ce type de pratiques, outre la nature des produits, biens et services, commercialisés (par définition, elles ne peuvent concerner que des biens plus ou moins durables, dont il s’agit précisément d’augmenter la durée d’usage), mais aussi l’augmentation du capital fixe et la diminution de sa vitesse de rotation qu’elles impliquent, qui ne peuvent être prises en charge que par des capitaux déjà fortement concentrés et centralisés (de préférence en situation d’oligopoles). Tandis que rien ne garantit qu’un usage partagé d’un bien de consommation en réduise l’usure proportionnellement à son usage : le moindre soin apporté par le consommateur à ce dernier peut au contraire l’augmenter.
« La consommation responsable doit conduire l’acheteur, qu’il soit acteur économique (privé et public) ou citoyen consommateur, à effectuer son choix en prenant en compte les impacts environnementaux à toutes les étapes du cycle de vie du produit (bien ou service) » (Benady et Ross-Carré, 2021 : 98). Conçue comme une démarche essentiellement citoyenne, elle s’appuie sur l’information du consommateur via l’étiquetage des produits, la labellisation (l’élaboration d’écolabels) et la certification, l’affichage environnemental (fournissant des informations sur l’impact environnemental des produits), les publications des associations de consommateurs (type Que choisir ? Association des consommateurs de France), etc. Là encore, rien de bien nouveau sous le soleil : les incitations à la consommation responsable sont aussi vieilles que… la consommation marchande tout court et elles n’ont jamais empêché celle-ci de croître exponentiellement, tout comme la reproduction élargie du capital dont elle est un moment. Tout simplement parce que « citoyen consommateur » est un oxymore : si le citoyen est en principe mû par le souci de l’intérêt général (en l’occurrence écologique), le consommateur est prisonnier de son intérêt particulier, lié à son niveau et à son mode de vie tels qu’ils sont déterminés par sa situation dans les rapports de production. Ce qui conduit le second à effectuer des « choix » qui s’écartent des injonctions du premier, bien plus souvent que l’inverse.
Venons-en à « l’allongement de la durée d’usage » des produits, en commençant par la réparation des objets usagés. Elle présuppose que les industriels mettent à disposition des consommateurs ou des artisans spécialisés dans la maintenance des appareils les pièces de rechange nécessaires plusieurs années après que le produit a été vendu. Ils ne sont encore qu’une très faible minorité à s’en soucier, en y gagnant toutefois un avantage compétitif. Là encore l’augmentation du capital fixe et la diminution de sa vitesse de rotation, qui en sont des conséquences inévitables, constituent des freins sensibles, qui montrent bien en quoi la nature capitaliste du procès de production fait directement obstacle à son orientation écologique.
Mais surtout assurer la réparation des produits suppose de lutter contre leur obsolescence programmée, dont nous savons qu’elle recourt notamment à des défectuosités volontaires et à rendre ces objets irréparables dès leur conception et fabrication. La condamnation pénale de ce type de pratique, telle que celle introduite en France par la « Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire » du 10 février 2020 ou telle qu’elle est envisagée (mais pas encore adoptée) par la réglementation européenne, ne suffira sans doute pas à y mettre fin, tant sont étendus les moyens des industriels (et de leurs lobbies) en la matière. Plutôt que de compter sur une action collective des consommateurs, il aurait été plus efficace de rendre possible une action collective… des producteurs (les ouvriers, techniciens et ingénieurs) qui sont les premiers et les mieux informés des pratiques des industriels en la matière, puisque ce sont eux qui les mettent en œuvre. Mais, là encore, cela est peu compatible avec les rapports capitalistes de production.
Enfin, même rendus réparables, les objets ne seront pas nécessairement réparés tant que le commun des consommateurs ne disposera ni du temps libre ni des moyens (outillage, locaux) ni du savoir-faire nécessaire à cette fin. Bien que tendent à se développer, mais précisément en dehors des circuits capitalistes, tant l’information nécessaire à ce sujet (notamment par le biais d’Internet) que les ateliers coopératifs qui y sont dédiés.
« L’allongement de la durée d’usage » des produits peut aussi s’obtenir par leur réemploi et leur réutilisation. Ils consistent à donner « une deuxième vie aux objets en les réemployant entre acteurs économiques et/ou entre particuliers via des achats d’occasion, du don ou de la location entre particuliers, ou même l’entraide entre particuliers » (Benady et Ross-Carré, 2021 : 7). C’est une pratique ancienne qui perdure sous forme des brocantes et des vide-greniers, sans compter évidemment les multiples formes d’entraide (trocs ou dons) entre parents, amis, voisins, collègues de travail, etc. Elle peut aussi se développer sous forme d’activités associatives, à but lucratif (comme dans le cas du réseau Envie) ou non (comme dans le cas des communautés Emmaüs). Toutes activités qui, significativement, présentent un caractère non capitaliste voire anticapitaliste. Mais c’est aussi une pratique qu’a tendue à envahir le capital marchand : le marché de l’occasion ne se limite plus aujourd’hui aux véhicules automobiles mais s’étend à l’ensemble des biens de consommation un tant soit peu durables, notamment via certains sites Internet (cf. Le bon coin).
« L’allongement de la durée d’usage » peut encore passer par « la réutilisation des produits et des composants arrivant en fin de vie comme ressource pour fabriquer des produits neufs identiques, voire plus performants » (Aurez et Gorgeault, 2016 : 130). C’est le cas par exemple lorsque, dans une casse automobile ou cimetière de voitures, des pièces sont prélevés sur ces dernières avant qu’elles ne soient broyées pour être revendues d’occasion et remontées sur des véhicules dont l’usage est prolongé d’autant. Mais, comme cet exemple le laisse entendre, cela présuppose que de pareilles opérations aient été rendues possibles par la conception et la production tant du produit usagé en fin de vie que de celui destiné à recevoir les composants en provenance du précédent. Où l’on retrouve les limites rencontrées dans la réparation. (La troisième partie sera publiée le 19 mai)
Bibliographie
Aurez Vincent et Georgeault Laurent (2016), Économie circulaire. Système économique et finitude des ressources, Louvain-la Neuve, De Boeck Supérieur.
Benady Anne et Ross-Carré Hervé (2021), L’économie circulaire, La Plaine Saint-Denis, Afnor Éditions.
----------------------------------------
Partie 3
Par Alain Bihr
Reste en définitive « le recyclage des déchets ». [Voir les deux premières parties de cet essai, publiées sur ce site les 16 et 17 mai 2023.] Il suppose la récupération des matériaux constituant les objets en fin de vie susceptibles d’entrer dans un nouveau procès de production. En sont donc exclues les opérations de valorisation énergétique des déchets (leur combustion) ou leur emploi dans des opérations de remblaiement ou d’enfouissement.
Limites et perversité du recyclage
Commençons par remarquer que, contrairement à ce que laissent entendre la notion d’« économie circulaire » et, plus encore, le slogan stupide « 100 % recyclable » de plus en plus souvent apposé sur les marchandises, la récupération des matériaux par recyclage des déchets qu’ils constituent au terme de leur cycle de vie ne saurait être parfaite (complète). D’une part, une partie de ces matériaux se disperse inévitablement au cours de l’usage même des objets qu’ils constituent et ce bien avant que ces derniers deviennent des déchets hors d’usage : la lame du couteau usagé perd de sa largeur au fil de son utilisation et de ses aiguisages successifs ; les matières textiles de nos vêtements se dispersent pour partie sous l’effet des frottements liés à leur port et à leurs lavages répétés ; lorsqu’on les remplace en les récupérant pour recyclage, les plaquettes de frein n’ont plus leur épaisseur initiale ; etc.
D’autre part, certains matériaux ne se recyclent que difficilement, du fait qu’ils se trouvent mêlés à d’autres matériaux ; c’est le cas des alliages métalliques, s’il s’agit d’en extraire séparément les métaux qui les composent ; c’est le cas de tous les matériaux auxquels sont ajoutés des additifs (solvants, colorants, etc.) qui les rendent impropres à certains recyclages (par exemple dans l’industrie agroalimentaire) : ainsi de la plupart des plastiques ; c’est le cas surtout des emballages qui mêlent souvent en couches inextricables bois, métaux et plastiques (une simple canette de bière en aluminium est entourée à l’extérieur d’une couche de vernis et à l’intérieur d’une couche de plastique pour éviter le contact du breuvage avec le métal). Ou encore, les recyclages successifs dégradent la qualité du matériau qui ne peut en subir en conséquence qu’un nombre limité : c’est le cas du papier (recyclable au mieux cinq fois) tout comme des plastiques PET (polyéthylène téréphthalate), pourtant les plus recyclables des plastiques, et même du verre (sa transparence s’altère sauf à ce qu’il soit strictement trié par couleur) ; ce qui nécessite le recours à des adjonctions de matière première vierge à chaque recyclage. Le recyclage est même impossible lorsque les matériaux sont irrécupérables parce que dispersés en quantités infimes dans la masse d’autres matériaux ; c’est le cas là encore des métaux employés sous forme de poudres ou de fils très fins dans la confection de peintures, de plastiques, de cosmétiques, de textiles, etc. : ce sont ainsi 20 % du cadmium et 95 % du titane utilisés dans le monde qui se trouvent irrémédiables perdus (Berlingen, 2020 : 61).
Enfin, les opérations de recyclage engendrent elles-mêmes des pertes (rejets et déchets) de matières tout comme des dissipations d’énergie, à l’instar de toutes les opérations productives. Sans compter qu’elles peuvent engendrer de nouveaux dégâts écologiques (prélèvements inconsidérés de matières premières, rejets de déchets toxiques et de polluants), notamment quand elles sont délocalisées dans les formations périphériques présentant un bas niveau de réglementation en matière de protection de l’environnement.
En conséquence, le recyclage ne peut nullement réaliser « une empreinte écologique neutre » comme le suggère l’article L. 110-1-1 du Code de l’environnement (cité par Benady et Ross-Carré, 2021 : 2) : il ne supprime pas la nécessité de procéder sans cesse à de nouveaux prélèvements de matières premières, générateurs de rejets supplémentaires ; tout au plus peut-il en réduire le volume et le rythme. Mais ces nouveaux prélèvements seront d’autant plus importants que la « croissance économique » sera gourmande en matières premières, jusqu’au point de rendre éventuellement dérisoires les effets bénéfiques (en termes de réduction des prélèvements des ressources naturelles) opérés par le recyclage. Ainsi, recycler à 80 % un matériau au bout de vingt ans d’usage ne conduit pas à réduire, au terme de cette durée, des quatre cinquièmes le prélèvement additionnel sur les ressources naturelles destiné à composer les pertes et fuites intervenues si, entre-temps, la consommation productive de ce matériau s’est accrue ; bien plus, si le taux annuel de croissance de cette dernière a été en moyenne de 3 % pendant ces vingt ans, le bénéfice du recyclage s’en trouve tout simplement annulé [1]! Et qu’on ne pense pas qu’il s’agisse là d’une hypothèse d’école :
« L’acier est le matériau majeur le plus recyclé au monde. Pourtant, au rythme actuel du développement de sa production-consommation de 3,5 % par an au cours du XXe siècle, le taux de recyclage actuel au niveau mondial, de l’ordre de 62 %, ne fait gagner à l’humanité qu’environ 12 années contre la raréfaction de la ressource en fer. C’est-à-dire que la consommation de minerai cumulée au cours du temps sera, en 2012, celle qu’on aurait connue en 2000 sans aucun recyclage. Et, en 2062, celle de 2050, si l’on cessait désormais entièrement de recycler. Amener, à l’échelle mondiale, le taux de recyclage à un niveau de 90 % ne ferait gagner à l’humanité que huit années supplémentaires (soit 20 ans de décalage), en l’absence de ralentissement de la progression de la consommation d’acier. Ce n’est qu’au-dessous de 1 % de croissance annuelle de la consommation mondiale d’une matière première que l’effet positif du recyclage sur la ressource devient important » (François Grosse cité par Arnsperger et Bourg, 2016 : 112).
Toutes ces limites, indépassables, du recyclage sont systématiquement occultées, méconnues et déniées, par tous les discours qui vantent les vertus de ce dernier, qu’ils soient tenus par des capitalistes (industriels ou commerçants) ou des (ir)responsables politiques, cherchant à rassurer consommateurs et citoyens en leur présentant le recyclage comme la solution au double problème (insoluble) de la consommation productive croissante de matières premières non reproductibles et de l’entassement des déchets (non recyclables). Tout en faisant reposer sur eux la responsabilité, via le tri des ordures ménagères, de la réussite d’une opération que conditionnent bien plus sûrement les choix effectués en amont, par les producteurs (capitalistes), des matériaux constituant leurs produits et leur emballage, tout comme d’ailleurs en aval l’existence ou non de filières industrielles de recyclage aussi efficaces que possible.
Il faut enfin dénoncer les effets pervers du recyclage lui-même. D’une part, dès lors que le déchet est érigé en ressource, qu’il devient valorisable au sens capitaliste du terme et qu’il est transformé du coup en matière première de nouvelles branches du capital industriel et du capital commercial [2], ces derniers requièrent inévitablement, au fur et à mesure où s’opèrent dans ces branches la concentration et la centralisation de ces capitaux, la production d’une masse toujours croissante… de déchets ! Et cette masse croissante de déchets requiert elle-même en amont une quantité croissante de produits recyclables, finissant sous forme de déchets. Par exemple :
« Tout comme leurs anciens ancêtres contremaîtres des chiffonniers, les principaux groupes industriels iraient contre la réussite de leurs entreprises en encourageant la réduction de ces flux détritiques. Dès lors, en rationalisant et systématisant cette “récup’” moderne, ne nous engageons-nous pas dans un itinéraire imposé ? Si les déchets deviennent demain nos principales ressources, ne sommes-nous pas tout simplement contraints de jeter pour continuer à produire ? » (Monsaingeon, 2017 : 107).
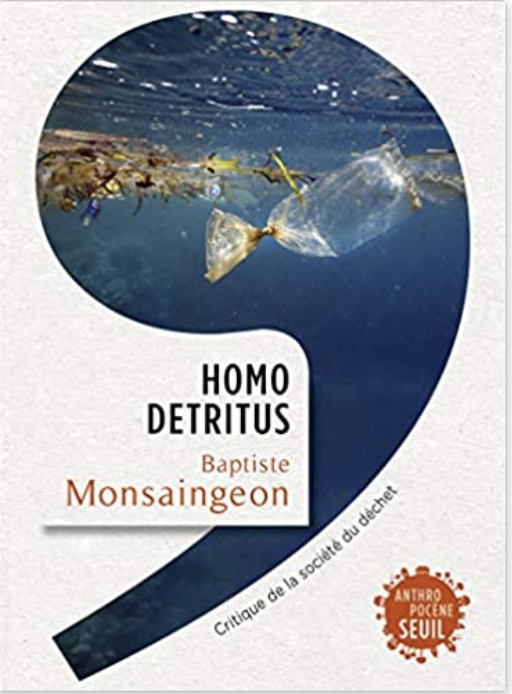 Ainsi, loin d’opérer comme des freins limitant l’échelle et le rythme de la consommation productive et improductive de matières premières et d’énergie, l’industrie et le commerce capitalistes du recyclage opèrent-ils au contraire comme des accélérateurs de l’une et de l’autre. Autrement dit, tout comme n’importe quelle branche de la production capitaliste, elle procède de l’hubris qui est la marque propre de cette dernière. Tandis que, d’autre part, les mêmes effets pervers se produisent du côté de la consommation improductive : en triant ses déchets, en alimentant l’industrie et le commerce capitalistes de ces derniers, le consommateur lambda peut se persuader, en toute bonne (in)conscience, de continuer à consommer autant et aussi mal tout en contribuant à sauver la planète : « bien jeter est devenu un moyen pour pouvoir continuer à (mieux) consommer (…) Le bien jeter est une modalité de cet oubli plus qu’un mode de résolution d’un problème en cours : un rituel contemporain de dénégation » (Id. : 113 et 118).
Ainsi, loin d’opérer comme des freins limitant l’échelle et le rythme de la consommation productive et improductive de matières premières et d’énergie, l’industrie et le commerce capitalistes du recyclage opèrent-ils au contraire comme des accélérateurs de l’une et de l’autre. Autrement dit, tout comme n’importe quelle branche de la production capitaliste, elle procède de l’hubris qui est la marque propre de cette dernière. Tandis que, d’autre part, les mêmes effets pervers se produisent du côté de la consommation improductive : en triant ses déchets, en alimentant l’industrie et le commerce capitalistes de ces derniers, le consommateur lambda peut se persuader, en toute bonne (in)conscience, de continuer à consommer autant et aussi mal tout en contribuant à sauver la planète : « bien jeter est devenu un moyen pour pouvoir continuer à (mieux) consommer (…) Le bien jeter est une modalité de cet oubli plus qu’un mode de résolution d’un problème en cours : un rituel contemporain de dénégation » (Id. : 113 et 118).
Le recyclage sert ainsi essentiellement de moyen, d’alibi et de paravent de la poursuite de « la croissance ». Loin de limiter et encore moins de faire cesser le pillage et le gaspillage des ressources naturelles, il permet de les poursuivre et de les amplifier en les « verdissant ». Conséquences :
« L’extraction [des ressources naturelles] se développe à un rythme deux à trois fois plus rapide que le recyclage, alertent les auteurs du Circulating Gap Report, un rapport annuel sur la progression de l’économie circulaire dans le monde et ses obstacles. Ils évoquent une “linéarité qui s’auto-entretient” liée au manque de solutions pour la fin de vie des produits, qui relève aussi d’une mauvaise conception initiale » (Berlingen, 2020 : 78)
Concluons. Se situant dans le cadre des rapports capitalistes de production, les différentes pratiques et techniques de « l’économie circulaire » ne peuvent ni d’ailleurs ne veulent se proposer de mettre fin à la nécessité d’une reproduction élargie du capital et par conséquent à l’élargissement inévitable de son empreinte écologique. Elles peuvent tout au plus réduire l’échelle et ralentir le rythme de la seconde relativement à ceux de la première.
C’est à une conclusion identique que parviennent Christian Arnsperger et Dominique Bourg. Défendant une conception radicale de « l’économie circulaire » impliquant une réduction drastique de l’échelle du procès social de production, soit l’instauration d’une économie stationnaire ou quasiment stationnaire, de fait incompatible avec le maintien des rapports capitalistes de production (ce dont eux-mêmes n’ont cependant aucune conscience, semble-t-il), ils en viennent à dénoncer les conceptions de « l’économie circulaire » qui se limitent à réduire l’empreinte écologique des capitaux singuliers sans se préoccuper de celle du capital social dans son ensemble. C’est que « des performances accrues de circularité au niveau micro et/ou meso peuvent aller de pair avec une détérioration des performances macro en termes de flux nets de matière » (Arnsperger et Bourg, 2016 : 96). Par exemple :
« Une entreprise ou un secteur peut parfaitement faire d’immenses progrès en termes de circularité (par exemple en rendant ses produits davantage recyclables par unité d’input et/ou d’output) sans que l’économie dans son ensemble devienne plus circulaire. Au contraire, des effets pervers bien connus, dits “effets rebonds” [3] , peuvent transformer une meilleure circularité “micro” en une moins bonne circularité “méso” et “macro” (…) des performances accrues de circularité au niveau micro peuvent aller de pair avec une détérioration des performances macro en termes d’énergie nette – notamment si les technologies de circularisation sectorielles requièrent une plus forte consommation de ressources dans d’autres secteurs pourvoyeurs de ces technologies ou de certaines composantes de ces dernières » (Id. : 105-106).
Si bien qu’en définitive, « vouloir mesurer la circularité d’une économie sans se préoccuper du degré auquel cette économie continue de croître est un contresens grave » (Id. : 100).
Sur la sobriété matérielle et l’efficacité énergétique
Examinons enfin ce qu’il en est des gains en matière de sobriété matérielle tout comme d’efficacité énergétique au sein du procès de production capitaliste. De tels gains sont avérés et d’ailleurs constamment renouvelés. Ils procèdent essentiellement de la mise au point de procédés permettant de limiter les pertes (rejets et déchets de matières premières, dissipation de l’énergie sous forme de chaleur ou reconversion de cette dernière) qui surviennent lors de tout procès de production, autrement dit de transformation de la matière et de l’énergie.
Cependant la limitation de pareilles pertes rencontre elle-même des limites physiques indépassables. Sans même se référer à ce que nous enseigne le second principe de la thermodynamique, relevons par exemple que, si le passage des ampoules à incandescence aux ampoules fluo-compactes ou à LED a permis de multiplier par dix l’efficacité énergétique (en passant de 15 à 150 lumens par watt consommé), il existe une limite de 200 lumens par watt au-delà de laquelle il n’est plus possible de produire de la lumière blanche (Cassoret, 2020 : 139). Et, plus on progresse dans la réduction de la consommation productive de ressources naturelles par unité produite, plus de nouveaux progrès sont difficiles à obtenir, en entraînant eux-mêmes un surcroît de consommation productive de matière et d’énergie.
Surtout, là encore, il se produit d’inévitables effets rebonds, inévitables parce que liés à la nécessité d’élargissement constant de l’échelle de la reproduction immédiate du capital : toute diminution relative de la consommation productive de ressources naturelles (matières premières ou énergie), par exemple par heure de travail, par unité de PIB ou par habitant, se traduit finalement par une augmentation absolue de celle-ci. En diminuant les coûts de production, les gains réalisés en matière de sobriété matérielle ou d’efficacité énergétique ont pour principal effet d’accroître la demande, partant la consommation productive de ressources naturelles, réduisant par conséquent les bénéfices de ces gains jusqu’à pouvoir les annuler et même finalement jusqu’à augmenter la consommation globale de ces ressources. Quelques exemples parmi de nombreux autres possibles :
- Entre 1975 et 1996, l’efficacité énergétique, mesurée par le rapport du PIB à la quantité de dioxyde de carbone (CO2) émise pour le produire, a augmenté de 30 % aux Pays-Bas, de 34 % aux Etats-Unis, de 50,2 % en Autriche et de 64 % au Japon, ce qui n’a empêché la quantité totale de leurs émissions de CO2 d’augmenter respectivement de 24,3 %, de 29,7 %, de 11,6 % et de 25,9 %, les émissions par tête s’accroissant pour leur part respectivement de 9,1 %, 5,9 %, 4,9 % et 12 % (Foster, Clark et York, 2010 : 142). Tout simplement parce que le taux de croissance (le taux d’accumulation : le taux d’accroissement de son échelle et le taux d’accélération de son rythme) a été bien supérieur au taux de réduction de la consommation des combustibles fossiles par point de croissance ou par habitant. Si bien que l’efficacité énergétique croissante des formations capitalistes les plus développées (une moindre empreinte écologique par unité de richesse produite) est allée de pair avec une empreinte écologique globale accrue de ces mêmes formations, que ce soit au niveau global ou à celui de chacun de leurs membres.
- Aux Etats-Unis, entre 1980 et 2010, l’efficacité énergétique des véhicules automobiles (mesurée par la distance parcourue par quantité de carburant consommé) a été augmentée de 30 % (Foster, Clark et York, 2010 : 178), grâce à des moteurs moins gourmands, des véhicules plus aérodynamiques, une diminution des frottements au sol, etc. Mais cela n’a en rien fait diminuer la quantité totale de carburant consommé du fait de l’augmentation du nombre des véhicules, de leur usage plus intensif (un exemple type d’effet rebond), de l’augmentation de leur poids (due à leur taille, à leurs équipements de plus en plus nombreux) et de leurs performances (capacité d’accélération, vitesse de pointe, etc.), qu’il s’agisse des véhicules personnels avec la mise en circulation des monospaces et des SUV (sport utility vehicle )[4] ou des poids lourds. On voit clairement sur cet exemple que des innovations techniques sont incapables par elles-mêmes et à elles seules de garantir une moindre empreinte écologique, en termes de prélèvements de ressources naturelles ou de rejets de déchets.
- Aux Etats-Unis toujours, entre 1975 et 2010, la consommation moyenne par mile des avions a été réduite de 40 % mais la consommation totale de carburants de l’aviation civile à augmenter de 150 % (Foster, Clark et York, 2010 : 178). Même tendance en France : entre 2000 et 2019, alors que les émissions de CO2 par passagers-équivalents-kilomètres-transportés ont diminué de 112,2 g à 83,5 g, soit une réduction de plus d’un quart, la quantité totale de CO2 émise par le trafic aérien a augmenté de 20,3 à 23,7 millions de tonnes (+ 16,7 %) [5] .
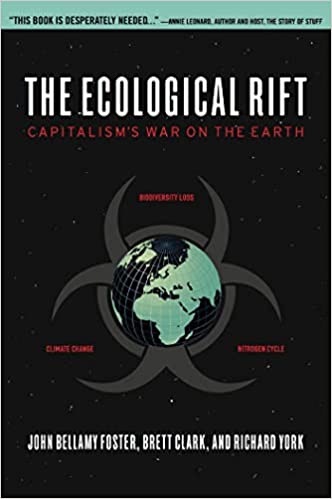 D’ailleurs, en dépit des gains d’efficacité énergétique, des chocs pétroliers des années 1970 et de la dépression consécutive à la crise financière de 2007-2009, la consommation d’énergie primaire mondiale n’a cessé de croître régulièrement, en passant de quelque quatre à quelque quatorze milliards de tonne équivalent pétrole entre 1965 et 2019. Si cette consommation a eu tendance à diminuer légèrement en France, tout comme dans d’autres formations centrales, à partir du milieu des années 2000, c’est à la faveur de la délocalisation des activités industrielles les plus gourmandes en énergie dans des formations périphériques et semi-périphériques, telles la Chine et l’Inde, où elle croît au contraire de manière exponentielle. C’est ainsi de l’équivalent de la consommation française que la consommation d’électricité mondiale croît toutes les années (Cassoret, 2020 : 19-21).
D’ailleurs, en dépit des gains d’efficacité énergétique, des chocs pétroliers des années 1970 et de la dépression consécutive à la crise financière de 2007-2009, la consommation d’énergie primaire mondiale n’a cessé de croître régulièrement, en passant de quelque quatre à quelque quatorze milliards de tonne équivalent pétrole entre 1965 et 2019. Si cette consommation a eu tendance à diminuer légèrement en France, tout comme dans d’autres formations centrales, à partir du milieu des années 2000, c’est à la faveur de la délocalisation des activités industrielles les plus gourmandes en énergie dans des formations périphériques et semi-périphériques, telles la Chine et l’Inde, où elle croît au contraire de manière exponentielle. C’est ainsi de l’équivalent de la consommation française que la consommation d’électricité mondiale croît toutes les années (Cassoret, 2020 : 19-21).
De même, selon un rapport du Panel international pour la gestion durable des ressources hébergé par le Programme des Nations Unies pour l’environnement publié en 2016, on a assisté à un triplement des quantités de matières premières extraites de la planète Terre au cours des quarante années précédentes [6]. Et, en dépit de tous les efforts visant à les réduire, elles devraient encore plus que doubler entre 2011 et 2060 selon en rapport de l’OCDE publié deux ans plus tard [7] .
S’impose dès lors une conclusion sans appel : « Un système économique dévolu aux profits, à l’accumulation et à l’expansion économique sans fin aura tendance à utiliser les gains d’efficacité ou les réductions de coûts pour élargir l’échelle globale de la production. L’innovation technologique sera donc fortement orientée vers ces mêmes objectifs expansifs » (Foster, Clark et York, 2010 : 179). En conséquence, il est parfaitement illusoire de penser que, dans un cadre capitaliste, il soit possible de promouvoir une tendance structurelle à l’économie globale dans l’usage des ressources naturelles et qu’une pareille tendance puisse être développée uniquement par des innovations techniques continues. De pareilles innovations techniques sont monnaie courante dans le procès immédiat de reproduction du capital ; et, quelle qu’ait pu être l’importance des gains obtenus par leur biais en matière de sobriété matérielle et d’efficacité énergétique par unité de produits (ou unité de valeur), ils n’ont jamais mis fin à la course à l’accumulation du capital et, partant, au (gas)pillage des ressources naturelles à grande échelle. Bien au contraire, ils en ont été les moyens mêmes, en leur servant de surcroît le plus souvent d’alibi.
En conclusion, pas plus que celles d’un « développement soutenable » ou d’une « croissance verte », la promesse « transition écologique » en cours ou à advenir n’est en mesure de fournir une solution à l’indépassable contradiction entre les exigences d’une reproduction sans cesse élargie du capital et la finitude du cadre écologique dans lequel elle est censée se développer. Comme les précédentes, elle apparaît comme une imposture qui masque la perpétuation du caractère écocidaire de la dynamique capitaliste tout en lui ouvrant de nouveaux champs et en lui fournissant de nouveaux moyens.
Notes
[1] Au terme de vingt ans de croissance au rythme de 3 % par an, la quantité de matériau à remplacer sera en gros 1,8 fois plus importante (1,0320 = 1,80611) que la quantité initiale et les 80 % de cette dernière issus du recyclage devront être complétés par un prélèvement de même quantité que celui opéré vingt ans auparavant.
[2] Les déchets représentent aujourd’hui un marché mondial de l’ordre de 300 milliards d’euros, dont la moitié est constituée par la valorisation des seuls déchets ménagers, qui ne représentent pourtant de 4 % de la masse globale des déchets (Monsaingeon, 2017 : 106).
[3] Un effet rebond se produit lorsque la réduction d’une limite apposée à la consommation d’un produit déterminé conduit à l’augmentation de cette dernière. Ainsi des économies de matières premières et d’énergie par unités produites, qui vont se traduire par la réduction du prix de ces dernières, peuvent provoquer une augmentation de leur demande globale et, partant, celle de la consommation productive de matières premières et d’énergie pour la fabrication de ce bien ou service. La réduction au niveau micro s’accompagne d’une augmentation au niveau macro.
[4] Selon un rapport de l’Agence internationale de l’énergie, les SUV consomment en moyenne 25 % de plus de carburant qu’une automobile de taille moyenne : https://www.connaissancedesenergies.org/afp/transports-les-4×4-urbains-source-majeure-daugmentation-des-emissions-mondiales-de-co2-selon-laie-191016
[5] Direction générale de l’aviation civile, Les émissions gazeuses liées au trafic aérien en France en 2020, Paris, 2021, page 6.
[6] United Nations Environment Program, Global Material Flows and Resource Productivity. An Assessment Study of the UNEP International Resource Panel, Paris, 2016, page 30.
[7] OCDE, OECD Highlights. Global Material Resources Outlook to 2060 – Economics Drivers and Environmental Consequences, Paris, 2018, page 4.
Bibliographie
Arnsperger Christian et Bourg Dominique (2016), « Vers une économie authentiquement circulaire », Revue de l’OFCE, n°145.
Aurez Vincent et Georgeault Laurent (2016), Économie circulaire. Système économique et finitude des ressources, Louvain-la Neuve, De Boeck Supérieur.
Benady Anne et Ross-Carré Hervé (2021), L’économie circulaire, La Plaine Saint-Denis, Afnor Éditions.
Berlingen Flore (2020), Recyclage : le grand enfumage. Comment l’économie circulaire est devenue l’alibi du jetable, Paris, Rue de l’Echiquier.
Cassoret Bertrand (2020), Transition énergétique. Ces vérités qui dérangent !, Louvain-la-Neuve, Paris, De Boeck Supérieur.
Écoinfo (2012), Impacts écologiques des TIC. Les faces cachées de l’immatérialité, Les Ulis, EDP Sciences.
Foster John Bellamy, Clark Brett et York Richard (2010), The Ecological Rift: Capitalism’s War on the Earth, New York, Monthly Review Press.
Frenoux Emmanuelle (2019), « Quel impact environnemental pour l’informatique ? », EcoInfo, Paris, CNRS, Limsi, Polytech Paris-Sud.
Lévy Maurice et Jouyet Jean-Pierre (2006), L’économie de l’immatériel : la croissance de demain. Rapport de la commission sur l’économie de l’immatériel au Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, Paris, La Documentation française.
Monsaingeon Baptiste (2017), Homo detritus. Critique de la société du déchet, Paris, Éditions du Seuil.
Tanuro Daniel (2012), L’impossible capitalisme vert, Paris, La Découverte.




