Agenda militant
Ailleurs sur le Web
![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)
- Au cœur du capital (12/03)
- Le débat des représentants des partis, avec Paul Vannier (12/03)
- Meeting avec Bagayoko, Coquerel et Mélenchon à Saint-Denis ! (11/03)
- Ludivine Bantigny, "La Bourse ou la vie. Le Front populaire, histoire pour aujourd’hui" (11/03)
- C’est quoi le "marxisme classique" et le "marxisme occidental" ? (10/03)
- “Le socialisme est la maison commune de tous les combats justes.” – Entretien avec Joseph Andras (10/03)
- Sur Franceinfo : Brigitte Boucher et les irresponsables (10/03)
- Ce que révèle l’affaire Epstein (10/03)
- Au Liban, d’une guerre coloniale à l’autre et du droit de résister (10/03)
- POUR UN FRONT ANTIFASCISTE AU SECOND TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES (10/03)
- Meeting de la campagne municipale LFI à Lille (10/03)
- Meeting avec Jean-Luc Mélenchon et Sophia Chikirou à Paris ! (09/03)
- Colombie : la gauche de Gustavo Petro valide le dernier test des législatives avant la présidentielle (09/03)
- Penser l’émancipation autrement, discuter l’apport de marxistes hétérodoxes [Podcast] (09/03)
- Terrorisme d’Ultra-droite (08/03)
- "L’Iran est sur le point d’obtenir l’arme nucléaire" : trente ans de prophéties démenties (08/03)
- Hommage au chercheur marxiste Michael Parenti – Compilation d’entretiens (08/03)
- La guerre de trop : les Américains et les Israéliens n’ont rien compris à l’Iran ! (08/03)
- Poutou annonce un probable soutien du NPA-A à Mélenchon en 2027 (07/03)
- Attaques en série contre LFI (07/03)
- Des maires insoumis pour tout changer | Clip officiel - Municipales 2026 (07/03)
- Romaric Godin : "La force fondamentale du capitalisme le pousse vers le néofascisme" (07/03)
- Quentin Deranque était en première ligne dans la bagarre (06/03)
- Tirer une balle dans la tête sans intention de donner la mort (06/03)
- Les États-Unis et Israël nous entraînent dans une barbarie suicidaire (06/03)
Liens
Guillaume Faburel : "Le modèle métropolitain est proprement écocidaire"
Ces articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » sont publiés à titre d'information et n'engagent pas la Tendance CLAIRE.
Guillaume Faburel : « Le modèle métropolitain est proprement écocidaire » – Le Comptoir
Guillaume Faburel est géographe, professeur à l’Université Lyon 2 et chercheur à l’UMR Triangle. Auteur de « Métropoles barbares » (2018), qui a reçu le Prix du livre d’écologie politique, en 2018, et de « Pour en finir avec les grandes villes » (2020) aux éditions Le Passager clandestin, il a publié cette année « Indécence urbaine » (Climats-Flammarion), qui analyse la métropolisation comme une colonialité écologique de nos vies. Un ouvrage indispensable pour comprendre la dynamique du capitalisme actuelle.

Le Comptoir : Qu’appelez-vous la “métropolisation” ?
Guillaume Faburel : Pour se figurer ce qu’est la métropolisation, il faut d’abord rappeler le rythme de la croissance urbaine. Il y a aujourd’hui 4,4 milliards d’urbains à travers le monde (60 % de la population) contre 751 millions (30 %) en 1950. Et la terre s’urbanise deux à trois fois plus vite (cas de la France) que la croissance démographique, soit l’équivalent d’une ville comme New York sortant de terre chaque mois dans le monde. Mais surtout, cette croissance opère d’abord par concentration, avec ce jour 600 villes de plus d’1 million d’habitants et 50 agglomérations de plus de 10. Or, si les 200 métropoles répertoriées représentent 12 % de la population planétaire, elles produisent 48 % du PIB mondial. Il y a donc du capital à fixer et de la “richesse” à produire, à condition de vite grossir. Voici la raison première de la métropolisation des cinquante dernières années.
En fait, cette métropolisation a deux ressorts principaux, sur le modèle des ville-monde, historiquement au nombre de trois (Londres, New York, Tokyo), puis de quatre (Paris), et maintenant de sept à douze selon les critères. Économique tout d’abord, par la mutation néolibérale du capitalisme, avec commandement urbain des activités dites à haute valeur ajoutée (tertiarisation de l’économie), tel que montré par la sociologue Saskia Sassen, et financiarisation des projets pour une rente immobilière démultipliée grâce à la dérégulation et à la marchandisation (tel que montré par le géographe David Harvey). La rente immobilière de l’Île-de-France pèse par exemple trente milliards d’euros annuellement. Politique maintenant, par la conversion rapide des institutions et de la fabrique urbaine aux logiques et régimes entrepreneuriaux, avec partenariats publics-privés et agilité lucrative de marché.
Avec cette visée double, les grandes villes ont partout développé des projets d’aménagement cherchant l’attractivité (à l’exemple de ceux relatifs aux jeux olympiques), mais également se sont étendues (i.e. périurbanisation) en raison de l’incapacité espaces centraux à pouvoir accueillir tout le monde. Et les mêmes dynamiques se retrouvent dans des villes moyennes, en plus petit, avec le soutien ardent de programmes d’État, en termes de construction et d’architecture, d’enseignes commerciales et de piétonisation…
Quels sont les problèmes écologiques et sociaux que pose la métropolisation ?
La dynamique décrite crée de grandes disparités, avec gentrification et ségrégations croissantes au sein des espaces métropolitains et exclusion des classes populaires et de plus en plus de la “classe” moyenne. Le prix des logements a par exemple en France doublé en euros constants en vingt ans, tiré par la hausse au sein des métropoles. Par ailleurs, l’accélération et le mouvement, la connexion et le divertissement… promus par les modes de vie métropolitains, comme plus largement la consommation et la sur-stimulation dans ces antres de la machine à désirs et de la culture marchande, colonisent tous les temps sociaux et ce faisant suscitent pour les mieux insérés plaisir et jouissance par surcroît d’activités, et pour les autres, perte de sens, impuissance et souffrance.
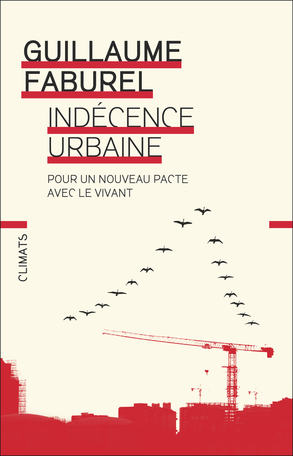
Enfin, toujours par effets de concentration et néo-libéralisation, la centralisation des pouvoirs et la délégation technique des compétences prévalent. Les habitants sont peu à peu dépossédés de leurs capacités d’intervention et, finalement, de toute démocratie de proximité. Voilà pour quelques effets de la métropolisation du monde, avec partout les mêmes recettes pour obtenir une part du gâteau : de la festivalisation à la touristification, de l’airbnbisation à la foodification (i.e conversion des trottoirs en terrasses), des grands évènements sportifs aux gestes de la starchitecture…
Mais c’est surtout par ses conséquences écologiques que cette croissance interpelle. En fait, si la population mondiale a été multipliée par 4,6 de 1900 à 2015, celle urbaine l’a été par 14, et, dans le même temps, la consommation énergétique a été multipliée par 15, l’extraction de matériaux par 12, les déchets par 11 et les émissions de CO2 par 15. Et les grandes villes y exercent un poids déterminant puisque les 85 métropoles du C40 (groupe des plus grandes villes du monde réunies dans la lutte contre le changement climatique) représentent 8 % de la population mondiale pour près de 70 % des émissions de gaz à effet de serre. En outre, matériau essentiel à la densification, le béton, arme de construction massive du capitalisme selon le philosophe Anselm Jappe, asphyxie les sols, détruit les biotopes, évince végétaux et animaux… Et il faut faire venir de très loin pour vivre concentrés à ce point, y compris une énergie surconsommée en raison de la stimulation, de la distinction, par la concentration. Les 100 plus grandes villes de France ont par exemple trois jours d’autonomie alimentaire.
Voilà donc le problème : le modèle métropolitain est proprement écocidaire. Et, les politiques techno-solutionnistes (ex : rénovation thermique), durabilistes (ex : agriculture urbaine) ou encore de redirection écologique des équipements n’y changeront rien. Au contraire. Non seulement elles participent des ségrégations évoquées – les actions écologiques trient aussi les populations (éco-quartiers ou encore électro-mobilité) – mais surtout elles maintiennent dans l’illusion d’une adaptation de ces macro-systèmes. « Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes » nous disait Bossuet.
Validez-vous la distinction entre métropoles et France périphérique ?
Au regard de ce qui précède, oui. Certes, les modes de vie tendent à se ressembler du fait l’urbanisation généralisée. Mais, il y a bien des différences notables des centres métropolitains jusqu’aux campagnes reculées, si l’on en juge par exemple les revenus ou encore les choix politiques. Le Grand Paris, ce sera 40 milliards d’Euros pour les transports de la région capitale. En proportion de population, la Creuse attend toujours ses 700 millions. Surtout, ces différences sont le fruit de relations de subordination. Le développement métropolitain est le produit direct de territoires servants, avec dedans, notamment, mécanisation agricole, élevage industriel, accaparement forestier, extraction des matières… dans les campagnes (tout comme aujourd’hui l’agri-voltaïsme et les grands méthaniseurs). Tout ceci pour nourrir et chauffer des populations à ce point concentrées et ce faisant déliées de tout savoir-faire de la terre.
Et, par-delà le seul exemple de l’agriculture industrielle, ce colonialisme intérieur existe de longue date, si l’on en juge, autre exemple, les réseaux de transport rapide dont le projet d’A69 pour accéder à la métropole Toulousaine incarne aujourd’hui l’anachronisme. Ce colonialisme a été mis en lumière dès les années 1960 par la géographie autonomiste, notamment Maurice le Lannou, et a été plus largement nourri depuis lors dans sa compréhension du modèle d’analyse marxiste centre-périphérie, qui partait initialement des rapports inégalitaires Nord-Sud. C’est sur cette base que le géographe Christophe Guilluy parle de fractures par des rapports culturels différenciés à la mondialité… métropolitaine, avec sentiments de déréliction et de dépossession dans les périphéries, ou encore que le journaliste David Goodhart distingue les Somewhere des Anywhere dans des réalités différentes vis-à-vis de l’un des fétiches de cette mondialité : le nomadisme planétaire.
Difficile de ne pas entendre ce point de vue lorsque l’on voit les gilets jaunes réclamer reconnaissance et respect d’une autre économie morale que celle des métropoles (cf. travaux du politiste Samuel Hayat). En fait, même si les experts et mondes universitaires vivant le plus souvent dans les grandes villes et travaillant auprès des institutions d’État n’ont que peu intérêt à en parler, les centres du pouvoir économique et politique sont bien ce jour les métropoles, et les périphéries sont bien des mondes asservis et subalternisés, que ces périphéries soient extérieures ou intérieures aux espaces métropolitains, à l’exemple également des quartiers populaires avec leurs “premiers de corvée” nécessaires à la méga-machine urbaine et à sa pérennité.
Comment expliquer que la gauche soit si forte dans les métropoles ?
Elle y est forte parce que, tel que décrit, il y a bien quelques problèmes sociaux et écologiques à y traiter. Mais elle l’est surtout parce que l’engagement en découlant nourrit des croyances qui mobilisent, non sans question, toujours ses bases électorale et militante.

Jean-Claude Michéa
La première de ces croyances est que la ville, la grande, serait encore milieu propice au mélange social et au brassage culturel, à l’anonymat libérateur. Elle composerait une mosaïque de mondes sociaux qui inclinerait à une tolérance plus élevée aux différences (urbanité), offrant à l’individu la possibilité de s’arracher du contrôle social des anciennes communautés… villageoises. On y accèderait à un statut et à des droits grâce à la masse des corps réunis. Voilà pour le Droit à la ville développé il y a maintenant plus de cinquante ans par le philosophe Henri Lefebvre et encore très en vogue au sein de la gauche urbaine. Je laisse chacune et chacun juge de telles vertus, véhiculées jusqu’aux penseurs néolibéraux des “classes créatives”. Tel que montré par l’historien Christopher Lasch ou encore le philosophe Jean-Claude Michéa, nous avons affaire ici à une mythologie vivace, celle du progrès et donc de l’émancipation (par la délivrance matérielle du tout fossile), dont les trajectoires sont étroitement associées à la ville, particulièrement à celle industrielle des deux siècles écoulés.
Mais, plus encore et dans le prolongement, c’est la capacité d’action la cheville ouvrière de ce récit, expliquant sans doute davantage l’incapacité à trancher le nœud gordien que constitue la ville dans ces mondes militants. Puisant dans une certaine histoire, celle des luttes et révoltes urbaines, les grandes villes sont encore représentées comme creusets et foyers politiques. Avec dès lors, pour les opposants urbains à la métropolisation par exemple, des vertus elles-aussi promues comme cardinales de l’agglomération, que ce soit la socialisation et la subjectivation politique par la densité, la solidarité et la communauté politique par la proximité, l’expression politique et la visibilité par le nombre rassemblé.
Du coup, entre être agent involontaire de vies urbaines contre-écologiques en y résidant et être militant au plus près ou dans les institutions pour œuvrer à la transformation du monde (là aussi, vieille idylle avec la ville), cette gauche a choisi. Et ce malgré le fait que nous avons là affaire à toutes les pratiques routinisées (de l’interpellation à la manifestation notamment), totalement fondues dans le jeu ordonné des pouvoirs institués, qu’ils soient d’État ou des Métropoles, rendues pleinement compatibles avec l’organisation héritée des légitimités et du capitalisme qui les soutient. Et ce malgré également l’évidente stérilité écologique et sociale des combats conduits (y compris en bloquant et sabotant) ou des politiques menées, que ce soit par des opposants ou des équipes en responsabilité. L’environnementalisme de bureaux et des réseaux sociaux n’a jamais fait écologie. Comme disait Bernard Charbonneau : « La liberté est née dans les villes, mais, maintenant, pour vivre, elle est obligée d’en sortir. »
La solution est-elle dans un départ massif vers la campagne ou le périurbain ?
Il me semble que nous n’avons en fait pas d’autres choix que d’ouvrir ou plutôt de ré-ouvrir cette option d’un nouvel équilibre territorial, défendue dès les années 1960. Si l’on veut réduire nos empreintes écologiques pour revenir sous le seuil des limites planétaires, cela ne pourra se faire sans privilégier d’autres habitats que les grandes villes métropolisées, au profit de plus petites et surtout des villages et de leurs communautés. Seule la proximité directe au vivant, au plus près des ressources et effets de nos comportements, peut éveiller l’attention au point de questionner nos habitudes de consommation et plus encore nos vies dont nous avons totalement délégué la gestion à la centralisation et aux concentrations.
Or, il se trouve que, en plus ou à cause de la dégradation des environnements urbains, la contrariété vis-à-vis de la densité urbaine est sans cesse rappelée en France par enquêtes interposées depuis les années 1950, avec le désir de campagne clairement manifesté. Nous constatons également des vies périurbaines qui s’affranchissent lentement mais sûrement des centralités servicielles et culturelles métropolitaines. Il existe même de récents et timides programmes nationaux en Espagne, au Japon et même en France (programme EMILE), qui proposent des aides au déménagement. Alors certes, tout ceci n’est pas sans poser quelques grandes questions, au premier chef celle de modifier en profondeur les modes de vie pour éviter d’étendre le problème plutôt que de diminuer les pressions. Mais c’est bien tout l’objet de se rapprocher du vivant en vue de faire communauté terrestre par une autre écologie que celle finalement très artificielle du durabilisme et du techno-solutionnisme urbains. La révolution ne consiste pas à détruire le capitalisme, mais à refuser de le fabriquer, indique le sociologue John Holloway.
L’autonomie est en fait la seule écologie digne face à la dévastation orchestrée par l’urbanisation. Depuis les grandes villes, c’est proprement impossible, à moins de débétonner et de désimperméabiliser au moins 50 % de la surface de Paris !
Pourtant, il semblerait que c’est en métropole que la conscience écologique est la plus forte…
Nous pourrions même dire que c’est là, a priori, une des rares utilités des métropoles : forger une conscience écologique par sa propre impéritie. Mais, à y regarder de plus près, de quelle conscience s’agit-il ? À quelle écologie faisons-nous référence lorsque l’on est à ce point détourné des moyens vivriers, nourriciers de notre première finalité : subvenir directement de sa main à des besoins premiers. Raison pour laquelle l’appel se fait de plus en plus pressant à un réempaysannement de notre société, depuis des structures syndicales ou des mondes de la décroissance. Et l’écologie des villes n’y forme pas particulièrement. Sinon, nous n’aurions pas autant de velléités de bifurcations et de débranchements, chez les jeunes adultes notamment.
Les habitants du rural et du périurbain semblent être autant aliénés au mode de vie capitaliste que les autres, non ?
Oui, bien sûr, et ce toujours et encore par effet de métropolisation, puisque comme dit précédemment, les campagnes ont été asservies à l’urbain, que ce soit à des fins d’approvisionnement ou de villégiature, et le périurbain est bien une manifestation artificielle de la croissance urbaine par effet de polarisation économique et donc d’étalement résidentiel. De ce fait, les modes de vie capitalistes affectent toutes les existences et nous sommes toutes et tous embarqués sur le même vaisseau amiral : la métropole (étymologiquement ville-mère).
Toutefois, face aux descentes matérielles et énergétiques, face à la disparition exponentielle des espèces et à l’artificialisation rapide des sols… les campagnes disposent des ressources matérielles de la survie collective. Celles de la terre et des forêts, de la matière et même de logements (ex : vacants), y sont implantées. Et elles seraient suffisantes au rééquilibrage géographique défendu plus tôt. En outre et surtout, sans angélisme ni inconscience de la folklorisation qui guette, d’autres cultures de la terre et de l’autonomie, de la main et de ses savoir-faire subsistent dans les ruralités. Voilà un moyen pour décoloniser nos imaginaires de croissance et tendre vers un peu plus de mesure et de tempérance, avec humilité et responsabilité, décence et dignité.
Comme l’a écrit Pierre Gevaert, en 1994, « la société moderne industrielle et urbaine, ivre de consommation, a mis à sac la nature. Que nous le voulions ou non, c’est contraints et forcés, pour essayer de survivre, qu’une société à prédominance rurale s’imposera bientôt. »
Nos Desserts :
- Pour trouver Indécence urbaine en librairie
- Site du mouvement Post-urbain, animé par Guillaume Faburel
- Grand entretien de Guillaume Faburel sur le site de Marianne
- Débat entre Guillaume Faburel et Gilles Savary sur le site de Marianne
- Retrouvez nos entretiens de l’Atelier Paysan et de Pierre Bitoun sur la paysannerie
- (Re)lire notre article sur la pauvreté rurale
- Retrouvez tous nos articles sur la décroissance





