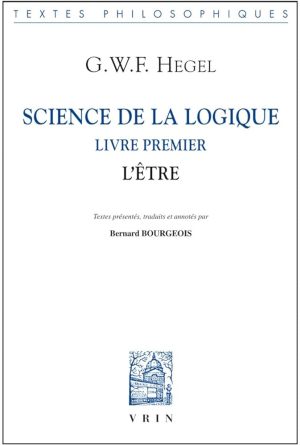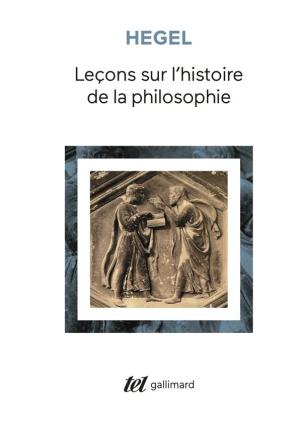Agenda militant
Ailleurs sur le Web
![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)
- Au cœur du capital (12/03)
- Le débat des représentants des partis, avec Paul Vannier (12/03)
- Meeting avec Bagayoko, Coquerel et Mélenchon à Saint-Denis ! (11/03)
- Ludivine Bantigny, "La Bourse ou la vie. Le Front populaire, histoire pour aujourd’hui" (11/03)
- C’est quoi le "marxisme classique" et le "marxisme occidental" ? (10/03)
- “Le socialisme est la maison commune de tous les combats justes.” – Entretien avec Joseph Andras (10/03)
- Sur Franceinfo : Brigitte Boucher et les irresponsables (10/03)
- Ce que révèle l’affaire Epstein (10/03)
- Au Liban, d’une guerre coloniale à l’autre et du droit de résister (10/03)
- POUR UN FRONT ANTIFASCISTE AU SECOND TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES (10/03)
- Meeting de la campagne municipale LFI à Lille (10/03)
- Meeting avec Jean-Luc Mélenchon et Sophia Chikirou à Paris ! (09/03)
- Colombie : la gauche de Gustavo Petro valide le dernier test des législatives avant la présidentielle (09/03)
- Penser l’émancipation autrement, discuter l’apport de marxistes hétérodoxes [Podcast] (09/03)
- Terrorisme d’Ultra-droite (08/03)
- "L’Iran est sur le point d’obtenir l’arme nucléaire" : trente ans de prophéties démenties (08/03)
- Hommage au chercheur marxiste Michael Parenti – Compilation d’entretiens (08/03)
- La guerre de trop : les Américains et les Israéliens n’ont rien compris à l’Iran ! (08/03)
- Poutou annonce un probable soutien du NPA-A à Mélenchon en 2027 (07/03)
- Attaques en série contre LFI (07/03)
- Des maires insoumis pour tout changer | Clip officiel - Municipales 2026 (07/03)
- Romaric Godin : "La force fondamentale du capitalisme le pousse vers le néofascisme" (07/03)
- Quentin Deranque était en première ligne dans la bagarre (06/03)
- Tirer une balle dans la tête sans intention de donner la mort (06/03)
- Les États-Unis et Israël nous entraînent dans une barbarie suicidaire (06/03)
Liens
La Phénoménologie de l’Esprit de Hegel
Ces articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » sont publiés à titre d'information et n'engagent pas la Tendance CLAIRE.
Première approche
Voici la première partie d’un texte consacré au célèbre ouvrage de Hegel, « La Phénoménologie de l’Esprit ». D’abord rédigé en vue d’un cours donné à un public d’étudiants en licence de philosophie, nous avons jugé utile de publier ce texte sur Le Comptoir et de le mettre ainsi à la disposition des lecteurs curieux de connaître une œuvre qui a bouleversé et façonné le paysage de la pensée moderne européenne. Dans cette première partie, nous proposons une première approche générale dans la logique de la Phénoménologie de l’Esprit d’une part, et de la signification générale de la philosophie telle que l’entend Hegel d’autre part.
La Phénoménologie de l’Esprit est le premier livre important qu’ait écrit le philosophe allemand, Georg-Wilhelm-Friedrich Hegel, publié en 1807. C’est un ouvrage qui contient en germe tout le système hégélien à venir. Ouvrage dense, très difficile à lire, parce que rédigé sur le vif, sans relecture ni effort de pédagogie. On sent, en le lisant, que le plan s’invente au fil de la plume.
Hegel a trente-sept ans au moment de sa parution : il n’est donc plus vraiment un jeune homme, mais du point de vue de sa carrière académique, il est encore un tout jeune philosophe. On peut dire que l’ouvrage a les défauts caractéristiques d’une œuvre de jeunesse, notamment celui de vouloir tout mettre à l’intérieur, de tout jouer en une seule fois. D’où une impression de trop-plein, une densité excessive. C’est trop ! Chaque phrase est une prouesse. Chaque phrase dit quelque chose d’essentiel. Il y a une saturation de sens.
Une œuvre tardivement reconnue
Les grandes œuvres philosophiques, comme La République de Platon, ou la Critique de la raison pure (1781) de Kant, comportent de nombreux passages dont l’enjeu n’est pas primordial, des passages plus calmes et plus légers, à côté de ceux dans lesquels s’exprime une pensée géniale et décisive, et cela n’est pas un problème. Une fois que Hegel aura acquis la reconnaissance académique, et qu’il sera dans une situation matérielle et morale plus sereine, son écriture deviendra plus fluide et plus aérée, si l’on ose dire… Même si l’on restera toujours dans ce que Nietzsche appelle « la lourdeur du style allemand ».
Cette densité, ce trop-plein de langage conceptuel qui ne laisse aucun répit à son lecteur, est sans doute l’une des causes principales qui explique que, au moment de sa publication, la Phénoménologie sera un échec total. Ce ne sera que plus tard, avec la publication du premier volume de la Science de la logique (1812), que Hegel connaîtra le succès. Puis la première version de son Encyclopédie (1817) fera de lui de grand philosophe de l’Allemagne. Il deviendra le philosophe en quelque sorte « officiel » du pays.
Pendant plus d’un siècle, on étudiera le Hegel de la Science de la logique et de l’Encyclopédie, ses œuvres de maturité, et très peu le Hegel de la Phénoménologie de l’Esprit. Seuls les hégéliens purs et durs en reconnaissent l’importance, comme ceux qu’on appelle les Jeunes-Hégéliens, parmi lesquels un certain Karl Marx. Dans ses Manuscrits de 1844 notamment, le jeune Marx se confronte à Hegel de manière critique, mais en esquissant en même temps une philosophie de la conscience révolutionnaire très imprégnée de dialectique hégélienne. Dans ce texte, Marx reconnaît la grandeur de la Phénoménologie de l’Esprit, qu’il considère comme la première œuvre donnant à comprendre que l’homme produit lui-même ses conditions d’existence à travers un processus de transformation du monde par le travail. Marx reprend à la Phénoménologie l’idée selon laquelle la condition humaine est le résultat du travail humain – et non l’inverse.
« Chaque phrase dit quelque chose d’essentiel. »
Mais à quelques exceptions près, personne n’accorde encore à ce livre le statut qu’il mérite. Au XXe siècle, en Allemagne, c’est Heidegger qui sera responsable de sa redécouverte, dans un cours qu’il donne à ses étudiants durant l’hiver 1930-1931. En France, c’est l’influence conjointe de Jean Hippolyte, à travers sa traduction et ses commentaires, et d’Alexandre Kojève, à travers son fameux séminaire, auquel assisteront Lacan, Bataille, Breton, Merleau-Ponty et bien d’autres, qui installera la Phénoménologie comme un classique incontournable de la philosophie moderne.
L’interprétation que Kojève en fera sera décisive pour l’histoire de la philosophie française contemporaine. On peut dire que le Hegel de Kojève est plutôt l’expression de la pensée singulière de Kojève se faisant, s’inventant à travers la lecture de Hegel. Son commentaire n’est pas un commentaire scientifique, ce n’est pas une exégèse pointilleuse et parfaitement fiable. C’est réellement une interprétation qui fait de Hegel un philosophe athée et défenseur d’une vision marxisante de l’histoire, en plaçant la dynamique de la dialectique du Maître et de l’Esclave au centre de l’œuvre. L’enjeu, c’est l’humanisation de l’Homme à travers l’accès progressif à la conscience de soi. Pour résumer brièvement : c’est à travers la Lutte d’une part, remportée par le Maître, et le Travail d’autre part, assigné à l’Esclave, que le monde s’humanise, depuis cette dualité première, brutale, jusqu’à la conscience bourgeoise, liée à la Révolution française, et pour finir, dans la forme de l’État « absolu », représenté à l’époque de Hegel par l’Empire napoléonien, permettant à l’Homme de se réaliser en tant que Citoyen.
Napoléon incarnerait ainsi la fin de l’Histoire. Mais Kojève, reprenant à son compte le point de vue hégélien, qu’il conceptualise comme la Sagesse définitive, actualisera cette conception de l’histoire en substituant l’URSS à l’Empire napoléonien : l’URSS comme l’État absolu ; et en substituant Staline à Napoléon : Staline comme figure propre à incarner la fin de l’histoire. Fin de l’histoire au sens où l’État stalinien signifie l’État absolu où se trouvent abolies la différence de condition et la lutte entre Maître et Esclave.
Bref, à partir des années 1930, la Phénoménologie va s’installer au cœur de la philosophie européenne jusqu’au point d’occulter parfois le reste de l’œuvre hégélienne, le système de la maturité auquel on s’en tenait jusque-là.
Qu’y a-t-il de si passionnant, de si décisif dans ce livre, qui en fait l’un des plus commentés de l’histoire de la philosophie ? Qu’est-ce qui fait qu’on doit le lire encore aujourd’hui, malgré sa langue labyrinthique, malgré sa densité extrême et sa difficulté rebutante ?
« Marx reprend à la Phénoménologie l’idée selon laquelle la condition humaine est le résultat du travail humain – et non l’inverse. »
Un prospectus qui dit l’essentiel
Pour nous y introduire, on peut s’intéresser à la manière dont Hegel présente lui-même son livre, sous forme de teasing en quelque sorte, puisqu’il rédige lui-même le prospectus publicitaire envoyé aux librairies au moment de la parution. Hegel a en effet envoyé aux libraires un prospectus anonyme pour les inciter à vendre son livre : il fait comme si les éditeurs l’avaient rédigé, mais tout le monde sait que c’est lui-même qui en est l’auteur. En guise d’introduction dans la matière de l’ouvrage, nous pouvons nous attacher à suivre linéairement ce document, pour en dégager quelques points essentiels.
« Ce volume expose le savoir en devenir.
[Dans cette première phrase, deux mots-clés résument l’ouvrage : 1. « le savoir » ; 2. « en devenir ». Hegel indique que la conception du savoir présentée dans son ouvrage a quelque chose de très novatrice. Le savoir, la connaissance, la vérité, c’est une seule et même chose en quelque sorte ; c’est l’objet de la philosophie, c’est ce que cherche le philosophe : le philosophe cherche à savoir, à connaître, à accéder à la vérité. Jusqu’à Hegel (et parfois aujourd’hui encore), on avait pris l’habitude de considérer qu’une vérité était quelque chose de définitif, de figé. Il y a des vérités, et une fois qu’on les découvre, on les sait une fois pour toutes. Or, Hegel nous annonce que le savoir dont il va être question dans son ouvrage est un processus, que c’est un savoir en devenir : il n’est pas donné d’emblée, et n’est pas figé une fois pour toutes : il progresse, il est en mouvement. C’est une idée étonnante. Hegel ne compte pas nous présenter le savoir comme tel, son contenu achevé, les objets fixés du savoir, mais il veut nous présenter la trajectoire du savoir, le chemin qui va vers le savoir, du non-savoir au savoir.]
La Phénoménologie de l’esprit doit venir prendre la place des explications psychologiques ou des discussions abstraites sur ce qui fonde le savoir.
[La philosophie à la mode du temps de Hegel est une philosophie « abstraite », qui définit les objets du savoir de manière abstraite, comme si ces définitions étaient vraies de toute éternité, des connaissances figées hors du temps. Et l’on cherche le fondement de ces connaissances dans la « psychologie », c’est-à-dire dans l’esprit humain, comme si le savoir dépendait in fine de notre subjectivité. C’était notamment la démarche de Kant qui ramenait la connaissance aux structures de l’esprit humain. Ce n’est pas la « psychologie » au sens où nous l’entendons actuellement. Et n’est-ce pas un peu étonnant qu’un philosophe dont le langage est aussi abscons, présente son ouvrage comme un remède aux « discussions abstraites » ?
Mais il faut garder à l’esprit que la complexité n’est pas l’abstraction, que la difficulté du langage ne signifie pas que ce dont on parle soit « abstrait ». Ce n’est pas du tout la même chose ! L’abstraction, cela consiste à présenter des connaissances comme des vérités définitives qui sortent un peu de nulle part, et qu’on peut relier plus ou moins vaguement aux facultés de l’esprit humain. « Abstrait », cela signifie : désincarné, déréalisé, mal fondé, c’est le contraire du réel et de l’effectif. Hegel veut partir du réel, de ce qui est effectivement. La vérité, c’est ce qui est concrètement. D’ailleurs, Hegel est l’auteur d’un petit opuscule polémique qui s’intitule Qui pense abstrait ? (publié en 1807 également), très éclairant pour comprendre la distinction entre sa perspective et ce qu’il appelle la pensée abstraite.]
Elle examine la préparation à la science dans une perspective qui fait d’elle une science nouvelle, intéressante, la première science de la philosophie.
[Hegel souligne le mot qui résume le projet qui préside à son ouvrage. La Phénoménologie est une préparation. En termes plus philosophiques, on appelle ça une propédeutique : il s’agit de préparer notre esprit à une connaissance plus approfondie, à ce que Hegel appelle « la Science ». Cela rejoint évidemment l’idée du « savoir en devenir ». Il y a un chemin qui mène au savoir, ce chemin prépare notre conscience à recevoir le savoir, et ce savoir, ce sera l’objet de la Science qui n’est pas encore contenue dans ce livre. On est encore dans la préparation : la Science, ce sera l’ouvrage suivant, déjà prévu par Hegel, la Science de la logique. D’autre part, le projet est de faire une « science » de la philosophie, la « première », nous dit Hegel. Autrement dit, il s’agit de substituer la philosophie par une science. L’idée de « science », ici, n’est pas à comprendre au sens ordinaire, comme une manière de connaître et d’étudier les objets du monde et de l’univers, mais comme une manière de fonder l’ensemble des domaines du savoir. C’est une idée très à la mode au temps de Hegel, selon laquelle le rôle principal de la philosophie est d’unifier le savoir, et de fonder le savoir, d’exposer la raison ultime, le principe de vérité qui fonde tout savoir.
La Phénoménologie est donc destinée à exposer le chemin qui prépare l’accès à cette Science, à cette vérité fondatrice qui est l’objet de la quête de la philosophie depuis ses origines. C’est au sens où cette Science remplacera la philosophie, comme l’acquisition du Graal remplacerait la quête du Graal, que Hegel dit qu’elle est « nouvelle » : au sens où elle sera enfin découverte. Quant à savoir si elle est « intéressante », sans aucun doute, mais Hegel fait aussi sa propre publicité en l’affirmant de cette manière.]
Elle appréhende les différentes figures de l’esprit comme autant de stations du chemin par lequel celui-ci devient Savoir pur ou Esprit absolu.
[Beaucoup de choses sont dites ici. Déjà, Hegel introduit le concept d’Esprit. Qu’est-ce que l’Esprit ? C’est un concept qui n’est jamais clairement exposé dans l’ouvrage. On est censé comprendre plus ou moins spontanément de quoi il s’agit. À ce stade, on peut noter que l’Esprit renvoie à l’activité de la conscience qui parcourt la trajectoire du non-savoir au savoir – ce Savoir, qui est le but et la fin de l’ouvrage, et que Hegel appelle « pur » ou « absolu ». Hegel nous dit autre chose d’important, il souligne le mot « figures », et le mot « stations ». Le chemin du Savoir n’est pas une trajectoire linéaire, ce n’est pas un chemin qui va tout droit, d’un point A à un point B, c’est un parcours composé de figures, c’est-à-dire de formes concrètes, dans lesquelles s’incarne l’Esprit. L’Esprit, qui est l’activité de la pensée vers le savoir, ou la pensée s’activant, se mouvant vers l’accès au Savoir, l’Esprit, précisément, ne demeure pas dans l’éther de l’abstraction : il s’incarne, il séjourne dans les formes de la conscience et de la culture, qui sont autant de jalons vers le savoir. Par exemple, dans les premiers jours, au moment où la conscience s’éveille, il séjourne dans la conscience la plus naïve. La conscience qui dit : la vérité, ce que je sais, c’est qu’ici nous sommes à Paris et qu’il fait gris. Ici et maintenant. Hic et nunc. C’est la première expérience que fait la conscience : que je suis ici, et que j’y suis maintenant. Évidemment, c’est une forme de conscience extrêmement pauvre et insuffisante, qui devient vite intenable, qui doit être rapidement dépassée. Mais il faut que l’Esprit en passe par cette forme très naïve du savoir pour avancer.
Une autre forme, beaucoup plus élaborée, une autre figure dans laquelle l’Esprit s’incarne au long de son parcours, c’est la figure de la conscience romantique, c’est-à-dire la conscience de l’individu qui se sent en contradiction avec le monde qui l’entoure. La conscience de l’unité perdue, la conscience poétique et mélancolique. Bref, les formes concrètes de conscience que l’on trouve dans l’histoire et la culture sont considérées, chez Hegel, comme des figures dans lesquelles l’Esprit s’incarne au long de son chemin vers le Savoir absolu. D’autre part, Hegel souligne le mot « stations » : cela signifie que ces figures dans lesquelles l’Esprit s’incarne sont des moments qui possèdent en eux-mêmes leur légitimité et leur durée. Ce ne sont pas seulement des lieux de passages, comme des ponts à traverser : l’Esprit s’y arrête, il y « séjourne », il doit habiter pleinement chacune des figures dans lesquelles il s’incarne, afin d’éprouver jusqu’au bout la vérité propre à chaque figure, et en éprouver alors les limites. Car chaque figure est en fait limitée quelque part : chaque figure dans laquelle l’Esprit s’incarne révèle une part de vérité, mais en exclut d’autres, et en ce qu’elle exclut d’autres parts de vérité, elle ne délivre pas de Vérité totale, elle n’est pas le « Savoir absolu ». Elles sont des étapes, des stations sur le chemin vers l’Absolu.]
[… Passons sur la seconde partie de ce prospectus, dans laquelle Hegel détaille un peu le contenu de l’ouvrage. Ce n’est pas très parlant pour nous dans ce contexte.]
Un deuxième volume contiendra le système de la logique comme philosophie spéculative, et des deux autres parties de la philosophie, les sciences de la nature et les sciences de l’esprit. »
[Hegel annonce que la Phénoménologie n’est que le premier volume de l’œuvre projetée. C’est en quelque sorte la préface du système. Mais c’est également déjà un système en soi, dans le sens où le livre anticipe le système – le livre contient déjà le système à venir, mais encore en germe : le système est préfiguré, à travers le cheminement que Hegel présente, du non-savoir au savoir. Une fois que la trajectoire de l’Esprit parvient à son achèvement – c’est-à-dire une fois qu’on arrive au dernier chapitre de la Phénoménologie, alors le système va pouvoir « commencer » si l’on ose dire, et il fera trois parties : une Logique, une Philosophie de la Nature et une Philosophie de l’Esprit.]
La signification hégélienne de la philosophie
Dans notre époque relativiste, on a du mal à prendre au sérieux les gros systèmes philosophiques du passé. Il n’est pas rare de croiser des gens qui confondent la philosophie avec des ouvrages de développement personnel. Et l’on dit encore : « sois philosophe ! », ou « ma philosophie » (comme dans cet énorme tube des années 2000 : « Je n’ai qu’une philosophie, être acceptée comme je suis »). Bref, on rattache facilement la philosophie à une option purement personnelle, ou on la restreint à la singularité de son auteur. Tel philosophe dit ça, tel autre dit autre chose, à moi de choisir ce que je prends et ce que je laisse, ou de ne rien choisir du tout.
Mais cette façon de voir ne permet pas de comprendre ce qui est en jeu dans une philosophie digne de ce nom, comme celle de Hegel. Lire Hegel et interpréter Hegel, ce n’est pas chercher à « développer » ma petite personne, et ce n’est pas non plus avoir affaire à ce que pense l’individu Hegel – un individu particulier qui aurait produit une théorie sur le réel à laquelle il serait loisible de préférer une autre théorie. Le sens de la philosophie, dans l’esprit de Hegel, est un sens profondément impersonnel – et il faut bien entendre ce sens si l’on veut entendre quelque chose de Hegel.
La Phénoménologie se présente comme l’histoire de la Conscience qui accède au Savoir, ou encore l’histoire de l’Esprit qui se déploie, à travers différentes étapes, vers son but, qui est le Savoir absolu. On peut s’en tenir pour l’instant à l’idée que c’est le mouvement de l’Esprit qui est en jeu, le mouvement de l’Esprit vers la vérité. Mais ce n’est pas le philosophe en tant qu’individu singulier qui pense et récapitule ce mouvement de l’Esprit : c’est l’Esprit qui se pense lui-même à travers la pensée du philosophe. Autant que possible, le philosophe doit s’effacer au profit de la vérité qu’il s’attache à retranscrire. Son rôle est de pure médiation.
Et c’est là une différence fondamentale entre la philosophie et la simple histoire des idées. Il y a philosophie précisément quand la pensée s’émancipe des déterminations contextuelles et des contingences empiriques. Il y a philosophie quand, loin de renvoyer à la psychologie individuelle de celui qui l’exprime, la pensée manifeste ce qui est dans la pure clarté des concepts, en même temps que cette pensée définit ces concepts, en explicite la logique.
On peut lire à ce sujet ce que dit Hegel dans ses leçons de Berlin sur l’histoire de la philosophie : « Le contenu et la valeur d’une philosophie sont distincts de la personnalité et du caractère individuel. Dans l’histoire de la philosophie, les productions sont d’autant plus excellentes qu’on peut moins les imputer à l’individu particulier et moins lui en attribuer le mérite et qu’elles dépendent davantage au contraire de la pensée libre et que cette pensée dépourvue de particularité même est le sujet qui produit. »
C’est une illusion propre à l’individualisme contemporain que de croire que l’individu se détermine par lui-même à penser, et qu’il peut alors élaborer des représentations et des théories sur le réel : en réalité, la conscience individuelle est toujours déjà prise dans un Tout de pensée qui lui préexiste. C’est dans ce tout préexistant que la conscience individuelle se forme et se meut. Penser, c’est toujours être déterminé à penser, soit à travers des habitudes de pensée irréfléchies – et c’est ce qu’on appelle la simple opinion –, soit à travers une logique qui s’explicite par elle-même – et c’est ce qu’on appelle une pensée.
« La Phénoménologie se présente comme l’histoire de la Conscience qui accède au Savoir. »
Pour ne pas en rester à la simple opinion, la pensée doit être lucide, éclairée, consciente d’elle-même. Or, on peut dire qu’une pensée est lucide à partir du moment où elle est capable de se penser elle-même. Autrement dit, penser, c’est accéder à la connaissance de la logique qui commande notre pensée, c’est être capable de mettre au jour les structures qui déterminent ce que nous pensons. C’est là que Hegel va directement s’opposer à Kant, qui avait tenté cette mise au jour des structures de la pensée dans sa fameuse Critique de la raison pure. Chez Kant, les structures déterminantes de la pensée renvoient à la subjectivité finie, aux limites propres à l’esprit humain. On a affaire à des objets que l’on ne connaît qu’à travers le prisme de nos structures de pensée limitées. Chez Hegel (c’est l’un de ses apports majeurs), les structures de notre pensée se déterminent à travers l’histoire humaine, et notre subjectivité finie, avec ses schémas de pensée et ses limites, est le produit d’une histoire qui l’excède largement.
C’est pour cela que Hegel va accorder une importance majeure à l’histoire de la philosophie : celle-ci ne représente pas un simple intérêt érudit pour les doctrines anciennes : elle est l’étude de la genèse et du déploiement de la logique immanente à notre pensée. Autrement dit, l’histoire de la pensée est l’histoire de la provenance de notre pensée à nous, l’histoire de ce qui nourrit et produit la pensée qui nous habite et qui nous détermine.
Dans ses Leçons sur la philosophie de l’histoire, Hegel écrit : « Ce que nous sommes, nous le sommes aussi historiquement […]. Dans ce que nous sommes, l’élément impérissable commun à tous est lié indissolublement à ce que nous sommes historiquement. Le trésor de la raison consciente d’elle-même qui nous appartient, qui appartient à l’époque contemporaine, ne s’est pas produit de manière immédiate, n’est pas sorti du temps présent, mais est essentiellement un héritage. » Autrement dit, nous ne pensons pas ce que nous voulons comme nous le voulons, mais nous sommes déterminés à penser par notre situation historique, c’est-à-dire par l’héritage qui nous précède, qui nous porte et qui nous forme.
Nos Desserts :
- Lire la Phénoménologie de l’Esprit (PDF)
- « Hegel. L’esprit comme vie d’une totalité » dans la revue Archives de Philosophie (2007)
- « Le témoignage de l’esprit chez Hegel » dans la Revue des sciences philosophiques et théologiques (2017)
- « Hegel : les enjeux de l’anthropologie » dans la Revue de métaphysique et de morale (2006)
- « La philosophie de la nature dans l’Encyclopédie de Hegel » dans la revue Archives de Philosophie (2003)
- Série de quatre émissions sur la philosophie de Hegel sur France Culture
- Sur Le Comptoir, lire la 2ème partie de notre étude sur Hegel
---------------------------------------------------------
Système et langage
Dans cette seconde partie, nous approfondissons le sens de la pensée hégélienne à partir de la notion de système, qu’il importe d’éclairer pour entendre ce que signifie le projet de Hegel. Or, le système hégélien ne se laisse pas comprendre sans le mettre en perspective avec l’apport déterminant de Hegel, qui est celui de mettre au centre la question du langage. Forts de ces données, nous pouvons ensuite nous attacher à esquisser une définition des concepts qui composent le titre de l’ouvrage : l’Esprit et la Phénoménologie.
Hegel est le penseur de la « Raison consciente d’elle-même », c’est-à-dire la raison en pleine possession d’elle-même – autrement dit, c’est le pur logos, ou cette Sagesse absolue qu’il appelle Science. Il est donc en même temps le penseur de l’achèvement de l’histoire de la philosophie, ou de l’accomplissement de la philosophie, puisque la philosophie est l’histoire de la quête d’une sagesse qui est à présent atteinte. Quant au système que Hegel présentera dans l’Encyclopédie, ce n’est pas un système parmi d’autres : c’est le système, c’est-à-dire l’armature même de notre pensée enfin devenue consciente et redéployée dans son unité fondamentale. C’est la logique de notre pensée explicitée dans la moindre de ses articulations. Le système, c’est l’ensemble des structures qui déterminent notre pensée, présenté sous la forme d’une totalité cohérente et articulée, puisque, selon les mots de Hegel : « système signifie proprement Totalité et n’est vrai que comme Totalité. »
Un projet systématique
C’est une autre différence avec Kant : Hegel projette de présenter un Système. Cela ne veut pas dire que l’idée de système serait une idée neuve. Hegel est loin d’être le premier philosophe à avoir voulu présenter sa philosophie de manière systématique. L’idée selon laquelle la philosophie doit se présenter sous la forme d’un système remonte à l’Antiquité : ce sont principalement les Stoïciens qui se sont appliqués à présenter leur philosophie sous la forme d’un système en trois parties : la logique, la physique et la morale. Le mot « système », du grec sustêma, est emprunté à la médecine : il désigne un organisme, c’est-à-dire un tout organique composé de différentes parties.
Au Moyen-Âge, c’est certainement le philosophe irlandais Jean Scot Érigène, au IXe siècle, qui portera au plus loin l’exigence de système. Heidegger rappellera que cette exigence de système est à distinguer de la forme traditionnelle des Sommes, la forme propre aux penseurs scolastiques, dont la plus célèbre est la Somme théologique de Thomas d’Aquin. La forme-Somme répond à une exigence de mise en ordre pédagogique, à l’image d’un manuel scolaire. Tandis que chez Jean Scot Érigène, dans l’œuvre maîtresse qu’il rédige aux alentours de l’an 860, le Periphyseon, le système ne répond pas à une exigence extérieure à l’objet du savoir (une exigence d’ordre pratique ou pédagogique), mais il répond à l’articulation interne du savoir – à la manière dont s’agencent les objets du savoir en eux-mêmes, dans l’ordre du réel lui-même. L’articulation du système doit refléter l’agencement de l’Être en lui-même.
C’est dans cette optique que les Stoïciens ordonnèrent leur système, et c’est dans cette optique que Hegel tient à l’exigence du système pour sa propre philosophie. La vieille division stoïcienne va longtemps tomber dans l’oubli, et elle ne sera remise au jour qu’au XVIIIe siècle, par Kant. En effet, si la philosophie de Kant n’est pas un système à proprement parler, il la présente tout de même sous la forme de trois ouvrages majeurs : La Critique de la raison pure (1781, remaniée en 1787) ; La Critique de la raison pratique (1788) ; et la Critique de la faculté de juger (1790). La Critique de la raison pure porte sur la raison théorique, donc sur le savoir : c’est une pensée dirigée vers l’objet de la connaissance, la manière dont il nous apparaît et ne nous apparaît pas (et la manière dont l’objet de la métaphysique nous demeure insaisissable). La seconde Critique, quant à elle, s’occupe de l’action, de la pratique : sa question centrale est celle du Sujet lui-même et de son comportement vis-à-vis de la Loi morale. Enfin, la troisième Critique ne s’occupe ni de l’objet du savoir ni du sujet de l’action : elle s’occupe de la façon dont l’un passe dans l’autre, de la façon dont les deux termes se rapportent l’un à l’autre, et comment cette relation entre le sujet et l’objet se déploie dans les domaines de l’art et de la vie.
Il y a donc une tripartition de la philosophie chez Kant, mais ce qui intéresse Kant, ce n’est pas vraiment l’objet du savoir, c’est notre savoir de l’objet ; ce n’est non plus la Loi morale en elle-même, c’est notre rapport à la Loi morale ; et ce n’est pas l’œuvre d’art ou la vie en soi, c’est notre façon de nous y rapporter, à travers ce qu’il appelle le « jugement » (esthétique et téléologique). Donc, finalement, ce qui intéresse Kant, c’est le sujet conscient, le sujet réflexif, sa manière de savoir, d’agir et de juger. Hegel va reprendre cette idée d’une tripartition, mais sous la forme d’un système qui accède aux réalités sans s’en tenir exclusivement à cette dimension de réflexion du sujet sur lui-même.
Ce qui préoccupe Hegel, c’est de faire une philosophie qui surmonte la coupure entre le sujet conscient (qui pense et qui réfléchit) et l’objet pensé – coupure qui, chez Kant, se traduit dans la rupture radicale entre l’objet en soi, le « noumène », qui nous demeure inaccessible en tant que tel, et l’objet tel que nous le connaissons à travers les limites de notre esprit, à travers le prisme de notre pensée, le « phénomène ». Hegel cherche à fonder une philosophie qui ne soit pas seulement une philosophie de l’Objet (ce qui correspondrait à une philosophie de la Nature) ni simplement une philosophie du Sujet (ce qu’on appelait alors une « philosophie de l’Esprit »). Il s’agit de fonder une philosophie qui englobe le Sujet et l’Objet, qui surmonte leur contradiction, et qui les réunit sous le principe d’Identité. Il y aura donc une philosophie de la nature et une philosophie de l’esprit, mais le coup de génie de Hegel sera de reconnaître que l’identité entre sujet et objet se trouve avant tout dans le langage. C’est le langage qui va apparaître comme le lieu où sujet et objet s’identifient, s’égalisent et, d’une certaine façon, passent l’un dans l’autre.
« Ce qui intéresse Kant, c’est le sujet conscient, le sujet réflexif, sa manière de savoir, d’agir et de juger. »
Un apport majeur de Hegel : la centralité du thème du langage
En effet, qu’est-ce que parler ? C’est, d’une part, pour un sujet, s’exprimer, donc s’extérioriser, donc s’objectiver d’une certaine manière. Si je parle, je présente ce que je pense au monde, donc j’objective la pensée qui me constitue comme sujet. Et si le langage est une extériorisation du sujet, il est en même temps une intériorisation de l’objet. Car, d’autre part, quand je parle de quelque chose, quand je fais entrer une chose dans mon langage, cette chose cesse d’être une réalité matérielle située dans un espace-temps bien précis : elle se trouve ramenée au plan d’une idée, donc réduite à son essence. Donc parler, c’est objectiver le sujet et subjectiver l’objet ; le langage est le lieu où sujet et objet passent l’un dans l’autre, c’est le lieu où ils échangent leurs déterminations. Et ce que découvre Hegel, c’est que pour être une véritable philosophie de l’identité entre sujet et objet, la philosophie doit être une philosophie du langage, donc une logique (étymologiquement, logos signifie avant tout « parole », comme dans le verset qui introduit l’Évangile de Jean : « Au commencement était le Logos », qu’on traduit par « Au commencement était le Verbe, la Parole »).
En effet : qu’est-ce que la logique ? C’est du langage sur du langage ; c’est le langage parlant de lui-même ; c’est le langage qui déploie son architecture ; c’est le langage qui explicite les catégories fondamentales que nous retrouvons dans chacun de nos énoncés. C’est pour cette raison que la logique va apparaître comme la philosophie « absolue », la philosophie à l’état le plus chimiquement pur. Si l’on prend la philosophie de la nature ou la philosophie de l’esprit, il y a du langage, certes, il y a un langage qui se déploie, mais qui parle d’autre chose que de lui-même, alors que dans la logique, le langage ne parle que de lui-même, et c’est ainsi que la logique est comprise comme Savoir absolu, ou plus exactement : le savoir de l’absolu se sachant lui-même.
« Ce qui préoccupe Hegel, c’est de faire une philosophie qui surmonte la coupure entre le sujet conscient (qui pense et qui réfléchit) et l’objet pensé. »
Hegel revient en quelque sorte à la tripartition des Stoïciens, au système tel qu’il était apparu dans l’Antiquité, et qui comportait une logique, une physique (c’est-à-dire une philosophie de la nature) et une morale (la philosophie de l’esprit de Hegel correspondra à une philosophie du droit, de la moralité et des mœurs). On assiste donc, dans le dernier système de l’histoire occidentale, à un retour au premier système : le système stoïcien, avec la même tripartition. Cette tripartition correspond également à celle des universités de l’époque, où l’on trouvait trois grandes facultés : celle de Médecine, celle de Droit, et celle de Théologie. Chez Hegel, la théologie, c’est la logique, puisque comme il le dira lui-même : « La logique doit être saisie comme le système de la raison pure, comme le royaume de la pensée pure. Ce royaume est la vérité elle-même, telle qu’elle est sans voile en et pour soi ; pour cette raison, on peut dire : ce contenu est la présentation de Dieu tel qu’il est dans son essence éternelle, avant la création de la nature et d’un esprit fini ». Autrement dit, la logique, c’est la pensée de Dieu lui-même avant la création du monde. C’est le langage, le logos, tel qu’il se parle à lui-même et en lui-même.
Après ces remarques d’ordre général, il est peut-être temps de dire quelques mots sur le titre de l’ouvrage, Phénoménologie de l’Esprit, en commençant par la fin : l’Esprit.
Qu’est-ce que l’Esprit ?
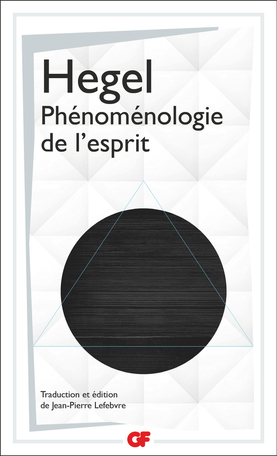 Le mot « Esprit » (Geist), Hegel ne le définit jamais clairement – on est censé comprendre spontanément de quoi il s’agit. Pour en dire quelques mots, le concept d’Esprit s’oppose à celui d’Être ou de Substance en tant que ces derniers renvoient à une identité immuable, à quelque chose d’unifié et de strictement déterminé par l’objet dont ils représentent le substrat (l’être de telle chose, la substance de tel objet), tandis que l’Esprit renvoie à une existence spirituelle agissante, toujours en mouvement, et identifiée à une activité entièrement libre, c’est-à-dire une activité spirituelle auto-déterminée. L’Être est déterminé, tandis l’Esprit se détermine librement lui-même et, en cela, l’Esprit est par excellence un Sujet. Il faut ajouter que l’Esprit réunit en lui à la fois l’universalité et la singularité. L’Esprit est englobant, c’est un tout, et en ce sens il est universel ; mais en même temps, il se détermine librement, il est un sujet conscient de soi, et en ce sens il est singulier.
Le mot « Esprit » (Geist), Hegel ne le définit jamais clairement – on est censé comprendre spontanément de quoi il s’agit. Pour en dire quelques mots, le concept d’Esprit s’oppose à celui d’Être ou de Substance en tant que ces derniers renvoient à une identité immuable, à quelque chose d’unifié et de strictement déterminé par l’objet dont ils représentent le substrat (l’être de telle chose, la substance de tel objet), tandis que l’Esprit renvoie à une existence spirituelle agissante, toujours en mouvement, et identifiée à une activité entièrement libre, c’est-à-dire une activité spirituelle auto-déterminée. L’Être est déterminé, tandis l’Esprit se détermine librement lui-même et, en cela, l’Esprit est par excellence un Sujet. Il faut ajouter que l’Esprit réunit en lui à la fois l’universalité et la singularité. L’Esprit est englobant, c’est un tout, et en ce sens il est universel ; mais en même temps, il se détermine librement, il est un sujet conscient de soi, et en ce sens il est singulier.
Dans la Phénoménologie de l’Esprit, il faut entendre l’Esprit comme une communauté d’esprits – comme on parle de « l’esprit » d’une communauté ou d’un peuple. C’est le modèle de la cité grecque que Hegel convoque ici, bien éloigné de l’individualisme moderne qui représente au contraire une atomisation de l’Esprit.
Cette caractérisation de l’Esprit comme esprit d’une collectivité socio-politique provient du chapitre VI de la Phénoménologie de l’Esprit, intitulé « L’esprit », mais peut-être que, déjà dans cet ouvrage, l’Esprit ne se réduit pas à cette définition. Il semble que, plus largement, au long du livre, la notion d’Esprit renvoie au sujet en formation, c’est-à-dire au thème central de l’ouvrage tel que Hegel l’explicite : « L’esprit conscient de lui-même […] dans sa formation à la culture. »
Mais il ne faut pas perdre de vue que l’Esprit désigne moins un individu qu’une forme générale qui se réalise en s’incarnant dans des figures plus particulières, et jusque dans les individus. Si l’Esprit n’existe pas en dehors des figures concrètes dans lesquelles il s’incarne, il ne se réduit pourtant à aucune d’entre elles. Il y a un cheminement de l’Esprit vers le savoir, vers la science : l’Esprit passe d’une figure à l’autre sans jamais se perdre. Il peut s’altérer et changer entièrement de contenu, mais il ne se dissout jamais dans telle ou telle incarnation particulière – l’Esprit ne fait que séjourner dans des figures particulières, sans jamais perdre de vue sa réalisation pleine et entière qui est l’horizon ultime de son cheminement.
On peut dire, pour résumer, que l’Esprit tel que l’appréhende la Phénoménologie de l’Esprit (ce sera un peu différent dans l’Encyclopédie), cet « Esprit » signifie la « conscience » et plus particulièrement la « conscience de soi ». C’est une conscience accédant à soi-même en passant par des figures autres, par de l’altérité. Dans la Préface, Hegel affirme que le mouvement de l’Esprit vers le Savoir – ce qui revient au mouvement de l’Esprit vers la pleine possession de soi – consiste en « la connaissance de soi dans l’être-autre ». L’Esprit est une forme subjective qui a affaire à un contenu objectif – c’est une relation de sujet à objet ; « la connaissance de soi dans l’être-autre », cela signifie que, d’un côté, l’Esprit assimile le contenu objectif auquel il a affaire, il plie ce contenu objectif à sa propre forme, c’est-à-dire qu’il se reconnaît lui-même, il reconnaît sa propre subjectivité dans l’objet (comme chez Kant, où l’objet renvoie aux structures de notre esprit) ; et d’un autre côté, en l’assimilant ainsi à lui-même, l’Esprit doit en passer par ce contenu extérieur et objectif, l’Esprit s’extériorise dans ce contenu, il s’aliène dans cette objectivité. Ce passage du sujet dans l’objet est en même ce qui donne à l’Esprit une réalité objective, un contenu concret. Sans quoi l’Esprit resterait une abstraction pure, un peu comme la forme reste abstraite si elle ne se concrétise pas dans une matière (selon l’hylémorphisme d’Aristote).
« Chez Hegel, la théologie, c’est la logique. »
Le but de l’Esprit, c’est de se saisir lui-même, de se saisir en tant qu’Esprit. Au départ, l’Esprit n’est Esprit que pour nous, qui philosophons, et qui le contemplons ainsi comme quelque chose d’extérieur, un concept, une idée, mais quelque chose qui n’est pas nous. C’est le point de départ. Mais le point d’arrivée, c’est que l’Esprit se prend lui-même comme son propre objet et se connaît lui-même adéquatement. Il en vient ainsi à connaître sa propre essence, y compris à travers nous, au point où nous participons nous-mêmes à cette prise de conscience progressive de l’Esprit. Au départ, l’Esprit ne connaît que des êtres objectifs, des objets, auxquels il s’oppose, lui qui est pure subjectivité. Mais au fur et à mesure de son activité subjective, au fur et à mesure que s’accroît sa connaissance de lui-même, qui passe par cette confrontation à « l’être-autre » des objets auxquels il a affaire, il accomplit son chemin vers la pure connaissance de soi. À la fin, l’Esprit devient le pur philosophe, le philosophe idéal, c’est-à-dire qu’il devient la pleine sagesse dont la philosophie est la quête : Hegel écrit qu’il devient « le savoir du spirituel et le savoir de lui-même comme esprit ».
Comment l’Esprit passe-t-il d’une figure à l’autre au cours de son cheminement ? C’est que chaque passage est à analyser comme la transition d’une figure encore inadéquate à une figure plus adéquate : la figure suivante doit remédier à l’inadéquation de la figure précédente. À chaque étape de son parcours, l’Esprit se heurte au caractère unilatéral, limité, de la figure dans laquelle il séjourne : chaque figure est limitée en ce qu’elle révèle une nature partielle ou incomplète, elle représente un aspect de la réalité qui exclut d’autres pans de la réalité. Or, le mouvement de l’Esprit est tout entier tendu vers l’universel, c’est seulement dans l’accès à l’universel que l’Esprit atteint la pleine unité à soi. Il est donc amené à dépasser ou à transgresser la figure dans laquelle il s’incarne momentanément, pour aller vers une figure plus complète, vers une réalité plus englobante. Ce que Hegel appelle « la formation » de l’Esprit, la Bildung, c’est ce chemin sur lequel l’Esprit avance en abandonnant les étapes précédentes.
La phénoménologie
Venons-en à présent au mot de « phénoménologie ». Il faut le distinguer de ce qu’on entend aujourd’hui par « phénoménologie », quand on pense à Husserl et à ses successeurs (Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, etc.). Et s’il faut oublier Husserl pour comprendre la phénoménologie selon Hegel, il faut également garder en tête que ce n’est pas Hegel qui invente ce concept. Le mot « phénoménologie » apparaît en 1764 sous la plume d’un philosophe allemand assez oublié, un certain Johann Heinrich Lambert, qui concevait l’idée d’une science des phénomènes, ou une science des apparences, qu’il appelait encore une « optique transcendantale », dont le but aurait été de montrer comment on peut distinguer le vrai de ce qui n’est qu’apparent. La phénoménologie, chez Lambert, c’est le projet d’une science des illusions à partir de laquelle on pourrait corriger la conscience pour lui permettre d’atteindre la vérité.
Parmi les amis de Lambert, un certain Emmanuel Kant se trouve tout à fait séduit par ce terme de « phénoménologie », au point qu’en 1770, il rédige un ouvrage majeur qu’il souhaite alors intituler « Phénoménologie de l’Esprit ». Finalement, cet ouvrage paraîtra onze ans plus tard sous le titre de Critique de la raison pure. Dans une lettre qu’il adresse à Lambert, Kant explique que sa « phénoménologie » serait la science qui précède la métaphysique, par son rôle purement correctif ou, pour employer le mot de Kant, son rôle « préservatif » : c’est-à-dire que la phénoménologie sert à préserver la raison des incursions illusoires de la sensibilité. C’est donc une propédeutique, une introduction au véritable savoir, à la véritable métaphysique, et non une véritable métaphysique.
« La phénoménologie, chez Lambert, c’est le projet d’une science des illusions à partir de laquelle on pourrait corriger la conscience pour lui permettre d’atteindre la vérité. »
Hegel assigne un rôle similaire à sa « phénoménologie » puisque celle-ci n’est pas encore la véritable Science : elle n’est qu’une propédeutique. Elle est destinée à servir de prologue au Système de la science, mais un prologue dont le rôle est tout à fait décisif. Si la Phénoménologie ne fait pas partie du Système en tant que telle, et si, dans le même sens, elle ne présente pas la vérité du Système, c’est parce que, dans la veine de la tradition qui remonte à Lambert, elle consiste plutôt une en une science des illusions perdues, qui doit introduire au système du savoir proprement dit.
Nos Desserts :
- Lire la Phénoménologie de l’Esprit (PDF)
- « Hegel. L’esprit comme vie d’une totalité » dans la revue Archives de Philosophie (2007)
- « Le témoignage de l’esprit chez Hegel » dans la Revue des sciences philosophiques et théologiques (2017)
- « Hegel : les enjeux de l’anthropologie » dans la Revue de métaphysique et de morale (2006)
- « La philosophie de la nature dans l’Encyclopédie de Hegel » dans la revue Archives de Philosophie (2003)
- Série de quatre émissions sur la philosophie de Hegel sur France Culture
- Sur Le Comptoir, lire la 1ère partie de notre étude sur Hegel
----------------------------------
De la conscience naïve à la conscience philosophique
Dans cette troisième et dernière partie, nous abordons la question centrale de la « Phénoménologie de l’Esprit », qui est celle du développement de la Conscience : depuis son état le plus naïf, le plus immédiat, jusqu’à son état le plus avancé, qui est celui de la philosophie. À la question de la conscience est corrélée, comme nous l’avons vu, la question du langage : nous abordons ainsi la question du langage propre à la philosophie, dans sa différence avec le langage ordinaire de la conscience non-philosophique.
Dans le paragraphe 36 de la première édition de l’Encyclopédie, Hegel présente la Phénoménologie de l’Esprit comme « l’histoire scientifique de la conscience ». La Phénoménologie est une histoire scientifique, une analyse de la conscience qui accède elle-même à la science. La « science », pour Hegel, c’est le nouveau nom de la philosophie, c’est la philosophie une fois qu’elle accède au savoir dont elle était en quête. Hegel indique, dans la préface, qu’il souhaite que la philosophie délaisse son statut de quête permanente – la philosophie comme « amour et recherche du savoir » – pour devenir science effective. Ainsi la Phénoménologie raconte les différentes étapes du processus par lequel l’Esprit se forme et s’élève depuis la conscience la plus naïve jusqu’à atteindre le « savoir absolu ».
Une histoire de la conscience
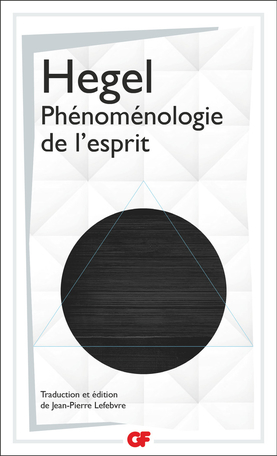 La conscience naïve prend ce qui est donné immédiatement à l’expérience comme ce qui ce qui est le vrai. Ici, il y a une salle de classe ; maintenant, il est 11 heures du matin. Cette connaissance immédiate laisse croire que ces données se suffisent à elles-mêmes : la vérité du monde se résume à cette salle de classe et à ces onze heures du matin. Un pas supplémentaire consiste à dire : ici, je me trouve dans une salle de classe, et maintenant, il est pour moi onze heures du matin, parce que je me trouve dans le fuseau horaire de Paris, tandis qu’il est actuellement trois heures à Mexico City. Il y a donc un moi, une expérience singulière qui entre en compte dans cet « ici et maintenant » (hic et nunc) que je pourrais prendre naïvement pour une vérité absolue. Ce « je » intervient aussi parce que je parle, parce que j’ai conscience de moi à travers cette expérience de la salle de classe et du fuseau horaire, qui sont des données objectives, des objets, des « êtres-autres », et dont je peux dire, en me les appropriant : « c’est mon expérience ». Voilà un exemple de progrès de la conscience vers le savoir, dans les balbutiements de sa formation.
La conscience naïve prend ce qui est donné immédiatement à l’expérience comme ce qui ce qui est le vrai. Ici, il y a une salle de classe ; maintenant, il est 11 heures du matin. Cette connaissance immédiate laisse croire que ces données se suffisent à elles-mêmes : la vérité du monde se résume à cette salle de classe et à ces onze heures du matin. Un pas supplémentaire consiste à dire : ici, je me trouve dans une salle de classe, et maintenant, il est pour moi onze heures du matin, parce que je me trouve dans le fuseau horaire de Paris, tandis qu’il est actuellement trois heures à Mexico City. Il y a donc un moi, une expérience singulière qui entre en compte dans cet « ici et maintenant » (hic et nunc) que je pourrais prendre naïvement pour une vérité absolue. Ce « je » intervient aussi parce que je parle, parce que j’ai conscience de moi à travers cette expérience de la salle de classe et du fuseau horaire, qui sont des données objectives, des objets, des « êtres-autres », et dont je peux dire, en me les appropriant : « c’est mon expérience ». Voilà un exemple de progrès de la conscience vers le savoir, dans les balbutiements de sa formation.
La Phénoménologie est le premier ouvrage philosophique qui ne présente pas des affirmations sur ce qui est (ce qu’est Dieu, ce qu’est le monde, ce qu’est l’âme), mais qui prétend décrire la manière dont ce qui est se présente à notre conscience. Notre conscience accède au savoir à travers notre expérience du monde, et c’est un savoir qui se transforme en suivant une logique sur laquelle notre conscience individuelle n’a pas la maîtrise. C’est que, pour Hegel, dès notre naissance, dès que nous posons notre premier regard sur le monde, nous sommes embarqués dans le savoir – et ce fait d’être jetés dans le savoir nous assigne à une tâche qui nous dépasse, à un travail de la conscience, qui vaut pour chacun d’entre nous et pour l’humanité entière, et qui consiste à amener ce savoir, d’abord intime, complètement intérieur, jusqu’à sa formation ultime, qui est un savoir universel.
Là où Kant semble examiner du dehors ce qu’est le savoir : jusqu’où va le savoir, sur quoi porte le savoir, etc., Hegel, au contraire, analyse le parcours d’une conscience jetée dans le savoir sous tous ses aspects : la sensation, la perception, l’entendement, la raison, la moralité, la religion, etc. Hegel cherche à voir comment cette conscience parcourt tous les étages du savoir jusqu’au sommet, jusqu’à un point d’arrêt que Hegel désigne par l’expression plus ou moins énigmatique de « Savoir absolu ».
Là où la conscience naïve dit : « Le vrai, c’est une salle de classe à 11 heures du matin », c’est-à-dire là où la conscience prend son expérience de l’ici et du maintenant pour le tout de la vérité, la conscience qui a atteint le Savoir absolu dira : « Le vrai, c’est la connaissance rationnelle du devenir de l’Esprit depuis la conscience naïve jusqu’au Savoir absolu ». Autrement dit, l’histoire de la conscience est celle du passage de la conscience naïve à la conscience lucide, cette conscience qui est en mesure de se vérifier elle-même en convoquant la mémoire du chemin parcouru, la conscience accédant à la logique qui la détermine, c’est-à-dire la conscience consciente de son histoire.
Il y a donc une nécessité de temps, de maturation : on ne saute pas les étapes – chacune d’entre elle est nécessaire au parcours. Voici un passage du dernier chapitre où il est question du Savoir absolu :
« La science n’apparaît pas dans le temps et la réalité effective avant que l’Esprit ne soit parvenu à cette conscience au sujet de lui-même En tant qu’il est l’Esprit qui sait ce qu’il est, il n’existe pas plus tôt ni nulle part ailleurs qu’après que [et là où] il a achevé le travail consistant, pour lui, à assujettir sa configuration imparfaite, à se procurer, pour sa conscience, la figure de son essence, et de cette manière à égaliser sa conscience de soi avec sa conscience. »
En quelque sorte, dans cet extrait, tout est dit. L’Esprit n’advient pas instantanément, comme par un coup de pistolet. Il doit passer par un certain nombre d’étapes et séjourner en chacune d’elle. D’autre part, cette formation de l’Esprit ne peut être effectuée que par l’Esprit lui-même : aucune instance tierce – aucun dieu, aucun philosophe, aucune autorité politique – ne peut la provoquer de l’extérieur : elle ne peut être qu’une auto-formation, une auto-détermination. Enfin, la Science – c’est-à-dire le savoir – fait partie de l’expérience. Elle n’est pas en surplomb, et ne s’acquiert pas à n’importe quel moment : l’Esprit ne peut pas prétendre à un savoir portant sur une expérience qu’il n’a pas eu le temps de s’approprier en lui-même et par lui-même. Au contraire, la Science ne se trouve qu’au terme du chemin : c’est pourquoi l’un des concepts-clés de la pensée hégélienne est celui de « travail », qui connote à la fois un effort et un processus de production.
« Notre conscience accède au savoir à travers notre expérience du monde. »
Il faut comprendre que le travail dont il s’agit ne renvoie pas à la production d’un objet particulier, mais il signifie le processus d’accès à la Science. C’est la connaissance de soi que vise le travail de l’Esprit. Il faut entendre la manière étonnante dont Hegel caractérise la « science ». On a l’habitude d’entendre par « science » le fait d’acquérir des connaissances sur le monde. Pour Hegel, ce n’est pas exactement cela, c’est d’abord l’accès à une parfaite conscience de soi, grâce à une ressaisie globale et adéquate à soi des états de conscience qui, avant d’atteindre ce stade, demeuraient encore partiels et inadéquats. Le travail de l’accès à la Science est un processus d’égalisation (ou d’identification) entre la conscience de l’objet et la conscience de soi : le sujet va se prendre lui-même comme objet de son savoir, et il réalise ainsi une identification qui surmonte la vieille dichotomie métaphysique du sujet et de l’objet. C’est cette recherche d’identité qui résume le principe du parcours phénoménologique : accéder à la complétude, à l’unité du savoir, en surmontant la division entre le rapport à soi (le même) et le rapport à l’objet (l’autre).
C’est que, comme on l’évoquait en parlant d’unification entre la Conscience et la Science, Hegel part du principe qu’il y a un écart : il y a un décalage, au départ, entre ces deux éléments : la Conscience ne se trouve pas dans l’élément de la Science et vice-versa. Autrement dit, la Conscience est dans l’obscurité, dans l’ignorance, et la Science se tient à l’extérieur, dans les objets du savoir qu’il reste à connaître. Cet écart, ce décalage entre Science et Conscience est un problème philosophique majeur, et c’est ce problème qui exige d’en passer par cette sorte de long prologue qu’est la Phénoménologie, ce prélude au Système de la Science. Le travail dont il est question, et dont la Phénoménologie retrace l’histoire, c’est l’effort préalable et nécessaire pour amener le Sujet jusqu’au point de vue à partir duquel il pourra devenir réceptif à la pure vérité de la Science.
Conscience ordinaire et conscience philosophique
Il faut encore lever un malentendu. Quand nous parlons de conscience, nous pensons spontanément à un sujet conscient faisant face à un objet extérieur. Cet objet peut être un objet de connaissance ou un objet de désir. Donc le concept de Conscience voudrait dire : être un sujet faisant face à un objet et, en quelque sorte, être un sujet qui s’appuie sur cet objet, un sujet fondé sur cet objet. Car l’objet, c’est avant tout ce qui s’oppose au sujet, c’est ce qui lui fait obstacle, mais c’est aussi ce sur quoi le sujet s’appuie, ce sur quoi il fonde la certitude de sa propre réalité, et qui le préserve ainsi du vertige métaphysique du néant.
Or, dans la logique propre à la philosophie, la conscience signifie tout autre chose. La conscience au sens philosophique, à la différence de la conscience au sens ordinaire, est une conscience qui n’a ni dedans ni dehors, qui n’a ni extériorité ni intériorité. Si l’on admet, avec Hegel, que l’objet de la philosophie, c’est le savoir lui-même, et que, réciproquement, l’objet du savoir, c’est la philosophie, alors il devient impossible de maintenir une distinction entre sujet et objet. Dans le savoir, dans la philosophie, dans le langage du Logos, il n’y a plus rien qui fasse obstacle, il n’y a plus rien qui se tiendrait en face : il n’y a plus d’objet qui s’oppose, puisque, rappelons-le, le sens étymologique de l’objet, l’objetum, c’est ce qui s’oppose, ce qui est posé devant moi à la manière d’un obstacle, ce qui n’est pas moi. Et du fait qu’il n’y a plus d’objet, il n’y a plus non plus de sujet : le sujet disparaît en même temps que l’objet, puisque le sujet se définit lui-même en se reconnaissant comme l’autre du monde objectif qui l’entoure, comme un « je » qui ne serait pas un objet. Avec l’irruption de la philosophie survient une déstabilisation radicale, nos schémas d’entendement se trouvent gravement mis en cause, et notre tendance serait de continuer à nous raccrocher désespérément à un objet, quel qu’il soit.
C’est une mise en cause qui a lieu depuis la naissance de la philosophie. Prenons un exemple célèbre issu de l’Hippias majeur de Platon. Socrate demande au sophiste Hippias : « Qu’est-ce que le beau ? », et Hippias lui répond spontanément : « Le beau, c’est une belle jeune fille, ou bien un beau vase… » Mais Socrate ne cherche pas à savoir ce qui est beau, il ne cherche pas à savoir quels objets sont beaux : il veut savoir ce qu’est le beau en lui-même. Hippias se fait ici le porte-voix de la conscience commune, il est incapable de penser une essence sans se raccrocher à des objets : il est incapable de penser une beauté qui ne serait pas la beauté d’une chose, qui ne serait la beauté de rien ni de personne, une beauté sans objet, le beau considéré en lui-même. L’incompréhension d’Hippias est celle de la conscience commune devant la conscience philosophique. Il n’est pas facile de comprendre ce que font les philosophes quand ils prennent des termes généraux – en l’occurrence le beau, mais ce pourrait être aussi l’Un, l’Être, le Bien… – et qu’ils interrogent ces termes sans les rattacher à aucun référent objectif.
« C’est la connaissance de soi que vise le travail de l’Esprit. »
En cela, la philosophie est une expérience de retournement : au lieu d’appliquer telle ou telle catégorie à des choses, le philosophe se demande ce que signifie cette catégorie en elle-même. La catégorie est ainsi suspendue, et cela, au premier abord, ne peut susciter qu’étonnement et incompréhension. Ce retournement, ce passage du point de vue de la conscience commune à la conscience philosophique, Hegel le situe d’abord dans le langage, en tant que le langage est l’élément premier de la philosophie, l’élément du savoir. Il s’agit de passer d’un langage ordinaire, prédicatif, c’est-à-dire un langage dont la logique repose sur l’idée d’un sujet parlant d’un objet distinct, à un langage proprement philosophique, où le sujet parlant se retrouverait lui-même dans son énoncé : un langage spéculatif (au sens où les propositions reflètent le sujet parlant, le contiennent, un langage où le sujet est donc en même temps celui qui parle et celui qui est parlé).
Le langage propre de la philosophie : la proposition spéculative
Donnons un exemple de langage ordinaire, prédicatif : « Cette feuille est blanche. » Il y a trois instances : le sujet « feuille » est un sujet grammatical auquel j’attribue le prédicat « blanche » ; en lui attribuant ce prédicat, et en formulant cette proposition, je suis le sujet parlant, je suis celui qui fait le lien entre « cette feuille » et la couleur « blanche ». Mon être de sujet parlant apparaît dans la copule « est », qui fait le lien entre le sujet « feuille » (qui est un objet, pour moi), et le prédicat « blanc » (que je lui attribue).
En appliquant ce langage prédicatif à une proposition philosophique, cela peut donner : « Le réel est rationnel ». Le sujet « réel » est un sujet grammatical auquel j’attribue le prédicat « rationnel » ; en formulant cette proposition, c’est moi, le sujet parlant, qui établit un lien entre le « réel », que je prends comme objet, et la qualité d’être « rationnel », que je lui attribue comme un prédicat.
Dans les deux cas, la proposition ne donne pas d’information sur l’essence de l’objet – elle ne répond pas à la question philosophique de Socrate, la question qui est à l’origine de la philosophie : « Qu’est-ce que ? » En grec : « ti esti ? » La proposition « la feuille est blanche » tient tout entière de ma propre capacité à percevoir et à faire le lien entre l’objet feuille et la couleur blanche. Mais le prédicat « blanc » ne fait pas partie de l’essence de la feuille en général – celle-ci pourrait tout aussi bien être rose, jaune, mauve, elle n’en demeurerait pas moins « feuille ». C’est donc à la perception d’un sujet extérieur, à la perception d’un tiers, que renvoie en ultime instance la valeur de cette proposition. De la même façon, quand je dis : « le réel est rationnel », j’applique au réel un prédicat qui ne le constitue pas en son essence. Du moins, la proposition fonctionne comme pour celle de la feuille blanche, comme si le réel était une chose en soi, indépendante, à laquelle j’attribue le prédicat de la rationalité, sans que ce prédicat lui soit essentiel. « Le réel est rationnel » dans une circonstance, et pourrait ne pas l’être dans une autre ; cela dépend de ce que le sujet parlant perçoit du réel.
« La philosophie est une expérience de retournement. »
Or, depuis ses commencements avec Socrate et Platon, la philosophie recherche l’essence, et il lui faut un langage à la hauteur de cette recherche. C’est là qu’intervient la proposition spéculative.
Dans la Philosophie du droit (1821), Hegel écrit la célèbre formule : « Ce qui est réel est rationnel, et ce qui est rationnel est réel. » Ici, on a affaire à une sorte de phrase-miroir, dont les deux propositions se reflètent l’une l’autre. Le sujet parlant s’efface au profit d’un signe d’égalité parfaite : réel = rationnel / rationnel = réel. Cela ne dépend pas d’un contexte ou d’une perception du locuteur : cela est ainsi. C’est la nature du réel que d’être rationnel et c’est la nature du rationnel que d’être réel. Rappelons que dans le mot « spéculatif », il y a l’idée du speculum, c’est-à-dire le miroir en latin. La proposition spéculative est censée refléter l’essence de la chose dont on parle. Autrement dit, la proposition spéculative exprime l’identité de ce dont il est question.
Autre exemple : « Dieu est un ». C’est une proposition prédicative : j’attribue au sujet « Dieu » le prédicat « un ». Cela veut dire que le fait d’être « un » est incident ; c’est moi qui définis Dieu ainsi, mais Dieu aurait pu être deux, ou trois. Qu’il soit « un » serait contingent, et non consubstantiel à son essence. C’est moi qui fais le lien entre Dieu (le sujet de ma proposition), et la qualité d’être « un » (le prédicat).
« Dieu est l’Un » : ici, il faut lire la proposition comme une proposition spéculative : Dieu = sujet / l’Un = sujet / « est » = exprime une identité, une égalité parfaite. Ce n’est pas un sujet tiers qui intervient pour faire le lien entre le sujet de la proposition et un prédicat, c’est le sujet Dieu qui se reflète dans le sujet l’Un (la proposition est réversible, et peut se réduire à Dieu = Un / Un = Dieu). Tout, dans cette proposition, renvoie au sujet Dieu ou l’Un, comme s’il se présentait lui-même à travers le langage.
Dernier exemple : « L’être est le néant ». C’est une proposition spéculative. Il ne s’agit pas d’attribuer le néant à l’être, comme un prédicat qu’on attribuerait à un objet : c’est l’être lui-même qui se présente dans cette proposition.
Si, comme chez Heidegger, l’Être se comprend par différenciation d’avec les « étants » particuliers (avec ce qui est), alors il n’est pas un étant, il n’est rien d’étant : il est, par définition, le non-étant, le non-ens. « L’être est le néant », c’est l’être qui se pose tel qu’il est, et ma propre réflexion, ma propre parole n’a rien à y changer ni à intervenir.
Pour résumer, dans le langage spéculatif, c’est la vérité ou le concept qui se déploie de lui-même, sans qu’un sujet particulier ait à intervenir. C’est le langage propre de la philosophie, comprise comme le mouvement de la pensée qui se pense elle-même, et c’est un langage qui exclut le sujet empirique, le sujet kantien, qui ne pense que dans les limites de sa subjectivité finie. Si la pensée pense à travers moi, quand je philosophe, ce n’est pas moi qui interviens dans la formulation des concepts : mon moi individuel – capable de faire des liens et de dire des choses sous la forme du langage prédicatif – s’efface au profit du langage spéculatif où la chose se présente d’elle-même, sous l’égide du libre déploiement de la logique conceptuelle de l’identité.
Mais si le moi est exclu de ce langage, il est toujours tenté d’y revenir. Je reviens, mon ego revient, parce que je reste libre d’intervenir sur ces propositions spéculatives. Je les commente, je prends de la liberté sur ce qu’elles disent, je les interprète, je leur donne une coloration personnelle, je « raisonne » à leur propos en me croyant très intelligent. Hegel appelle cela « ratiociner », et il nous en met en garde :
« Ratiociner, c’est prendre de la liberté à l’égard du contenu [de la proposition spéculative], et la vanité de se croire au-dessus de lui ; ce qu’elle requiert, c’est l’effort intense de renoncer à cette liberté, et qui, au lieu d’être le principe qui en déplace arbitrairement le contenu, et le noie dans cette liberté, consiste à le laisser se déplacer par sa propre nature, c’est-à-dire par lui-même, dans son mouvement propre, et à contempler ce mouvement. S’abstenir d’interférer avec des incursions personnelles dans le rythme immanent des concepts, ne pas s’immiscer en lui à partir de son propre arbitre ou d’une quelconque sagesse acquise de quelque autre manière : cette retenue est, en elle-même, un moment essentiel de l’attention due au concept. »
La proposition spéculative, c’est l’idée d’un langage en phase avec la signification impersonnelle de la philosophie. Je dois m’oublier pour séjourner dans le rythme de la chose même. C’est l’attitude que Hegel impose au philosophe : une attitude de retenue, d’abstention, d’inactivité. Mais une inactivité qui n’est pas rien. Si je ne dois pas intervenir dans le déploiement immanent du discours conceptuel, mon être est cependant nécessaire à la production du sens, du moins en partie, en ce que le concept lui-même va se servir de mon « être-autre », de mon Moi comme d’une altérité, comme d’un obstacle à franchir vers une vérité plus englobante. Pour comprendre cela, il reste à lire le livre lui-même.
Concluons très rapidement. Si l’on veut résumer la Phénoménologie de l’esprit en une formule, il s’agit de rendre compte philosophiquement de la vérité du savoir philosophique. C’est-à-dire qu’il s’agit de fonder la légitimité du savoir philosophique, par rapport aux autres formes du savoir, ces formes dont la Phénoménologie montrent qu’elles jalonnent le parcours de l’Esprit, en ce qu’elles précèdent et préparent l’accomplissement du savoir philosophique qui est le Savoir absolu.
Nos Desserts :
- Lire la Phénoménologie de l’Esprit (PDF)
- « Hegel. L’esprit comme vie d’une totalité » dans la revue Archives de Philosophie (2007)
- « Le témoignage de l’esprit chez Hegel » dans la Revue des sciences philosophiques et théologiques (2017)
- « Hegel : les enjeux de l’anthropologie » dans la Revue de métaphysique et de morale (2006)
- « La philosophie de la nature dans l’Encyclopédie de Hegel » dans la revue Archives de Philosophie (2003)
- Série de quatre émissions sur la philosophie de Hegel sur France Culture
- Sur Le Comptoir, lire la 1ère et la 2ème partie de notre étude sur Hegel