Agenda militant
Ailleurs sur le Web
![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)
- L’amitié pour faire peuple (17/01)
- Chikirou : La nourriture est une affaire politique (16/01)
- Entretien avec Emmanuel Todd (16/01)
- Un mois de grèves et de luttes : Décembre 2025 (16/01)
- Lordon : Boulevard de la souveraineté (15/01)
- L’affaire d’État Alstom : l’étau se resserre autour de la responsabilité de Macron (15/01)
- Coquerel sur France 2 mercredi 14 janvier (14/01)
- Le "moment eurocommuniste" ou la déstalinisation ratée du PCF (14/01)
- Etats-Unis : comprendre la « nouvelle doctrine de sécurité nationale » et ses implications (14/01)
- La loi du plus fort - La chronique de Pierre-Emmanuel Barré (12/01)
- Retour sur le blocage du périph’ - A propos de la résistance à l’accord UE-Mercosur et à la politique d’abattage total. (12/01)
- Venezuela : des médias intoxiqués par la propagande de guerre (12/01)
- Où vivent les plus riches ? Ce que la géographie des hauts revenus dit des fractures françaises (11/01)
- Une récompense pour les criminels ! Le prix Nobel de la « paix » (11/01)
- La crise de la gauche portugaise. Entretien avec Catarina Príncipe (11/01)
- Victor Klemperer, critique impitoyable du sionisme (11/01)
- USA - VENEZUELA : UNE OPÉRATION MAFIEUSE SALUÉE PAR LES "COLLABOS" - Maurice Lemoine (11/01)
- Le paradoxe de la Sécurité sociale : et si, pour faire des économies, il fallait l’étendre ? (11/01)
- LFI : Soutien au peuple venézuélien contre l’agression de Trump ! (10/01)
- Du militarisme à gauche. Réponse à Usul et à Romain Huët (09/01)
- Face à l’impérialisme trumpiste : ne rien céder (08/01)
- Attaque américaine au Venezuela : ce que révèle le "zéro mort" de franceinfo (08/01)
- Que signifie "abolir la monnaie" ? (08/01)
- Abject dessin antisémite dans Marianne contre le député LFI Rodriguo Arenas (08/01)
- "ILS FONT LE SAV DE TRUMP !" CE QUE DISENT LES MÉDIAS FRANÇAIS SUR LE VENEZUELA (08/01)
Liens
Connaissez-vous Robert Brenner ?
Ces articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » sont publiés à titre d'information et n'engagent pas la Tendance CLAIRE.
https://www.contretemps.eu/capitalisme-origines-brenner-marxisme-politique/
Étienne Furrer rend compte avec précision du livre de François Allisson et Nicolas Brisset : Aux origines du capitalisme. Robert Brenner et le marxisme politique (ENS Éditions, 2023). Ce livre, dont on pourra lire un extrait ici, est important dans la mesure où il rend accessible à un public francophone une partie du travail de Robert Brenner et la controverse à laquelle celui-ci a donné lieu à propos des origines du capitalisme, tout en restituant le contexte intellectuel de ce débat.
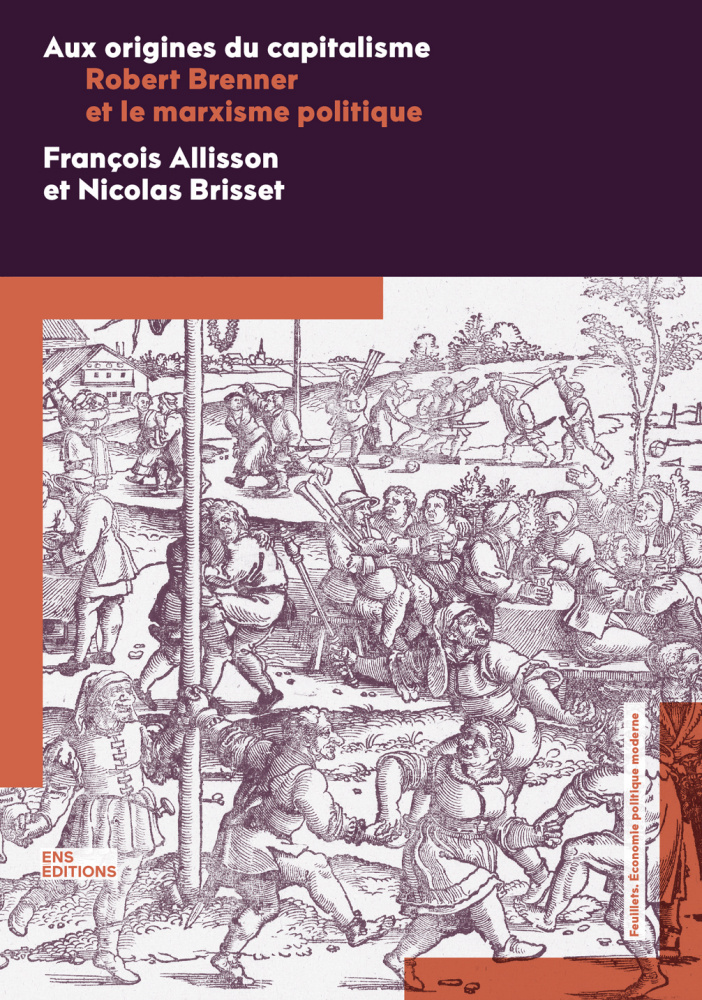
Si vous ne connaissez ni Robert Brenner ni le Brenner Debate, les deux historiens de la pensée économique François Allisson et Nicolas Brisset ont bien l’intention de réparer ce tort. En effet, selon le sociologue Razmig Keucheyan, cité par les deux auteurs, Brenner serait « l’économiste critique le plus influent au cours des dernières années au plan international » (p. 9). Cette influence est d’ailleurs évidente si l’on se tourne vers les nombreuses traductions en coréen, portugais, allemand, espagnol, chinois, japonais et turc de son ouvrage phare, The Boom and the Bubble. The US in the World Economy (2002)[1].
L’influence intellectuelle de Brenner peut être datée au moins à 1976, lorsqu’il publie dans la revue Past and Present un article retentissant, « Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe ». À seulement trente-trois ans, il fait feu de tout bois contre deux célèbres historiens de son temps, Michel Postan et Emmanuel Le Roy Ladurie, ce qui lui vaudra de donner son nom au débat qui s’ensuivit : le Brenner Debate.
Depuis lors, il a retravaillé et affiné ses thèses, jusqu’à en donner une version amendée et définitive en 2007, intitulée « Property and Progress: Where Adam Smith Went Wrong », traduite dans le présent ouvrage. Par conséquent, le livre d’Allisson et Brisset revêt bien sûr un intérêt de diffusion, puisque cette traduction est inédite[2]. Toutefois, les deux auteurs, en historien de la pensée économique, nous proposent bien plus : à la fois une véritable interprétation du Brenner Debate, du contexte intellectuel qui l’entoure, et une restitution de sa préhistoire et de certaines de ses filiations.
Ce compte-rendu se focalisera donc uniquement sur cette première partie, et non sur l’article de Brenner, puisqu’il y est introduit, présenté et résumé.
L’historiographie marxiste de la transition, du modèle smithien au modèle marxien
Dans le premier chapitre, Allisson et Brisset reviennent sur trois étapes importantes, antérieures au Brenner Debate, du débat sur la transition du féodalisme au capitalisme : les écrits liminaires de Marx et Engels ; le débat Dobb-Sweezy ; et, de manière plus originale, les débats soviétiques[3]. La première étape est un passage obligé. En effet, tout historien marxiste — ou presque — travaille à partir d’une exégèse de l’œuvre de Marx et se positionne vis-à-vis d’elle.
Brisset et Allisson suivent quant à eux la thèse de Brenner, largement partagée dans le marxisme contemporain, suivant laquelle il y a chez Marx deux modèles de la transition. D’ailleurs, cette distinction est également faite dans le débat Dobb-Sweezy et dans l’historiographie soviétique. Le premier modèle se trouve dans les textes plus philosophiques, dits parfois de jeunesse, comme L’idéologie allemande, Misère de la philosophie et le Manifeste du parti communiste. Les deux historiens le résument ainsi :
« Dans le premier modèle de développement, la tendance à l’accroissement de la division du travail induit une pression sur des relations de propriété féodales qui seront petit à petit broyées par le commerce international. Une telle vision suppose une représentation statique des relations de propriété, qui nécessite de trouver ailleurs le moteur de l’histoire : d’abord dans le développement des forces productives (considérées comme indépendantes des rapports de propriété), puis dans celui du commerce. Marx et Engels semblent donc considérer une tendance à la recherche des gains commerciaux de la part des individus. Nous ne sommes ici pas très loin d’Adam Smith, qui explique la division du travail par “le penchant qui les porte [les hommes] à trafiquer, à faire des trocs et des échanges d’une chose pour une autre” (Smith 1991 [1776], p. 81). » (p. 23)
Le deuxième modèle, que l’on trouve dans les Grundrisse et dans Le capital, opère une double rupture par rapport au premier. D’abord, il dissocie le commerce de la production capitaliste, en partant de l’idée que leurs règles de reproduction divergent. Le commerce ne fait rien, en soi, aux rapports de production — ou, du moins, il ne suffit pas en lui-même à les transformer. Ensuite, puisque le commerce ne peut avoir ce « rôle dissolvant », Marx remplace l’idée « d’un commerce international qui aurait libéré les tendances capitalistes jusqu’alors contraintes par l’ordre féodal » par « l’idée selon laquelle le processus d’accumulation ayant mené au capitalisme a été produit par des comportements féodaux : la relation salariale émerge du système féodal lui-même » (p. 26).
Le féodalisme n’est plus cette chape de plomb, datant de la chute de l’Empire romain, qui contraint et écrase les tendances naturelles de l’être humain à l’échange et à la division du travail. Ce second modèle « place la relation de propriété, c’est-à-dire le mode d’accès aux moyens de production, au premier plan, et la lutte au sein des rapports de production […] vient se substituer à la dialectique entre forces productives et division du travail » (p. 27).
À l’inverse d’Adam Smith, pour qui la division du travail dérive de l’échange et de la prise de conscience par les individus des gains de temps et d’argent qu’ils peuvent faire grâce à la spécialisation, Marx considère la division du travail comme une « conséquence de la lutte des classes ». Les auteurs reprennent l’analyse de Marx dans cet extrait sur le processus d’accumulation primitive :
« Pillage des biens de l’Église, aliénation frauduleuse des domaines de l’État, vol de la propriété communale, transformation usurpatoire de la propriété féodale et de la propriété de clan en propriété privée moderne, menée à son terme avec un terrorisme impitoyable : autant de méthodes idylliques de l’accumulation initiale. C’est par elles que furent conquis les champs pour l’agriculture capitaliste, que la terre fut incorporée au capital, et que fut créé pour l’industrie des villes l’apport nécessaire en prolétariat exploitable à merci. […] C’est ainsi que le peuple des campagnes, brutalement exproprié et expulsé de sa terre, réduit au vagabondage, fut astreint par des lois d’un terrorisme grotesque à la discipline nécessaire au salariat, à coups de fouet, de marquages au fer rouge et de tortures. » (cité p. 27-28)
En partant du second modèle de développement, le capital se comprend avant tout comme un « rapport social ayant un impact qualitatif sur le fonctionnement de l’économie », car « la pression de la concurrence pour la maximisation du profit rend nécessaire l’augmentation de la productivité par l’approfondissement de l’exploitation du travail et par le réinvestissement systématique des surplus [je souligne] » (p. 28). Et Allisson et Brisset de poursuivre :
« Autrement dit, alors que les seigneurs féodaux, qu’il y ait du commerce ou non, n’avaient pas nécessairement intérêt à améliorer les terres pour augmenter la production, le rapport de propriété capitaliste rend nécessaire le progrès technique. »
Ainsi, lecapitalisme est une émergence, une combinaison particulière de faits sociaux et de conflits politiques féodaux qui créent un fait social non-féodal, car moderne, qui dissout de l’intérieur les règles de reproduction du féodalisme. Cette focale sur l’aspect originellement politique du capitalisme, situé dans la lutte entre paysans et seigneurs sera à l’origine de l’appellation « marxisme politique » appliquée à Brenner.
La dissolution du féodalisme entre cause interne et externe
Le conflit entre ces deux modèles s’est reproduit sous d’autres formes, notamment dans le débat Dobb-Sweezy. Dans son livre Studies in the Development of Capitalism (1946), l’économiste Maurice Dobb soutient que la révolte des petits producteurs contre l’augmentation de la rente féodale et leur fuite dans les villes créent les conditions de leur affranchissement (vis-à-vis du travail contraint, de la corvée, du servage, etc.). En effet, les seigneurs sapent l’économie manoriale en surexploitant leurs serfs. Ces derniers fuiront vers les villes, obligeant les seigneurs à améliorer leurs conditions ou à les affranchir[4].
Cela résulte dans un second temps en une différenciation et une mise en compétition des travailleurs libres — anciens serfs libérés — via les différentes possibilités d’accès à la petite propriété ou au salaire. Ce n’est qu’alors qu’apparait un véritable marché du travail capitaliste. D’où un apparent paradoxe :
« Pour entrer de plain-pied dans le capitalisme, il fallut que le capital commercial recule devant le capital productif, c’est-à-dire qu’apparaisse une classe capitaliste composée de producteurs et non de marchands. » (p. 37)
Dès lors, les révolutions libérales, portées par cette nouvelle classe de travailleurs libres, visent à détruire les vestiges du féodalisme, les monopoles commerciaux, la propriété seigneuriale et les corporations, qui continuent à contraindre leurs activités libres. Comme Dobb le résumera plus tardivement dans sa carrière, c’est « finalement de la petite production (dans la mesure où elle assure l’indépendance d’action et introduit une différenciation sociale) que le capitalisme est sorti » (cité p. 37). La cause de la dissolution du féodalisme lui est interne ; il se dissout à cause de ses propres contradictions.
Sur fond d’exégèse marxiste, l’économiste Paul Sweezy fera la critique de la perspective de Maurice Dobb dans son article « The Transition from Feudalism to Capitalism » publié dans la revue marxiste Science and Society en 1950. Pour lui, le commerce international joue un rôle prépondérant dans la transition. Tout en rejoignant l’idée que la fuite des serfs est un marqueur fondamental de ladite transition, il s’oppose à l’explication politique pour en donner une version plus socio-économique.
En effet, Dobb oublierait une chose : la raison active ou positive pour laquelle les paysans quittent leurs terres. Certes, les paysans se révoltent contre l’augmentation de la rente, notamment en fuyant vers les villes : mais c’est une pure raison réactive ou négative. Mais la fuite, sans garantie d’opportunité, n’est-elle pas un pari des plus risqués ? Pour Sweezy, « le développement rapide des villes, qui offraient la liberté, l’emploi et un meilleur statut social, a exercé un puissant pouvoir d’attraction sur la population rurale opprimée » (1950, p. 140)[5].
Il ajoute un maillon explicatif à la thèse de la commercialisation : l’arrivée d’une élite marchande (bourgeoisie commerciale) ne défait pas mécaniquement le féodalisme, mais crée des opportunités nouvelles pour les paysans et les petits producteurs. Allisson et Brisset le résument en quelques mots : « alors que Sweezy pense [le capital marchand] comme une source de financement pour l’industrie naissante, Dobb considère au contraire qu’il reste soumis à la logique féodale » (p. 39).
La loi économique fondamentale du féodalisme et l’historiographie soviétique
Côté soviétique, on trouve plusieurs variations sur la transition. Les auteurs le notent d’emblée : les enjeux politiques différaient. Bien sûr, le carcan marxiste-léniniste empêchait les historien·ne·s de se pencher sur l’histoire de la transition au socialisme, largement écrite par les idéologues du communisme. Aussi, l’indisponibilité des archives n’est pas étrangère aux difficultés rencontrées par les historien·ne·s.
Malgré tout, ils et elles ont produit une série impressionnante de recherches sur le féodalisme européen[6], « moins par intérêt intrinsèque que parce que ce terrain leur paraissait plus libre et moins risqué » (p. 41). Bien que les chercheuses et chercheurs soviétiques mentionnent peu la littérature occidentale, jugée bourgeoise, ils et elles la lisent. Dès lors, rien d’étonnant à ce qu’un historien comme Isaak Zvavich publie, dans la revue Voprosy istorii, une recension élogieuse du Studies in the Development of Capitalism de Dobb. Un autre historien soviétique publie quant à lui, dans la même revue en 1955, une recension du symposium The Transition from Feudalism to Capitalism (1954), comprenant le débat Dobb-Sweezy[7].
Allisson et Brisset retracent ici les grandes lignes du débat[8] sur la loi économique fondamentale du féodalisme. Il prend place dans la principale revue d’histoire soviétique, Voprosy istorii (Questions d’histoire), entre 1951 et 1955. Ce débat, qui résonne étonnamment avec les discussions occidentales, comporte plusieurs textes clés[9]. Par exemple, l’article de Pankratova critique la confusion entre production marchande et production capitaliste. Il ne s’agit pas seulement de constater une évolution des forces productives pour juger que le féodalisme se dissout. Si les « historiens se sont bornés à étudier les forces productives », leur tâche devrait également consisté « à révéler les relations de production, et à montrer le développement de la lutte des classes » (p. 48).
En fait, Pankratova avance que les historiens qui datent le capitalisme en Russie d’avant le XIXe siècle se trompent : il ne suffit pas de constater le développement de la production marchande — certes, terrain fertile pour l’apparition du capitalisme — ni de voir apparaitre des formes de travail salarié pour y voir du capitalisme ou du salariat. Ces derniers se traduisent par l’apparition d’une classe ouvrière et d’un marché du travail. Pour elle — comme pour Trotski —, c’est donc l’abolition du servage en 1861 qui est un moment paradigmatique de l’émergence du capitalisme en Russie.
Quant à la loi économique fondamentale du féodalisme, Polânskij explique qu’elle réside dans la distinction entre la nature de ce qui est approprié par les classes possédantes et la manière de se l’approprier. Au sein du féodalisme, la rente est avant tout payée sous la forme de travail ou en nature ; le moyen qui garantit son appropriation est extra-économique — violence ou garantie de protection. Il est alors évident que l’accumulation économique est limitée par la nature de ce qui est cumulable : la subsistance ne peut se stocker à l’infini et la corvée ne peut se déployer hors de son environnement productif direct, le champ ou l’atelier. La productivité est donc extrêmement limitée.
Par conséquent, la loi économique du féodalisme correspond aux limites de l’économie naturelle que l’économie monétaire et marchande des villes tend à dépasser. Toutefois, malgré la proximité des questions posées et les quelques acteurs ayant favorisé la circulation entre ces aires géographiques (notamment Christopher Hill et Maurice Dobb), Allisson et Brisset rappellent que ces débats « n’étaient pas intégrés » (p. 51). Maintenant que ces affinités ont été rappelées, les deux auteurs vont se plonger dans les travaux de Brenner lui-même et dans le Brenner Debate.
Le contexte marxiste et le projet intellectuel de Brenner
Les auteurs présentent dans leur second chapitre les conditions et le contexte intellectuel du Brenner Debate. Il s’agit de rappeler toute une série d’éléments : le rôle des revues britanniques Past and Present et de la “première” New Left Review(1960) dans le renouveau d’un marxisme humaniste et hétérodoxe ; la place de E. P. Thompson dans la formulation d’une histoire par en bas du développement des sociétés capitalistes — donc, surtout, d’une histoire des résistances à son développement — en remettant « les classes sociales au cœur de l’historiographie » (p. 60) ; la prise de contrôle de la NLR par Perry Anderson en 1962, et les critiques de Thompson vis-à-vis de cette nouvelle ligne éditoriale, trop théorique et antihumaniste.
Brenner, alors historien (de l’économie) américain, entrera quant à lui dans le comité de rédaction de la revue à partir de 1970. Et si la focale de Brenner sur la lutte des classes pourrait le rapprocher de Thompson, son appartenance à la New Left Review dans cette seconce période, ainsi que sa manière d’argumenter, très théorique et peu étayée d’exemples empiriques, le situe assez loin du « populisme » (selon le mot de Perry Anderson cité par Davis, 2006)de ce dernier.
Les motivations de son article de 1976 sont quant à elles très claires. En s’opposant au modèle de la commercialisation, dit smithien, et au modèle démographique, de Postan et Le Roy Ladurie, Brenner cherche à démontrer leurs faiblesses respectives, car ni l’un ni l’autre ne rendent compte de « la structure des rapports de classes, du pouvoir de classe, qui déterminera dans quelle mesure et de quelle façon certains changements démographiques et commerciaux pourront affecter les évolutions à long terme, qu’il s’agisse de la distribution des revenus ou de la croissance économique » (cité p. 54 et 63-64).
Brisset et Allisson le rappellent : Brenner veut en même temps « rompre avec l’historiographie libérale, qui part du principe que le marché est partout en puissance » tout en produisant « une histoire économique centrée sur les luttes pour l’appropriation des moyens de subsistance » (p. 54). Il s’agira pour eux d’expliquer par la suite comment Brenner se situe par rapport aux deux modèles précités, puis d’expliciter comment il affine ses analyses grâce à plusieurs concepts, notamment ceux de relations sociales de propriété et de règles de reproduction.
Trois éléments centraux de l’argumentation
Modèle smithien et modèle malthusiano-ricardien
Pour Brenner, les deux modèles, le smithien et le malthusiano-ricardien, ne se valent pas. C’est surtout au second qu’il s’attaque. Celle-ci a le mérite d’avoir battu en brèche le modèle smithien « en soulignant que la montée en puissance du commerce en différents points d’Europe et à différentes époques n’a pas eu partout les mêmes effets » (p. 65). Certes, le développement commercial a parfois bel et bien déstabilisé l’économie féodale. Mais, dans d’autres cas, il l’a renforcé, découlant parfois sur un retour du servage — notamment en Russie.
La thèse centrale du modèle matlhusiano-ricardien, défendue notamment par Le Roy Ladurie, est que ce n’est pas le commerce international et les « réseaux marchands » qui déterminent le développement des économies féodales, mais bien les « mouvements démographiques de long terme » (p. 65). Ce mouvement se compose de deux phases : l’accroissement et le déclin de la population. Le Roy Ladurie le qualifie « d’homéostatique » dans la mesure où la population s’autorégule de manière inconsciente, l’accroissement de la population produisant « des crises majeures en raison de l’abaissement du ratio terre/travail », alors le déclin produit une augmentation de ce ratio et « à des périodes fastes pour les travailleurs agricoles ». Mais Brenner prend l’approche malthusienne à son propre piège. On ne peut en effet comprendre la poursuite et le développement exponentiel de la croissance économique au 19e siècle alors même que la population croit de manière tout à fait exponentielle. « Qu’est-ce qui est venu mettre fin à l’équilibre qu’évoque Le Roy Ladurie ? » demandent Allisson et Brisset.
Les relations sociales de propriété et les règles de reproduction
Si le mérite de la thèse malthusienne est d’avoir remis en cause la généralisation et le déterminisme commercial propre au modèle smithien, celui-ci apporte quant à lui quelque chose que celui-là élude : une explication par « l’émergence de comportements spécifiques » (p. 67). Brenner reconnait au modèle smithien ce mérite, mais il avance qu’il faut les dénaturaliser en refusant notamment le postulat d’un penchant naturel de l’homme à échanger qui expliquerait l’émergence du capitalisme. Au fond, c’est justement ce qu’il s’agit de comprendre, et seule l’historicisation le permet. Pour ce faire, il se munit donc de ce concept des relations sociales de propriété, qu’il définit comme suit :
« [les relations sociales de propriété sont] les relations entre producteurs directs, entre exploiteurs, et entre exploiteurs et producteurs directs. Des relations qui, prises ensemble, rendent possible et définissent l’accès régulier des individus et des familles aux moyens de production (terre, travail, outils) et/ou au produit social. L’idée est que de telles relations, propres à chaque société, définissent les contraintes fondamentales encadrant et limitant les comportements économiques individuels. Elles constituent des contraintes dans la mesure où elles déterminent non seulement les ressources dont disposent les individus, mais également la manière dont ils y ont accès et, plus généralement, leur revenu. Les relations sociales de propriété sont maintenues et reproduites collectivement — en dehors du contrôle de chaque individu — par des communautés politiques constituées précisément à cette fin. Et c’est parce que ces communautés politiques constituent et maintiennent ces relations sociales de propriété collectivement et par la force — en mettant en œuvre des fonctions politiques normalement associées à l’État, comme la défense, la police et la justice — que les acteurs économiques individuels ne peuvent généralement les modifier, et doivent les considérer comme une réalité acquise, à l’instar du cadre à l’intérieur duquel ils effectueront leurs choix. » (p. 128 dans la traduction de l’article, cité p. 66)
C’est seulement à partir de l’analyse comparée des différentes formes de relations sociales de propriété que l’on peut comprendre le développement du capitalisme. Dès lors, il s’agit « d’abord de saisir ces variations, afin d’indiquer quels types d’organisations sont à l’origine de la transition vers le capitalisme » (p. 69).
Il y a donc des relations de propriété féodales et des relations de propriété capitalistes. Dans les premières, les seigneurs sont propriétaires de leur domaine, mais les paysans ont un droit de possession sur les terres domaniales qu’ils cultivent — un droit donné par l’usage. Les paysans sont par conséquent en possession de leurs moyens de reproduction, alors que les seigneurs s’approprient des biens par des moyens extra-économiques. Brenner parle donc d’une « forme de propriété politiquement constituée » (p. 70). D’un point de vue subjectif, « les stratégies des individus dans le cadre d’un système féodal sont elles-mêmes féodales ».
C’est ce que Brenner conceptualise ici comme des « règles de reproduction », la systématicité par laquelle « les individus et les familles adoptent un ensemble correspondant et particulier de stratégies économiques » (p. 71). Autrement dit, les relations de propriété féodales ne peuvent produire un développement économique, car elles se traduisent par des stratégies de reproduction féodales.
D’un côté, les paysans n’ont pas de raisons d’augmenter la productivité de leurs terres et ont tout intérêt à diriger leur production vers l’autoconsommation. La règle de reproduction pour les paysans est donc « la sécurité d’abord » (p. 72). De l’autre, les seigneurs ne peuvent augmenter la productivité des terres, puisque les paysans n’ont pas de motivations à le faire. En résumé, c’est par le renforcement du potentiel militaire, par des moyens extra-économiques, que les seigneurs constituaient leur richesse — oscillant entre conquête et protection de ses sujets, sur lesquels ils perçoivent une rente.
À l’inverse, dans les relations de propriété capitalistes, les seigneurs ont perdu leur pouvoir d’accumulation politique et les paysans leurs droits à la possession de leurs moyens de subsistance. Dès lors, la productivité de la terre devient un enjeu capital. D’abord, État moderne oblige, « les propriétaires terriens n’ont plus accès aux bénéfices de l’accumulation politique » (p. 71), en conséquence de quoi ils se doivent de tout faire pour améliorer le revenu de leurs terres.
Pour ce faire, ils les louent à des fermiers capitalistes, qui leur paieront donc un loyer. Ce fermier loue sa terre avec l’intention de faire un bénéfice, si et seulement s’il arrive à maximiser la productivité du travail sur l’exploitation en utilisant des travailleurs libres ou de nouvelles techniques — peu importe, les deux sont dorénavant du capital. Nous sortons d’un rapport binaire pour entrer dans un rapport ternaire, typique du capitalisme, comportant le propriétaire foncier, l’exploitant capitaliste et le travailleur libre. Allisson et Brisset précisent que « c’est donc le rapport de propriété qui confère une place centrale au marché, et non l’inverse », et que « dans le cadre des règles de reproduction capitalistes, il est au contraire absolument nécessaire de saisir toutes les opportunités de gain, en raison d’une situation de concurrence généralisée » qui suppose « de diminuer les coûts et de se spécialiser » (p. 72).
Le passage du féodalisme au capitalisme
Il nous reste à parler du passage d’un type de relation à l’autre, c’est-à-dire de la transition du féodalisme au capitalisme en elle-même. Pour comprendre comment l’on passe de l’un à l’autre, on fait face à un premier problème : si, pour Brenner, les stratégies de reproduction correspondent aux régimes de propriété, est-il seulement possible qu’il y ait un changement social ? Ce dernier résout l’équation en proposant une explication de la transition en termes « d’effets involontaires d’actions volontaires ». Les actions volontaires correspondent en effet aux règles de production.
Prenons par exemple les corporations : pour se protéger, elles verrouillent l’accès à un métier. Limiter la concurrence permet de maintenir un certain niveau de rareté tout un assurant que les compétences techniques des fournisseurs de biens ou de services soient authentifiées. Mais, ce faisant, les travailleurs libres restent en dehors des institutions féodales et sont amenés, par la force des choses — par la force de leurs règles de reproduction capitalistes — de vouloir les détruire.
Brenner identifie trois voies européennes de développement : l’anglaise, typiquement capitaliste, celle d’Europe de l’Est, typiquement féodale, et enfin la française, caractérisée par la petite propriété terrienne. Résumons-les très brièvement : lorsque la peste noire frappa l’Angleterre et que le ratio terre/travail diminua, « l’entente des lords anglais vola en éclats en raison de la résurgence de la concurrence pour les tenanciers » (p. 74).
L’augmentation de la demande seigneuriale de main-d’œuvre permit aux paysans, se faisant en quelque sorte désirer (car rare), de prendre l’ascendant sur la noblesse. Les seigneurs devaient proposer les meilleures conditions pour attirer les potentiels tenanciers, notamment en donnant le statut de « tenanciers libres », qui passait par la remise de la « copie du registre manorial où étaient consignées les conditions de sa tenure ». Puisque la common law britannique reconnait à tout homme libre le droit de la saisir, ces copies pouvaient faire office de preuves devant les instances judiciaires quand un litige se présentait entre le seigneur et le producteur direct.
En réponse à cette résistance légale — et parfois aux agitations paysannes —, les lords ont répondu en « poussant pour la fin des droits coutumiers (enclosures, contestations des droits de glanages et des accès aux forêts seigneuriales) et en soumettant les terres détenues en copie à des augmentations de rentes lors de transferts, essentiellement intergénérationnels ». Les paysans s’opposèrent bien sûr à ces tentatives de réaffirmation seigneuriales. Ils ne purent cependant empêcher l’accumulation privée des propriétés, imposées par les lords avec l’aide de l’État central monarchique.
Allisson et Brisset résument :
« L’organisation féodale anglaise tendait à concentrer le pouvoir extra-économique entre les mains de la couronne, et le pouvoir économique entre celles des grands propriétaires terriens. Dès lors, le mode de reproduction de ces propriétaires devient économique : il fallait louer sa terre au plus offrant, ce qui incitait les tenanciers à être plus productifs. Par comparaison, en Europe de l’Est, la paysannerie n’était, selon Brenner, pas suffisamment organisée pour imposer une telle “libération”. Le servage restait donc l’organisation dominante. Inversement, en France, le rapport de force était plus favorable aux paysans, de sorte qu’ils arrivaient à la fois à asseoir leur propriété, et à préserver les droits coutumiers. C’est la raison pour laquelle la France se serait dirigée vers un régime de petites propriétés paysannes préservées des aléas du marché, l’autosubsistance restant la norme. » (p. 75)
Les paysans anglais abandonnent donc la règle de reproduction « safety first » typique du féodalisme dans le même mouvement de passage entre les relations sociales de propriété féodales et celles capitalistes. Désormais, la paysannerie anglaise, dans sa concurrence pour les baux, se devra d’adopter la « règle smithienne de maximisation du rapport prix/coût par voie de spécialisation, d’accumulation et d’innovation » (Brenner cité par Allisson et Brisset, p. 76).
L’avenir du marxisme politique
Les réactions critiques à la thèse de Brenner font l’objet du chapitre 8 (p. 81). Elles sont nombreuses, et relativement inégales entre elles ; certaines sont attendues, comme celles des tenants du modèle malthusien ; d’autres sont plus constructives, celle de Guy Bois notamment, un historien marxiste. C’est d’ailleurs sa critique qui donna son nom au « marxisme politique ». Par « politique », il entendait souligner le fait que Brenner aurait, en quelque sorte par réactance vis-à-vis de l’économisme marxiste orthodoxe, forcé le trait sur les facteurs politiques et oublié les réalités économiques.
Brenner répondra que les facteurs politiques sont indissociables du développement économique. Pour ce qui des coreligionnaires ou des héritiers, il serait trop long de tous les passer en revue[10]. Allisson et Brisset préfèrent se focaliser sur trois auteurs en particulier, ayant utilisé et complété les analyses de Brenner : Andreas Malm, Ellen Meiksins Wood, et Xavier Lafrance. Je développerai en particulier l’apport de Wood, qui me semble être plus directement critique et en prise avec les arguments théoriques de Brenner.
Je commencerai toutefois par quelques mots sur les apports de Malm et de Lafrance. Le mérite de Malm est d’avoir montré que les choix technologiques s’expliquent en termes de rapports de propriété, et non en termes purement techniques. Il y a des choix politiques derrière les technologies, car la stratégie de reproduction capitaliste, qui implique l’augmentation de la productivité, doit également tenir compte et anticiper les résistances populaires à cette augmentation.
Quant à Xavier Lafrance[11], il est le premier à explicitement utiliser le cadre de Brenner dans un travail de longue haleine, monographique, sur la transition au capitalisme en France. Si l’on devait garder un argument clé, c’est que le capitalisme français est une importation étatique, une « imposition autoritaire » de Napoléon III, aux prises avec la montée en puissance de l’Angleterre et de la Prusse. Le développement industriel devient alors un enjeu majeur de la politique du Second Empire, par la création d’organismes de crédit visant à remplacer l’autofinancement, une stratégie nationale de développement ferroviaire, la mise en place de grands magasins en vue de rationaliser le marché intérieur, la signature des accords Cobden-Chevalier produisant une pression constante de type capitaliste sur la production française et le détricotage des droits locaux au profit d’un droit du travail organisant la subordination des ouvriers.
Incontestablement, la coreligionnaire principale de Brenner dans le marxisme politique est Ellen Meiksins Wood. Après avoir rappelé plusieurs de ses riches contributions, intellectuelles et politiques (p. 88-89), Allisson et Brisset proposent de se pencher sur les travaux visant à enrichir ceux de Brenner[12]. Wood avance que malgré les limites du modèle de la commercialisation, il serait trop rapide de considérer le commerce international comme n’ayant aucun lien avec l’émergence du capitalisme.
Pour elle, on restituera au mieux l’émergence du capitalisme anglais en comprenant l’insertion spécifique de l’Angleterre dans les réseaux marchands internationaux. Wood va en fait proposer, suite à un débat avec Brenner sur les Provinces-Unies, de distinguer les règles du commerce féodal et du commerce capitaliste. En effet, Brenner considère que les Provinces-Unies avaient constitué des relations sociales de propriété capitalistes, mais que leur transition aurait « avorté » (p. 91).
Pour Wood, Brenner contredit son propre argument sur l’émergence du capitalisme en Angleterre, puisque la limite de la transition au capitalisme est externe, et non-interne. Elle sort en quelque sorte Brenner de cette contradiction, en proposant une relecture du cas des Provinces-Unies autour de trois arguments : d’abord, contrairement à ce qu’avance Brenner, les relations de propriété restaient féodales ; ensuite, la dépendance vis-à-vis du marché international suivait une logique féodale, « dans la mesure où cette dépendance concerne la consommation (il faut vendre pour acheter), alors que dans un cadre capitaliste, c’est le profit qui devient la condition de la survie » (p. 92) ; enfin, l’augmentation des rendements agricoles, sur laquelle Brenner s’appuyait pour qualifier les relations sociales des Provinces-Unies de « capitalistes », dérivait non pas de la pression constante propre au marché capitaliste, mais d’une pression cyclique, de crise, forçant le pays à produire davantage pour assurer l’approvisionnement en subsistances grâce aux bénéfices tirés de l’exportation de marchandises manufacturées.
Ici, l’apport de Wood est décisif dans la réaffirmation de la primauté capitalistique de l’Angleterre[13]. Le commerce des Provinces-Unies resterait tout à fait féodal : « sa domination commerciale sur le reste de l’Europe s’exerce en raison d’une supériorité extra-économique, par sa maîtrise des routes commerciales, et non en raison de ses capacités à réagir aux variations des coûts de revient des différents sites de production » (p. 93). Les profits ne dérivent pas de la concurrence, mais bien du monopole des routes commerciales.
Wood distingue donc les stratégies de reproduction féodales et capitalistes dans la sphère commerciale elle-même : la première consiste à « vendre pour pouvoir acheter » ; la seconde à « maximiser son profit dans un contexte de prédation économique ». Elle résume : « Il est primordial de distinguer la nécessité de vendre pour survivre de la nécessité d’atteindre un taux de profit moyen pour survivre, ceci indépendamment de ses propres besoins de consommation » (cité p. 94).
D’ailleurs, en temps de crises, la réponse des élites des Provinces-Unies ne sera pas d’améliorer la productivité. Pire, la possibilité largement répandue dans les Provinces-Unies de reconvertir son capital économique en capital politique via l’achat d’une charge publique permettait aux élites de se réfugier dans des privilèges féodaux, évitant en cela d’assumer la concurrence commerciale, là où les lords anglais se devaient d’améliorer la productivité de leurs terres.
L’amélioration des terres n’est rendue « vitale » que par la pression constante, « la dépendance pleine et entière aux marchés » (p. 97) des baux et des travailleurs libres, typiques de la triade anglaise du propriétaire foncier (dont les revenus dépendent de l’efficacité de l’exploitant), de l’exploitant fermier (dont le salaire dépend de la productivité) et du salarié agricole ou du saisonnier (des dépossédés de leurs moyens de reproduction).
Que faire de Brenner ?
Il n’y aurait aucun intérêt à traduire les textes de Brenner si ceux-ci n’avaient pas quelque chose à nous dire. Au fond, c’est en répondant à la question « pourquoi le Brenner Debate importe-il ? » que l’on répond à la question de « pourquoi le traduire ? ». Et l’intérêt de Brenner réside avant tout dans sa mise en évidence du rôle fondamental de la propriété dans la structuration de l’ordre politique. Sa force épistémologique réside quant à elle dans sa position d’intermédiaire, entre le post-marxisme propre à la New Left et aux poststructuralismes et le marxisme “populiste” à la Thompson : il maintient une analyse de classe sans pour autant s’intéresser à l’agentivité des classes populaires.
Ici, on laissera ce débat se poursuivre entre les tenants de Thompson et les marxistes politiques. Il est à parier qu’un équilibre entre ces deux tendances serait des plus fertiles. D’ailleurs, à l’intérieur du marxisme politique, on trouve des chercheurs comme Benno Teschke et Samuel Knafo qui se posent eux-mêmes en intermédiaires, en critiquant un certain marxisme politique qui tend, à cause de sa puissance théorique, à prendre ses distances avec les multiples historicités de la transition[14].
Qui plus est, ces critiques ont fait mouche, puisque les très brennériens/woodiens, relativement proches des fondateurs, Xavier Lafrance et Charles Post, ont édité un ouvrage collectif qui mériteraient une urgente traduction, Case Studies in the Origins of Capitalism (2019). L’entreprise comparative y prend une envergure intellectuelle et collective absolument décisive. Dans les termes du marxisme politique, elle analyse la transition au capitalisme en Angleterre, en France, en Catalogne, aux États-Unis, au Canada, au Japon, entre l’Empire ottoman et la Turquie, ou encore à Taïwan. Tout un programme !
Bibliographie
Brandon, Pepijn. « Marxism and the « Dutch Miracle »: The Dutch Republic and the Transition-Debate », Historical materialism, vol.19 no 3. p. 106-146.
Davis, Madeleine. « The Marxism of the British New Left », Journal of Political Ideologies. 2006, vol.11 no 3. p. 335‑358.
Evans, Jessica. « Mediating Capitalism’s ‘Rules of Reproduction’ with Historical Agency: Political Marxism, Uneven and Combined Development and Settler-Capitalism in Canada », Historical Materialism. 2021, vol.29 no 3. p. 153‑174.
Ganshof, François-Louis. « Marc Bloch. Rois et Serfs. Un chapitre d’histoire capétienne. », Revue belge de Philologie et d’Histoire. 1922. p. 758‑763.
Hyams, Paul R. « La joie de la liberté et le prix de la respectabilité : autour des chartes d’affranchissement anglaises et d’actes français analogues (v. 1160-1307) », Bibliothèque de l’école des chartes. 2006, vol.164 no 2. p. 371‑389.
Knafo, Samuel et Benno Teschke. « Political Marxism and the Rules of Reproduction of Capitalism: A Historicist Critique », Historical Materialism. 2020, vol.29 no 3. p. 54‑83.
Lafrance, Xavier. « The Vacuity of Structurelessness: Situating Agency and Structure in Exploitative and Alienated Social Relations », Historical Materialism. 2021, vol.29 no 3. p. 84‑106.
Lafrance, Xavier et Charles Post (eds.). Case Studies in the Origins of Capitalism. Cham : Palgrave Macmillan. 2019. (Marx, Engels, and Marxisms).
Moreno Zacarés, Javier. « Two Historicisms: Unpacking the Rules of Reproduction Debate », Historical Materialism. 2021, vol.29 no 3. p. 175‑198.
Pal, Maïa. « Radical Historicism or Rules of Reproduction? New Debates in Political Marxism: An Introduction to the Symposium on Knafo and Teschke », Historical Materialism. 2021, vol.29 no 3. p. 33‑53.
Post, Charles. « Structure and Agency in Historical Materialism: A Response to Knafo and Teschke », Historical Materialism. 2021, vol.29 no 3. p. 107‑124.
Salgado, Pedro. « Anti-Eurocentric Historicism: Political Marxism in a Broader Context », Historical Materialism. 2021, vol.29 no 3. p. 199‑223.
Sweezy, Paul et Maurice Dobb. « The Transition from Feudalism to Capitalism », Science & Society. 1950, vol.14 no 2. p. 134‑167.
Wood, Ellen Meiksins. L’origine du capitalisme : une étude approfondie. Traduit par François Tétreau. Montréal : Lux. 2009.
Notes
[1] Pour ce qui est d’une éventuelle version française, elle se fait toujours attendre.
[2] On trouve d’autres traductions des articles de Brenner dans la revue en ligne Période : http://revueperiode.net/author/robert-brenner/.
[3] Que François Allisson soit un spécialiste du marxisme russe explique ce décalage inattendu mais très éclairant.
[4] L’affranchissement des serfs est particulièrement courant au XII, XIII et XIV siècle (Hyams, 2006). Pour la France, Marc Bloch avait donné de brillantes analyses, à contre-courant de la mythologie libérale portée par Guizot, de l’affranchissement des serfs par Saint-Louis en 1315 (Ganshof, 1922). Dans ses analyses, Bloch avance que les seigneurs ont voulu l’affranchissement, partant de l’idée qu’ils forceraient les paysans à racheter la terre — plus ou moins comme en Russie après 1861 —. Cet argument pose, il me semble, des problèmes à l’analyse de Brenner.
[5] Dobb, faisant usage de son droit de réponse, rétorque quant à lui : « Une fois de plus, comme le souligne Sweezy, les villes ont agi comme des aimants pour les serfs fugitifs. Il ne m’importe guère de débattre de la question de savoir si cette fuite des serfs était due à l’attraction de ces aimants urbains (et alternativement, dans certaines parties de l’Europe, à l’attrait des terres libres) ou à la force répulsive de l’exploitation féodale. Il est évident qu’il s’agissait des deux, à des degrés divers selon les époques et les lieux. Mais l’effet spécifique de cette fuite est dû au caractère spécifique de la relation entre le serf et l’exploiteur féodal. » (1950, p. 160)
[6] Les auteurs citent notamment l’article des historiennes soviétiques Sidorova et Gutnova publié dans les Annales en 1960 : « Comment l’historiographie soviétique aperçoit et explique le Moyen Âge occidental ».
[7] Allisson et Brisset donnent encore plusieurs exemples de cette circulation des idées entre soviétiques et occidentaux, allant dans les deux sens, malgré les freins idéologiques et la barrière de la langue (voir p. 46).
[8] En laissant par exemple de côté, comme ils le précisent, le débat sur la genèse du capitalisme dans l’industrie, qui pris quant à lui place dans la revue Srednie veka (Moyen Âge) entre 1953 et 1955.
[9] Traduit en français : « À propos de la périodisation de l’histoire de la Russie à l’époque du féodalisme » (1951) de Pashuto et Cherepnin ; « Sur le rôle de la production marchande dans la transition du féodalisme au capitalisme » (1953) par la rédactrice de la revue, Anna Pankratova ; « La question de la loi économique fondamentale du féodalisme » (1954) de Polânskij ; « Sur la loi économique fondamentale de la formation féodale (résultats des discussions) » (1955) sous la forme d’un résumé collectif anonyme visant à clore le débat.
[10] Sont ici cités, en plus de ceux dont les travaux seront analysés plus en détail, Benno Teschke, Hannes Lacher, David McNally et Georges Comninel.
[11] Une interview de Lafrance réalisé par Selim Nadi avait d’ailleurs été publiée sur le site Contretemps en 2020 https://www.contretemps.eu/construction-capitalisme-france-entretien/.
[12] On lira également sur Contretemps le chapitre « Les origines agraires du capitalisme » de son ouvrage L’origine du capitalisme, une étude approfondie (2009).
[13] L’historien marxiste néerlandais Pepijn Brandon a vivement critiqué cette lecture woodienne de l’histoire des Pays-Bas (2011).
[14] Ce débat, qui mériterait d’être traduit, a été lancé par un texte de Teschke et Knafo (Knafo et al., 2020), et s’est déroulé dans un numéro de la revue Historical Materialism (Post, 2021; Lafrance, 2021; Evans, 2021; Moreno Zacarés, 2021; Salgado, 2021; Pal, 2021).




