Agenda militant
Ailleurs sur le Web
![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)
- Xavier Niel roule pour le PS (13/03)
- Au cœur du capital (12/03)
- Le débat des représentants des partis, avec Paul Vannier (12/03)
- Meeting avec Bagayoko, Coquerel et Mélenchon à Saint-Denis ! (11/03)
- Ludivine Bantigny, "La Bourse ou la vie. Le Front populaire, histoire pour aujourd’hui" (11/03)
- C’est quoi le "marxisme classique" et le "marxisme occidental" ? (10/03)
- “Le socialisme est la maison commune de tous les combats justes.” – Entretien avec Joseph Andras (10/03)
- Sur Franceinfo : Brigitte Boucher et les irresponsables (10/03)
- Ce que révèle l’affaire Epstein (10/03)
- Au Liban, d’une guerre coloniale à l’autre et du droit de résister (10/03)
- POUR UN FRONT ANTIFASCISTE AU SECOND TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES (10/03)
- Meeting de la campagne municipale LFI à Lille (10/03)
- Meeting avec Jean-Luc Mélenchon et Sophia Chikirou à Paris ! (09/03)
- Colombie : la gauche de Gustavo Petro valide le dernier test des législatives avant la présidentielle (09/03)
- Penser l’émancipation autrement, discuter l’apport de marxistes hétérodoxes [Podcast] (09/03)
- Terrorisme d’Ultra-droite (08/03)
- "L’Iran est sur le point d’obtenir l’arme nucléaire" : trente ans de prophéties démenties (08/03)
- Hommage au chercheur marxiste Michael Parenti – Compilation d’entretiens (08/03)
- La guerre de trop : les Américains et les Israéliens n’ont rien compris à l’Iran ! (08/03)
- Poutou annonce un probable soutien du NPA-A à Mélenchon en 2027 (07/03)
- Attaques en série contre LFI (07/03)
- Des maires insoumis pour tout changer | Clip officiel - Municipales 2026 (07/03)
- Romaric Godin : "La force fondamentale du capitalisme le pousse vers le néofascisme" (07/03)
- Quentin Deranque était en première ligne dans la bagarre (06/03)
- Tirer une balle dans la tête sans intention de donner la mort (06/03)
Liens
Les partis pris de la « nouvelle historiographie » de la Commune de Paris
Ces articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » sont publiés à titre d'information et n'engagent pas la Tendance CLAIRE.
https://www.contretemps.eu/commune-paris-1871-histoire-tombs-deluermoz/
Les dates-anniversaires de la Commune de Paris sont un révélateur puissant des tendances du débat historiographique consacré à cet événement mais aussi de l’état général des courants sociaux et politiques qui se sont réclamés de son héritage. Ainsi, dans une France encore portée par le souffle de mai 68, le centenaire a été marqué l’ampleur des cortèges populaires, signe du rayonnement du mouvement ouvrier et de la gauche politique de l’époque, et, côté historiographique, par l’émergence d’une nouvelle approche, celle de « l’histoire par en bas » représentée par les travaux de Jacques Rougerie.
Le contraste est frappant avec le cent-cinquantenaire de 2021, tant par la relative discrétion de la commémoration, entièrement laissée aux soins d’associations comme « Faisons vivre la Commune » ou l’historique « Ami.e.s de la Commune de Paris », que par la tonalité des quelques travaux, essentiellement académiques, parus à cette occasion.
C’est à une approche critique de ces derniers qu’est consacré l’ouvrage d’Emmanuel Brandely Les historiens contre la Commune, paru en avril dernier aux éditions Les nuits rouges. Dans cette « nouvelle historiographie de la Commune », l’auteur distingue avant tout une volonté de normalisation de l’événement, menée au nom d’une approche supposément « scientifique » et « dégagée des lectures idéologiques ».
Celle-ci révèle pourtant rapidement ses propres partis pris. Soucieuse d’intégrer l’événement dans un récit national structuré autour du consensuel référent « républicain », cette historiographie se caractérise par une polémique systématique, tantôt ouverte, tantôt implicite, dirigée contre les « mythes » véhiculés, selon elle, par les interprétations marxistes de la Commune, à commencer par celle consignée dans les écrits de Marx lui-même.
L’extrait que nous publions développe cet aspect, en s’attachant plus particulièrement aux travaux de deux historiens qui ont bénéficié d’une visibilité particulière lors du cent-cinquantenaire : Robert Tombs, figure de la droite intellectuelle britannique, curieusement adoubé en France par certains historiens et éditeurs de gauche, et Quentin Deluermoz, auquel Emmanuel Brandely avait déjà consacré un article publié dans nos colonnes.
Stathis Kouvélakis
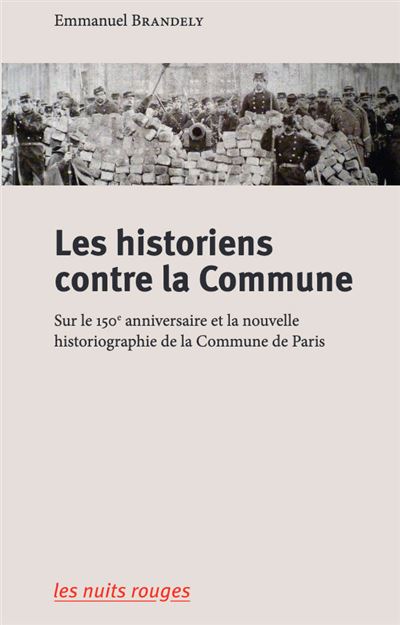
Nouvelle historiographie contre « grille de lecture marxiste »
Dans un article récent consacré à l’historiographie de la Commune, Quentin Deluermoz crédite à juste titre Robert Tombs d’avoir « tout particulièrement contribué à sortir la Commune des grands schémas interprétatifs qui en orientaient le sens : avant tout la grille de lecture marxiste »[1]. La nouvelle historiographie ne se contente pas, en effet, de réfuter « les mythes marxistes », elle prétend également disqualifier la « grille de lecture marxiste » appliquée à la Commune. L’accusation est plus ou moins toujours la même : les « analyses marxistes » auraient plaqué sur la Commune une « grille de lecture » du XXe siècle pour en faire une révolution prolétarienne et socialiste préfigurant la révolution bolchévique d’octobre 1917. Mais il faut observer, d’abord, qu’elle se garde bien de citer les « analyses marxistes » en question, ce qui la dispense de les réfuter précisément sur le terrain du débat historique et lui permet, en outre, de les caricaturer impunément. Ensuite, que, par une ironie involontaire, les historiens qui reprochent aux « marxistes » leurs anachronismes, multiplient les anachronismes dans leurs propres travaux. Car s’il est en effet tout à fait anachronique de chercher dans la Commune l’application de « principes marxistes » pour la réduire à un prélude d’octobre 1917, il ne l’est pas moins de se prévaloir de leur absence pour conclure qu’elle n’est pas une révolution socialiste. C’est pourtant, on va le voir, ce que font très souvent les nouveaux historiens de la Commune.
« Peuple » contre « prolétariat » ?
Pour disqualifier la méthode du marxisme, les nouveaux historiens opposent systématiquement les catégories marxiennes/marxistes à la « réalité » du Paris de 1871, manière de se présenter comme des observateurs pragmatiques aux prises avec des idéologues. Robert Tombs assure, par exemple, qu’« il est clair, et cela ne peut plus être controversé, que les communards constituaient “le peuple” plutôt que “le prolétariat” »[2], ce qui sous-entend évidemment que les marxistes déforment la réalité pour la faire entrer dans les cases de leur théorie. Que vaut cette objection ? Observons d’abord que Marx, s’il emploie bien dans La Guerre civile en France une douzaine de fois les mots « prolétaires(s) / prolétariat / prolétarien » et vingt fois le terme « classe ouvrière », utilise aussi vingt-et-une fois le mot « peuple » (sans compter les occurrences de « populaire »)[3]. Comme l’explique Stathis Kouvélakis :
« La Commune en tant que telle est définie [par Marx] comme “gouvernement du peuple lui-même”, l’expression du “peuple agissant pour lui-même et par lui-même” (…) Ce sont donc les “masses populaires” qui apparaissent comme le sujet de l’ “émancipation sociale”, ce qui signifie que cette dernière n’est pas simplement l’affaire du prolétariat mais qu’elle désigne un processus plus expansif, au sein duquel le prolétariat est amené non à se fondre dans un ensemble indifférencié mais à jouer un rôle dirigeant, à constituer un “peuple révolutionnaire” sous hégémonie ouvrière »[4].
Marx écrit d’ailleurs dans un brouillon de La Guerre civile en France que « la révolution communale représente toutes les classes de la société qui ne vivent pas du travail d’autrui » et parle, dans la version définitive, de la Commune comme de « la représentation véritable de tous les éléments sains de la société française », la qualifiant même de « gouvernement véritablement national ». C’est dire si l’analyse de Marx (et donc des marxistes conséquents) est plus subtile et nuancée que la caricature qui en est faite.
Mais accordons à Tombs la prééminence du terme « peuple » sur celui de « prolétariat » lors de la Commune. Qu’est-ce que cela prouve ? Comme l’explique Jacques Rougerie dans un article intitulé « Le peuple de 1870-1871 » : « l’important n’est pas tant de constater cette prééminence immédiatement évidente du terme, que d’en rechercher le contenu en 1871 »[5]. Et quel est le contenu du mot « peuple » dans la bouche des Parisiens de l’époque ? Rougerie répond : « ce qui le définit au premier chef, comme tout au long du premier XIXe siècle, c’est le travail » et précise : « peuple s’oppose fondamentalement à bourgeoisie ». Il ajoute que « Peuple, Paris, prolétaires, producteurs, citoyens s’équivalent ou à peu près, comme classes laborieuses, travailleurs, peuple travailleur »[6]. « Peuple » et « prolétariat » sont donc, à l’en croire, quasiment synonymes en 1871. Les opposer l’un à l’autre n’a donc aucun sens d’un point de vue historique (mais a bien sûr une signification politique évidente).
Et contrairement à ce qu’écrit Robert Tombs, il ne fait pas de doute, lorsqu’on se penche sur les documents de l’époque, qu’une partie significative des communards revendiquait bel et bien son appartenance au « prolétariat ». Par exemple les membres du club Ambroise, aussi appelé… « club des prolétaires », l’un des plus importants de la Commune, qui décide en mai 1871 de publier un éphémère journal qu’il intitule… Le Prolétaire, dans lequel on peut lire : « Nous sommes le prolétariat, c’est-à-dire cet homme-peuple… »[7]. Ou le « délégué au Journal officiel » – sans doute Charles Longuet – dans un article intitulé « la Révolution du 18 mars », publié dans le Journal Officiel de la Commune du 20 mars :
« Les prolétaires de la capitale, au milieu des défaillances et des trahisons des classes gouvernantes, ont compris que l’heure était arrivée pour eux de sauver la situation en prenant en main la direction des affaires publiques. (…) La bourgeoisie (…) ne comprend-elle pas aujourd’hui que le tour de l’émancipation du prolétariat est arrivé ? »[8].
Frappant obstinément sur le même clou, l’historien britannique écrit ailleurs que « les communards ne formaient pas un “prolétariat” – si nous utilisons ce terme pour désigner principalement un ensemble d’ouvriers non qualifiés travaillant à une assez grande échelle dans des industries modernes, plutôt que dans l’usage contemporain plus large du terme “prolétariat”, comprenant ceux qui travaillent pour gagner leur vie »[9]. Ce qui signifie textuellement que les communards ne peuvent être rattachés au « prolétariat » si l’on entend par là désigner les ouvriers de la grande industrie concentrée (au sens que l’on donnera au mot au XXe siècle). Mais si l’historien se dispense de ce grossier anachronisme et emploie le terme dans son acception de 1871, alors les communards font bel et bien partie du prolétariat, c’est-à-dire de « ceux qui travaillent pour gagner leur vie ». Les hommes et les femmes de 1871 (Marx compris) utilisaient évidemment les mots de leur époque en les chargeant du sens de l’époque. « La simple prudence voudrait, quand nous n’en sommes qu’à la préhistoire du mouvement socialiste, qu’on accorde aux mots de 1871 que leur contenu de 1871 »[10] avertissait Rougerie en 1964. Qui a jamais prétendu que les communards étaient des OS travaillant à la chaîne dans l’automobile ? Si cette absurde caricature attribuée à des marxistes imaginaires (ou en tous cas anonymes) prétend disqualifier « la grille de lecture marxiste », c’est un peu court.

29 mai 2021 – La « montée au mur » du cent-cinquantenaire ©Stathis Kouvélakis
« Antagonismes sociaux » contre « lutte des classes » ?
Selon la même méthode, après le prolétariat, vient logiquement le tour de la lutte des classes. Ainsi Quentin Deluermoz fait-il mine de s’interroger : « La Commune dans l’Histoire : lutte des classes ou surgissement spontané des exploités ? »[11]. L’alternative n’a en elle-même guère de sens (le second terme n’excluant évidemment pas le premier), mais on devine qu’elle n’est posée que pour nier la pertinence d’une lecture de l’événement en termes de lutte de classes. Le même historien est d’ailleurs plus affirmatif dans un autre texte : « L’analyse en termes de lutte des classes a été mise à mal : dans cette révolution de travailleurs, les notions de “peuple” et “d’antagonismes sociaux” prévalaient »[12]. Comme cette citation est extraite d’un article consacré à « Jacques Rougerie, historien de la Commune » – à qui est donc attribué le mérite d’avoir « mis à mal » « l’analyse en termes de lutte des classes », nous y reviendrons –, le plus simple est sans doute de laisser Rougerie lui-même « répondre » à Deluermoz :
« Il y aurait donc une minorité – mais une minorité seulement – d’ouvriers et d’ouvrières dotés d’une véritable conscience de classe. Le vrai problème n’est pas là. Nous sommes en 1871, nous ne sommes qu’en 1871. Prenons garde que notre vocabulaire habituel (…) risque ici d’être tout à fait inadapté, anachronique à rebours. (…) il y a bien – même et y compris dans la plus petite entreprise, dans la plus artisane – un irréductible antagonisme, et un antagonisme pleinement ressenti, entre patron et salarié, ou mieux entre exploiteur et producteur. Ce n’est pas haine de classe : nous avons vu que celle-ci se fixe sur d’autres adversaires. Mais l’ouvrier de 1871 (comme celui de 1848) a très simplement conscience d’être, dans l’association qui le lie avec un patron, le seul véritable producteur. L’idée est exprimée sans cesse (…) l’ouvrier se sait lésé d’une part de ce qui lui appartient, et (…) il faut que cela change. »[13].
Rougerie souligne certes que le communard a de multiples ennemis – d’abord et dans cet ordre : le prêtre, le marchand qui spécule et affame le peuple, et le propriétaire parasite qui prélève par le loyer une part considérable du revenu du travailleur – et que l’antagonisme capital/travail n’est, selon lui, ni le seul, ni même le premier. Mais on voit aussi que loin de nier cet antagonisme « entre patron et salarié », il insiste au contraire sur le fait que le conflit « irréductible » « entre exploiteur et producteur » est alors « pleinement ressenti » jusque « dans la plus petite entreprise ». On notera au passage qu’il adresse aux historiens de la Commune une véritable leçon de méthode historique. Il répond en effet par avance à ceux qui, comme Tombs, font mine de se demander « pourquoi les communards, dans leurs mots et dans leurs actions (notamment dans leurs déclarations officielles et leur législation), n’ont-ils pas défini le conflit comme une lutte de classe ? »[14], que « le vrai problème n’est pas là », qu’il est « anachronique » et « inadapté » de demander à des révolutionnaires de 1871 d’utiliser les mots de 1917, et surtout que ce n’est pas parce que le mot n’y est pas que la chose fait défaut. La lutte des classes étant, on le sait, une réalité indépendante du degré de conscience qu’en ont ses acteurs.
Mais au fait, est-il bien vrai que « dans leurs mots » les communards n’ont « pas défini le conflit comme une lutte de classe » ? Pour le vérifier, il faut se plonger « en bas », parmi le petit peuple communard, et tendre l’oreille à ce qui se dit alors dans les clubs de la capitale. Écoutons par exemple cette oratrice du club féminin de la Délivrance à l’église de la Trinité :
« Pour nous autres, la plaie sociale qu’il faut d’abord fermer, c’est celle des patrons, qui exploitent l’ouvrier et s’enrichissent de ses sueurs. Plus de patrons qui considèrent l’ouvrier comme une machine de produit. Que les travailleurs s’associent entre eux, qu’ils mettent leur labeur en commun et ils seront heureux »[15] ;
ou cet ouvrier sculpteur qui, dans un projet qu’il soumet à la Commission du Travail et de l’Échange, se fixe comme objectif explicite « l’abolition du patronat, exploitation de l’homme par l’homme »[16] ; ou l’ouvrier tailleur Dupire : « Nous voulons qu’il soit mis un terme à l’ignoble exploitation des travailleurs par les capitalistes »[17] ; ou encore le communard Paget-Lupicin décrire, quelques mois avant la Commune, dans une brochure intitulée le Droit du travailleur, l’antagonisme social à ses yeux fondamental : « D’un côté les exploiteurs, de l’autre les exploités. (…) Ici les salariés, là les patrons. Ici les prolétaires, là les capitalistes ». Écoutons enfin les participants à la réunion républicaine de Charonne, 58 rue de Bagnolet, qui votent à l’unanimité en janvier 1871 la résolution suivante :
« Les citoyens et citoyennes présents à cette réunion, composée exclusivement de travailleurs victimes du capital » en appellent à l’unité des « républicains socialistes » afin « d’instituer d’office la Commune, Commune révolutionnaire dont la majorité des membres, pour être juste, devra être composée d’ouvriers ; d’ouvriers vrais, d’ouvriers non patrons, mais d’ouvriers travaillant de leurs mains pour subvenir à leurs besoins » « en remplaçant les hommes de l’Hôtel de ville [c’est-à-dire le gouvernement de la Défense nationale], débris et échos de toutes les royautés, ligue permanente et impitoyable de l’exploitation du prolétariat ».
Rougerie, qui cite ce document, commente : « Texte remarquable ! Rarement a été mieux mis en valeur l’antagonisme du capital et du travail, dont quelques-uns sont déjà clairement conscients »[18].
Les textes de l’Union des femmes sont par ailleurs tout à fait explicites sur le sens que donnent ces citoyennes à « ce combat à mort (…) du travail et de l’exploitation »[19] visant à « la rénovation sociale absolue, l’anéantissement de tous les rapports juridiques et sociaux existant actuellement, la suppression de tous les privilèges, de toutes les exploitations, la substitution du règne du travail à celui du capital, en un mot, l’affranchissement du travailleur par lui-même ! »[20]. D’où leur engagement dans la constitution d’associations coopératives de production visant à « soustra[ire] le travail au joug du capital exploiteur »[21]. Précisons que l’Union des femmes n’a rien du « groupuscule gauchiste », c’est pour l’époque une organisation de masse, implantée dans tous les arrondissements parisiens, organisant plusieurs milliers de travailleuses, c’est-à-dire davantage que la plupart des chambres syndicales parisiennes.
On pourrait certes objecter qu’il s’agit de documents d’« en bas » et qu’au sommet de la Commune le discours est différent. C’est en partie vrai, mais en partie seulement. Plusieurs textes officiels de la Commune expriment en effet, dans le vocabulaire de l’époque évidemment, l’antagonisme entre travailleurs et patrons. Même dans sa Déclaration au peuple français du 19 avril 1871, votée par le Conseil de la Commune à l’unanimité moins une voix, considérée comme son texte programmatique essentiel, largement cité et commenté par Marx, et si souvent mise en avant par les historiens pour illustrer la « confusion » et la « modération » de la Commune, la révolution communarde, on l’a vu, se fixe explicitement comme objectif « d’universaliser le pouvoir et la propriété » et « la fin » « de l’exploitation » à laquelle « le prolétariat doit son servage ». On pourrait ainsi multiplier les exemples montrant qu’il est tout simplement faux de prétendre que « les communards » n’ont « pas défini le conflit comme une lutte de classe ».

Paris, 29 mai 2021 – Père Lachaise, devant le mur des Fédérés ©Céline Cantat
« Les communards n’étaient pas communistes » ?
La tentative de disqualification du marxisme entreprise par les nouveaux historiens est évidemment guidée par la volonté de nier que la Commune puisse être lue comme une révolution socialiste. Pour cela, ils s’appuient sur le légalisme avéré du conseil de la Commune et sur son respect de la propriété privée, dont l’illustration la plus frappante est son attitude vis-à-vis de la Banque de France. Quentin Deluermoz assure ainsi, on l’a vu, que « contrairement à ce qu’ont espéré un temps les analystes marxistes, les communards dans leur ensemble n’ont pas voulu abolir la propriété »[22]. Robert Tombs, quant à lui, écrit que « la Commune ne manifesta pas un désir doctrinaire de réguler, comptant beaucoup sur les entreprises privées et sur le marché. (…) Aucun décret ne contesta le droit général de la propriété, et la Commune refusa explicitement les mesures d’expropriation »[23] et affirme péremptoirement que « les communards n’étaient pas communistes » [24]. Disons-le tout net, ces affirmations n’ont aucune pertinence historique. Dire que les « communards n’étaient pas communistes » n’a pas plus de sens que d’affirmer qu’ils l’étaient. Le problème n’étant pas de répondre par l’affirmative ou par la négative, mais bien de comprendre ce qu’était le « communisme » de 1871, avant de vérifier dans quelle mesure les communards l’étaient ou ne l’étaient pas. Et qu’était-ce au juste que ce « communisme » de 1871 ? Pour le savoir tendons de nouveau l’oreille à ce que disent les communards. Écoutons d’abord le citoyen Roulleau, cet ouvrier cloutier qui écrit (à sa façon) à la Commune le 26 avril 1871 pour se plaindre : « Citoyens, la Commune donne des commende de clous aux Patron cela nais pas bien et elle doi fair appel aux ouvrier avent moi je suis communiste garde national et inscrit depuis longtemp a la chambre du travail [syndicat des ouvriers cloutiers, membre de l’Internationale] et je ne travail pas parce que je ne veux pas travailler sous la commune pour un patron car on ais trop esclave »[25]. « Communiste », « garde national » et membre du syndicat. Dans cet ordre. L’identité communiste est donc bien revendiquée, parmi d’autres, par certains communards, certes minoritaires. Mais la revendication communiste n’est-elle pas plus largement partagée, même lorsqu’on ne s’en revendique pas explicitement ? Écoutons cette oratrice du club de la Délivrance : « Les ateliers dans lesquels on vous entasse vous appartiendront ; les outils qu’on met entre vos mains seront à vous ; le gain qui résulte de vos efforts… sera partagé entre vous »[26] ; ou ce « citoyen » qui prononce un discours pendant le siège au club de la Cour des miracles : « à l’avenir, ce ne sera plus le travail qui sera l’humble serviteur du capital ; non, ce sera le capital qui deviendra l’esclave du travail. Autre conséquence : tous les outils dont l’ouvrier se sert appartiendront à l’ouvrier. Même chose pour le local, même chose pour la terre »[27] ; ou encore « le citoyen Schneider », qui lors d’une réunion publique à l’Élysée-Montmartre en décembre 1870 explique que la Commune à venir « commanditera des associations ouvrières qui remplaceront les patrons, les grandes compagnies, et en particulier les compagnies de chemin de fer, dont elle congédiera les actionnaires, les administrateurs et autres parasites »[28]. Le mot « communisme » n’est certes pas prononcé, quant à l’idée on peut difficilement contester qu’elle y soit. Jacques Rougerie en explicite le contenu :
« Les ouvriers, formés en syndicats, entendent s’emparer dans chaque profession du monopole de la production, devenir “maîtres de leur travail”. Ils ne prétendent pas le faire par une dépossession brutale des patrons (notre collectivisation), mais par une opération savamment progressive (…) jusqu’à l’élimination totale du patronat »[29].
Comment nommer cette ambition de se rendre maîtres des outils de production jusqu’à élimination du patronat, sinon, pour paraphraser Marx, de « possible » communisme ?
Un « communisme » qui n’est certes pas celui du XXe siècle et coexiste avec des identités du passé, comme l’illustre cette lettre d’un ouvrier se réclamant de « l’hébertisme » à destination des élus de la Commune :
« Cela ne marche pas, citoyen, la Commune est en-dessous de sa mission (…). En ce moment il n’y a qu’un droit, c’est celui du prolétaire contre le propriétaire et le capitaliste, du pauvre contre le riche et le bourgeois (…). Qu’on ne nous berne plus avec ces mots vides de sens et vieux de probité, respect de la propriété, de droit, de produit du travail et de l’épargne ; tout nous revient, à nous prolétaires, tout est à nous, et nous le prendrons, entendez-le bien, beaux parleurs de l’Hôtel de Ville »[30].
On voit par cet exemple qu’il est faux de vouloir opposer, comme le font systématiquement les nouveaux historiens de la Commune, l’héritage sans-culotte au « communisme » ou au « socialisme » du communard. En effet, comme l’explique Marx, « la tradition de toutes les générations mortes pèse d’un poids très lourd sur le cerveau des vivants. Et même quand ils semblent occupés à se transformer, eux et les choses, à créer quelque chose de tout à fait nouveau, c’est précisément à ces époques de crise révolutionnaire qu’ils évoquent craintivement les esprits du passé, qu’ils leurs empruntent leurs noms, leurs mots d’ordre, leurs costumes, pour apparaître sur la nouvelle scène de l’histoire sous ce déguisement respectable et avec ce langage emprunté »[31]. Jacques Rougerie ne dit au fond pas autre chose :
« Peut-il s’agir des mêmes hommes qui veulent la Terreur ou le maximum des subsistances, et l’expropriation du Capital ? (…) le socialisme ne se fait vigoureux et conscient que chez un petit nombre de cadres ouvriers de l’insurrection, tandis que plus on est peuple, plus foncièrement on est encore sans-culotte. Mais tout compte fait, ces deux aspects ne sont-ils pas confondus, à la fois confusément et profondément ? (…) Il y a mille exemples, en 1871, de cette intime union, contradictoire seulement en apparence, contradictoire pour des idéologues, de la vieille tradition révolutionnaire de 93 et du socialisme en train de naître »[32].
Un « socialisme en train de naître » que Georges Bertin, par exemple, ouvrier typographe membre de l’Internationale et secrétaire de la commission du Travail et de l’Échange, entend contribuer à édifier en favorisant le développement des associations ouvrières de production pour « soustraire le travail à l’exploitation du capital », « soustraire le travailleur à l’influence des capitalistes monarchistes »[33] et réaliser « la révolution de l’égalité sociale »[34]. De nombreux communards inscrivaient donc leur action dans une perspective clairement « socialiste » ou « communiste », et la Commune elle-même, en dépit de son légalisme avéré, a parfois parlé un langage clairement socialiste. Le texte adressé « Au travailleur des campagnes » – rédigé par André Léo, signé « les travailleurs de Paris », mais imprimé par la Commune (qui se reconnaît donc dans la présentation qu’il fait de son combat) à 100.000 exemplaires pour être diffusé dans les provinces – ne dit-il pas explicitement « ce que Paris veut, en fin de compte, c’est la terre au paysan, l’outil à l’ouvrier, le travail pour tous » ? La grande majorité des élus au conseil communal, y compris parmi ceux qui ne faisaient pas partie de l’Internationale, se définissaient d’ailleurs comme « socialistes »[35]. Rougerie est donc tout à fait fondé à écrire que « l’insurgé de 71 est bien aussi un socialiste, en son temps, à sa façon »[36], ce qui sous-entend que son « socialisme » n’est évidemment pas celui du XXe siècle, mais aussi et surtout qu’il est anachronique de rechercher dans la Commune ce socialisme du XXe siècle, que ce soit pour la réduire à un prélude de la révolution bolchévique ou, au contraire, pour lui refuser toute dimension socialiste.
On touche là à un problème de méthode historique. Ce n’est pas le seul. Outre l’anachronisme, les travaux de la nouvelle historiographie sont aussi marqués par ce qu’il faut bien appeler un « objectivisme » forcené. Le nouvel historien de la Commune ne croit en effet que ce qu’il voit, et il ne voit que ce qui « est », c’est-à-dire ce qui est réalisé. Pour lui, en toute logique, en toute objectivité, une chose « est » ou « n’est pas », c’est aussi simple que ça. Et comme il ne voit pas « le socialisme » réalisé durant les 72 jours de la Commune, il conclut qu’elle n’est « pas communiste ». On lui objectera que suivant cette méthode, il faut également refuser la qualité de « communiste » à la révolution d’Octobre 1917 qui non seulement ne collectivise pas les terres mais les distribue aux paysans, comme la première « révolution bourgeoise » venue, et attend juillet 1918 (autant dire une éternité à l’échelle de la Commune) pour exproprier les capitalistes[37]. Nul doute que si la révolution bolchévique avait, comme la Commune, péri après 72 jours, il se trouverait aujourd’hui des historiens pour expliquer doctement, qu’au regard de son « maigre bilan », elle n’était « pas communiste »…
A juste titre, Jacques Rougerie récuse cette lecture « objectiviste » et montre qu’il faut aborder la révolution communarde comme un processus. Si au début la « Révolution ne s’est pas encore tout à fait reconnue elle-même »[38] et si « à la lettre (…) le Comité central dans sa grande majorité, sauf quelques hommes décidés, ne voulait [pas] de “révolution”, au sens exprès du terme (…). Plus en profondeur, plus réellement si l’on veut, l’évidence est non moins forte, ce qui progressivement se dévoile à travers tant de péripéties, c’est l’exigence d’infiniment davantage. La République qu’entend Paris, “avec toutes ses conséquences”, c’est le gouvernement du peuple par le peuple, c’est “la Sociale” (…). Tout ceci confusément encore, mal défini, difficilement exprimé, suffisamment toutefois pour apeurer sérieusement les bourgeois, même républicains : à preuve leur hâte à quitter maintenant la capitale. Ce qui n’avait été au premier chef que le combat républicain de la Ville contre les royalistes ruraux se transformait, ne pouvait que se transmuer inexorablement en révolution politique et sociale »[39].
La preuve la plus irréfutable de la dynamique socialiste engagée par la Commune, ne réside-t-elle pas, en effet, dans la réaction qu’elle provoque « en face », du côté des possédants ? Citant le républicain versaillais Jules Favre le 21 mars – « Est-ce que nous ne savons pas que les réquisitions commencent, que les propriétés privées vont être violées » – Rougerie commente malicieusement : « celui-là a bien compris que c’est une guerre sociale qu’on vient de déclarer. (…) Souvent, ce sont ses adversaires qui comprennent le mieux, le plus vite, le sens d’une révolution »[40].

Paris, place de la République, 29 mai 2021 ©Céline Cantat
Marx et Engels faux amis de la Commune ?
S’appuyant sur la correspondance de Marx et d’Engels, certains commentateurs suggèrent qu’ils auraient tenu un double discours sur la Commune, l’héroïsant en public, dans La Guerre civile en France par exemple, et la dénigrant « en privé ». Tombs assure ainsi, on l’a vu, que « les analyses marxistes classiques (…) comportent de nombreux mythes, des illusions rétrospectives et des déformations polémiques, comme Engels l’admettait en privé »[41]. Il ne donne aucune référence pour étayer son propos, mais on peut penser qu’il se réfère à une lettre à Bernstein de 1884, dans laquelle Engels écrit : « Le fait que dans la Guerre civile les tendances inconscientes de la Commune aient été portées à son compte comme des plans plus ou moins conscients était, dans les circonstances, justifié, voire nécessaire »[42]. Faut-il, comme certains auteurs, y lire l’aveu d’un gros mensonge ?
Ce serait faire un complet contresens. D’abord parce que La Guerre civile en France, bien qu’entièrement rédigée par Marx, est une Adresse du Conseil général de l’Internationale, c’est-à-dire un texte engageant collectivement les membres de ce Conseil général, dans lequel Marx ne peut donc s’adonner à la stricte expression de son point de vue personnel et doit tenir compte des exigences de synthèse inhérentes à la nature collective du texte en question (ce qui n’est pas le cas dans sa correspondance, qui n’engage que lui). Ensuite parce que lorsqu’il évoque les « tendances inconscientes » de la Commune, que Marx aurait présentées « comme des plans plus ou moins conscients », Engels ne fait que reprendre la distinction établie par Marx, par exemple dans sa préface à la Critique de l’économie politique (1859), entre le processus historique réel, marqué par la lutte des classes, et « les formes idéologiques sous lesquelles les hommes prennent conscience de ce conflit ». Ce qui signifie que, contrairement à ce que suggère Tombs, Marx n’attribue nullement à la Commune un contenu qu’elle n’aurait pas en réalité, il ne fait qu’expliciter des « tendances inconscientes » qui sont pour lui bien réelles, car « pas plus qu’on ne juge un individu sur l’idée qu’il se fait de lui-même, on ne saurait juger une telle époque de bouleversement sur sa conscience de soi ». Enfin parce que La Guerre civile en France n’est pas, et n’a jamais prétendu être, une histoire de la Commune (et encore moins une histoire « objective »). C’est un texte de combat, rédigé alors que la lutte fait encore rage à Paris, qui prend résolument son parti, et vise à la défendre contre les calomnies de la grande presse internationale la présentant comme une orgie plébéienne et un complot de l’AIT. Il s’agit donc d’un plaidoyer héroïsant la Commune, dont le contenu est alors « nécessairement » presque tout entier dicté et, comme le dit Engels, « justifié » par les « circonstances » de la Semaine sanglante.
De manière plus surprenante, dans un article publié à l’occasion du 150e anniversaire, Michel Cordillot, citant une lettre de Marx, assure que « Dix ans après la Commune, (…) Marx semble en être arrivé à la conclusion que la Commune n’avait pas été la révolution ouvrière ouvrant la voie à l’extinction du capitalisme telle qu’il l’avait imaginée. (…) Il dresse, dans la lettre qu’il adresse à Ferdinand Domela Nieuwenhuis le 22 février 1881, un constat qui se veut réaliste : “Outre qu’elle fut simplement la rébellion d’une ville dans des circonstances exceptionnelles, la majorité de la Commune n’était nullement socialiste et ne pouvait pas l’être. Avec un tout petit peu de bon sens, elle eût pu cependant obtenir de Versailles un compromis favorable à toute la masse du peuple, ce qui était la seule chose possible alors. À elle seule, la réquisition de la Banque de France eût mis un terme décisif aux fanfaronnades versaillaises”. Par rapport à La Guerre civile en France, cette formulation peut certes paraître très en retrait, voire contradictoire ; mais n’était-ce pas là ce qu’il pensait déjà au fond de lui-même durant la dernière décade de mars ? »[43].
Relevons tout d’abord une contradiction interne au texte de Michel Cordillot. Il commence en effet par dire que « dix ans après », Marx « semble en être arrivé à la conclusion que la Commune n’avait pas été la révolution ouvrière ouvrant la voie à l’extinction du capitalisme telle qu’il l’avait imaginée », ce qui sous-entend qu’il a changé d’avis entre 1871 et 1881, pour conclure « n’était-ce pas là ce qu’il pensait déjà au fond de lui-même durant la dernière décade de mars (1871) ? », ce qui suggère au contraire que son opinion n’a pas évolué entre 1871 et 1881. Ces deux hypothèses sont, du reste, également erronées. En effet, lorsqu’il évoque « la majorité de la Commune » qui « n’était nullement socialiste », Marx ne désigne évidemment pas « la Commune » comme expérience révolutionnaire mais uniquement « la majorité » des élus qui composent le conseil communal, c’est-à-dire la Commune comme gouvernement. Loin de renier ce qu’il disait en 1871 sur le « possible communisme » de la Commune, Marx ne fait dans cette lettre de 1881 que pointer les limites de sa direction. Des limites qu’il pointait déjà dans une lettre à Frankel et Varlin en mai 1871 – « La Commune me semble perdre trop de temps avec des bagatelles et des querelles personnelles. On voit qu’il y a encore d’autres influences que celles des ouvriers »[44] –, c’est-à-dire au moment même où il rédigeait La Guerre civile en France. On ne saurait donc lire dans sa lettre de 1881 un jugement « très en retrait », et a fortiori « contradictoire », avec La Guerre civile en France, la critique qu’il formule « dix ans plus tard » sur la Commune-gouvernement ne remettant absolument pas en cause son analyse de 1871 de la Commune-expérience révolutionnaire. En conséquence, il est tout à fait inexact de prétendre qu’en 1881 « Marx semble en être arrivé à la conclusion que la Commune n’avait pas été la révolution ouvrière ouvrant la voie à l’extinction du capitalisme telle qu’il l’avait imaginée ». Et puisque, « dix ans après », Marx n’a pas varié dans son analyse de la Commune, la seconde hypothèse de Michel Cordillot tombe d’elle-même : Marx ne pensait évidemment pas, même « au fond de lui-même », « durant la dernière décade de mars » 1871, c’est-à-dire dès les premiers jours de la Commune (!), qu’elle n’était pas « la révolution ouvrière ouvrant la voie à l’extinction du capitalisme telle qu’il l’avait imaginée ». Pour la simple raison qu’il était alors bien trop tôt pour en juger. Mais cette seconde hypothèse, certes formulée sur le mode interrogatif, est lourde de sous-entendus. Que penser, en effet, de l’auteur de La Guerre civile en France, célébrant en mai 1871 la Commune comme « la forme politique enfin découverte sous laquelle pouvait se mener l’émancipation économique du travail » et « le glorieux fourrier d’une société nouvelle », s’il pensait « au fond de lui-même » depuis le mois de mars que la Commune n’était pas « la révolution ouvrière ouvrant la voie à l’extinction du capitalisme » ? Comment ne pas conclure à la duplicité d’un Marx défendant publiquement une position à laquelle il n’a en réalité jamais cru ?
*
Photo d’illustration : Paris, place de la République, 29 mai 2021 ©Photo Céline Cantat
Notes
[1] Quentin Deluermoz « Jacques Rougerie, historien de la Commune », in Michel Cordillot (dir.), La Commune de Paris 1871, Paris, L’atelier, 2021, p. 1224. Un mérite qu’il accorde aussi, et d’abord, à Jacques Rougerie. Nous reviendrons plus loin sur cette affirmation.
[2] Robert Tombs, Paris bivouac des révolutions, Montreuil, Libertalia, 2014, p. 210.
[3] Cf. Stathis Kouvélakis, « Événement et stratégie révolutionnaire, Marx et Engels à la rencontre de la Commune », in Sur la Commune de Paris, Paris, Editions sociales, 2021, p. 41 et 42.
[4] Ibid., p. 42.
[5] Jacques Rougerie, « Le peuple de 1870-1871 », article (non daté) consultable sur www.commune1871-rougerie.fr.
[6] Ibid.
[7] Le Prolétaire du 10 mai 1871, cité par Rougerie dans « Le peuple de 1870-1871 ».
[8] « La révolution du 18 mars ». Cf. Sur la Commune…, op. cit., pp. 343-345.
[9] Paris bivouac…, op. cit., p. 202.
[10] Jacques Rougerie, Procès des communards [1964], réédition, Paris, Gallimard 2018, p. 382.
[11]Quentin Deluermoz, Commune(s) 1870-1871. Une traversée des mondes au XIXe siècle, Paris, Le Seuil, 2020, p. 300.
[12] Quentin Deluermoz, « Jacques Rougerie, historien de la Commune », in Michel Cordillot (dir.), La Commune de Paris…, op. cit., p. 1224.
[13] Procès des Communards…, op. cit., p. 353 et 355.
[14] Paris bivouac…, op. cit., p. 201.
[15] Procès des…, op. cit., p. 352.
[16] Ibid., p. 358.
[17] Jacques Rougerie, Paris libre 1871, Paris, Le Seuil, 1971, réédition 2004, p. 237-238.
[18] Ibid., p. 68-70.
[19] « Appel aux citoyennes de Paris » paru dans La Sociale le 11 avril. Source : Stathis Kouvélakis, Sur la Commune…, op. cit., p. 353-355.
[20] « Manifeste du Comité central de L’union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés », publié au JO du 8 mai 1871. in Stathis Kouvélakis, Sur la Commune…, op. cit., p. 357-359.
[21] Ibid.
[22] Commune(s)…, op. cit., p. 170.
[23] Paris, bivouac…, op. cit., p. 168-170.
[24] Ibid., p. 167.
[25] Procès des…, op. cit., p. 351.
[26] Ibid., p. 352.
[27] Ibid., p. 354.
[28] Paris libre…, op. cit., p. 71.
[29] Procès des…, op. cit., p. 358.
[30] Ibid., p. 328 et suivantes.
[31] Karl Marx, Le 18 Brumaire de Louis Napoléon Bonaparte, Paris, Editions sociales, 1968, p. 15.
[32] Procès des…, op. cit., p. 372-373.
[33] Paris libre…, op. cit., p. 179.
[34] Ibid., p. 175-176.
[35] Voir Jean-Louis Robert, « La Commune, révolution socialiste ? », dans Michel Cordillot (dir.), La Commune de Paris…, op. cit., p. 931.
[36] Paris libre…, op. cit., p. 235.
[37] Je reprends ici un argument développé dans un article signé César Corte, « La Commune, le Front unique et les libertés », La Vérité, n°552, mai 1971.
[38] Paris libre…, op. cit., p. 132.
[39] Ibid., p. 134-135. Son analyse rejoint celle que faisait en 1908 Louis Dubreuilh, un proche d’Édouard Vaillant à qui Jaurès avait confié la rédaction du volume de son Histoire socialiste consacré à la Commune : « Elle fut, dans son essence, elle fut dans son fond, la première grande bataille rangée du Travail contre le Capital. Et c’est même parce qu’elle fut cela avant tout, d’un républicanisme qui n’était qu’un socialisme s’ignorant et qui allait jusqu’à menacer les bases du vieil ordre social et à évoquer un ordre nouveau, qu’elle fut vaincue et que vaincue elle fut égorgée ».
[40] Ibid., p. 123.
[41] Paris bivouac…, op. cit., p. 355.
[42] Lettre de Friedrich Engels à Édouard Bernstein, 1er janvier 1884, in Sur la Commune…, op. cit., p. 303.
[43] Michel Cordillot, « Ce qu’en disait Marx », L’Histoire,hors-série n°90, janvier 2021, p. 85.
[44] Lettre de Karl Marx à Frankel et Varlin, 13 mai 1871, in Sur la Commune…, op. cit., p. 292.




