Agenda militant
Ailleurs sur le Web
![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)
- Antifascisme et LFI : les médias brutalisent le débat public (24/02)
- À Paris, la dynamique Chikirou (23/02)
- Meeting de la campagne municipale à Besançon (23/02)
- Municipales : La FI comme ligne stratégique ou l’usage contre-révolutionnaire de l’autonomie et de la radicalité (23/02)
- Conférence de presse de Mélenchon face aux nouveaux médias (23/02)
- Quand la finance colonise l’État (23/02)
- Faire face aux nazis, royalistes, fachos, identitaires, racistes... (23/02)
- À Bobigny, enseignants et collectifs mobilisés pour leurs élèves sans papiers (23/02)
- Francesca Albanese : itinéraire et succès d’une fake news (23/02)
- PS : 40 ANS DE TRAHISON ! (Saïd Bouamama, Nicolas Da Silva, Stefano Palombarini, Dr Zoé) (22/02)
- L’extrême droite : une histoire de morts (Ludivine Bantigny) (22/02)
- Manu Bompard et Mathilde Panot dans les médias ce dimanche (22/02)
- Rojava : l’État autonome kurde en Syrie en voie de disparition (21/02)
- Pour un antifascisme de masse ! (21/02)
- CENSURE PARTOUT : "On est une colonie numérique américaine" - Fabrice Epelboin (21/02)
- Affirmer notre antifascisme : le devoir du moment (20/02)
- Alternative communiste : Refuser l’instrumentalisation (20/02)
- L’AFFAIRE QUENTIN DERANQUE : CONTEXTE POLITIQUE et ANTI-FASCISME (20/02)
- LFI DANS LE VISEUR POLITICO-MÉDIATIQUE : À QUI PROFITE LA MORT DE QUENTIN DERANQUE ? (20/02)
- Mort de Quentin à Lyon : contre-enquête au cœur d’une ville gangrénée par la violence d’extrême-droite (20/02)
- Notre amie et camarade Susan George nous a quitté·es (19/02)
- Les titres de la presse auxquels vous avez échappé (19/02)
- Mort de la diplomate Leïla Shahid, éternel visage de la Palestine en France (18/02)
- Lordon : Les collaborateurs (18/02)
- NPA - L’Anticapitaliste : Défendre LFI, faire front face à la fascisation (18/02)
Liens
Les jeunes : victimes particulières du système capitaliste... et particulièrement enclins à la révolte
Nous nous adressons régulièrement, dans nos publications et notre activité, « aux travailleurs et aux jeunes ». Cette formule ne signifie pas que nous mettions ces deux catégories sur le même plan : contrairement aux travailleurs salariés, les jeunes ne forment pas en tant que tels une classe sociale. Leurs origines, leur situation, leurs conditions de vie sont profondément diverses : parler de « la jeunesse » comme si elle existait en-dehors de toute appartenance sociale, est idéologiquement pervers. Souvent le discours des médias et des politiciens bourgeois l’évoquent soit pour en louer les vertus (« la jeunesse » est alors vue comme « saine », porteuse de l’avenir du pays et bien sûr comme capital humain propre à « régénérer » le système) soit pour en mépriser les modes et les valeurs (« la jeunesse » apparaît en ce cas comme inquiétante, déviante voire délinquante ; elle est régulièrement associée à une sorte de « nouvelle classe dangereuse », voire à une forme de barbarie (1)). Ce double discours est une constante historique, et il a une teneur politique essentielle : il s’agit dans les deux cas d’instrumentaliser les jeunes, de les enfermer dans des généralités caricaturales, mais aussi de faire comme si la jeunesse était un groupe social à part entière, qu’il faudrait utiliser tout en s’en méfiant.
Pour autant, s’il est faux faire de « la jeunesse » une catégorie sociale (la biologie — une étape de la vie — ne fait pas une sociologie — un âge social avec des fonctions et des statuts déterminés), il y a des caractéristiques propres aux jeunes dont il faut tenir compte. Les uns sont des travailleurs salariés (y compris la moitié des étudiants d’aujourd’hui en France), mais ils subissent alors une exploitation spécifique à leur âge, une instrumentalisation économique que le système capitaliste prétend justifier en lui donnant des raisons de « nature » : on a 16, 20, 25 ans, il serait « normal » à cet âge de subir des discriminations à l’embauche, au salaire et aux conditions de travail. Les autres sont protégés de l’exploitation, lycéens ou étudiants ; mais leur instruction leur donne la possibilité de développer leurs facultés intellectuelles, notamment leur esprit critique — même si l’enseignement est largement tributaire de l’idéologie dominante ; de plus, ils sont aujourd’hui, dans leur grande majorité, enfants de travailleurs salariés et futurs travailleurs salariés eux-mêmes. Enfin, qu’ils soient travailleurs ou scolarisés, les jeunes ont en commun que les contraintes professionnelles et/ou familiales pèsent souvent moins sur eux que sur leurs aînés. Leur volonté de s’affirmer comme individus libres, l’énergie inhérente à leur âge, leur spontanéité et souvent leur soif d’utopie concrète leur donnent une disposition psychologique particulière qui, dans certaines situations historiques, peuvent jouer un rôle déclencheur de grands événements politiques et sociaux dont les classes sociales restent les protagonistes fondamentaux.
Quand mûrit une situation qui suscite particulièrement la contestation, voire la révolte, l’Histoire montre que les jeunes, travailleurs ou scolarisés, sont très souvent parmi les plus actifs et les plus radicaux ; chez eux, l’élément de la spontanéité, décisif dans tout mouvement social d’envergure, joue un rôle particulièrement saillant. De fait, les mouvements contestataires et révolutionnaires des XIXe et XXe siècles, dans tous les pays, ont vu généralement beaucoup de jeunes dans les rangs de l’avant-garde.
L’exploitation capitaliste des enfants et des adolescents au XIXe siècle
Le capitalisme dévoreur de chair fraîche
Au XIXe siècle, la bourgeoisie comme classe et son État ont pris conscience de la nécessité de réguler le travail des enfants et des adolescents. Ils étalèrent ainsi au grand jour leurs contradictions propres, comme Marx l’a montré dans le Capital. Car par essence, le capitalisme « pousse à l’exploitation productive des enfants » (2). C’est son fonctionnement même, reposant notamment sur l’extraordinaire développement du machinisme, qui a conduit à cet embrigadement économique des plus jeunes — comme des femmes : « Quand le capital s’empara de la machine, son cri fut : “Du travail de femmes, du travail d’enfants !” Ce moyen puissant de diminuer les labeurs de l’homme se changea aussitôt en moyen d’augmenter le nombre de salariés ; il courba tous les membres de la famille, sans distinction d’âge et de sexe, sous le bâton du capital. » (3) Il y avait là, outre cet appoint considérable d’exploités placés sous le joug du capital, un bon moyen de déprécier la valeur de la force de travail. Enfants et adolescents fournissaient de fait une main-d’œuvre très bon marché (quatre à dix fois moins chère que celle des hommes adultes), qui venait directement concurrencer les autres travailleurs.
La législation sur le travail des enfants : un compromis nécessaire au capitalisme
Or cette façon de jeter une main-d’œuvre juvénile dans les griffes des entreprises capitalistes ne pouvait que causer de véritables catastrophes humaines, pour la santé et la vie de ces enfants et de ces adolescents : altérations des poumons, bronchites chroniques, asthmes, scrofules, rachitisme, mortalité précoce (4)… La situation était tellement grave que les parlementaires bourgeois furent contraints de réagir. C’est ainsi que le Parlement anglais adopta au milieu des années 1830 une législation selon laquelle aucun enfant en dessous de 13 ans ne devait travailler plus de huit heures dans une fabrique (5). Et, en 1850, la journée de travail « des adolescents et des femmes » passa officiellement de 15 à 12 heures. En France, il fallut attendre 1841 pour qu’une loi interdise le travail… des moins de 8 ans ! En 1874, le travail industriel fut interdit aux moins de 12 ans et le travail de nuit interdit avant 16 ans pour les garçons et 21 ans pour les filles ; en 1892, la journée de travail fut limitée à dix heures jusqu’à 16 ans ; en 1900, elle passa à dix heures pour les moins de 18 ans. L’obligation scolaire, et corrélativement l’interdiction du travail en dessous de ce seuil, fut portée à 13 ans en 1882, 14 ans en 1936 et 16 ans en 1959. Cette législation a été récemment remise en cause d’abord par le gouvernement Jospin-Buffet, qui a légalisé le travail des lycéens professionnels à partir de 13 ans dans le cadre des stages en « alternance », ensuite par le gouvernement Chirac-Villepin, qui a porté de 16 à 15 ans l’âge minimum à partir duquel peut être souscrit un contrat d’apprentissage.
Si pareilles législations furent adoptées, ce n’est pas par générosité d’âme ou compassion soudaine de la part des parlementaires bourgeois, mais d’une part parce que l’état de santé et la mortalité des enfants et des jeunes étaient absolument catastrophiques : cela constituait une entrave au bon développement du capitalisme, qui a besoin de travailleurs capables de résister à l’exploitation, aptes à faire la guerre quand il le faut, mais aussi formés, ce qui suppose l’introduction de l’instruction qui limite le temps de travail des jeunes. D’autre part, la protection des enfants contre l’exploitation était une revendication primordiale du prolétariat conscient : la pression de la lutte de classe ouvrière joua un rôle décisif pour l’adoption effective de lois protectrices.
Le capital devait donc passer un compromis sur cette question. Ces lois d’ailleurs furent très souvent bafouées, et leur non-application n’entraînait dans la plupart des cas pour les patrons qui les violaient aucune sanction de la part de l’appareil judiciaire. Car même si le capital avait intérêt globalement à limiter la surexploitation des enfants, les capitalistes particuliers pouvaient toujours être tentés d’aller trop loin : « Après nous le déluge ! ».
« Trente Glorieuses » ?
Des jeunes toujours discriminés par leur âge
Si les enfants (les moins de 13 ans) ont ainsi été progressivement retirés du marché du travail dans les pays les plus développés, les jeunes ont quant à eux continué de subir une exploitation éhontée, qui a été et reste une exploitation spécifique à leur âge, et justifiée par leur âge dans le discours de la bourgeoisie. Au cours d’une période plus récente, familièrement associée à l’avènement d’un bien-être généralisé, ce que les jeunes ont subi en tant que jeunes (6) montre à quel point la relative « prospérité » du système n’a pas engendré l’épanouissement des individus.
Durant ces années 1950 et 1960, les jeunes étaient encore majoritairement des travailleurs. Dans la France de 1956, sur 4,9 millions de jeunes de 14 à 22 ans, plus d’un tiers avait quitté l’école dès 14 ans ; près des deux tiers des 14-20 ans étaient de jeunes travailleurs. Au début des années 1960 encore, 30 % des jeunes du milieu ouvrier et 60 % des jeunes ruraux n’avaient aucune qualification lorsqu’ils entraient dans le monde du travail, dès 14 ans. En 1970, 3,9 millions des 15-24 ans travaillaient dans les usines et les bureaux, contre 2,9 millions présents dans les collèges, les lycées et les facultés. Les étudiants à proprement parler n’étaient encore que 180 000 en 1957 mais leur nombre dépassa les 500 000 en 1968. Pour les jeunes directement happés par le monde du travail, trois situations étaient possibles : ils pouvaient être travailleurs agricoles, souvent alors rattachés à l’exploitation familiale ; ou bien ils étaient placés en apprentissage ; ou bien enfin ils étaient de jeunes salariés dans les secteurs industriel et tertiaire.
De jeunes ouvriers agricoles sans statut ni rémunération
Dans le premier cas, celui des jeunes agriculteurs, la situation était à l’exploitation sans statut. Simplement considérés comme des « aides familiaux », ces ouvriers agricoles (en 1959, ceux-ci étaient près de 300 000 sur les 685 000 jeunes de moins de 25 ans exerçant une profession agricole) ne disposaient d’aucune garantie, à commencer par celle du salaire : ils n’en recevaient aucun le plus souvent. Ils n’avaient par ailleurs aucun droit à une formation spécifique. Ce n’est qu’en 1973 qu’une loi relative au statut des associés d’exploitation a accordé aux aides familiaux un droit à rémunération et à formation professionnelle.
L’« apprentissage », prétexte à l’exploitation sans salaire
La situation des apprentis était elle aussi extrêmement précaire. Elle était également très symbolique du monstrueux cynisme des patrons à l’égard de cette main-d’œuvre juvénile que l’on ne saurait même pas qualifier de « bon marché » : elle était dans la majeure partie des cas purement et simplement gratuite. Au cœur des « Trente Glorieuses », vers 1960, ces jeunes apprentis étaient environ 250 000, répartis dans les professions les plus diverses. Leur rémunération n’était prévue ni par la loi ni par le Code du Travail. La recherche de « petites mains », de coursiers, de manutentionnaires et de femmes de ménage conduisait à la multiplication de contrats abusifs, sans valeur de formation réelle. Embaucher des apprentis permettait en effet aux employeurs de contourner la législation sur les salaires. On passait des contrats de plusieurs années d’« apprentissage » pour des professions qui s’apprenaient en quelques mois voire quelques semaines, ce qui permettait de faire travailler les jeunes à peu de frais. Les syndicats ouvriers dénonçaient ces soi-disant « contrats » comme de véritables escroqueries.
Jeunes salariés, abattements d’âge et « postes de jeunes »
Enfin, les jeunes engagés directement comme salariés dans la production industrielle ou le travail de bureau, soit les deux tiers des 14-20 ans en 1960, subissaient une forme de préjudice de l’âge institutionnalisé. Les arrêtés ministériels dits « Parodi-Croizat (7) », signés entre gouvernement, syndicats et patronat en 1946, avaient officialisé les « abattements d’âge » : à travail égal, les jeunes ne touchaient qu’une certaine proportion du salaire de base en fonction de leur âge — 50 % du salaire pour les 14-15 ans, 60 % pour les 15-16 ans, 70 % pour les 16-17 ans et 80 % pour les 17-18 ans. Au nom d’un prétendu paiement « normal » en proportion de la valeur créée — postulant que les jeunes auraient produit moins que leurs aînés —, les capitalistes se livraient bel et bien à une surexploitation : pour les jeunes, l’abaissement de la valeur de leur force de travail constituait une véritable discrimination (dont l’âge était le prétexte) visant à aggraver la concurrence entre les travailleurs.
Les jeunes, victimes du chômage et de la précarité
En 1968, 39 % des demandeurs d’emploi étaient des jeunes de moins de 24 ans ; ce pourcentage a été multiplié par 3 depuis 1962. Il poursuivit sa progression, atteignant 45,8 % en 1974 et 46,2 % en 1976. À cette date, le taux de chômage des moins de 25 ans (12,2 %) était près de quatre fois supérieur à ce qu’il était dans l’ensemble de la population active. De surcroît, malgré la scolarisation prolongée et donc l’élévation de la formation, les jeunes occupaient une part croissante des emplois non qualifiés. Leurs « chances » de devenir, par exemple, ouvriers spécialisés étaient passées de 14,5 % en 1962 (contre 12,9 % pour l’ensemble de la population) à 15,9 % en 1968 (contre 13,2 %) et 17,6 % en 1972 (contre 12,8 %) (8). « Les jeunes [étaient] sur-représentés sur les situations de travail médiocres et pratiquement absents dans les situations de travail valorisées ou valorisantes (9). »
L’institutionnalisation de la précarité par un gouvernement « de gauche » : les TUC
Les gouvernements successifs, de droite comme « de gauche », ont imaginé toutes sortes de stratagèmes pour justifier toujours un peu plus l’exploitation des jeunes et pour en légaliser la flexibilité. L’un des exemples en est fourni par les « TUC » (« travaux d’utilité collective ») et autres SIVP (« stages d’initiation à la vie professionnelle ») mis en place en 1984 par le gouvernement Mitterrand-Fabius et que deux millions de jeunes ont subis : 20 heures de travail « au service » d’une collectivité locale ou d’un employeur quelconque, soit un mi-temps, payé un quart du SMIC.
Il a fallu pour cela les exclure totalement du salariat protégé en les dénommant « stagiaires » et en les confinant dans un chapitre spécialement créé pour eux, rejeté à la fin du Code du Travail, le livre IX. Rejetés du salariat, cela signifie qu’ils sont « “hors de” : hors des conventions collectives, hors de la législation du travail, celle du SMIC en particulier, hors de la fonction publique, hors des effectifs déclarés par l’entreprise, hors de toute protection sociale normale — retraite, Sécurité sociale… » (10). Les patrons ont battu des mains puisque, tout en étant pour tout ou partie exonérés de charges sociales, ils pouvaient désormais disposer d’une main-d’œuvre quatre fois moins chère, les TUC se substituant purement et simplement à des postes de salariés ! La juteuse idée était venue entre autres du soi-disant « socialiste » Jacques Delors, qui avait déclaré en 1976 lors d’une conférence d’« experts » : il faut « faire éclater nos catégories traditionnelles » et « rompre le clivage entre travail rémunéré et travail gratuit » (11). Et le tout autant soi-disant socialiste Mitterrand eut le front et la condescendance d’assurer à la télévision : « Des jeunes qui n’avaient rien à faire, qui traînaient, vous ne pouvez pas imaginer leur joie d’avoir retrouvé une part de dignité » (12). Ces jeunes sans droit et honteusement exploités pouvaient être qualifiés à juste titre de « parias du travail » et de « sous-classe d’exploités » (13).
Précarité, chômage, discriminations
Aujourd’hui, seuls 25 % des salariés de moins de 25 ans ont un contrat à durée indéterminée ; les autres connaissent stages, intérim, emplois saisonniers, contrats aidés. La situation est tellement grave (et la passivité des directions syndicales sur cette question tellement lourde) que la lutte se spécifie ponctuellement dans le combat contre la précarité, comme en témoigne le récent mouvement des « Stagiaires en colère ». Les diplômes ne suffisent plus à décrocher des emplois correspondant à la qualification : seuls 48 % des emplois non qualifiés sont effectués par des sans-diplôme, contre 83 % à la fin des années 1960 (14). Ce phénomène témoigne d’une tendance à la sur-éducation par rapport aux besoins des patrons : d’où la volonté patronale d’en soustraire une bonne partie au système scolaire le plus tôt possible, ou en tout cas de l’exclure des filières générales.
Le salaire des jeunes souffre également d’une forte discrimination par l’âge : en 2007, le salaire horaire moyen est de 8,54 € pour les moins de 30 ans, 11,54 € pour les 30-45 ans et 13,55 € pour les plus de 45 ans (15). Ce sont les jeunes qui de surcroît sont les plus touchés par le chômage : depuis le début des années 1980, le taux de chômage des 15-24 ans n’a jamais été inférieur à 25 %. À cet égard, il y a bien une spécificité dans la façon dont les jeunes sont victimes du capitalisme.
Cette situation provoque un phénomène dramatique que les sociologues analysent comme tout à fait inédit puisqu’il vient démentir les études menées depuis les travaux de Durkheim (Le Suicide, 1897) : « Alors qu’en France en 1950, les 65-74 ans se suicidaient près de 5 fois plus souvent que les 25-34 ans, le rapport tombe à 1,5 en 1995. » (16) Le suicide est devenu la deuxième cause de mortalité chez les jeunes de moins de 24 ans (derrière les accidents de la route), mais la première cause chez les 25-34 ans. Chaque jour, 380 tentatives et 30 suicides ont lieu en France ; 26 % de leurs auteurs ont moins de 30 ans ; près de 1 000 jeunes de 15 à 24 ans meurent chaque année, par suicide (17).
La participation des jeunes aux mouvements révolutionnaires
Les jeunes comme avant-garde
Dans l’histoire contemporaine, les jeunes, travailleurs ou scolarisés, n’ont eu de cesse de se trouver à la pointe des révoltes et des révolutions. Dans les entreprises, si les jeunes sont souvent moins syndiqués que les « anciens », ils sont néanmoins souvent plus contestataires et ont recours à des formes plus spectaculaires de lutte : non seulement l’absentéisme et le dénigrement carnavelesque du patronat (18), mais parfois le sabotage ou la séquestration de petits chefs ou de patrons… « Dans toutes les grèves du second Empire — surtout quand elles concernent les grandes entreprises modernes (mines, textile) — les jeunes ouvriers sont au premier rang » (19). L’historienne Michelle Perrot l’a elle aussi montré pour les grèves de la période 1871-1890 : parmi les meneurs des grèves, la catégorie des 20-25 ans se détache nettement ; plus de 70 % des grévistes ont entre 15 et 34 ans ; plus précisément, 42 % ont entre 20 et 29 ans ; « 35 ans marque une chute sensible » (20). Au cours des grèves les plus puissantes — celles des mineurs et des métallos à Rives-de-Gier (1894), au Creusot (1899), à Longwy (1905), celles du Front populaire puis de Mai 68 —, ils se sont distingués par leur forte présence parmi les grévistes, l’absence de responsabilités familiales jouant en faveur d’un plein engagement dans la grève. Chaque fois, ces grèves furent caractérisées par leur spontanéité, leur caractère souvent violent, mais aussi leur ténacité.
Au XIXe siècle et durant une bonne partie du XXe siècle, jusqu’aux années 1960 environ, les étudiants n’étaient, quant à eux, pas socialement liés à la classe ouvrière. Ils étaient au contraire une très faible minorité des classes d’âge concernées, issus très généralement de la moyenne et de la grande bourgeoisie. Mais la prolongation même de leurs études contribuait à aiguiser leur esprit critique. Dès lors, ils se trouvèrent fréquemment à l’initiative de mouvements insurrectionnels, liés non à des revendications économiques, mais à des objectifs politiques et démocratiques, lorsqu’il s’agissait de lutter contre un régime autocratique, pour la conquête et la défense de certaines libertés. Les étudiants participèrent ainsi aux grandes révolutions européennes du XIXe siècle. En France, lors des journées de juillet 1830 qui mirent à bas la monarchie restaurée, celle de Charles X, les étudiants participèrent au pillage d’armureries, donnèrent les premiers coups de feu contre l’armée du roi et aidèrent à dresser les premières barricades ; dans les quartiers populaires de l’Est parisien, étudiants républicains et ouvriers participèrent ensemble à la résistance armée, puis à l’offensive finalement victorieuse. En février 1848, ils furent aussi très présents parmi les insurgés qui renversèrent le régime de Louis-Philippe et proclamèrent la République, mais aussi parmi les révolutionnaires du « printemps des peuples » un peu partout en Europe. Dans chacun de ces moments révolutionnaires, le rôle de la classe ouvrière a été moteur et véritablement déterminant ; mais les étudiants ont souvent concouru à déclencher les mouvements.
Cette sensibilité particulière des étudiants à la défense des libertés démocratiques leur a souvent fait rejoindre les ouvriers en lutte. Le cas de la Russie au début du XXe siècle est à cet égard frappant. Subissant directement les contraintes d’un régime particulièrement oppressif, les étudiants se soulevèrent à maintes reprises contre le tsarisme. C’est pourquoi, dès 1901, Lénine en appelait à la jonction des travailleurs et des étudiants : « Les meilleurs représentants de nos classes instruites ont prouvé et consacré, comme en fait foi le sang de milliers de révolutionnaires suppliciés par le gouvernement, leur capacité et leur volonté de secouer de leurs pieds la poussière de la société bourgeoise pour rejoindre les rangs des socialistes. Et il est indigne du titre de socialiste, l’ouvrier qui peut voir d’un œil indifférent le gouvernement envoyer la troupe contre la jeunesse universitaire. L’étudiant a aidé l’ouvrier ; l’ouvrier doit venir au secours de l’étudiant » (21).
De fait, en 1905 comme en 1917, les révolutions russes ont été marquées, dans les villes, par l’alliance des étudiants et des travailleurs. Les universités ont accueilli les premiers grands rassemblements d’ouvriers et d’étudiants, puis des soviets, auxquels les étudiants prirent pleinement leur part. Les grandes révolutions politiques ont ensuite chaque fois connu pareille solidarité et pareille unification entre étudiants et travailleurs. En Hongrie en 1956, c’est bien à la convergence des étudiants et des travailleurs révolutionnaires que l’on a assisté ; la révolution y a d’ailleurs été ouverte par des étudiants qui, à Budapest, organisèrent de gigantesques rassemblements, exigeant entre autres le retrait des troupes soviétiques stationnées dans le pays, des élections générales au scrutin secret et le retour au multipartisme, mais aussi la modification des normes de travail pour les ouvriers et la reconnaissance du droit de grève. Ces derniers mots d’ordre indiquaient clairement l’attention portée par les étudiants aux revendications ouvrières et le caractère prolétarien de leur perspective sociale et politique (22).
Il en fut de même en France en mai 1968, cette grève générale la plus importante du mouvement ouvrier français, que les étudiants ont contribué à mettre en mouvement, très vite relayés, dans les entreprises, par une avant-garde composée souvent de jeunes travailleurs. C’est bien au capitalisme, à l’impérialisme et au gaullisme que les étudiants s’en prenaient dans leurs revendications (23). De multiples tentatives de jonction concrète sur le terrain entre lycéens, étudiants et ouvriers furent alors faites, que les dirigeants du Parti communiste français et de la CGT cherchèrent à toute force à empêcher. À Renault-Billancourt, une manifestation étudiante fut organisée devant l’usine fermée d’autorité. Aux usines Renault de Flins, les combats furent très durs entre ouvriers et étudiants d’une part, forces de l’ordre d’autre part ; la « rencontre entre ouvriers et étudiants s’est opérée contre la volonté de la CGT et du PC qui se sont employés à les dénigrer » (24) . CRS et grévistes aux abords de Flins et de Sochaux les 10 et 11 juin s’affrontèrent là encore violemment ; ces heurts firent trois morts : un lycéen et deux ouvriers (25). On voit ici que les manifestations étudiantes ont été un élément déclencheur d’un mouvement révolutionnaire qui était fondamentalement un mouvement de classe.
La jeunesse révoltée
Mai 68 a trouvé son origine dans la protestation des jeunes contre la guerre du Vietnam (26). Il y avait là un prolongement de la forte mobilisation que, déjà, les jeunes travailleurs « rappelés », comme soldats du contingent, et les étudiants avaient engagée contre la guerre d’Algérie à partir de 1955. D’une part, les rappelés protestèrent massivement contre leur envoi en Algérie, en provoquant des manifestations et des mobilisations un peu partout en France (blocage de trains, voies ferrées envahies, rassemblements imposants, affrontements avec la police et la gendarmerie…). D’autre part, l’UNEF de l’époque (à laquelle un étudiant sur eux était affilié) avait pris des initiatives de manifestations et d’actions, comme les grands rassemblements anti-guerre à Paris et dans les grandes villes de province le 27 octobre 1960, que les partis politiques « de gauche », à commencer par le PCF, ne prenaient pas. Cette prégnance de la lutte contre la guerre chez les jeunes s’explique en partie par le fait que ce sont les jeunes qui servent de chair à canon dans les guerres impérialistes. Ce sont eux qui sont enrôlés dans une militarisation forcée au travers du service militaire. C’est pourquoi les manifestations lycéennes et étudiantes contre la loi Debré remettant en cause les sursis militaires en 1973 ont été extrêmement puissantes et très bien organisées. Mais cette protestation contre le service militaire s’éclaire aussi par la révolte spontanée des jeunes contre l’injustice des guerres et les maux qu’elles engendrent pour les peuples. Par là même, les jeunes se sont une fois de plus retrouvés au premier rang des mobilisations contre la guerre en Irak, par exemple, en 2003.
Au-delà, au cours des trente dernières années en France, lycéens et étudiants ont battu le pavé et se sont mobilisés avec un grand sens de l’organisation et de la lutte : contre la loi Saunier-Seïté en 1976 (loi prévoyant déjà l’autonomie et la mise en concurrence des universités), contre la loi Devaquet en 1986 (tentative d’instaurer la sélection à l’entrée de l’Université), contre la loi Fillon en 2005… Deux mouvements particulièrement puissants ont vu les jeunes se mobiliser sur des questions non pas spécifiques aux réformes touchant directement lycéens et étudiants, mais en tant que futurs salariés, travailleurs en formation, conscients de leur appartenance à la classe ouvrière au sens large : les mouvements contre le CIP (Contrat d’insertion professionnelle, réservé aux jeunes et sous-payé) en 1994 et contre le Contrat Premier Embauche (CPE) et la prétendue « loi sur l’égalité des chances » en 2006 (27). La révolte des jeunes des quartiers populaires en novembre 2005 a exprimé quant à elle le rejet des discriminations à l’embauche, des contrôles d’identité au faciès et la stigmatisation généralisée qui leur est quotidiennement infligée (28). Chacune de ces mobilisations a profondément inquiété la bourgeoisie et le pouvoir d’État qui, chaque fois, y a réagi avec une grande violence, policière et politique. Tant il est vrai que « la peur de la jeunesse est, toujours, la manifestation première de la peur de la révolution elle-même » (29). Mais cette « peur » est en fait une véritable terreur de la bourgeoisie à l’idée que la classe ouvrière puisse prendre le relais, comme l’a exprimé sans détours un ancien conseiller de De Gaulle à propos de Mai 68 : « Face à des situations de ce type, l’État ne peu répondre que par des solutions classiques qui consistent à diviser ce qui est uni : l’université s’est unie au mouvement ouvrier, ce qui, pour un État, est insupportable. il n’est pas possible d’éviter un mouvement ouvrier, mais il n’est pas possible d’avoir en même temps un mouvement étudiant ; il faut à tout prix avoir l’un et l’autre successivement, mais pas ensemble, et le drame de 1968 c’est qu’on les a vu venir, se réunir, se conjuguer et qu’on n’a pas pu empêcher cette vague» (30).
Pour l’organisation autonome de la jeunesse
Les dirigeants révolutionnaires ont toujours appelé tout particulièrement à la mobilisation de la jeunesse et à son organisation autonome. Ils ont sans cesse conjuré les militants de ne pas « craindre la jeunesse », comme y invitait Lénine en février 1905 : « La jeunesse décidera de l’issue de la lutte, la jeunesse étudiante et plus encore la jeunesse ouvrière. Secouez toutes les vieilles habitudes d’immobilité, de respect hiérarchique, etc ! » (31) Il le répétait en octobre de la même année : « Allez aux jeunes ! Formez sur le champ, en tous lieux, des groupes de combat, formez-en parmi les étudiants et surtout les ouvriers ! » (32) Il le redisait encore en 1906 : « Nous sommes un parti de novateurs, et la jeunesse suit toujours de préférence les novateurs. Nous sommes un parti qui combat avec abnégation un vieux régime pourri. La jeunesse sera toujours la première à marcher pour une lutte où il faut faire don de soi […] Nous serons toujours le parti de la jeunesse dans notre classe d’avant-garde ! » (33) Et c’est aussi la raison pour laquelle il prônait à ses camarades d’être « sans réserve partisans de l’indépendance de l’union de la jeunesse sur le plan de l’organisation non seulement parce que les opportunistes craignent cette indépendance, mais quant au fond. Car, sans une complète indépendance, la jeunesse ne pourra pas faire son éducation de bons socialistes, ni se préparer à faire progresser le socialisme. Donc, pour l’indépendance la plus complète de l’union de la jeunesse, mais aussi pour une complète liberté de la critiquer en toute camaraderie pour ses erreurs ! » (34)
Trotsky y insistait également dans le Programme de transition fondant la Quatrième Internationale. Il soulignait la nécessité pour le parti communiste révolutionnaire de s’ouvrir largement aux jeunes, source d’un programme et d’une activité révolutionnaires vivants et ardents : « Quand s’use un programme ou une organisation, s’use aussi la génération qui les a portés sur ses épaules. La rénovation du mouvement se fait par la jeunesse, libre de toute responsabilité pour le passé » (35). Il avait de fait analysé le rôle essentiel des jeunes durant la Révolution d’Octobre au sein du parti bolchevik : « Tout parti révolutionnaire trouve de prime abord un appui dans la jeune génération de la classe montante. La sénilité politique s’exprime par la perte de la capacité d’entraîner la jeunesse. Les partis de la démocratie bourgeoise, éliminés de la scène, sont contraints d’abandonner la jeunesse à la révolution ou au fascisme. Le bolchevisme, dans l’illégalité, fut toujours le parti des jeunes ouvriers. Les mencheviks s’appuyaient sur des milieux supérieurs et plus âgés de la classe ouvrière, non sans en tirer une certaine fierté et considéraient de haut les bolcheviks. Les événements montrèrent impitoyablement leur erreur : au moment décisif, la jeunesse entraîna les hommes d’âge mûr et jusqu’aux vieillards » (36).
De fait, l’un des signes les plus évidentes de la bureaucratisation et de la sclérose des organisations réside toujours dans leur incapacité à attirer les jeunes et dans le vieillissement de leurs membres : c’est vrai aujourd’hui au PCF, dans les principaux syndicats, mais aussi à LO et au PT. Inversement, c’est bien souvent des jeunes qu’est venue la contestation contre les bureaucraties dans le mouvement ouvrier. Ce fut le cas par exemple au sein du PCF lors de la crise de 1931, dite du groupe « Barbé-Célor », dirigeants des Jeunesses communistes accusés par l’appareil stalinien de tenir des réunions fractionnelles clandestines au sein du parti et taxés de « gauchisme » ; ce fut encore le cas pendant la guerre d’Algérie lors de la crise dite « Servin-Canova », et ses rebondissements en 1965 quand, à l’issue d’un travail d’opposition puis de fraction à l’intérieur de l’Union des étudiants communistes (UEC), une centaine de jeunes militants (parmi lesquels Alain Krivine) furent exclus et fondèrent la Jeunesse communiste révolutionnaire (JCR). La SFIO (Section française de l’Internationale ouvrière), ancêtre du Parti socialiste, connut elle aussi plusieurs sécessions de ce type, notamment chez les Jeunesses socialistes de la Seine influencées par le groupe de Marceau Pivert et les trotskystes qui y pratiquaient l’entrisme dans les années 1930, puis au début des années 1960 quand une majorité de jeunes socialistes allèrent rejoindre des partis tout nouvellement fondés, qui se disaient anticapitalistes et revendiquaient l’indépendance de l’Algérie : le Parti socialiste autonome (PSA) puis le Parti socialiste unifié (PSU).
Pour toutes ces raisons — spécificité de l’exploitation et de l’oppression capitalistes à l’égard des jeunes, force insurrectionnelle d’une partie de la jeunesse —, en soumettant à la discussion son Projet de programme, le Groupe CRI y a proposé des revendications transitoires particulières pour les jeunes travailleurs, les lycéens et les étudiants (cf. http://groupecri.free.fr).
Mais surtout, il est essentiel que les jeunes révolutionnaires puissent agir avec la spontanéité, l’énergie et l’enthousiasme qui sont les leurs, même s’ils n’ont pas encore totalement assimilé le programme communiste. Cela demande en effet une longue expérience militante que, par définition, ils ne peuvent avoir, mais qui ne saurait les empêcher d’agir avec force et efficacité. Il est tout aussi nécessaire que, tout en pouvant rejoindre, pour ceux qui le souhaitent, le parti communiste révolutionnaire, les jeunes puissent discuter sur une base égalitaire, donc dans un cadre où ne pèsent pas la pression et l’autorité des militants plus âgés. C’est la raison pour laquelle il est impératif qu’ils disposent d’une organisation indépendante, où ils puissent s’exprimer et agir librement, hors de tout rapport hiérarchique. C’est pourquoi le Groupe CRI se prononce pour la construction d’une organisation de jeunesse communiste, révolutionnaire, internationaliste et réellement autonome.
1) Ce sont bien les termes de « barbares » et « barbarie » qu’ont utilisés par exemple les philosophes Robert Redeker et Catherine Kintzler en novembre 2005 pour qualifier les jeunes qui ont pris part à la révolte des banlieues : cf. Gérard Mauger, L’Émeute de novembre 2005. Une révolte protopolitique, Paris, Éditions du Croquant, 2006, p. 87 et 90.
2) Karl Marx, Le Capital, Livre I, Paris/Moscou, Editions sociales/Éditions du Progrès (en un volume), p. 355.
3) Idem, p. 378.
4) Cf. Roland Caty (dir.), Enfants au travail, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence, 2002, p. 26.
5) Idem, p. 271.
6) Cf. sur ce sujet Ludivine Bantigny, Le plus bel âge ? Jeunes et jeunesse en France de l’aube des « Trente Glorieuses » à la guerre d’Algérie, Paris, Fayard, 2007, p. 77 sq.
7) Ambroise Croizat était un dirigeant du Parti communiste français.
8) Jean-Paul Bachy, Les Jeunes et la société industrielle, Sceaux, Centre de recherches en sciences sociales du travail, 1977, p. 34.
9) Chantal Nicole-Drancourt, Laurence Roulleau-Bereger, Les jeunes et le travail 1950-2000, Paris, PUF, 2001, p. 32.
10) Michel Sérac, Têtes de T.U.C. Nouveaux chantiers de jeunesse, main-d’œuvre à bas prix : les “stages” pour jeunes, Paris, Selio, 1989, p. 15.
11) Cité ibidem, p. 41.
12) Émission d’avril 1985 citée ibidem, p. 19.
13) Idem, p. 61 et 84.
14) Daniel Cohen (coord.), Une jeunesse difficile. Portrait économique et social de la jeunesse française, Paris, Éditions Rue d’Ulm, 2007, p. 16.
15) Rapport de l’INSSE cité in « Salaires. Les femmes et les jeunes pénalisés », Le Monde, 13 décembre 2006.
16) Christian Baudelot, Roger Establet, « Une jeunesse en panne d’avenir », in Daniel Cohen (coord.), Une jeunesse difficile, op. cit., p. 52.
17) Site de l’Institut national de la Jeunesse et de l’Éducation populaire : http://www.injep.fr/Suicide-des-jeunes-2003.html
18) Cf. Gérard Noiriel, Les Ouvriers dans la société françaises XIXe-XXe siècle, Paris, seuil, 1986, p. 74.
19) Jean Bruhat, Jean Dautry, Émile Terse (dir.), La Commune de 1871, Paris, Éditions sociales, 1970, p. 194.
20) Michelle Perrot, Jeunesse de la grève (France 1871-1890), Paris, Seuil, 1984, p. 73-74.
21) Lénine, « Enrôlement forcé de 183 étudiants », Iskra, février 1901, republié in Lénine, Textes sur la jeunesse, Moscou, Editions du progrès, 1970, p. 81.
22) Cf. « L’héroïque révolution de 1956 en Hongrie. Les conseils ouvriers contre la bureaucratie stalinienne, pour le socialisme démocratique », Le CRI des travailleurs n°24, nov.-déc. 2006.
23) Cf. Kristin Ross, Mai 68 et ses vies ultérieures, [trad. fr.] Paris, Éditions Complexe, 2005, p. 14.
24) Xavier Vigna, « La figure ouvrière à Flins (1968-1973) », in Geneviève Dreyfus-Armand, Robert Frank, Marie-Françoise Lévy, Michelle Zancarini-Fournel (dir.), Les Années 68. Le temps de la contestation, Bruxelles, Complexe, 2000, p. 331.
25) Nicolas Hatzfeld, « Les ouvriers de l’automobile : des vitrines sociales à la condition des OS, le changement des regards », ibidem, p. 350.
26) Le 20 mars 1968, un étudiant avait brisé une fenêtre du siège d’American Express pour protester contre la guerre. Il fut arrêté par la police. Plusieurs étudiants avaient déjà été emmenés au poste pour avoir manifesté contre la guerre du Vietnam.
27) Cf. « Bilan et perspectives du mouvement (février-avril 2006) », Le CRI des travailleurs, n° 22, printemps 2006.
28) Cf. « Révolte des banlieues : la violence de la jeunesse populaire répond à la violence du capitalisme et de son État : il lui faut un programme et un parti révolutionnaires ! », Le CRI des travailleurs, n° 20, novembre-décembre 2005.
29) Michel Field, Jean-Marie Brohm, Jeunesse et révolution. Pour une organisation révolutionnaire de la jeunesse, Paris, Maspero, 1975, p. 169.
30) Témoignage de Bernard Ducamin, in De Gaulle en son siècle. Moderniser la France, Paris, Institut Charles de Gaulle/Plon/La Documentation française, 1992, p. 388.
31) Lénine, Lettre à A.A. Bodanov et S.I. Goussev, 11 février 1905, in Textes sur la jeunesse, op. cit., p. 151.
32) Lénine, Lettre au comité de combat près le comité de Saint-Pétersbourg, 16 octobre 1905, ibidem, p. 162.
33) Lénine, « La crise du menchevisme », Proletari, 7 déc. 1906, ibidem, p. 183.
34) Lénine, « L’Internationale de la jeunesse », Recueil du Social-Démocrate, déc. 1916, ibidem, p. 212.
35) Léon Trotsky, Programme de transition, chapitre XX.
36) Léon Trotsky, « La Révolution trahie » in De la révolution, Paris, Éditions de Minuit, 1963, p. 545.






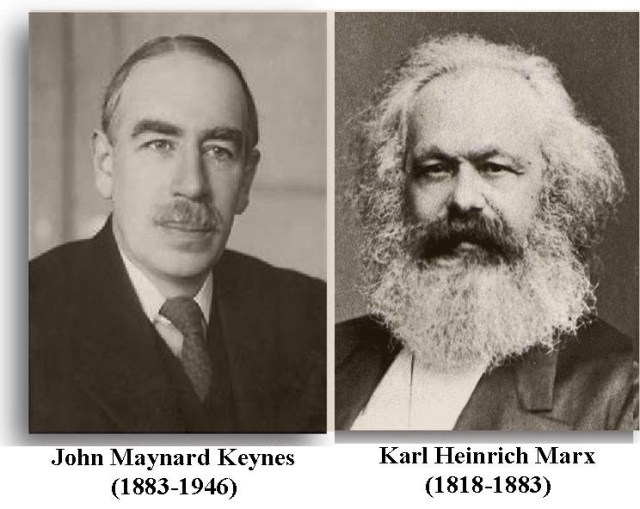

.png)