Agenda militant
Ailleurs sur le Web
![S’abonner au flux RSS [RSS]](images/rss.jpg)
- Au cœur du capital (12/03)
- Le débat des représentants des partis, avec Paul Vannier (12/03)
- Meeting avec Bagayoko, Coquerel et Mélenchon à Saint-Denis ! (11/03)
- Ludivine Bantigny, "La Bourse ou la vie. Le Front populaire, histoire pour aujourd’hui" (11/03)
- C’est quoi le "marxisme classique" et le "marxisme occidental" ? (10/03)
- “Le socialisme est la maison commune de tous les combats justes.” – Entretien avec Joseph Andras (10/03)
- Sur Franceinfo : Brigitte Boucher et les irresponsables (10/03)
- Ce que révèle l’affaire Epstein (10/03)
- Au Liban, d’une guerre coloniale à l’autre et du droit de résister (10/03)
- POUR UN FRONT ANTIFASCISTE AU SECOND TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES (10/03)
- Meeting de la campagne municipale LFI à Lille (10/03)
- Meeting avec Jean-Luc Mélenchon et Sophia Chikirou à Paris ! (09/03)
- Colombie : la gauche de Gustavo Petro valide le dernier test des législatives avant la présidentielle (09/03)
- Penser l’émancipation autrement, discuter l’apport de marxistes hétérodoxes [Podcast] (09/03)
- Terrorisme d’Ultra-droite (08/03)
- "L’Iran est sur le point d’obtenir l’arme nucléaire" : trente ans de prophéties démenties (08/03)
- Hommage au chercheur marxiste Michael Parenti – Compilation d’entretiens (08/03)
- La guerre de trop : les Américains et les Israéliens n’ont rien compris à l’Iran ! (08/03)
- Poutou annonce un probable soutien du NPA-A à Mélenchon en 2027 (07/03)
- Attaques en série contre LFI (07/03)
- Des maires insoumis pour tout changer | Clip officiel - Municipales 2026 (07/03)
- Romaric Godin : "La force fondamentale du capitalisme le pousse vers le néofascisme" (07/03)
- Quentin Deranque était en première ligne dans la bagarre (06/03)
- Tirer une balle dans la tête sans intention de donner la mort (06/03)
- Les États-Unis et Israël nous entraînent dans une barbarie suicidaire (06/03)
Liens
Le capitalocène de Jason W. Moore : un concept (trop) global ?
Ces articles de la rubrique « Ailleurs sur le web » sont publiés à titre d'information et n'engagent pas la Tendance CLAIRE.
https://www.contretemps.eu/capitalocene-jason-moore-concept-trop-global/
Le sociologue et historien de l’Université de Binghamton Jason W. Moore vient de publier en français L’écologie-monde du capitalisme, Comprendre et combattre la crise environnementale. Cet ouvrage reprend trois articles déjà publiés[1] qui sont encadrés ici d’une introduction et d’une conclusion inédites. L’auteur fait partie du courant marxiste écologiste ou écomarxiste, minoritaire parmi les penseurs de l’écologie mais dont l’audience s’élargit quelque peu à cause de l’aggravation de la crise écologique dans laquelle la logique capitaliste est mise en cause. Moore est très connu aux États-Unis et dans les pays anglophones, un peu moins en France, mais cet ouvrage devrait lui apporter une plus grande notoriété.
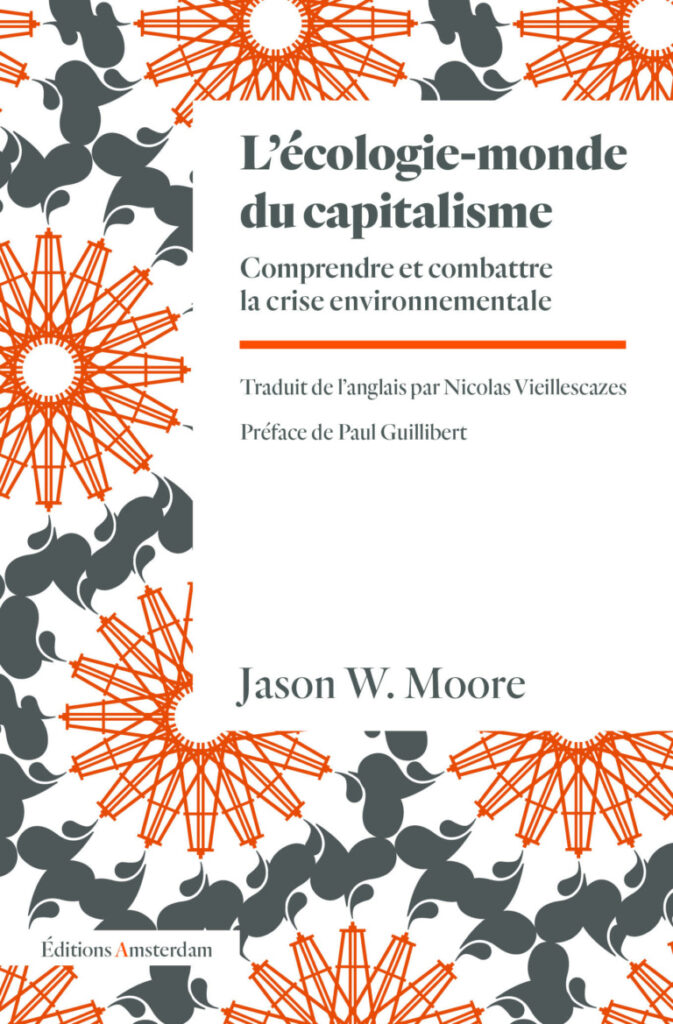
Jason W. Moore, L’écologie-monde du capitalisme, Comprendre et combattre la crise environnementale (Paris, Éditions Amsterdam, 2024, traduction de Nicolas Vieillescazes, préface de Paul Guillibert
Dans ses travaux bien représentés par ce dernier livre, Jason W. Moore entreprend de rebâtir une critique théorique du capitalisme à partir d’une mise en relation des concepts de Marx sur le capital et de ceux permettant de rendre compte de la crise écologique. Jusque-là, il se situe tout à fait dans la même ligne de pensée que les quelques-uns qui, des deux côtés de l’Atlantique, nourrissent les discussions au sein de l’écomarxism[2]. Mais Moore se singularise au sein de ce courant sur plusieurs aspects. Commençons par les identifier puis discutons-en : sa critique de l’anthropocène, le refus de la coupure société/nature, l’exploitation et l’appropriation indissociables, le travail et la valeur.
Le capitalocène contre l’anthropocène
Moore n’y va pas par quatre chemins, d’emblée il situe sa cible : « l’anthropocène [est] une nouvelle forme de déni climatique » (p. 32). L’anthropocène est un concept qui a été popularisé par deux scientifiques, le chimiste Paul Crutzen et le biologiste Eugene Stoermer en 2000, pour désigner une nouvelle ère géologique, après celle de l’holocène qui couvrait les 10 000 dernières années, marquée par les conséquences des activités humaines sur les écosystèmes terrestres[3]. Ainsi, selon ce concept, depuis la révolution industrielle, l’utilisation à grande échelle des énergies fossiles a été capable de modifier la lithosphère. Il conviendrait donc d’opérer, selon ces chercheurs, une nouvelle division des temps géologiques. Cette proposition a été rapidement entérinée tant au niveau du GIEC que dans le débat médiatique, mais n’a pas tardé à être critiquée.
En particulier, le géographe suédois Andreas Malm oppose en 2016 à la vision précédente celle du capitalocène : le passage historique de la force hydraulique à la machine à vapeur et au charbon à partir du XVIIIe siècle n’est pas dû essentiellement à une logique technique et économique, mais à une logique sociale de contrôle de la force de travail. Le saut vers les combustibles fossiles n’a donc obéi à aucune loi naturelle, mais à une modification du rapport de force dans le capitalisme naissant, qui assure à une classe la domination sur une autre : en cela, le charbon et la machine à vapeur permettent de mieux concentrer la force de travail ouvrière dans les usines et les villes, et donc de la contrôler. La transition est ainsi en phase avec la logique du capital et implique une modification de l’occupation de l’espace en même temps qu’une transformation du statut de travailleur.
Moore fait sien ce concept de capitalocène pour au moins deux raisons. La première est qu’on ne peut attribuer la responsabilité de la crise écologique à l’humanité entière, comme si chaque humain indifférencié, chaque groupe social, chaque pays envoyaient et avaient envoyé dans l’atmosphère autant de gaz à effet de serre, consommé autant de ressources et pollué autant l’eau, l’air et les sols, et accumulé autant de déchets. Clairement, le changement du climat n’est pas le fait de l’humanité en tant qu’espèce. Cette première raison est d’ailleurs partagée au-delà de l’écomarxisme[4] par tous ceux qui voient dans l’anthropocène un retour des thèses malthusiennes, dès lors qu’il est sous-entendu que la démographie humaine est à l’origine des ruptures d’équilibre.
Mais Moore conteste l’approche en termes d’anthropocène pour des raisons encore plus profondes. D’une part, il y voit une manière d’occulter non seulement la réalité du capitalisme et sa logique d’accumulation infinie, mais aussi son histoire, qu’il fait débuter symboliquement en 1492, date de la conquête de l’Amérique par Christophe Colomb, baptisée partout « découverte ». Parce que ce fut le point de départ de la mise en coupe réglée de territoires, de ressources naturelles, d’or, d’argent, et d’asservissement humain par la mise au travail d’esclaves dépossédés de toute humanité dans des exploitations de coton et de canne à sucre.
En son origine, le capital est inséparable de la prédation, de l’esclavage, du racisme, auxquels il ajoute la dimension sexiste ou genrée, on verra pourquoi plus loin. Autrement dit, en faisant remonter à la fin du XVe siècle et début du XVIe la naissance et l’essor du capitalisme, d’une part, il s’écarte de Malm qui fait coïncider ceux-ci avec la révolution industrielle et les combustibles fossiles ; d’autre part, il ne met pas en doute que l’exploitation de l’Amérique au XVIe siècle est de nature capitaliste ; certes les conquistadors avaient mobilisé du capital pour partir à la découverte de nouvelles terres, mais était-ce du capitalisme, ou dit autrement la présence de capital fait-elle automatiquement du capitalisme ?[5] De plus, il a existé d’autres empires coloniaux captant des richesses avant même ceux du Portugal, de l’Espagne, puis de l’Angleterre, de la Hollande et de la France à partir des XVIe et XVIIe siècles.
S’il y a accord pour dire que « la crise climatique n’est pas anthropogène mais capitalogène » (p. 35) parce qu’elle ne relève pas d’un homme générique mais d’un « homme historique », cet accord s’effiloche avec Moore pour rattacher le capitalocène, dit-il, avec ce que Marx considérait comme « ensembles de rapports de travail et de rapports métaboliques avec les tissus de la vie » (p. 35).
En voulant s’inscrire dans la lignée de Marx, de Braudel et de Wallerstein, Moore théorise « l’économie-monde du capitalisme ». Par là, il entend montrer que « la thèse du capitalocène n’a pas pour ambition de supplanter la biologie ; elle incorpore le changement biogéologique pour appréhender le capitalisme, comme une écologie-monde où s’articulent le pouvoir, le profit et la vie » (p. 41, 217). On pourrait penser à une synthèse très éclectique, mais elle va donner lieu à plusieurs controverses, alors que Moore reconnaît lui-même que « Capitalocène et Anthropocène sont peut-être des perspectives complémentaires plutôt que rivales » lorsque les chercheurs datent le début de l’augmentation de dioxyde de carbone (l’Orbis Spike) dans l’atmosphère en 1610 (p. 103).
La fin de la coupure société/nature : une ontologie de l’écologie-monde
Moore bâtit sa théorie en récusant fermement « la dualité Humain-Nature » et « la réticence à admettre que les organisations humaines – dont relève le capitalisme – font partie de la nature » (p. 51). Et c’est là qu’on pourrait voir surgir un premier paradoxe. Moore fait partie de ceux qui récusent la séparation entre la société et la nature, ou entre l’homme et la nature, parfois aussi nommée culture et nature. La vision traditionnelle de la relation que l’homme occidental, l’homme des Lumières, a nouée avec la nature a été critiquée par l’anthropologie contemporaine, notamment sous l’impulsion de Philippe Descola[6]. Même si Moore s’inscrit dans la suite de cette critique, il va porter celle-ci sur le terrain méthodologique et épistémologique.
« Les sciences sociales, écrit-il, se sont bâties non seulement sur le postulat de la fragmentation et de l’autonomie des sphères (culture, politique, économie, etc.), mais aussi sur l’exceptionnalisme humain. Depuis deux siècles, la pensée sociale est structurée par l’idée selon laquelle les rapports humains sont distincts de la nature mais aussi indépendants du tissu de la vie. » (p. 53).
Moore relie cette conception à la critique de l’anthropocène :
« Les dualismes Homme-Nature présupposent ce qu’il s’agit d’expliquer : comment en est-on venu à une séparation qui, à l’évidence, n’existe pas. Ils confondent les mouvements historiques de la modernité (l’aliénation, par exemple) avec des abstractions philosophiques (la « séparation d’avec la nature »). Ils évacuent le caractère profondément, intimement poreux ou perméable de la socialité humaine, dont les formes sont spécifiques, inégales et distinctes. Les dualismes Nature-Société ne peuvent saisir la manière dont les flux de la vie, humaine et extra-humaine, se lient et s’entremêlent ; ils nous empêchent de nous interroger sur le tissu conjonctif de la socialité humaine. » (p. 57).
Le refus radical de cette coupure vaut à Moore quelques controverses avec certains de ses collègues écomarxistes, en particulier John Bellamy Foster et Andreas Malm. Le premier considère qu’on peut à la fois voir la société comme étant distincte de la nature et partie intégrante du système terrestre ; cette vision, selon Foster n’a rien d’un dualisme soi-disant cartésien. Moore lui reproche que
« considérer que les organisations humaines appartiennent à la nature conduit à un monisme indifférencié où il n’est plus possible de distinguer la moindre spécificité humaine – et par conséquent « naturelle ». Une telle position, poursuit-il, anéantit la possibilité même d’une politique écologiste et socialiste [red-green politics]. Rien n’est plus éloigné de la vérité ! Lorsque l’on envisage les organisations humaines comme partie intégrante de la nature, il devient possible d’explorer les multiples connexions socio-écologiques qui nous rendent spécifiquement humains mais certainement pas « exceptionnels ». » (p. 59).
Avec Malm, Moore entretient une controverse méthodologique du même ordre. Il s’agit moins de savoir si le capitalocène démarre au XVe siècle ou au XIXe que de trancher entre deux visions. La première, Malm la qualifie d’« hybridiste » car elle vise « à fusionner les deux pôles de la nature et de la société »[7] prenant le parti d’un « monisme de substance » (la nature et la société partagent la même substance, au sens biologique et physico-chimique) « doublé d’un monisme de propriété » (aucune propriété ne distingue l’une de l’autre)[8] ; cette vision est celle de Moore et de Bruno Latour[9]. La seconde « consiste à dire que, bien que la société soit faite de la même substance que la nature, elle a des propriétés hautement distinctives – ce que la philosophie de l’esprit nomme un dualisme de propriété substantiellement moniste »[10]. Et Malm conclut :
« Les relations de production sont aussi matérielles que sociales, mais non naturelles. Le cycle carbonique est matériel et naturel, mais non social. […] C’est précisément parce qu’ils forment les parties continues d’un monde matériel qui les englobe tous deux que le social et le naturel s’entremêlent, mais ce n’est qu’en conservant leur différence analytique que nous pouvons distinguer ces aspects du monde que les humains ont construits de ceux que des forces et des puissances causales indépendantes d’eux ont générés, et examiner comment les uns et les autres ont pu, à des niveaux toujours plus complexes, se nouer »[11].
L’historien Armel Campagne ajoute :
« s’il y a bien une matérialité commune aux processus climatiques et aux sociétés humaines, rendant possible l’existence même du dérèglement climatique du fait des émissions d’origine humaine de gaz à effet de serre, il n’y a pas moins une autonomie des processus climatiques vis-à-vis des sociétés humaines (et vice-versa), d’où l’impossibilité d’un contrôle humain du climat. L’irréductibilité des uns aux autres explique d’ailleurs l’existence du dérèglement climatique, puisque s’il n’y avait pas d’autonomie du climat vis-à-vis des sociétés humaines, celles-ci n’auraient pu dérégler celui-ci de manière incontrôlée, provoquant « un hiatus irrémédiable dans l’équilibre complexe du métabolisme » [Karl Marx, Le Capital, Livre III] entre climat et sociétés humaines. La non-reconnaissance de cette irréductibilité, a contrario, implique une possibilité de contrôle humain du climat au travers des techniques de géo-ingénierie. D’autre part, l’hybridisme latourien peut mener à une position climato-sceptique, puisque dans une approche post-structuraliste, il n’y a pas de « nature » indépendante des sociétés humaines, celle-ci étant une création discursive. Si Moore peut défendre à un niveau théorique un post-dualisme intégral, dès qu’il retourne à ses explications historiques, il est obligé de recourir à un dualisme de propriétés, même s’il a raison d’insister sur l’existence d’une matérialité commune au capitalisme et aux processus biogéochimiques. »[12]
Mais Moore s’en tient à sa position :
« Le dualisme déchire la toile des connexions réelles qui existent entre les natures humaines et extra-humaines, et qui seront essentielles, au cours du siècle qui vient, pour toute politique émancipatrice et générative de vie. »[13]
Pourtant, il lui arrive de rejoindre presque ses contradicteurs :
« Les êtres humains et les organisations humaines sont manifestement distincts des environnements dans lesquels ils évoluent ; mais ce sont aussi des produits de ces environnements. » (p. 58).
Le préfacier de Moore, Paul Guillibert, bien qu’approbateur de l’ensemble de son œuvre, lui oppose à juste titre des nuances fortes :
« Comme beaucoup d’auteur-rices, Moore cède à un raccourci anticartésien qui frôle parfois le contresens : par exemple, lorsqu’il affirme que le « vocabulaire cartésien du changement social a la vie dure ». Descartes n’est ni un penseur de l’histoire ni un penseur de la société, encore moins de la culture. N’en déplaise à ses pourfendeurs contemporains, il n’est certainement pas un philosophe de la dualité nature-société, mais de la dualité âme-corps qui, pour n’en être pas moins problématique, ne relève pas exactement de la même discussion. »[14]
La discussion menée par Moore est philosophique et également stratégique.
« La manière dont on appréhende le capitalisme détermine les stratégies d’émancipation. Bien sûr, la philosophie ne résoudra pas la crise actuelle du capitalisme et les effroyables dangers qu’elle représente pour la vie. Mais il sera difficile d’élaborer une politique d’émancipation pour toutes les vies sans s’engager philosophiquement à faire précisément cela : émanciper toute vie. Une politique d’émancipation véritablement multispécifique nécessitera – et devra cultiver – des modes de pensée qui commencent par relier avant de séparer. » (p. 60).
Il entend ainsi dépasser les termes habituels de la discussion épistémologique car
« le noyau du problème est que le dualisme Nature-Société n’érige pas seulement des barrières d’ordre analytique ; il reproduit les systèmes de domination, d’exploitation et d’appropriation du « monde réel ». Cette fracture ontologique est l’expression symbolique de la séparation entre producteurs directs et moyens de production. Réunis, ces moments sont à l’origine du capitalisme comme système-monde et comme formation ontologique : comme écologie-monde. […] Cela signifie que le capitalisme se déploie sur deux registres : comme projet et comme processus. […] Le capitalisme « opérationnalise » par le biais de cette fracture ontologique Nature-Société, centrale à l’accroissement de la productivité du travail et à la recréation des Natures bon marché. Il est régi par l’idée selon laquelle il peut faire ce qu’il veut de la Nature. Parce que celle-ci est extérieure, elle peut être fragmentée, quantifiée, rationalisée et mise au service de la croissance économique, du progrès social ou de quel autre bien supérieur. » (p. 62-63).
On pourrait discuter la pertinence de ces deux « registres réunis » : peut-accorder au « projet » ontologique de domination du monde, qui serait selon Moore contenu dans le dualisme Nature-Société, l’effet performatif réalisant cette domination ? D’autre part, en tant que processus historique, la séparation entre producteurs et moyens de production est antérieure au capitalisme. Tout à son hostilité anti-cartésienne, Moore fait comme si les bases intellectuelles de la modernité n’avaient pas été jetées dès l’Antiquité grecque par le fait que la liberté humaine permet, par la raison, de s’émanciper de toutes les tutelles. Dans sa crainte que la dépendance des humains à l’égard de la nature soit oubliée, il en arrive à surinterpréter le rôle de la modernité post-Renaissance en Europe occidentale.
Cependant, comme Moore le répète lui-même à plusieurs reprises, on ne se situe pas seulement au milieu d’une discussion conceptuelle, on est cœur de la « praxis historique du capitalisme » (p. 63) qui consiste à associer exploitation et appropriation à des fins d’accumulation.
Exploitation et appropriation : du travail humain et non humain ?
L’écologie-monde de Moore, vue sous l’angle de sa dynamique historique d’accumulation infinie, repose conjointement sur l’exploitation du travail humain et sur l’appropriation sans frais du travail non humain accompli par les êtres vivants non humains et par la nature dans son ensemble. Pour étayer sa thèse, Moore part d’une analogie avec le travail domestique gratuit effectué par les femmes et débouche sur une nouvelle esquisse de théorie de la valeur, dont on se demandera si, juste ou fausse, elle correspond vraiment à celle de Marx comme il le prétend.
Moore étend au « travail non humain » la thèse soutenue aujourd’hui par beaucoup de théoriciennes féministes matérialistes. Longtemps, la tradition marxiste a considéré que le travail domestique effectué gratuitement était une façon pour le capitalisme d’économiser du capital. En participant gratuitement à la reconstitution de la force de travail, le travail domestique, bien que non productif de valeur et de plus-value, favorisait cette production. L’exploitation des femmes n’était alors qu’un sous-produit de l’exploitation des travailleurs. Mais le courant féministe matérialiste reconsidère cette vision en faisant une critique du travail pour y englober les tâches relevant de rapports sociaux de sexe qui sont des rapports de production et d’exploitation irréductibles à l’exploitation du travail prolétaire. En un mot, la domination et l’exploitation patriarcales relèvent d’une pratique sociale débordant largement ce qui se déroule au sein d’une entreprise capitaliste.
Par analogie, Moore considère l’accumulation du capital comme résultant du processus d’exploitation de la force de travail salarié et du processus « d’appropriation des Natures bon marché, tout particulièrement des quatre marchandises bon marché que sont la nourriture, le travail, l’énergie et les matières premières » (p. 104). Autrement dit, selon l’auteur, il existe « le travail de nombreux humains – mais aussi celui des animaux, des sols, des forêts et des natures extra-humaines de toute sorte » (p. 62, 119). Le premier est payé, l’autre pas ; le premier est visible, l’autre a « des coûts de reproduction [qui] ne sont consignés nulle part dans les livres de comptes » (p. 74). Avant de nous demander s’ils sont consignables, arrêtons-nous sur le concept de travail.
Il y a donc pour Moore du travail payé (celui du salariat, en laissant de côté le travail indépendant pour simplifier) et du travail impayé, celui des femmes et de tous les êtres vivants et entités naturelles (on suppose que pour Moore, il y a aussi le surtravail du salariat donnant naissance à la plus-value, mais ce point est chez lui assez flou, on verra pourquoi plus loin). À ce point, nous sommes devant un problème d’ordre épistémologique : doit-on considérer que le travail est une catégorie socio-anthropologique – en somme, le propre de l’être humain vivant en société – ou bien peut-on l’étendre aux animaux, au soleil qui rayonne, à la lune qui fait pousser les plantes et provoque les marées, aux forêts qui fabriquent de l’oxygène, aux minerais qui se fossilisent lentement, etc. ? Pour Moore, cette extension est indiscutable et cela le fonde à parler d’appropriation gratuite des fruits de ce « travail ». Mais, à notre sens, ce choix va à l’encontre de toutes les sciences sociales et de la philosophie, et en particulier à l’encontre de Marx qui pointait la différence entre la meilleure abeille et le plus mauvais architecte[15].
Moore sent-il la fragilité de sa position ? Il apporte une nuance subtile en disant que les entités naturelles – comme les forêts – sont « mises au travail à très grande échelle » (p. 93, je souligne JMH, aussi p. 89). Cette nuance était aussi apportée par son préfacier Guillibert dans un ouvrage personnel Exploiter les vivants, Une écologie politique du travail[16]. Mais elle est loin de résoudre le problème identifié ci-dessus parce que si tout est travail, alors plus rien ne distingue la spécificité de la condition humaine. À tel point que Guillibert préfère parler d’« activités de subsistance » plutôt que de « travail de subsistance chez les animaux non socialisés par les humains »[17], c’est-à-dire la faune sauvage. Moore ne s’attarde pas là-dessus parce que pour lui, l’important est de mettre en relation l’exploitation de ce qu’il appelle le travail payé et l’appropriation du travail impayé.
Moore explique :
« Il faut donc discuter de la Nature bon marché comme système de domination, d’appropriation et d’exploitation de manière à reconnaître la diversité du travail humain et extra-humain, qui est nécessaire au développement capitaliste mais n’est pas directement valorisé (payé) dans l’économie monétaire. C’est probablement grâce aux quatre marchandises de base que le capital empêche la masse de capital d’augmenter trop vite par rapport à la masse de Nature bon marché appropriée. » (p. 105-106).
Ou encore :
« Une politique révolutionnaire de la durabilité doit reconnaître la division tripartite – la « trialectique » – du travail en vigueur dans l’écologie-monde capitaliste : la force de travail, le travail humain non payé, le travail de la nature dans son ensemble. » (p. 178).
S’il s’agit de dire que tout capitaliste s’ingénie à réduire de façon absolue ses coûts de production – dont ceux correspondant aux intrants de terre, matières premières, énergie, etc., on a affaire à quelque chose d’exact mais d’une grande banalité :
« Le bois bon marché au XVIIe siècle et le pétrolé bon marché au XXe ont entraîné une diminution de la valeur du capital circulant, mais aussi de celle de la valeur des marchandises en général. » (p. 84).
S’il s’agit de préciser que ce sont les évolutions relatives des coûts du capital fixe, du capital circulant et des coûts salariaux les uns par rapport aux autres qui déterminent l’intensité capitalistique des activités capitalistes (la composition organique du capital, disait Marx), il n’y a là encore aucune nouveauté[18]. Enfin, s’il s’agit de découvrir une nouvelle explication de l’évolution du taux de profit, on s’aperçoit vite que l’on retrouve quelque chose de bien établi[19].
À propos de l’évolution du taux de profit, dans son ouvrage, et plus encore dans l’article publié dans Actuel Marx[20], Moore dit s’appuyer sur « la « loi générale » marxienne de la sous-production, loi importante mais rarement évoquée » (p. 75), qu’il résume ainsi, en citant le Livre III du Capital de Marx :
« Pour le dire en termes simples, le taux de profit est inversement proportionnel au niveau de la valeur de la matière première » (p. 75). Sauf que, la valeur de la matière première est celle de la production de celle-ci et est incluse comme partie du capital constant circulant. Rien n’est ici inédit[21].
Il n’y a pas de doute que Moore soit parfaitement au fait de toutes ces choses-là :
« Lorsque la fourniture de ces Natures approche de la composition-valeur moyenne de la production mondiale de marchandises, l’excédent écologico-mondial[22] chute et le rythme de l’accumulation ralentit » (p. 106).
Mais il lui faut trouver un chemin intellectuel pour relier sa théorie du capitalisme à son hypothèse de départ refusant la coupure société/nature :
« Par conséquent, il n’est possible de produire une interprétation adéquate de la centralité de la Nature bon marché dans l’accumulation sans fin du capital que dans un cadre postcartésien qui considère la valeur comme mode d’organisation de la nature. En ce sens, la loi de la valeur est coproduite à travers le tissu de la vie. La loi de la valeur est une loi de la Nature bon marché. » (p. 106).
Cependant, Marx, pour qui la loi de la valeur est un rapport social[23], est-il toujours autant la référence que revendique Moore ?
La valeur chez Jason W. Moore : contre la critique de l’économie politique ?
Moore prend soin de s’approcher au plus près de la méthode de Marx. Par analogie avec le travail abstrait chez Marx, il forge le concept de « nature abstraite » :
« L’Humanité et la Nature [sont des] abstractions réelles – en tant qu’abstractions dotées d’une force opératoire dans la reproduction du monde tel que nous le connaissons. » (p. 51).
Il s’agit pour Moore de souligner que cette abstraction de la nature résulte d’un processus socio-historique et non pas d’un raisonnement intellectuel. En cela, l’analogie avec le travail abstrait paraît recevable. Mais elle atteint ses limites quand vient le moment – complètement inattendu – de la mesurer :
« Si le temps est la substance du travail social abstrait (le temps de travail socialement nécessaire), l’espace est celle de la nature sociale abstraite. Ces deux dimensions forment une unité contradictoire : la spatio-temporalité du capitalisme comme mode d’organisation de la nature. Si les procédures managériales déployées au sein de la production marchande ont pour but de maximiser la productivité par quantum de travail abstrait, les capacités géo-managériales des États et des empires visent à identifier et à maximiser le travail/l’énergie non payés par unité de nature abstraite. » (p. 125-126, je souligne JMH).
S’agit-il d’une unité de nature abstraite pour quantifier l’espace nécessaire pour extraire un baril de pétrole, un kilogramme d’uranium, acheminer un litre d’eau ? Où se trouve la contradiction entre les deux dimensions, le temps et l’espace, indiquées plus haut, puisqu’elles doivent être minimisées toutes les deux ? On perd un peu de vue la dialectique revendiquée.
Si l’on comprend que, dans l’échange marchand, il est fait abstraction des caractéristiques concrètes des travaux qui ont élaboré les marchandises, et donc que le travail est rendu abstrait sur le marché, peut-on en dire autant « des quantités de matières et d’énergie qui sont pourtant le résultat de processus naturels, hautement spécialisés, différents, multiples et évolutifs »[24] ? Or, en aucun cas, il n’existe d’échange de biens naturels entre eux, ni des prétendus fruits du « travail » de ces biens naturels. Ce que le capital incorpore dans ses processus productifs, ce sont les biens eux-mêmes avec prise en compte du coût de leur mise à disposition, de leur « production » qui les transforme en marchandises.
Bref, le capital compte ce qu’il transforme en capital. C’est même la seule chose qu’il peut « consigner », et on peut lui faire confiance pour qu’il consigne vraiment ce que cela lui coûte. Les affirmations de Moore selon lesquelles « la Nature contient tout ce que la bourgeoisie ne veut pas payer (p. 187, je souligne JMH) ou que « la Nature est alors devenue tout ce que la bourgeoisie refusait de payer » (p. 198, je souligne JMH) sont un contresens, voire un non-sens. Le capital pourrait-il payer le soleil, ou payer l’utilisation du soleil et à qui ? Peut-être à un Elon Musk si celui-ci réussissait à s’approprier l’étoile qui nous éclaire et qui nourrit la vie ?
Dans la tentative de construire une nouvelle théorie de la valeur, aux fragilités conceptuelles sur le travail s’ajoutent d’autres fragilités sur la productivité. À de nombreuses reprises (notamment p. 83, 121, 122, 165), Moore considère que la recherche de la productivité de la terre a été remplacée par celle de la productivité du travail. Que produit (ou produisait) la terre selon Moore ? La valeur (p. 83, 119)[25]. Ou encore : le surplus écologique (p. 117). À aucun moment, l’auteur ne s’interroge sur le fait que ce qu’il appelle la productivité de la terre ne serait que la productivité du travail agricole. Mais la confusion éclate rapidement : « la productivité du travail devient ensuite la mesure décisive de la richesse » (p. 121, je souligne JMH). On en arrive au fin mot de l’histoire : Moore assimile valeur et richesse, c’est-à-dire valeur et valeur d’usage. Il fait comme si Marx et même l’économie politique de Ricardo n’avaient pas radicalement et définitivement établi leur distinction : « La terre peut exercer l’action d’un agent de la production dans la fabrication d’une valeur d’usage, d’un produit matériel, disons du blé. Mais elle n’a rien à voir avec la production de la valeur du blé »[26].
À deux reprises au moins Moore cite Marx pour dire que la fertilité du sol « pouvait avoir le même effet qu’une augmentation du capital fixe » (p. 76 et 169). Mais quel est l’effet du capital fixe ? D’accroître la productivité du travail, mais pas de produire de la valeur lui-même : le capital fixe est du travail mort et sa propre valeur est transmise dans celle de la marchandise finie. Et on se demande bien où « le capital circulant est l’élément oublié du modèle de Marx »[27].
Dans le fond, si Moore a raison de rappeler que la nature est source de valeurs d’usage, il a tort d’en conclure qu’elle est la source de la valeur, ce qui, on vient de le voir, est aux antipodes de la pensée de Marx. Il s’ensuit un flou majeur sur le concept utilisé par Moore de « surplus écologique » qui n’est jamais défini. Tantôt il semble désigner le surplus social (la plus-value) produit par la force de travail prolétaire après qu’est appropriée la nature, tantôt il semble désigner le résultat conjoint de cette appropriation et de l’exploitation de la force de travail, tantôt il pourrait représenter la valeur de ce qui est approprié par le capital ou bien la valeur créée imputable à la nature.
Aucun de ces sens n’est satisfaisant. Pire, les deux derniers pourraient être rapprochés de la notion de valeur économique intrinsèque ou de celle de valeur créée par la nature des économistes néoclassiques de l’environnement, reprises en chœur par toutes les institutions internationale[28]. Avec Moore, nous soutenons que l’activité économique s’insère obligatoirement dans des rapports sociaux et dans la biosphère ; on ne peut donc se passer de la nature pour produire collectivement des valeurs d’usage et on ne peut lui substituer indéfiniment des artéfacts. Mais le circuit de la richesse en termes de valeurs d’usage permettant de satisfaire les besoins humains relie le travail et la nature, tandis que le circuit de la valeur relie les humains entre eux et entre eux seulement[29].
Contrairement aux affirmations récurrentes de Moore, la valeur d’usage des choses naturelles utilisées (appropriées) par le capital est la base naturelle de la valeur mais pas sa cause. Ce point est véritablement décisif : autant Moore a raison d’insister sur l’importance de cette appropriation des éléments naturels indispensables à l’accumulation, autant il a tort d’en faire le déterminant de la valeur. Et ce n’est pas le va-et-vient permanent entre l’appropriation des quatre marchandises bon marché – la nourriture, le travail, l’énergie et les matières premières – et l’appropriation du travail des salariés, des femmes et de la nature ou encore « des femmes, de la nature et des colonies »[30] qui permet d’éclairer l’analyse, condensée dans « le travail/l’énergie de la nature » (p. 73, 122, 139, 202).
À le lire, on ne saura jamais si l’exploitation capitaliste du travail humain reste le « seul producteur de survaleur »[31] ou bien si cette dernière vient en partie du travail non humain, et si « l’essence historique de la hausse de la productivité du travail – comprise en termes de survaleur – réside dans l’utilisation du travail non payé de la Nature » (p. 175) doit être entendu comme la nature produit la survaleur. On notera aussi que le flux de production de valeur est confondu avec l’appropriation d’un stock « de travail non payé accumulé » (p. 130, 144).
« En d’autres termes, la plupart du travail effectué ne compte pas mais il est tout de même approprié par le capital : le travail non payé des natures humaines et extra-humaines est même la condition décisive (mais non suffisante) de son accumulation. » (p. 131-132).
Ou encore :
« La loi de la valeur, loin de pouvoir être réduite au travail social abstrait, trouve les conditions nécessaires à son auto-expansion dans la création puis l’appropriation de Natures bon marché. » (p. 134). On voit donc bien que conditions de la valeur et valeur sont deux points distincts[32].
La théorie de la valeur de Marx reste sans doute l’une des questions les plus épineuses à résoudre, mais il ne paraît pas que l’essai de Moore y apporte un éclairage nouveau. Au contraire, dans une phraséologie souvent inutilement complexe, sa prétendue reformulation de la loi de la valeur semble bien en deçà de ses espérances, sans doute même à rebours de la critique de l’économie politique[33]. Son adhésion à une forme d’intersectionnalité peut-elle sauver l’ensemble ?
Le capitalocène de Jason W. Moore englobe tout
L’une des formules préférées de Moore pour signifier l’écologie-monde du capitalisme est simple : le capitalisme est dans la nature, la nature est dans le capitalisme. Et il s’oppose à toute formulation qui consisterait à parler de l’interaction entre la société et la nature. Pour lui, la conjonction « et » doit être remplacée par la préposition « dans ». À ce titre, il récuse le concept de rupture métabolique entre la société et la nature[34] sur lequel ont beaucoup réfléchi ses collègues écomarxistes[35].
Par exemple, Foster estime que « Marx utilise le concept de rupture métabolique pour saisir l’aliénation matérielle des êtres humains vis-à-vis des conditions naturelles de leur existence dans le capitalisme »[36]. Aux yeux de Moore, ce concept laisserait croire que le capitalisme pourrait fonctionner sans son intrication avec la nature. Pour lui, l’inscription du capitalisme dans la nature et vice versa est en quelque sorte indépassable. Il s’ensuit une abondance de références qui mêlent tous les types de rapports sociaux que l’on peut identifier, notamment les rapports de classe et de genre.
« Comme l’a montré Silvia Federici, la structure de genre et de classe connaît un bouleversement sans précédent au milieu du XVIe siècle. Le lien étroit entre dégradation climatique et multiplication des « chasses aux sorcières » n’a rien d’un secret. C’est un moment essentiel de la défaite des forces prolétariennes et paysannes : la paysannerie et le semi-prolétariat, vaincus et divisés, ne peuvent empêcher la redéfinition du travail des femmes comme « non-travail », redéfinition qui jouera un rôle essentiel dans l’expansion proto-industrielle qui suivra. » (p. 42-43).
Sans mettre un instant en doute cette affirmation pour le moins étonnante, Moore ajoute « la surexploitation raciale, genrée et coloniale » (p. 45) parce que « l’expulsion des femmes et des peuples non blancs hors de la Société engendre des excédents significatifs pour le capital » (p. 86), et parce que « le travail non payé socialement nécessaire est le piédestal du temps de travail socialement nécessaire. Celui-ci se constitue non seulement dans le conflit capital-travail mais aussi dans la fourniture de travail non payé – conflit profondément genré, racialisé et multispécifique. » (p. 137).
En somme, histoire et théorie se rejoignent :
« Les révolutions culturelles du premier capitalisme ont produit successivement différents ordres raciaux et genrés à partir des abstractions réelles que constituent la Nature et la Société et elles ont créé d’immenses réservoirs de Nature humaine bon marché. La catégorie de Nature contient les moments genré et racial de l’accumulation initiale : violente expulsion de la majeure partie des êtres humains hors de la Société. » (p. 175).
Il y a une grande continuité dans la pensée de Moore puisque tout part de la critique du dualisme Homme-Nature et y revient :
« Fondamentalement, la création moderne du dualisme Homme-Nature a privé de leur humanité la majeure partie des êtres humains – à commencer par les femmes qui, après 1550, sont devenues sauvages, indociles, c’est-à-dire des êtres nécessitant le guidage civilisateur et rationnel de l’Homme. Déplacées du côté de la Nature, elles ont été dévalorisées – et pour les bourgeoisies émergentes, l’objet d’une accumulation illimitée. » (p. 197-198).
Et il conclut :
« Le prolétariat mondial (en fait, un semi-prolétariat, puisqu’il comprend une multitude de précariats et de classes de travailleurs agricoles) dépend du fémitariat et du biotariat – catégories qui reproduisent le capitalisme en tant que « mode de vie ». » (p. 203).
Un nouveau chapitre de discussion pourrait s’ouvrir au sujet de l’enchaînement des raisonnements précédents, mais il dépasserait les limites de cette recension. Contentons-nous de poser quelques questions. La chasse aux sorcières moyenâgeuse a-t-elle été pour quelque chose dans le démarrage du changement climatique et que signifie la transformation d’une éventuelle corrélation dans le temps avec une quelconque causalité ? Ne faut-il pas voir la chasse aux sorcières comme le moyen trouvé par l’Église catholique pour reconquérir un pouvoir très contesté en cette période ?
Le patriarcat et la dévalorisation des femmes ont-ils été inventés après 1550 ? Reconnaître la domination et l’exploitation subies par les femmes justifie-t-il de créer en outre par analogie un concept de biotariat, ce qui encore une fois est cohérent avec l’idée d’un « travail impayé » de la nature, mais n’a aucune portée théorique et stratégique puisque ledit travail impayé de la nature renvoie à une anthropologisation de ce qui existe en dehors même de l’être humain, indépendamment de lui.
Et c’est là que réside l’énorme paradoxe chez Moore : en voulant rompre avec l’idéalisme latourien[37] fondé sur le fait que « nous n’avons jamais été modernes »[38], au sens où n’avons jamais vraiment séparé l’homme et la nature ou bien que nous n’aurions jamais dû les séparer, Moore aboutit au même résultat que celui de Latour dont il veut pourtant s’éloigner : sous couvert d’éclectisme, tous les rapports intra-humains et les rapports externes sont dissous dans un amalgame invertébré au sein duquel les rapports de classes en tant que dynamiseurs de la transformation des sociétés finissent pas disparaître, ou du moins, par perdre toute portée historique[39].
Conclusion provisoire
Puisque Jason W. Moore indique lui-même qu’il propose une « synthèse provisoire » (p. 104), concluons nous-même provisoirement cette recension évidemment discutable. Son livre est important et il devrait être lu par tous ceux qui s’interrogent sur la nature profonde de la dénommée crise écologique.
La thèse qu’il développe a le mérite de proposer une vision globale d’un capitalisme qui met en jeu l’ensemble des forces de vie pour la reproduction de la vie, subordonnée depuis plusieurs siècles à l’exigence de l’accumulation du capital. De notre point de vue, il ne réussit cependant pas à justifier le refus de la moindre différence – on n’ose dire séparation – entre la société et la nature. Comme le dit Malm, il existe « un désaccord substantiel à savoir si la nature et la société devraient être distinguées le moindrement l’une de l’autre. Tel est bien le cœur du projet théorique de Moore : un hybridisme débridé sous un costume marxiste. »[40]
La thèse de Moore a aussi le mérite de souligner que les conditions de production de la survaleur (plus-value) qui se situent en amont de l’exploitation de la force de travail proprement dite sont des conditions sine qua non. Mais il s’égare en mélangeant conditions de la valeur et valeur, ou conditions de la production de la valeur et production de la valeur. De ce fait, ce qu’il présente comme théorie de la valeur échoue, selon nous, à renouveler celle de Marx. Pire, elle s’en éloigne assez nettement.
La vision que l’on peut qualifier d’intersectionnelle de Moore pourrait avoir une vertu d’ordre historique, c’est-à-dire permettant de rappeler que les premières formes d’accumulation capitaliste se sont développées sur la base de l’esclavage et sur celle de la spoliation de territoires et de richesses, en bref de la conquête d’un extérieur au capitalisme au sens strict, comme le soutenait à juste titre Rosa Luxemburg[41], contre l’explication léniniste de l’impérialisme. Le problème naît quand il cherche à en faire le support d’une critique de la modernité – dont la fameuse prétendue coupure société/nature est un signe – qui, sous couvert d’homme dans la nature et de nature dans l’homme, court le risque de contester subrepticement la conception de l’être humain comme être social.
Le philosophe canadien Maxime Ouellet, critique des Cultural Studies, attire l’attention sur la disparition des classes sociales dans ce type d’approche :
« S’appuyant sur le constat d’une crise de reproduction de la culture ouvrière, les Cultural Studies en viendront à hypostasier la prolifération de ces divers lifestyles comme autant de preuves de la capacité des individus à se distinguer face au conformisme de la culture dominante. Les enjeux de race et de genre viendront par la suite se greffer aux premières analyses portant sur la culture du mouvement ouvrier pour former la fameuse triade intersectionnelle : sexe, race, classe. Réduites à une identité culturelle comme les autres, les classes sociales tendront à disparaître des analyses des Cultural Studies, si ce n’est que pour dénoncer, dans une perspective moraliste, le classisme ; c’est-à-dire la discrimination dont sont victimes les pauvres, au même titre que les personnes racisées sont victimes du racisme systémique ou les femmes du patriarcat. Le matérialisme vulgaire du marxisme orthodoxe sera inversé pour prendre la forme d’un idéalisme abstrait décroché de tout ancrage avec la réalité matérielle. La posture dialectique du matérialisme culturel qui visait une critique radicale des structures sociales du capitalisme cédera ainsi la place à une posture individualiste libérale qui fera de la lutte contre toutes les formes de discrimination son principal centre d’intérêt. »[42]
Jason W. Moore échappe à ce reproche d’idéalisme philosophique ; on pourrait au contraire lui reprocher une sorte d’hypermatérialisme faisant de l’appropriation matérielle de la nature la clé de voûte ultime du capital. Ce serait un paradoxe de plus : les rapports sociaux capital/travail deviendraient évanescents pour analyser le capitalisme et ses transformations.
Jason W. Moore n’est pas le premier théoricien à affirmer d’emblée qu’il entend retrouver Marx et ses concepts pour mieux poser les siens, à rebours des interprétations traditionnelles. Il n’est pas le premier non plus à laisser quelques plumes dans l’opération. Au final, le capitalocène est un concept supérieur à l’anthropocène, on en conviendra facilement. Notamment, nous avons nous-même plaidé également pour « mettre la nature au centre du travail et le travail au centre de notre réflexion sur la nature », comme l’écrit Moore (p. 105). On conviendra aussi que Moore répète à raison l’enseignement de Marx selon lequel « le problème dont souffre le capitalisme [est] la tendance à accumuler plus de capital qu’il n’est possible d’en réinvestir avec profit » (p. 201), c’est la définition même de la suraccumulation de capital.
Pour le reste, la théorie suffit-elle pour trancher tous les différends ? Si l’on partage complètement les objectifs d’émancipation de l’auteur, il reste à élucider le fait que « l’émancipation ne peut être que relationnelle et doit concerner à la fois le prolétariat, le fémitariat et le biotariat » (p. 207). À trop user de néologismes dont le statut scientifique est plus que douteux, on risque d’égarer le lecteur, le chercheur et le citoyen. La conclusion de Jason W. Moore est intitulée « Vers le prolétarocène ». Ce n’est pas une formulation des plus heureuses car elle rappelle la prétendue science prolétarienne opposée à la science bourgeoise, de funeste mémoire.
On ne tiendra pas grief à Jason W. Moore d’être assez discret sur la stratégie, tellement elle est la grande interrogation de tous les mouvements d’émancipation. Son préfacier a plus d’audace ; Paul Guillibert termine sa préface par ces mots :
« Si l’accumulation du capital suppose la mise au travail de toutes les forces naturelles, la stratégie qui s’impose est celle du refus du travail. La grève écologique des forces productives du capital serait la tactique essentielle du communisme de vie. »[43]
Comme nous pensons avoir à peu près compris l’essentiel du livre de Moore, cela signifierait alors la fin de la vie ! Stratégie gagnante ?… Grève écologique ? De qui ? Du sol, des forêts, des océans, du soleil, etc. ? Ne serions-nous pas en train de recréer des fétiches : la nature qui travaille et donc qui pourrait se mettre en grève ? Cela rappellerait curieusement les critiques que nous adressions à Bruno Latour, à sa « classe écologique » et à son « parlement des choses ». Comme quoi, le capitalocène, pour être cohérent et opérationnel, demanderait de conserver un minimum de spécificité de l’être humain et des sociétés pour penser l’avenir, leur avenir.
*
Illustration : The climax of Hubert Airy’s image of his scintillating scotomata, reproduced in P. W. Latham’s On Nervous or Sick-Headache (1873)
Notes
[1] Les deux premiers articles sont : « The Capitalocène, Part I : on the nature end origines of our ecological crisis », The Journal of Peasant Studies, Vol. 44, Issue 3, 2017, p. 594-630, « The Capitalocène, Part II : accumulation by appropriation of unpaid work/energy », The Journal of Peasant Studies, Vol. 45, Issue 2, 2018, p. 237-279, . Le troisième est : « Opiates of the environmentalists ? Antropocene Illusions, Planetary Management and the Capitalocene Alternative » november 2021, .
[2] Citons entre autres : aux États-Unis, Paul Burkett, John Bellamy Foster, Joel Kovel, James O’Connor ; en Europe, Elmar Alvater, Ted Benton, Armel Campagne, François Chesnais, Cédric Durand, Jean-Marie Harribey, Razmig Keucheyan, Michaël Löwy, Andreas Malm, Daniel Tanuro, Frieder Otto Wolf. Un autre auteur du même courant a été introduit récemment en Europe, le Japonais Kōhei Saitō. L’André Gorz des années 1970 peut être aussi rattaché à ce courant. Un ouvrage collectif dirigé par Jean-Marie Harribey et Michaël Löwy, Capital contre nature, Paris, PUF, Actuel Marx Confrontation, 2003, faisait état des premières discussions au sein de ce courant en présentant les contributions au congrès d’Actuel Marx, « Congrès Marx international III, Le capital et l’humanité », Paris, 2001, . Voir aussi Jean-Marie Harribey, « Marxisme écologique ou écologie politique marxiennne », dans Jacques Bidet et Eustache Kouvélakis (sous la dir. de), Dictionnaire Marx contemporain, Paris, PUF, Actuel Marx Confrontation, 2001, p. 183-200, .
[3] Au sein de la Commission internationale de stratigraphie, la sous-commission de stratigraphie du Quaternaire a mis en place un Groupe de travail sur l’anthropocène. À la suite d’une discussion, les scientifiques ont (provisoirement ?) décidé en 2024 qu’ils ne pouvaient valider le concept d’anthropocène. L’Union internationale des sciences géologiques devrait également donner son avis.
[4] Voir notamment les travaux tout en nuances de Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, L’événement anthropocène, La Terre, l’histoire et nous, Paris, Seuil, 2013 ; ainsi que Jean-Baptiste Fressoz, « L’anthropocène est un « accumulocène » », Regards croisés sur l’économie, 2020/I, n° 26, p. 31-40, .
[5] Alain Bihr, dans Le premier âge du capitalisme (1415-1763), L’expansion européenne (Pages 2, Syllepse, 2018) fixe la date de 1415 comme point de repère du début de ce premier capitalisme, qui correspond à l’arrivée des Portugais dans le port de Ceuta, situé sur la côte nord de l’Afrique à la frontière du Maroc. S’il montre lui aussi l’importance de l’expansion coloniale et de l’emploi de main-d’œuvre servile, mais pour lui, il s’agit d’un « protocapitalisme » et non pas encore d’un capitalisme.
[6] Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005.
[7] Andreas Malm, « Nature et société : un ancien dualisme pour une situation nouvelle », Actuel Marx, PUF, « Marxismes écologiques », n° 61, premier semestre 2017, p. 47-63, ici p. 50.
[8] Ibid, p. 51.
[9] Selon Bruno Latour, Nous n’avons jamais été modernes, Essai d’anthropologie symétrique,Paris, La Découverte, 1991. il n’y aurait que des « hybrides » de nature et de société.
[10] Andreas Malm, « Nature et société : un ancien dualisme pour une situation nouvelle », op. cit., p. 52.
[11] Ibid., p. 54 et 57.
[12] Armel Campagne, « Le choc des éco-marxismes face au dérèglement climatique », Terrestres, 1er juin 2020, . Voir aussi du même auteur Le capitalocène, Aux origines historique du dérèglement climatique, Quimperlé, Éd. Divergences, 2017, file:///Users/admin/Desktop/Le_Capitalocene_Aux_racines_historiques.pdf.
[13] Jason W. Moore, « La nature dans les limites du capital (et vice versa) », Actuel Marx, PUF, « Marxismes écologiques », n° 61, premier semestre 2017, p. 24-46, ici, p. 26.
[14] La préface de Paul Guillibert est intitulée « Une cosmologie révolutionnaire pour un communisme de la vie » (p. 9-27). La citation ci-dessus est p. 19.
[15] Karl Marx, Le Capital, Livre I, Paris, PUF, 1993, p. 200.
[16] Paul Guillibert, Exploiter les vivants, Une écologie politique du travail, Éd. Amsterdam, 2023. Voir ma recension Jean-Marie Harribey, « Sur le livre Exploiter les vivants de Paul Guillibert, Les Possibles, n° 38, 15 décembre 2023, .
[17] Paul Guillibert, Exploiter les vivants, op. cit., p. 111.
[18] Dans le vocabulaire économique, le capital fixe désigne les moyens de production durables, le capital circulant les matières et l’énergie à renouveler à chaque cycle de production, le capital constant (chez Marx) réunissant les deux précédents, et le capital variable (chez Marx toujours) correspondant aux salaires payant la fo ce de travail ; la composition organique du capital est le rapport entre capital constant et capital variable.
[19] Pour ma part, j’ai formalisé cela dans une simple équation à partir d’une décomposition du taux de profit un peu différente de celle de Marx, qui fait apparaître l’influence conjointe du social et de l’écologie. Ainsi, la variation du taux de profit résulte de la somme de la variation de la répartition entre salaires et profits et de la variation de l’efficacité du capital : une variable de répartition + une variable matérielle. 1) Pour une efficacité du capital constante (l’efficacité du capital est l’inverse du coefficient de capital), le taux de profit augmentera si le taux de variation de la plus-value moyenne par travailleur est supérieur au taux de variation de la productivité moyenne du travail, ce qui revient à dire que le salaire augmente moins vite que la productivité du travail. Si, dans le même temps, l’efficacité du capital variait, la condition de l’augmentation du taux de profit deviendrait que le taux de variation de la plus-value moyenne par travailleur devrait être supérieur à la différence entre le taux de variation de la productivité moyenne du travail et celui de l’efficacité du capital. 2) Le taux de variation de l’efficacité du capital met en rapport la variation de la production et celle du stock de capital. Ce dernier comprend le capital fixe engagé mais aussi le capital circulant (la somme des deux formant le capital constant). Une hausse du coefficient de capital signifie que, pour produire la même quantité, il faut davantage de capital. Or, que signifie la crise écologique? Elle signifie que le rendement économique tiré des matières premières et des ressources énergétiques, qui constituent l’essentiel du capital circulant, diminue, ou, ce qui revient au même, que leur prix augmente. La conclusion est que le taux de croissance du taux de profit résulte de la combinaison de ces deux effets. Voir le détail technique dans Jean-Marie Harribey, « L’impact cumulé des crises sociale et écologique du capitalisme sur le devenir de la croissance : la fin programmée de celle-ci ? », Colloque international de la Revue de la Régulation, 10-12 juin 2015, ; et Le trou noir du capitalisme, Lormont, Le Bord de l’eau, 2020.
[20] Jason W. Moore, « La nature dans les limites du capital (et vice versa) », op. cit.
[21] Dans l’article cité p. 35-36, Moore fait état de la baisse du taux de rendement énergétique par rapport au capital investi, ce qui provoque une hausse du coût par unité de marchandise produite, et qui n’est pas étrangère à la menace de stagnation séculaire du capitalisme, mais cela n’implique pas une modification de l’origine de la valeur. Si la masse de capital variable (évaluée monétairement) augmente, la composition organique du capital augmentera, et pour une même masse de capital variable (salaires), le taux de profit diminuera si la plus-value qui figure au numérateur du taux de profit de Marx ne varie pas.
[22] Voir plus loin les remarques concernant le surplus écologique. Ici, il semblerait que cet « excédent écologico-mondial » représente la totalité du surplus de valeur.
[23] Une présentation résumée de ce point dans Jean-Marie Harribey, En quête de valeur(s), Paris, Éd. du Croquant, 2024.
[24] Paul Guillibert, Préface, op. cit., p. 20-21.
[25] Moore distingue subtilement « valeur » et « rapports de valeur ». La première se rapporte à la « forme valeur » de la marchandise, les seconds incluent ensemble l’exploitation de la force de travail et l’appropriation du « travail » des femmes et de la nature. (p. 136).
[26] Karl Marx, Le Capital, Livre III, 1894, dans Œuvres, Paris, Gallimard, La Pléiade, 1968, tome II, p. 1430. On peut lire dans l’édition française des Principes de l’économie politique et de l’impôt de Ricardo (1817, Paris GF-Flammarion, 1992) la correspondance échangée entre Ricardo et Say, dans laquelle le premier essaie d’expliquer (en vain) au second la différence entre richesse et valeur.
[27] Jason W. Moore, « La nature dans les limites du capital (et vice versa) », op. cit., p. 31.
[28] Voir par exemple le rapport de l’ONU-Unesco sur « La valeur de l’eau », « Rapport mondial des Nations unies sur la mise en valeur des ressources en eau 2021 : la valeur de l’eau », mars 2021, . Voir la critique dans Jean-Marie Harribey, « Le discours sur la valeur de l’eau ne vaut pas grand-chose », 7 avril 2022, La richesse, la valeur et l’inestimable, Fondements d’une critique socio-écologique de l’économie capitaliste, Paris, Les Liens qui libèrent, 2013, ; et En quête de valeur(s), Paris, Éd. du Croquant, 2024.
[29] Nous reprenons cette dernière phrase de notre La richesse, la valeur et l’inestimable, op. cit,, https :harribey.u-bordeaux.fr/travaux/ouvrages/livre.richesse.entier.pdf, p. 273.
[30] Jason W. Moore, « La nature dans les limites du capital (et vice versa), op. cit., p. 37.
[31] C’est ce que pense Paul Guillibert dans sa préface (p. 23), mais rien dans l’ouvrage de Moore ne l’accrédite fermement.
[32] Dans sa Théorie générale de l’emploi de l’intérêt et de la monnaie, Paris, Payot, 1969, p. 223, John Maynard Keynes, pourtant adversaire déclaré de Marx, fait du travail le seul facteur de production, les autres « facteurs » en étant les conditions.
[33] Je me suis longuement arrêté sur une page de Moore que je vais citer entièrement parce qu’elle croise ce que j’ai écrit fin 2023 avant d’avoir lu son livre ; la mise en parallèle des deux passages montre le différend d’interprétation de ladite loi de la valeur et de la compréhension de la critique de l’économie politique : « La valeur renvoie à deux choses : aux objets et aux relations auxquels on accorde de l’importance ; à des notions morales, par exemple dans la dualité fait-valeur qui a joué un rôle fondamental dans la pensée moderniste. Chez Marx, la « loi de la valeur » vise précisément à identifier le noyau relationnel du capitalisme dans la reproduction élargie du travail abstrait. Les marxistes après Marx ont considéré la loi de la valeur comme un processus économique correspondant au premier sens du mot valeur, à savoir les relations auxquelles la civilisation capitaliste accorde de l’importance. Par conséquent, il a été difficile de soutenir que la loi de la valeur peut recouvrir les deux sens du terme. Difficile mais pas impossible. Sur le plan historique, les nouvelles pratiques de savoir – dans les domaines de la cartographie, de la botanique, de l’agronomie, du calcul – ont joué un rôle fondamental dans le développement capitaliste. Or, introduire ces questions symbolico-culturelles dans le noyau relationnel de la valeur, c’est déstabiliser le dualisme subjectif-objectif souvent présupposé de l’économie politique. Le « monde objectif » de la valeur est un produit subjectif, celui de « l’imagination du capital ». Le capital emploie son pouvoir symbolique à représenter comme objectifs des rapports de valeur en réalité arbitraires. Il existe donc un lien étroit entre le savoir et la culture, d’une part, et, d’autre part la valeur en tant que travail abstrait. » (Moore, p. 149). Dans la conclusion de mon En quête de valeur(s), j’écris (p. 89-91) : « S’il est commode, pour la clarté de l’exposé, de séparer la valeur au sens économique et les valeurs dans leur sens philosophique, éthique ou politique, parce que l’une renvoie à un ordre quantitatif et les autres à un ordre qualitatif non mesurable, et surtout pas en monnaie sous peine de fétichisme, il n’en reste pas moins que la légitimation de l’ordre quantitatif dépend de celui de la qualité du « bien », du « beau », du « juste », comme l’exprimaient les anciens philosophes grecs. Prenons un dernier exemple : si, depuis le 1er janvier 2024, le Smic net mensuel français vaut 1398,70 euros pour 35 heures travaillées par semaine, d’une part cela ne dit rien de ce qu’a produit le smicard, d’autre part son montant intègre implicitement la hauteur à laquelle la société traversée de conflits « juge bon » d’accorder – ou de ne pas accorder – à ce salarié. Les valeurs ont donc une influence sur la légitimité de la plus ou moins grande valeur qui sera socialement validée : au nom des valeurs, tel niveau de valeur économique sera jugé positivement ou négativement, même si ce n’est pas ce jugement qui en détermine le niveau, lequel dépend fondamentalement des conditions sociales et techniques de production. L’économique n’est donc pas indifférent au normatif. Si l’on suit Émile Durkheim pour qui les représentations collectives sont beaucoup plus, voire autre chose, que l’addition des consciences individuelles, la valeur est un fait social « total », selon le mot que Marcel Mauss avait employé pour la monnaie, représentant la valeur économique par excellence. « Total » dans le sens où la valeur est l’achèvement d’un processus qui va de l’organisation de la division du travail, aux rapports sociaux dans lesquelles celle-ci est mise en œuvre pour produire et à la validation marchande et/ou politique qui sanctionnera sa traduction en monnaie. C’est donc un processus aux composantes matérielles, techniques, sociales, politiques et culturelles entremêlées, et la difficulté conceptuelle vient du fait que ces différentes composantes, bien que faisant partie d’un tout, ne relèvent pas d’un même instrument d’appréhension, les unes pouvant être réduites à un quantum de monnaie, mais pas les autres. Un fait social total mais disparate, aux composantes non superposables et non substituables. »
[34] Marx utilise le concept de métabolisme de son contemporain le chimiste allemand Justus von Liebig pour désigner le travail comme médiation entre l’humain et la nature. La rupture métabolique est causée par le développement capitaliste sur plusieurs plans : dans le cycle métabolique de la nature, la circulation des nutriments du sol est perturbée ; sur le plan de l’espace, opposition entre la ville et la campagne et entre les régions du monde ; sur le plan temporel, divergence entre le temps de la nature et celui du capital. Voir Koei Saïto, « La théorie du métabolisme chez Marx à l’ère de la crise écologique », Tracées, Revue de Sciences humaines, n° 40, 2021, p. 161-182, .
[35] Voir notamment John Bellamy Foster, Marx’s Ecology, Materialism and Nature, New York, Montly Review Press, 2000 ; Ecology Against Capitalism, New York, Montly Review Press, 2002 ; Marx écologiste, Éd. Amsterdam, 2011. Paul Burkett, Marx and nature : a red and green perspective, London, Palgrave Macmillan, 1999 ; Marxism and ecological economics, toward a red and green political economy, Boston, Brill, 2006. Pour ma part, j’ai constamment utilisé la conjonction « et » pour exprimer l’exploitation conjointe de la force de travail et de la nature : sans l’exploitation de la nature, celle du travail n’aurait pas eu de support matériel, et sans l’exploitation du travail, celle de la nature n’aurait pu s’enclencher et se généraliser ; il s’ensuit que la crise sociale et la crise écologique sont les deux facettes d’une même réalité.
[36] John Bellamy Foster, Marx écologiste, op. cit., p. 62.
[37] Voir ma recension du dernier livre de Bruno Latour et Nikolaj Schultz, Mémo sur la nouvelle classe écologique, Paris, Les Empêcheurs de penser en rond, 2022, Jean-Marie Harribey, « De quoi la classe écologique de Bruno Latour est-elle le nom ? », 20 janvier 2022, .
[38] Selon le titre de l’ouvrage de Bruno Latour, Nous n’avons jamais été modernes, op. cit.
[39] Il n’est pas rare aujourd’hui de voir cette dilution prendre une place importante dans les écrits radicaux qui aboutissent à nier toute capacité heuristique et stratégique au concept d’exploitation de la force de travail. En français, est bien représentatif de cette vision l’essai d’Emmanuel Renault, Abolir l’exploitation, Expériences, théories, stratégies,La Découverte, 2023 ; voir ma recension critique, Jean-Marie Harribey, « Du travail et de l’exploitation, À propos du livre d’Emmanuel Renault », Les Possibles, n° 39, Printemps 2024, .
[40] Andreas Malm, « Nature et société : un ancien dualisme pour une situation nouvelle », op. cit., p. 61-62.
[41] Rosa Luxemburg, L’accumulation du capital, 1913, Paris, Petite collection Maspero, 1972.
[42] Maxime Ouellet, « De la New Left à la Fake Left : les Cultural Studies et la crise de la réalité », Cahiers Société, n° 4, 2022, p. 71-72. À la p. 66, Ouellet parle de « sainte trinité » pour « triade intersectionnelle », . Moore emploie lui aussi l’expression de « trinité du travail social abstrait, de la nature sociale abstraite et de l’accumulation initiale » (p. 134-135). Dans « The Capitalocène, Part II », op. cit., p. 20, il parle de la « trinité du capital/pouvoir/nature ». Dans le Livre III du Capital, Marx avait ironisé sur « la formule trinitaire » des économistes classiques qui, en faisant la somme du salaire, du profit et de la rente foncière, avaient cru trouver l’origine de la valeur.
[43] Paul Guillibert, Préface, op. cit., p. 27.




